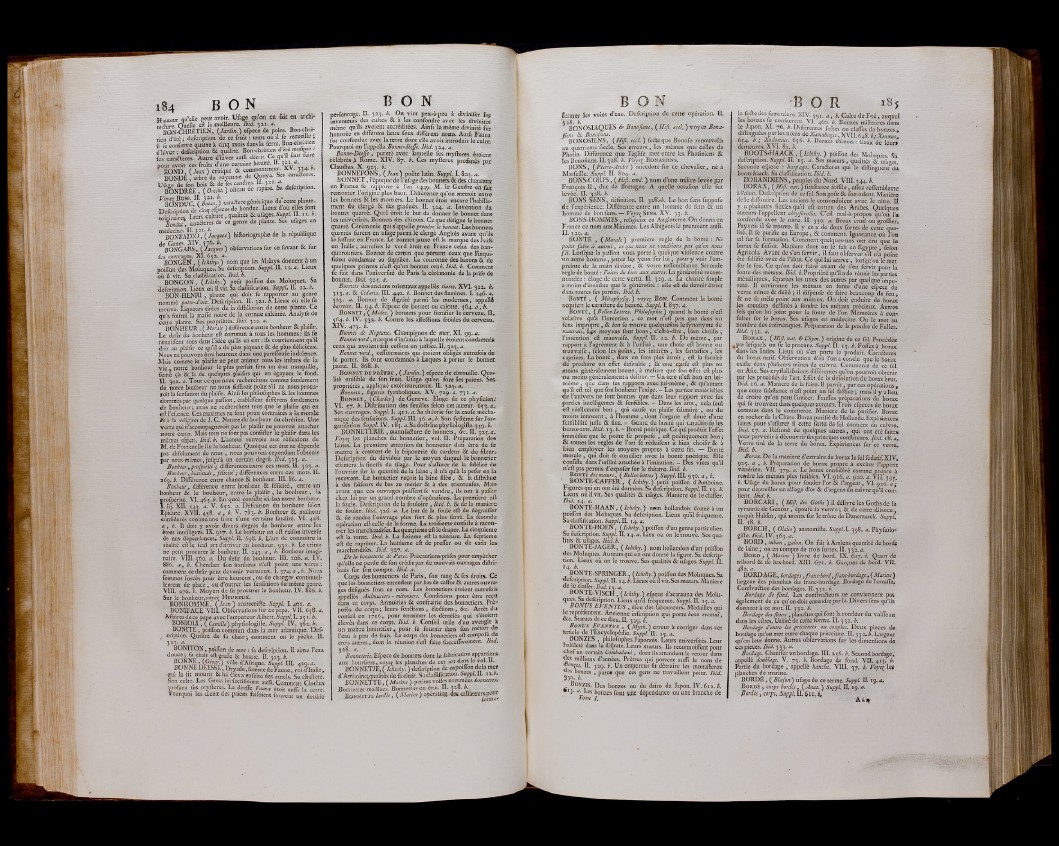
ï84 BON Hauteur qu’elle peur avoir. Ufage qu’on en (ait en archi-
teflure. Quelle eft la meilleure. Ibid. 311 .a.
BON-CHRÉTIEN, {Jardin.) efpece de poire. Bon-chrétien
d’été; defcription de ce fruit : tems où il fe recueille ;
il fe conferve quatre à cinq mois dans la ferre. Bon-chretien
d'hiver : defcription & quaUtè. Bon-chrétien d’été mufque :
fes cara&eres. Autre d’hiver aufli décrit. Ce quil faut faire
pour avoir ces fruits d’une certaine beaute. 11.
BOND, ( Jean ) critique & commentateur. XV . 334-*-
BONDE, arbre du royaume de Quoya. Ses carafteres.
Ufaze de fon bois & de fes cendres. 11. 32I-f- .
B^NDRÉE, ( Omïht. ) oifeau de rapine. Sa defcription.
j f f i w r a j î p l f carafleregénérique d^cctte plante.
Defcription de cinq efp«« * bonduc Lieux d ou elles font
Originaires Leurs culture, qualités & ufages. W II. r i. 4.
Bonducy carafteres de ce genre de plante. Ses ufages en
m^BONFADI&Z> ( Jaques ) hiftoriographe de la république
de Genés. XIV. 576. b.
BONGARS, (Jacques) obfervationsfur cefavant oc fur
fes ouvrages. Xl. 652. a.
BONGEN, {Ichthy. ) nom que les Malays donnent à un
poiiTon des Moluques. Sa defcription. Suppl. II. 12. a. Lieux
où U vit. Sa claflification. Ibid. b.
BONGON, {Ichthy.) petit poiflon des Moluques. Sa
defcription. Lieux où il.vit.Sa claflification. Suppl. II. ia. b.
BON-HENRI, plante qui doit fe rapporter au genre
nommé patte-d’oie. Defcription. II. 321. b. Lieux où elle fe
trouve. Liqueurs tirées de la diftillation de cette plante. Ce
qu’a fourni la mafle noire de la cornue calcinée. Analyfe de
cette plante. Ses propriétés. Ibid. 322. a.
BONHEUR, ( Morale ) différence entre bonheur 8c plaifir.
Le dcfir du bonheur eft commun à tous les hommes : ils fe
réunifient tous dans l’idée qu’ils en ont : ils conviennent qu’il
doit au plaifir ce qu’il a de plus piquant 8c de plus délicieux.
Nous ne pouvons être heureux dans une pareffeufe indolence.
Mais comme le plaifir ne peut animer tous les inftans de la
vie , notre bonheur le plus parfait fera un état tranquille,
fernè çà 8c là de quelques plaifirs qui en égayent le fond.
H. 322. a. Tout ce que nous recherchons comme fondement
de notre bonheur ne nous fiiffiroit point s’il ne nous procurait
la fenfation du plaifir. Ainfi les philofophes 8c les hommes
dominés par quelque paflion, établi/fent différens fondemens
de bonheur ; mais ne recherchent tous que le plaifir qui en
eft l’eftence. Ces maximes ne font point contraires à la morale
& à la religion de J. C. Nature du bonheur du chrétien. Une
vertu qui n’accompagneroit pas le plaifir ne pourrait attacher
notre coeur. Mais tous ne font pas confifter le plaifir dans les
mêmes objets. Ibid. b. L’auteur renvoie aux réflexions de
M. de Fontenelle fur le bonheur. Quoique cet état ne dépende
pas abfolument de nous , nous pouvons cependant L’obtenir
par nous-mêmes, jufqu’à un certain degré. Ibid. 323. a.
Bonheur, profpcrité; différences entre ces mots. 11. 323. a.
Bonheur, béatitude , félicité ; différences entre ces mots. II.
169. b. Différence entre chance 8c bonheur. III. 86. a.
Bonheur, différence entre bonheur 8c félicité, entre un
bonheur & le bonheur, entre le plaifir , le bonheur, la
profpérité. VI. 463. b. En quoi confifte ici-bas notre bonheur.
I. iij. XII. 143. a. V. 652. a. Définition du bonheur félon
Epicure. XV1L 458. a , b. V. 783. b. Bonheur 8c. malheur
confiderés comme une fuite d’une certaine fatalité. VI. 428.
a , b. Il doit y avoir divers degrés de bonheur entre les
êtres intelligens. IX. 917. b. Le bonheur en eft raifon inverfe
de nos dépendances. Suppl. IL 698. b. L’art de connoître la
réalité eft le feul art d’arriver au bonheur. 931. b. Le crime
ne peut procurer le bonheur. II. 243. a , b. Bonheur imaginaire.
VIII. 560. a. Du defir du bonheur. III. 206. a. IV.
886. a, b. Chercher fon bonheur n’eft point une vertu :
comment ce defir peut devenir vertueux. 1. 374. a , b. Nous
ibmmes forcés pour être heureux, ou de changer continuellement
de place, ou d’outrer les fenfations du-même «;enre.
VIII. 276. b. Moyen de fe procurer le bonheur. IV. 886. b.
Sur le b o n h e u r , Heureux.
BONHOMME, {Jean) anatomifte. Suppl. 1. 401. a.
' BONIFACE VIII. Obfervations fur ce pape. VII. 658. a.
Affaires de ce pape avec l’empereur Albert. Suppl. I. 251. b.
BONIOLI, { Camille) phyfiologifte. Suppl. IV. 302. b.
BONITE, poiffon commun dans la mer atlantique. Def-
. cripdon. Qualité de fa chair; comment on le pêche. II.
323. a.
BONITON, poiflon de mer : fa defcription< Il aime l’eau
eft gratte 8c bonne. II. 323. b.
§ 1*11111 l i t ! d’Afrique. Suppl. ill. 429. a.
BONNE DEESSE| Dryade, femme de Fàune, roi d’Italie,
qui la fit mourir 8c lut éleva enfiüte des autels. Sa chafteté.
Son culte. Les Grecs lui focrifioient aufli. Comment Clodius
profana fes myfteres. La deefle Fauna étoit aufli la terre.
Pourquoi les dieux des païens faifoient fouvent un double
BON perfonnage. II. 323. b. On vint peu-à-peu à divinifer Us
inventeurs des cultes 8c à les confondre avec les divinités
même qu'ils avoient accréditées. Ainfi la même divinité fur '
honorée en différens lieux fous différens noms. Ainfi Fauna
fut confondue avec la terre dont elle avoit introduit le culte.
Pourquoi on l’appella Bonne-déejfe. Ibid. 3 24. a.
Bonne-Déejfe, pureté avec laquelle fes myfteres étoient
célébrés ii Rome. XIV. 87. b. Ces myfteres profanés par
Claudius. X. 923. b.
BONNEFONS, {Jean) poète latin. Suppl. I. 803,0.
BONNET, l’époque de Tufage des bonnets 8c des chapeaux
en France fe rapporte à l’an 1449. M. le Gendre en fait
remonter l’origine plus haut. Différence qu’on mettoit entre
les bonnets. 8c les mortiers. Le bonnet étoit encore l’habillement
du clergé 8c des gradués. II. 324. a. Invention du
bonnet quarré. Quel étoit le but de donner le bonnet dans
les univerfités. Bonnets des chinois. Ce que défigne le bonnet
quarré. Cérémonie qui s’appelle prendre le bonnet. Les bonnets
quarrés furent en ufage parmi le clergé Anglois ayant qu’ils
lefùflent en France. Le bonnet jaune eft la marque des Juifs
en Italie ; autrefois le verd ¿toit en France celui des banqueroutiers.
Bonnet de carton que portent ceux que l’inqui-
fition condamne au fupplice. La couronne des barons 8c de
quelques princes n’eft qu’un bonnet orné. Ibid. b. Comment
fe fait dans l’univerfité de Paris la cérémonie de la prife de
bonnet. Ibid. 325. a.
Bonnets des anciens orientaux appellés tiares. XVI. 3,12. b,
313. a. 8c Cidaris. III. 440. b. Bonnet des flammes. I. 246. a.
323. a. Bonnet de dignité parmi les modernes, appellê
barrette. IL 94. b. Efpece de bonnet ou calotte. 364. <z, b.
Bonnet , {Médec. ) bonnets pour fortifier le cerveau. II.
364. b. IV. 332. b. Contre les affeôions froides du cerveau.
XIV. 473. b.
Bonnet de Neptune, Champignon de mer. XI. 99, a.
Bonnet verd, marque d’infamie à laquelle étoient condamnés
ceux qui avoient fait ceflion en juftice.II. 32 f.a
Bonnet verd, cefiionnaires qui étoient obligés autrefois de
le porter. Ils font condamnés à Luques à porter le bonnet
jaune. II. 868. b.
Bonnet de prêtre , {Jardin.) efpece de citrouille. Qua-
lité nuifible de fon fruit. Ufage qu’en font les païens. Ses-
propriétés, appliqué extérieurement. II. 32¿¡.a.
Bonnets y figures iymboliques. XV. 729. a. 731. a.
Bo nne t , {Charles) deGeneve. Eloge de ce phyficieni
VI. 37. b< Diftribution des feuilles félon cet auteur. 633. a.
Ses ouvrages. Suppl. I. 411. a. Sa théorie fur la caufe mécha-
nique des lenfations. Suppl. III. 36. a, b. Son fyftême fur l’or-
ganifation.Suppl. IV. 183. a.Sadoétrinephyfiologifte.^39. b.
BONNETERIE , manufacture de bonnets, &c, II. 323. ai
Voye[ les planches du bonnetier, vol. II. Préparation de9
laines. La première attention du bonneüer doit être de fe
mettre à couvert de la friponerie du cardeur 8c du fileurj
Defcription du dévidoir par le moyen duquel le bonnetier
eftimera la finefle du filage. Pour s’aflùrer de la fidélité de
l’ouvrier fur la quantité de la laine , il 11’a qu’à la pefer en la
recevant. Le bonnetier reçoit la laine filée, 8c. la diftribue
à des faifeurs de bas au métier 8c à des tricoteufes. Mais
avant que ces ouvrages piiiflent fe vendre, ils ont à pafler
chez- lui par un grand nombre d’opérations. La première eft
la foule. Defcription de la fouloire , Ibid. b. 8c de la manière
de fouler. Ibid. 326. a. Le but de la foule eft de dégraifler
8c de rendre l’ouvrage plus fort 8c plus ferré. La féconde
opération eft celle de la forme. La troifieme confifte à racou-
trer les marchandifes. La quatrième eft le draper. La cinquième
eft la tonte. Ibid. b. La fixieme eft la teinture. La feptieme
eft de raprêter. La huitième eft de prefler ou de catir les
marchandifes. Ibid. 327. a.
De la bonneterie de Paris. Précautionsprifes pour empêcher
qu’elle ne perde db fon crédit par de mauvais ouvrages diftri-
bués fur ion compte. Ibid. a.
Corps des bonnetiers de Paris, fon rang 8c fes droits. Ce
que les bonnetiers entendent par bas de caftor 8c autres ouvrages
défignés fous ce nom. Les bonnetiers étoient autrefois
appellés Aulmuciers - mitoniers. Conditions pour être reçu
dans ce corps. Armoiries 8c confrairie des bonnetiers. Pré-
pofés du corps; leurs fondions, éle&ions, &c. Arrêt du
confeil en 1716, pour terminer les démêlés qui s’étoient
élevés dans ce corps. Ibid. b. Confeil utile d’un aveugle à
un maître bonnetier, pour fe fournir dans'fon métier de
l’eau à peu de frais. Le corps des bonnetiers eft eompofé de
trois autres, dont la réunion s’eft faite fucceflivement. Ibid.
328. a. '
Bonneterie. Efpece de bonnets dont la fabrication appartiens
aux bourfiers, voyerles planches de cet art dans le vol. 11.
BONNETJE, ( Ichtchy. ) defcription de cepoiflon delà mer
d’Amboine;qualités de fa chair. Sa claflificarion. Suvpl.ll. 12 .b.
BONNETTE, ( Marine ) petites voiles nommées bonnettes*
Bonnettes maillées. Bonnettes en étui. IL W M
B onnette lardée, ( Marine ) opération gss calfoteurspour
fermer
BON fermer les voies d’eau. Defcription de cette opération. II.
^ BONOSIAQUES 6* Bonofiens, ( Hiß. eccl. ) voyez Bona-
fiens 8c Bonofiens. •
BONOSIENS, ( Hiß. cccL ) fede que Bonofe renouvella
au quatrième fiecle. Ses erreurs , les mêmes que celles de
Phorin. Différence que l’églife met entre les Photiniens 8c
les Bonofiens. II. 328. b. Voye{ Bonasiens.
BONS, {Pierre-André) anecdote fur ce chevalier, né à
Marfeille. Suppl. II. 804. a.
' BONS-CORPS, ( Hiß. med. ) nom d’une milice levée par
François I I , duc de Bretagne. A quelle occafiop elle fut
levée. II. 328. b.
BONS SENS, définition. II. ^18.*b. Le bon fens fuppofe
de l’expérience. Différence entre un homme de fens oc un
‘homme de bon fens. — Voye[ Sens. XV. 33. b.
BONS-HOMMES, religieux en Angleterre. On donna eii
France ce nom aux Minimes. Les Albigeois le prenoient aufli.
II. 329. a.
BONTÉ , ( Morale ) première regle de la bonté : Ne
point faire à autrui, ce que nous ne voudrions pas qu'on nous
fit. Lorfque la paflion vous porte à quelque violence contre
■un autre homme, jettez les yeux fur lu i, pour y voir l’empreinte
de la main divine, 8c votre reflemblance. Seconde
■regle de bonté : Faites du bien aux autres. La généralité recommandée:
éloge de cette vertu. II. 329. a. La charité fimple
a moins d’étendue que la générofité : elle eft de devoir étroit
dans toutes fes parties. Ibid. b.
■ B onté , ( Métaphyfiq. ) voyeç B on. Comment la bonté
acquiert le caradere de beauté. Suppl. 1. 837. a.
B onté , ( Belles-Lettres. Philofophie ) quand la bonté n’eft
relative qu’à l'intention , ce mot n’eft pris que dans un
fens impropre, -8c bon fe trouve quelquefois le iynonyme de
mauvais. Les moyens font bons , c’eft-à-dire, bien choifis ;
l’intention eft mauvaife. Suppl. II. 12. b. De même, par
rapport à l’agrément 8c à l’utilité , une chofe eft bonne ou
mauvaife, félon les goûts, les intérêts , les fantaifles, les
caprices. La bonté, dans un fens plus étroit, eft la faculté
de produire un effet defirable ; 8c une c^ufe eft plus ou
moins généralement bonne, à mefure que fon effet eft plus
•ou moins généralement à defirer. — Un être n’eft bon en lui-
même , que dans fes rapports avec lui-même, 8c qu’autant
qu’il eft tel que fon bonheur l’exige. - Les parries'matérielles
•de l’univers ne font bonnes que dans leur rapport avec fes
parties intelligentes 8c fenfibles. - Dans les arts, cela feul
eft réellement bon , qui caufe. un plaifir falutaire , ou du
moins innocent, à l’homme , dont l’organe eft doué d’une
fenfibilité jufte 8c fine. - Genre de bonté qui caradérife les
beaux-arts. Ibid. 13. b.-Bonté poétique. Ce qui produit l’effet
immédiat que le poète fe propofe , eft poétiquement bon ;
& toutes les regles de l’art fe réduifent à bien choifir 8c à
bien employer les moyens propres à cette fin. —• Bonté
‘ morale, qui doit fe concilier avec la bonté poétique. Elle
confifte dans l’utilité attachée à l’imitation.' - Des vices qu’il
n’eft pas permis d’expofer fur le théâtre. Ibid. b.
B onté des meeurs, ( Belles-lettres ) Suppl. III. 930. a.b.
BONTE-CAFFER, {Ichthy.) petit poiflon d’Amboine.
Figures qui en ont été données. Sa defcription. Suppl. II. 13. b.
Lieux où il vit. Ses qualités 8c ufages. Maniere de le clafler.
' Ibid. 14. a.
BONTE-HAAN, ( Ichthy. ) nom hollandois donné à un
•poiflon des Moluques. Sa defcription. Lieux qu’il fréquente.
Sa claflification. Suppl. H. 14. a.
BONTE-HOEÑ, ( Ichthy. ) poiflon d’un genre particulier.
Sa defcription. Suppl. 11. 14. a. Lieu où on le trouve. Ses qualités
8c ufages. Ibid. b.
• BONTE-JAGER, {Ichthy.) nom hollandois d’un poiflon
des Moluques. Auteurs qui en ont donné la figure. Sa aeferip-
•tion. Lieux où on le trouve. Ses qualités 8c ufages. Suppl. H.
BÓNTE-SPRINGER, (Ichthy.) poiflon des Moluques. Sa
■ defcription. Suppl. II. 14. b. Lieux où il vit. Ses moeurs. Maniere
de le clafler. Ibid. ic.a.
BONTE-VlSCli , ( Ichthy. ) efpece d’acarauna des Molu-
ráP“ 00, Lieux qu’il fréquente. Suppl. II. 13. a'.
BONUS EVENTUS, dieu des laboureurs.. Médailles qui
•lereptéfentent. Ancienne infeription qui porte bono eventui,
8cc. Statues de ce dieu. II. 3 29. b.
Bonus E ventus , {Mytk.) erreur à corriger dans cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. II. 13. a.
BONZES , philofophes Japonois. Leurs uniyerfités. Leur
habileté dans la difpute. Leurs moeurs. Ils reconnoiflent pour
chef un certain Combadaxi, dont ils attendent le retour dans
des millions d’années. Prêtres qui portent aufli le nom de
«onrej. II. 329. b. Un empereur fit détruire les monafteres
es bonzes , parce que ces gens ne travaillent point. Ibid.
33°- b.
B onzes. Des bonzes ou du daïro du Japon. IV. 6x2. b.
•13. a. Les bonzes font wie dépendance ou une branche de
Tçme I. '
B O R fis
la içôcdesiamanêens. XIV. fç i. a , b. Culte de Foc, auquel
les bonzes fe con&erem VI. 4fó. 4. Bonzes militaires dans
n/nap°z ‘ 1 Differentes .fcftês On claiTes de bonzes .
dubnguees par les noms de Xamabugis, XVII. 648 4 • Xcnxus
I H ¡ 9 1 6<6. 4. Bonzes chinois : lieux de leurs’
demeures. XVI. 82. b.
BOOTS-HAACK, ( Ichihy. ) poiflon des Moluqtiés. Sà
defcription. Suppl.,II. 13. a. Ses moeurs, qualités -8c ufages.
Seconde eipece : harpago. Caraéleres qui le diftinguent du
boots-haaek. Sa Claflificatioii. Ibid. b.
BORANDIENS, peuples dti Nord. VIII. 344. h.
v BORAX, ( Hiß. nat.) fubftance foifile, allez reflemblante
à-l’alun. Defcription de ce fel. Son goût 8c fon odëur. Manière
de le difloudre. Les anciens le confondoient avec le nitre. II
y a plufieürs fiecles qu’il eft connu des Arabes. Quelques
auteurs 1 appellent chryfocolla. C’eft mal-à-propos qu’on l’a
confondu avee le nitre. II. 330. a. Borax crud ou groflier.
Pays ou il fe trouve. B y eiï a de deux fortes de cette qualité.
Il fe purifie en Europe, 8c comment. Ignorance où l’on
eft fur fa formation. Comment quelques-uns ont cru que le
borax fe faifoit. Maniere dont on le fàit en Égypte , félon
Agrícola. Avant de s’en fervir, il faut obferver s’il n’a point
été falfifiê avec de l’alun. Ce qui lui arrive , lorfqu’on le met
fur le feu. Ce qu’on doit faire avant de s’en fervir pour la
fonte des métaux. Ibid. b. Propriété qu’il a de réunir les parties
métalliques, féparées les unes .des autres par quelque impureté.
Il environne les métaux en foiîte d’une efpece de
verre mince 8c délié ; il difpenfe de faire beaucoup de feu,
8c ne fe mêle point aux métaux. On doit enduire de borax
les creufets deftinés à fondre les métaux précieux. Autres
fels qu’on lui joint pour la fonte de l’or. Mémoires à con-
fulter fur le borax. Ses ufages en médecine. On le met au
nombre des cofinétiques. Préparation de la poudre de Fuller.
Ibid. 3 31. a.
B o r a x , {Hiß. nat. & Chym. ) örigiiie de ce fel. Procédés
*Par lefquels on le le procure. Suppl. II. 13. b. Fofles à borax
dans les Indes. Lieux où s’en porte le produit. Carafter-es
du borax natif. Obfervation d’où l’on a conclu que le borax
exifte dans plufieurs mines de cuivre. Commerce de ce fel
en Afie. Ses cryftallifations différentes qu’on pourroit obtenie
par les procédés de l’art. Effet de la diflolution du borax brut.
Ibid. 16. a. Maniere de la foire. Il paroît, par ces opérations ,
que cette fubftance n’eft point un fel faftice ; mais il y a lieu
de croire qü’oii peut l’imiter. Faufles préparations du borax
qui fè trouvent dans quelques auteurs. Trois efpeces de borax
connues dans'le commerce. Maniere de le purifier. Borax
en rocher de la Chine. Borax purifié de Hollande. Expériences
faites pour s’aflùrer fi cette forte de fel contient du cuivre.
Ibid. 17. a. Réfumé de quelques autres, qui ont été foites
pour parvenir à découvrir fes principes conftituans. Ibid. 18. a.
Verre tiré de la terre du borax. Expériences fur* ce verre.
Ibid. b.
Borax. De la maniere d’extraire du borax le fel fédatif.XlV.
9 21| I » b. Préparation de borax propre à exciter l’appéric
vénérien. VII. 379. a. Le borax confidéré comme propre à
rendre les métaux plus fufibles. VI. 916. a. 920. a. VII. 393.
b. Ufage du borax pour fouder l’or 8c l’argent, VI. 920. a ¿ !
pour dépouiller un alliage d’or 8c d’argent du cuivre qu’il con-,
tient. Ibid. b.
BORCARI, ( Hiß. des Goths ) il délivre les Goths de la
tyrannie de Gemiar, époufe fa veuve ; 8c de cette alliance-,
naquit Haldin, qui monta fur le trône de Danemarck. Suppl.
II. 18. b.
BORCH, ( Olaiis ) anatomifte. Stippl.ï. 398. a. Phyfiologifte.
Ibid. IV. 363. a.
BORD, ruban , galon. On fait à Amiens quantité de bords
de laine ; on en compte de trois fortes. II. 332.a.
Bo rd , ( Marine ) livre de bord. IX. 617. b. Quart dé
tribord 8c de bas-bord. XIII. 671. b. Garçons de bord. VII.
482. a.
BORD AGE, bordages , franc-bord ,franc-bordagc, ( Marine )
largeur des planches au franc-bordage. Bordage de l’arcafle;
Conftruâion des bordages. II. 332. b.
Bordage de fond. Les conftru&eurs ne conviennent pas
également de ce qu’on doit entendre par là. Divers fens qu’ils
donnent à ce mot. H. 332. b.
Bordage des fleurs, planches qui font la rondëur du vaifleaii
dans les côtes. Utih’té de cette forme. II. 332. b.
Bordage d’entre les préceintes ou couples. Deux pièces de
bordage qu’on mec entre chaque préceinte. II. 332. b. Largeur
qu’on leur donne. Autres obfervations fur les aimenfions de
ces pièces. Ibid. 333. a.
Bordage. Chauffer un bordage. HI. 236. b. Second bordage,’
appelle doublage. V. 73. b. Bordage de fond. VIL 413. b.
Partie du bordage , âppellè hanche. VIII. 37. b. Voyc{ les
planches de marine.
BORDÉ, ( Blafon) ufage de ce terme. Suppl. II. ig^a.
BORDÉ, corps bordés, {Anat. ) Suppl. II, 19- a.
flor dés, corps, Suppl, IL 611, h*
A a *