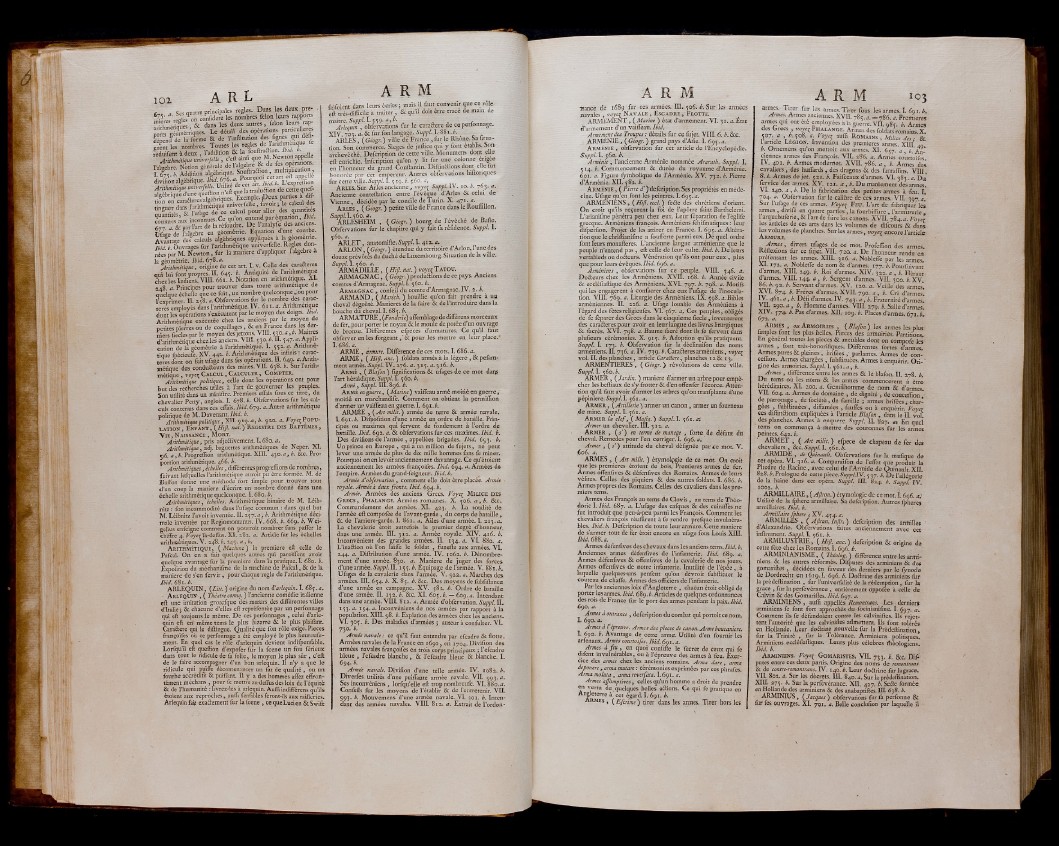
ìà -
A R L
m
102
* „ S auatre principales réglés. Dans les deux pre- .
reeles on confidere les nombres, félon leurs rapp.or.ts
ÀhSéfaue & “ ans les deux antres, félon leurs rap-
^m^éomitrinnes. Le détail des opérations parncuUeres
üépenf de la forme 8t de Knftiturion des lignes qui défisnent
les nombres. Toutes les ïedes ded aruhménque f
rédulfent à deux l’addition & la fouftraéhon. Ibtd. b.
1l i î l É P unmrfilU, c’eft ainf. que M. Newton appeUe
l’àlnebre Notion générale del’algebre & de fes opérations.
I . T 5 " : Addition algébrique.
Arithmétique univcrfellc. Utffité tradutaon de cette quefalgébrique
d’une » « m M S p î e . Deux parties i dif- 18 calcul des
tmguer dans 3 tCuï pour aller des quantités
ri77 T & par l’art de la réfoudre. De l’analyfe .des anciens.
Dfaée'de falgebrc en géométrie. Etuianon dune courbe.
Avantage des calculs algébriques appliques a la géométrie.
Ibid b Ouvrages fur l’arithmétique umverfelle. Réglés données
par M. Newton, fur la maniéré dappbquer 1 algèbre à
la géométrie. Ibid. 678. a.
Arithmétique, origine de cet art. I. v. Celle des carafleres
qui lui font propres. II. 645- *■ Antiquité de 1 arithmétique
chez les Indiens. VIII. 661. i. Notadon en arithmétique. XI.
a% Principes pour trouver dans toute arithmétique de
quelque échelle que ce ioit, un nombre quelconque „ou pour
îexprimer. lï. 238. «. Obfervations fur le nombre des caractères
employés dans l’arithmétique. IV. 611. a. Arithmétique
dont les opérations s’exécutent par le moyen des doigts. Ibid.
Arithmétique exécutée chez les anciens par le moyen de
petites pierres ou de coquillages, & en France dans les derniers
fiedes par le moyen des jettons. VIII. 530. * , b. Maîtres
d’arithmétique chez les anciens. VIL. 530.*. II. 547. ^. Application
de la géométrie à l’arithmétique. I. 552. ¿. Arithmétique
fpécieufe. XV. 442. b. Arithmétique des infinis : caractères
dont on fait ufage dans fes opérations. U. 649- Arithmétique
des. condutaurs des mines. VII 638. b. Suri arithmétique
, voyez C a l c u l , C a l c u l e r , C om p te r .
Arithmétique politique, celle dont les opérations ont pour
but des recherches utiles à l’art de gouverner les peuples.
Son utilité dans un mïniftre. Premiers effais fous ce titre, du
chevalier Petty, anglois. I. 678. b. Obfervations fur les calculs
contenus dans ces effais. Ibid. 679. ¿.Autre arithmétique
politique de M. Davenant. Ibid. b. _
Arithmétique politique , XII. 919. a , b. 920. ¿. Voye^ POPULATION
, E n f a n t , g p j g nat.) R e g i s t r e des Baptemes ,
V i e , N a is san c e , M o r t .
Arithmétique, pris adjectivement. L 680. a.
Arithmétique, àdj. baguettes1 arithmétiques de Neper. XI,
96. | » b. Progreffion aritlimétique. XIII. 430. ¿ , b. 8cc. Proportion
arithmétique. 466. b.
Arithmétiques , échelles , différentes progreflions de nombres,
fuivant lefquelles l’arithmétique auroit pu être formée. M. de
Buffon donne une méthode fort fimple pour trouver tout
d’un coup la maniéré d’écrire un nombre donné dans une
échelle arithmétique quelconque. 1 .680. b.
Arithmétiques, échelles. Arithmétique binaire de M. Léib-
nitz : fon incommodité dans l’ufage commun : dans quel but
M. Léibnitz l’avoit inventée. II. 257. a , b. Arithmétique décimale
inventée par Regiomontnnus. IV. 668. b. 669. b. Wei-
gelius enfeigne comment on pourroit nombrer fans palier le
chiffre 4. Voyez là-deffus. XI. 282. a. Article fur les échelles
arithmétiques. V. 248. ¿. 249. ¿ , 6.
A r ithm é t iq u e , ( Machine ) la première eu celle de
Pafcal. On en a fait quelques autres qui paroilfent avoir
quelque avantage fur la première dans la pratique. I. 680. b.
Expofition du méchanifme de la machine de Pafcal, & de la
maniéré de s’en fervir, pour chaque réglé de l’aritlimétique.
Ibid. 681. b.
ARLEQUIN , (L i t t . )' origine du nom OU arlequin. I. 685. a.
- A r l e q u in , ( Théâtre comiq. ) l’ancienne comédie italienne
eft une imitation grotefque des moeurs.des différentes villes
d’Italie j & chacune d’elles eft repréfentée par un perfonnage
qui eft toujours le même. De ces perfonnages , celui d’arlequin
eft eu mêmetems le plus bizarre & le plus plaifant.
Caratare qui le diltingue. Qualité que fon rôle exige. Pièces
françoifes où ce perfonnage a été employé le plus heureufe-
ment. En quel cas le rôle d’arlequin devient indifpenfable.
Lorfqu’il eft queftion d’expofer fur la feene un fou férieux
dans tout le ridicule de fa folie, le moyen le plus sûr , c’eft
de le faire accompagner d’un bon arlequin. Il n’y a que le
ridicule qui puifle décontenancer un fat de qualité , ou un
fourbe accrédite & puiffant. Il y a des hommes allez effrontément
médians, pour fe mettre au-deffus des loix de l’équité
& de l’humanité : livrez-les à arlequin. Aufli indifférens qu’ils
ètoient aux reproches, aufli fénfibles feront-ils aux railleries.
Arlequin fait exatament fur la feene, ce que Lucien 8c Swift
A R M
faifoient dans leurs écrits ; mais il faut convenir que ce rôle
eft très-difficile à traiter, & qu’il doit être tracé de main de
maitre. Suppl. L 3 39*Ä
Arlequin , obfervations fur le caraftere de ce perfonnage.
XIV. 703. a. 8c lur fon langage. Suppl. I- 881. A. £
ARLES, ( Géogr. I ville de France, fur le Rhone. Sa fitua-
tion. Son commerce. Sieges de juftice qui y font établis. Son
archeyêché. Defcription de cette ville. Monumens dont elle
eft enrichie. Infcription qu’on y lit fur une colonne énjoee
en Î’honneur du grand Conftantin. Diftinétions dont elle fut
honorée par cet empereur. Autres obfervations hiltoriques
fur cette yiiie. Suppl. I. 559. b. 5,6°. a,
A rles. Sur Arles ancienne , voye^ Suppl.YW. 10. b. a.
Ancienne conteftation entre l’evêque d Arles & celui de
Vienne, décidée par le concile de Turin. X. 471. a.
A rles , ( Géogr. ) petite ville de France dans le RouffiUon.
tppl.l. 560. a.
ARLESHEIM , {Géogr.) bourç de l’évêché de Balle.
Obfervations fur le chapitre qui y tarit fa réfidence. Suppl. I. ,
560. a. •
ARLET, anatomifte.Suppl.I. 412.a.
ARLON, (Géogr.) étendue du territoire d’Arlon, 1 une des
douze prévôtés du duché de Luxembourg. Situation de la ville.
Suppl. I. 560. a.
ARMADILLE, ( Hiß. nat. ) voyei T a to u .
ARMAGNAC, ( Géogr.) productions de ce pays. Anciens
comtes d’Armagnac. Suppl. I. 560. b.
A rm a g n a c , confeil du comte d’Armagnac. IV. 2. b.
ARMAND, ( Maréch. ) bouillie qu’on fait prendre à un
cheval dégoûté. Maniérés de la faire & de l’introduire dans la
bouche du cheval. 1 .683. b.
ARMATURE, (Fonderie) affemblage de différents morceaux
de fer, pour porter le noyau & le moule de potée d’un ouvrage
de bronze. Différentes elpeces d’armatures. Ce qu’il faut
obferver en les forgeant f 8c pour les mettre en leur place/
1 .686. a. /
ARME, armure. Différence de ces mots. 1. 686. a.
ARMÉ, ( Hiß. anc. ) foldats armés à la légère, & pefam-
ment armés. Suppl. IV. 276. a. 315. ¿.316. b.
A rmé , (Blafon) lignifications & ufages de ce mot daqs
l’art héraldique. Suppl. 1. 360. b.
Armé, Suppl. III. 896. b.
A rmé en guerre, (Marine) vaiffeau armé moitié en guerre
moitié en marchandife. Comment on obtient la permifiion
d’armer ur vaiffeau en guerre. 1 .691. b.
ARMÉE , (Artmilit.) armée de terre 8c armée navale.'
L 691. b. Difpofition d’une armée en ordre de bataille. Principes
ou maximes qui fervent de fondement à l’ordre de
bataille. Ibid. 692. a. & obfervations fur ces maximes. Ibid. b.
Des divifions de l’armée, appellées brigades. Ibid. 693. b.
Un prince en Europe, qui a un million de fujets, ne peut
lever une armée de plus de dix mille hommes fans fe miner.
Pourquoi on en levoit anciennement davantage. Ce qu’étoient
anciennement les armées françoifes. Ibid. 694. a. Armées d&
l’empire. Armées du grand-feigneur. Ibid. b.
Armée d’obfervation, comment elle doit être placée. Armée >
royale. Armée à deux fronts. Ibid. 694. b.
Armée. Armées des anciens Grecs. Foye^ M ilice des
G r e c s , Ph a lan g e. Armées romaines. X. 306. ¿ , b. & c.
Commandement des armées. XI. 423. b. La totalité de
l’armée eft compofée de l’avant-garde, du corps de bataille ,
8c de Farriere-garde. I. 861. ¿. Ailes d’une armée. I. 213.a.
La chevalerie étoit autrefois le premier degré d’honneur,
dans une armée. HI. 312. ¿. Armée royale. XIV. 416. b.
Inconvénient des grandes armées. II. 134. a. VI. 880. a.
L’inaétion où l’on laiffe le foldat , fùnefte aux armées. VI.
244. a. Diftribution d’une armée. IV. 1062. b. Dénombrement
d’une armée. 830. a. Maniere de juger des forces
d’une armée. Suppl. II. 13 3. b. Équipage de l’armée. V. 881. A.
Ufages de la cavalerie dans l’armée. V. 922. a. Marches des
armées. III. 654. b. X. 83. b. 8cc. Des moyens de fubfiftance
d’une armée en campagne. XV. 382. b. Ordre de bataille
d’une armée. II. 132. b. 8cc. XI. 603. b. — 609. a. Intendant
dans une armée. VIII. 812^. Armée d’obfervation. Suppl. H.
133.¿. 154.¿.Inconvéniens de nos armées par rapport à ia
population. XIII. 98. b. Expiation des armées chez les anciens.
VI. 303. b. Des maladies d’armées ; auteur à confulter. VI.
730. b.
Armée navale : ce qu’il faut entendre par efeadre & flotte.
Armées navales de la France en 1690. en 1704. Divifion des
armées navales françoifes en trois corps principaux ; l’efeadre
bleue , l’efeadre blanche, & l’efeadre bleue & blanche. I.
694. b.
Armée navale. Divifion d’une telle armée. IV. 1082. b.
Diverfes utilités d’une puiffante armée navale. VII. 993. a.
Ses inconvéniens, lorfqu’elle eft trop nombreufe. VI. 880. a.
Confeils fur les moyens de l’établir & de l’entretenir. VII.
993. b. Mouvemens d’une armée navale. VI. 20t. b. Intendant
des armées navales. VIII. 812, a. Extrait de l’ordon-
A R M A R M 103
nancè de 1689 fur ces armées. III. 306. b. Sur les armées
navales, voyez N a v a l e , E s c a d r e , F lo t t e .
A RM EM EN T , ( Marine ) état d’armement. VI. 31. ¿.État
d’armement d’un vaiffeau. Ibid.
Armement des Troupes : détails fur ce fujet. VIII. 6. b. & c,
ARMÉNIE , ( Géogr. ) grand pays d’Afie. I. 693. a.
A rménie , obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. I. 360. b.
Arménie, l’ancienne Arménie nommée Ararath. Suppl. I.
314. b. Commencement & durée du royaume d’Arménie.
601. a. Figure fymbolique de l’Arménie. XV. 732. b. Pierre
d’Arménie. XII. 382. b.
A rménie , ( Pierre d’ )'defcription. Ses propriétés en médecine.
Ufage qu’en font les peintres. 1. 693^.
ARMÉNIENS, (Hijl.eccl.) fe ta des chrétiens d’orient.
On croit qu’ils reçurent la foi de l’apôtre faint Barthelemi.
L’arianifme pénétra peu chez .eux. Leur féparation de l’églife
grecque. Arméniens françois. Arméniens fchifmatiques : leur
aifperfion. Projet de les attirer en France. I. 693. a. Altération
que le chriftianifme a foufterte parmi eux. D e quel ordre
font leurs monafteres. L’ancienne langue arménienne que le
peuplé n’entend pas , eft celle de leur culte. Ibid. b. De lenrs
vertabieds ou dotaurs. Vénération qu’ils ont pour eux, plus
que pour leurs évêques. Ibid. 606. a.
Arméniens , obfervations fur ce peuple. VIII. 346. a.
Dotaurs chez les Arméniens. XVII. 168. b. Année civile
& eccléfiaftique des Arméniens. XVI. 797. b. 798. a. Motifs
qui les engagèrent à confacrer chez eux Fufage de l’inoculation.
VIII. 769. a. Liturgie des Arméniens. IX. 398. ¿.Bibles
arméniennes. II. 226. a. Ufage louable des Arméniens à
l’égard des fêtesreligieufes. VI. 367. a. Ces peuples, obligés
de fe féparer des Grecs dans le cinquième fiecle, inventèrent
des caratares pour avoir en leur langue des livres liturgiques
& facrés. XVI. 798. a. Baume facré dont ils fe fervent dans
plufieurs cérémonies. X. 913. b. Adoption qu’ils pratiquent.
Suppl. I. 173. b. Obfervation fur la déclinaifon des noms
arméniens. II. 736. a. IV. 739. b. Caratares arméniens, voye^
vol. II. des planches , article Carailere, planches 12 & 13.
ARMENTIERES , ( Géogr. ) révolutions de cette ville.
Suppl. I. 360. b.
ARMER, ( Jardin. ) maniéré d’armer un arbre pour empêcher
les beftiaux de s’y frotter & d’en offenfer l’écorce. Attention
qu’il faut avoir d’armer les arbres qu’on tranfplànte d’une
pépinière. Suppl. I. 361. a.
A rmer , ( Artillerie ^ armer un canon, armer un fourneau
.de mine. Suppl. I. 361. a.
A rmer la clef, ( Mufiq. ) Suppl. I. 561. ai
Armer un chevalier. III. 312» a.
A rmer , ( r ’ ) en terme de manege , forte de défaut dit
cheval. Remeaes poür l’en corriger. I. 696. a. '
Armer , ( s’ ) attitude du cheval défignée par ce mot. V.
606. a.
ARMES , ( Art milit. ) étymolpgie de ce mot. On croit
que les premières étoient de bois. Premières, armes de fer.
Armes offenfives & défenfives des Romains. Armes de leurs ,
vélites. Celles des piquiers & des autres foldats. I. 686. b.
Armes propres des Romains. Celles des cavaliers dans les premiers
tems.
Armes des François au tems de Clovis, au tems de Théo-
doric I. Ibid. 687. a. L’ufage des cafques & des cuiràffes ne
fut introduit que peu-à-peu parmi les François. Comment les
chevaliers françois réuflirent à fe rendre prefque invulnérables.
Ibid. b. Defcription de toute leur armure. Cette maniéré
de s’armer tout de fer étoit encore en ufage fous Louis XIII.
Ibid. 688. a.
Armes défenfives des chevaux dans les anciens tems. Ibid. b.
Anciennes armes défenfives de l’infanterie. Ibid. 689. ¿,
Armes défenfives & offenfives de la cavalerie de nos jours.
Armes offenfives de notre infanterie. Inutilité de l’épee ,v à-
laquelle quelques-uns penfent qu’on | dévroit fubitituer le
couteau de chaffe. Armes des officiers de l’infanterie.
Par les anciennes loix d’Angleterre , chacun étoit obligé de i
porter les armes. Ibid. 689. b. Articles de quelques ordonnances i
des rois de France fur le port des armes pendant la paix. Ibid.
690. a.
Armes a outrance, defcription du combat qui portoit ce nom.
I. 690. a.
Ames à l épreuve. Ames des pièces de canon. Ame boucahiere.
I. 690. b. Avantage de cette arme. Utilité d’en fournir les
arfenaux. Ames courtoifes. Ibid. 691. a.
Ames a feu, en quoi confine le fecret de ceux qui fe
difent invulnérables, ou à l’épreuve des armes à feu. Exercice
des ames chez les anciens romains. Arma dare, ama
deponere, ama mutare : cérémonies exprimées par ces phrafes.
Arma moluta , arma rcverfata.I.691. a.
Ames djfomptives, celles qu’un homme a droit de prendre
en vertu de quelques belles aétions. Ce qui fe pratique en
Angleterre à cet égard. I.* 691. b.
A rmes , ( Efcrime ) tirer dans les armes. Tirer hors les
armes. Tirer fur les armes.Tirer fous les armes. I. 6oi. h.
Arnus. Armes anciennes. XVII. 785. „. _ ,8 6 , e. Premières
armes qui ont été employées à la guerre.'VII. 985. b. Amies
des Grecs , * { Phalan g e Armes des foldats romains. X.
i ° 7; S , Ç..ÇO». a. Voycq aufli R om a in s , Milict des; &
1 article Légion. Invention des premières armes. XIII 40»
b. Oriiemens qu’on mettoit aux armes. XI. 637. a , b. Anciennes
armes des François. VII. 286. a. Armes courtoifes,.
IV. 401. b. Armes modernes. XVII. 786. a , b. Armes des
cavaliers | des huffards, des dragons & des fantafiins. VIII.
8. ¿. Armes de jet. 321. b. Faifceaux d’armes. VI. 383. a. Du
fervice des armes. XV. 121. a , b. Du maniement des armes.
VI. 240. a , b. De' la fabrication des petites armes à feu. I.
704. a. Obfervation fur le calibre de ces armes. VII. 397. a.
Sur l’ufage de ces armes. Voye^ F eu. L’art de fabriquer les
armes , divifé en quatre parties , la fourbiffure, l’armurerie -
1 arquebuferie, & Fart de faire les canons. XVII. 784. a. Foyer
les articles de ces arts dans les volumes de difeours & dans
les volumes de planches. Sur les armes, voyez encore l ’article
A rmure.
r> d rmeS ’ divers M j P de 00 mot- Profefliort des armes.
Réflexions fur ce fujet. VII. 72 a a. De l’honneur rendu en
préfentant les armes. XIII. 316. ¿. Nobleffe par les armes.
XI. 172. a. Nobleffe de nom & d’armes. 177. b. Pourfuivant
d’armes. XIII. 249. b. Roi d’armes. XIV. 322^ , b. Héraut
d’armes. VIII. 144. ¿ , b. Sergent d’armes. VII. 300. b. XV.
86. b\ 92. b. Servant d’armes. XV. 120. a. Veille des armes*.
XVI. 874. b. Freres d’armes. XVII. 790. a , b. Cri d’armes.
IV. 461.0, A Défi d’armes. IV. 743. a , b. Fraternité d’armes.
VU. 290. a , b. Homme d’armes. VIII. 279. b. Salle d’armes.
XIV. 374. b. Pas d’armes. XII. 109. b. Places d’armes. 671.
672. a. ■ s. . , ~ '
A rmes , ¿ « A rmoiries , ( Blafon) les armes les plus
amples font les plus belles. Pièces des armoiries. Partirions>
En général toutes les pièces & meubles dont on compofe les
armes. , font très-honorifiques. Différentes fortes d’armes.
Annes pures & pleines , brifées ,• parlantes. Armes de con^
ceflion. Armes chargées , fubftituées. Armes à enquérir. Ori- ‘
gine des armoiries. Suppl.I. 361 .a ,b .
Ames , différence entre les armes & le blafon. IÎ. ||||
Du tems où les noms 8c les armes commencèrent a être
héréditaires. XI. 200. a. Gentilhomme de nom & d’armes*
VII. 604. a. Armes de domaine , de dignité j de conceffion
depatronage , defociété, de famille ; armes brifées * chargées
,fubltituées, diffamées , fauffes ou à enquérir. Voyez
ces diftinétions expliquées à l’article Blafon , dans le H. vol.
des planches. Armes à enquere. Suppl. H. 807. ¿> En quei
tems on commença à'mettre des couronnes fur les armes
peintes. 642. b.
‘ ARMET , ( Art milit. ) efpece de chapeau de fer des
chevaliers , &c. Suppl. I. 361. b.
ARMIDE , de Quinault. Obfervations fur la mufique de
cet opéra. VI. 316. a. Comparaifon de l’effet que produit la
Phedre de Racine, avec celui de l ’Armide de Quinault. XII.
828.¿.Prologuede cettepiece.%y»/.IV. 537.¿ .D e l’allégorie
de la haine dans cet opéra. Sûppl. III. 824. b. Suppl. IV.
1002. b.
ARMILLAIRE, ( Aftron.) étymologie de ce mot. 1. 696. a.'
Utilité de la iphere armillaire. Sa defcription. Autres fpheres
armillaires. Ibid. b.
Amillaire fphere ,• XV. 434. a.
ARMILLES , ( Afiron. Infln ) defcription dés àrmilles '
d Alexandrie. Obfervations faites anciennement avec cet
infiniment. Suppl. I. 361. b.
ARMILUSTRIE » ( Hijl. anc. ) defcription 8c origine de
cette fête-chez les Romains. L 696. b.
; ARMINIANISME, ( Thçoloe. ) différence entre les arminiens
& les autres réformés. Diiputes des arminiens & des
gomariftes , décidées en faveur des derniers par le fynode
de Dordrecht en 1619.1. 696.. ¿. Dotaine des arminiens fur
la predeitination , fur l’univerfalité de la rédemption, fur la
grâce , fur la perfévérance , entièrement oppofée à celle de
Calvin & des Gomariftes. Ibid. 697. a.
ARMINIENS , aufli appellés Remontrons. Les derniers
arminiens fe font fort approchés du-focinianifine. I 697. ¿.
Comment ils fe défendoient contre les calviniftes. Ils rejettent
l’autorité que les calviniftes admettent. Ils font tolérés
en Hollande. Leur dotaine nouvelle fur la Prédeftination »
fur la Trinité , fur la Tolérance. Arminiens politiques.
Arminiens eccléfiaftiques. Leurs plus célébrés fhéologiens.
Ibid. b. *
Arminiens. Foye^ Gomaristes. yH . 733. b. 8cc. Disputes
entre ces deux partis. Origine des noms de remontrons
8c de contre-remontrans.TV. 140. b. Leur dotaine fur la grâce.
VIL 802. a. Sur les décrets. III. 840. a. Sur la prédeftination.
XIII. 273. b. Sur la perfévérance. XH. 427. ¿. Seta formée
en Hollande des arminiens 8c des anabaptiftes. III. 638. ¿.
ARMINIUS, (Jacques) obfervations fur fa perfonne &
fur fes ouvrages. XI. 7 0 1 . a. Belle conclufion par laquelle il -