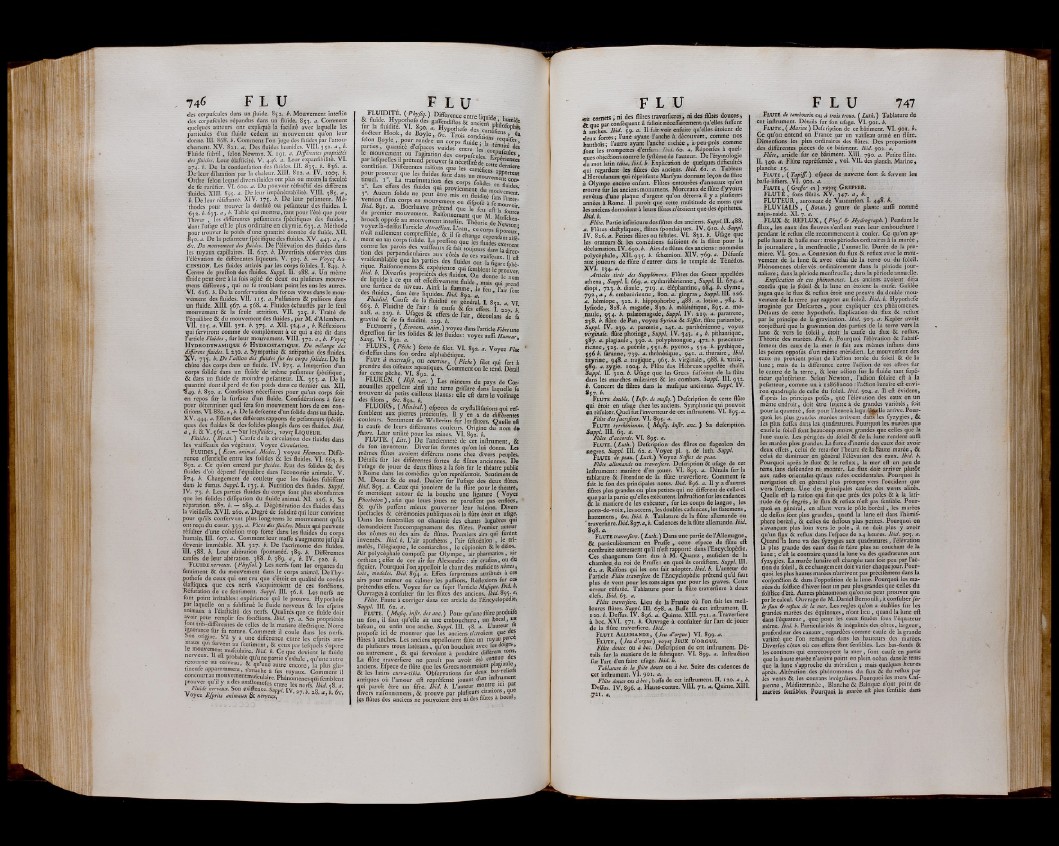
74<S F L U
<Ies corpnfcules dans un ftuidc. 85 a. b. Mouvement inteftin
des corpufcules répandus dans un fluide. 853. a. Comment
quelques auteurs ont expliqué la facilité avec laquelle les
particules d'un fluide cedent au mouvement qu’on leur
donne. III. 868. b. Comment l’on juge des fluides par l’attouchement.
XV . 82.1. a. Des fluides humides. VIII. 352. a , b.
'Fluide fubtil , félon Newton. X. 191. a. Différentes propriétés
des fluides. Leur élafticitè. V . 446. a. Leur expanfibilite. VI.
274. b. D e la condcnfation des fluides. III. 835. b. 836. a.
D e leur dilatation par la chaleur. XIII. 812. a. IV. 1003. b.
Ordre félon lequel divers fluides ont plus ou moins la faculté
de fe raréfier. VI. 600. a. Du pouvoir réfraftif des différens
fluides. XIII. 805. a. De leur impénétrabilité. VIII. 383. a ,
b. De leur réfimnee., XIV. 173. b. D e leur pefanteur. Méthodes
pour trouver la denfité ou pefanteur des fluides. I.
632. b .6 33. a , b. Table qui montre, tant pour l’été que pour
l’hiver , les différentes pefanteurs fpécifiques des fluides,
dont l’ufage eft le plus ordinaire en cnymic. 63 3. a. Méthode
pour trouver le poids d’une quantité donnée de fluide. XII.
'830. a. De la pefanteur fpécifique des fluides. X V . 443. a , b.
Oc. Du mouvement des fluides. D e l’élévation des fluides dans
'les tuyaux capillaires. II. 627. b. Diverfités obfervées dans
l ’élévation de différentes liqueurs. V . 303. b. — Voye^ As-
c e s s io n . Les fluides attirés par les corps folides. I. 849. b.
Centre de prefiioh des fluides. Suppl. II. 288. a. Un même
'fluide peut être à la fois agité de deux ou plufieurs mouve-
mens différens, qui ne fe troublent point les uns les autres.
'V I . 616. b. De la confervation des forces vives dans le mouvement
des fluides. VII. 1x3. a. Pulfations & pulfions dans
un fluide. XIII. <67. a. 368. a. Fluides échauffés par le feul
mouvement & la feule attrìtion. VII. 323. b. Traité de
l’équilibre & du mouvement des fluides, par M. d’Alembert.
VII. x i 3. a. VIII. 371. b. 373. a. XII. 324. a , b. Réflexions
qui ferviront comme de complément à ce qui a été dit dans
l ’article Fluides, fur leur mouvement. VIII. 372. a , b. Voye{
H y d r o d y n a m i q u e 6* H y d r o s t a t i q u e . D u mélange des
différens fluides. I. 230. a. Sympathie & antipathie des fluides.
'X V. 735. b. D e l'aflion des fluides fu r les corps folides. D e la
chute des corps dans un fluide. IV. 873. a. Immerfion d’un
corps folidè dans un fluide de même pefanteur fpécifique,
& dans un fluide de moindre pefanteur. IX. 333. a. D e la
quantité dont il perd de fon poids dans ce dernier cas. XII.
^49. b. 830. a. Conditions néceffaires pour qu’un corps foit
en repos fur la furface d’un fluide. 'Confédérations à faire
pour déterminer quel fera fon mouvement hors de ces conditions.
V I. 880. a ,b . De la defeente d’un folide dans un fluide.
XV . 444. a. Effets des différens rapports de pefanteürs fpécifiques
des fluides & des folides plongés dans ces fluides. Ibid.
a y b. & V . 363. a. — Sur lesfluides, voyc^ L i q u e u r .
Fluides. ( Botan.) Caufe de la circulation des fluides dans
les vaiffeaux des végétaux. Voyez Circulation.
F l u id e s , ( Econ. animal. Médec. ) voyez Humeurs. Différence
effentielle entre les folides oc les fluides. VI. 663. b.
892. a. Ce qu’on entend par fluides. Etat des folides & des
fluides d’où dépend l’équilibre dans l’économie animale. V .
874. b. Changement de couleur que les fluides fubiffent
dans le foetus. Suppl. I. 133. b. Nutrition des fluides. Suppl.
IV. 73. b. Les parties fluides du corps font plus abondantes
que les folides : diflipation du fluide animal. XI. 226. b. Sa
réparation. 287. b. — 289. a. Dégénération des fluides dans
la vieilleffe. XVlI. 260. a. Degré de folidité qui leur convient
.pour qu’ils confervent plus long-tems le mouvement qu’ils
ont reçu du coeur. 339. a. Vices des fluides. Maux qui peuvent
réfulter d’une cohéfion trop forte' dans les fluides tut corps
"humain. III. 607. a. Comment leur mafTe s’augmente jufqu’à
devenir imméable. XI. 327. b. D e l’acrimonie des fluides.
III. 388. b. Leur altération fpontanéd. 389. b. Différentes
caufes de leur altération. 388. b. 389. a , b. IV . 320. b.
F l u i d e nerveux. ( Phyfiol. ) Les nerfs font les organes du
fentiment & du mouvement dans le corps animal. D e l’hy-
pothefe de ceux qui ont cru que c’étoit en qualité de cordes
elafliques que ces nerfs s’acquittoicnt de ces fondions.
Réfutation de ce fentiment. Suppl. III. 36. b. Les nerfs ne
font point irritables: expérience qui le prouve. Hypothefe
par laquelle on a fubflitué le fluide nerveux & les cfprits
animaux a l’élafticité des nerfs. Qualités que ce fluide doit
avoir pour remplir fes fondions. Ibid. 37. a. Ses propriétés
tont très-différentes de celles de là matière éle&rique. Notre
ignorance fur fa nature. Comment il coule dans les nerfs,
son origine. S’il y a une différence entre les cfprits animaux
qui fervent au fentiment, & ceux par lefquels s’opère
muf?uî:îire* Ibid- b- Ce que devient le fluide
nerveux. 11 eft probable qu’une partie sVxhalc, qu’une autre
retotirne au cerveau, 8c qu*une autre encore, la plus glu- '
tineufe apparemment, s’attache à fes tuyaux. Comment il
concourtaumouvementmufculaire. Phénomènes qûi femblcnt
prouver qu il y a des anaftomofes entre lés nerfs Ibid. 38. *.
V o v ~ r T T * * • t ° CG-V oyez Efprtts animaux OC n c 1 Mr 1yV‘ *c7. bu. 28,. u9, b. Oc.
F L U
. i s â B ¡ ¡g
félon B o y le , pour rJd re ’ 8 » ! ^
parues, quantité d'efpaccs vuides entre 1« « J™ ,"4, * •
le mouvement ou l'agitation des corpufcules S - *
par leftpielles tlpré ten i prouver la néceflité decen?,| K
condition. Différentes raifons qne les carrifl» dcrmere
pour prouver que les fluides font dans un moÜv J PPOr" “
tinuel. i . La ttanfmutation des corps folié,. co“ ‘'
a . Les effets des fluides qui
3». Aucun fohde ne peut être mis en fluidité f °m S '" ' -
venuon dun corps en mouvement ou difoofé 1 ' r‘
Ibid. 89,. a. Boerhaave prétend q u e T î S eft S T ’
du premier mouvement. Raifonnemen, que M Muffchen*
broeck oppofe au mouvement intellin. Théorie H. N . " '
voyez là-Jeffus l'article Aurailion. L'eàu i S t e ?
neft nullement compreflible, & il fc change c^eudim‘3“« ’
ment en un corps folide. La preffion que les g ®
contre les parois des
non des perpendiculaires aux côtés de ces vaiffeaux Ù S
vraifemblable que les parties des fluides ont la figure fohé
- f t.P j ence r fcniblent l!prouver
Ibtd b. Diverfes propriétés des fluides. On donne le nom
de liquide à ce qui eft effeiliyement fluide, mais qui prend
une furfoce de niveau. A nfi la flamme Je Iw i r
des fluides, fans être liquides. / S X . ’ a. ’ *“ font
i ? “ re, d?, !a fluidité en générai 1. 852. a. V I ÎÎÎ 1 fië s Æ »S callft & M effets, t. 227. A 228. a 229 b Ufagcs & effets de l'air, découlans tfe fi
gravité & de fa fluidité. 229. b.
a î 1'? - ) v °y c z dans l'article Fibre une
digreflion fur les folides & les fluides : voyez aufli H um a ,,
oang. VI. 092. a. *
• ( p/ cl“ ) fo« e de filet. VI. 892. tr. Voyez Flui
ci-deffus dans fon ordre alphabétique.
F u j i à m a cm f i , ou courtine, ( P â l i t ) filet qui fert à
prendre des oifeaux aquatiques. Comment on le tend. Détail
lur cette pêche. V I. 892. a.
FLUKEN. ( Hifl. nat. ) Les mineurs du pays de Cor-
nouailles appellent ainfi une terre grifâtre dans laquelle fe
trouvent de petits cailloux blancs : elle eft dans le voifinaee
des filons, Oc. 892. b.
F LU O R S , ( Minéral.) efpeces de cryftallifations qui ref-
femblent aux pierres précieufes. Il y en a de différentes
couleurs. Sentiment de Wallerius fur les fluors. Quelle eft
la caufe de leurs différentes couleurs. Origine du nom de
fluors. Leur utijité pour les mines. VI. 892. b.
FLUTE. ( Litt. ) D e l’ancienneté de cet infiniment, &
de fon inventeur. Diverfes formes qu’on lui donna. Les
mêmes flûtes avoient différens noms chez divers peuples.
Détails fur les différentes fortes de flûtes anciennes. Do
l’ufage de jouer de deux flûtes à la fois fur le théâtre public
à Rome dans les comédies qu’on repréfentoit. Sentimens dé
M. Donat & de mad. Dacier fur l’ufoge des deux flûtes.
Ibid. 8 9 3 a. Ceux qui jouoient de la flûte pour le théâtre,
fe mettolent autour de la bouche une ligature ( Voyez
Phorbeion) y afin que leurs joues ne panifient pas enflées, *
& qu’ils pufient mieux gouverner leur haleine. Divers
foeélacles & cérémonies publiques où la flûte étoit en ufage.
jP
Dans les ic» îuucniiues funérailles on chantoit cnantoit des nos enants chants lugubres îuguurcs qui
«jut
demandoient l’accompagnement des flûtes. Premier auteur
des nômes ou des airs de flûtes. Premiers airs qui furent
inventés. Ibid. b. L ’air apothétos , l’air fchoénion , le flùr.
mêlés, l’élégiaque, le comiarchos, le cépionien &lcdéios.
Air polycépnale compofé par O lympe, air pharmatios, air
orthien ; effet de cet air fur Alexandre : air cradias, ou du
figuier. Pourquoi l’onappclloit le chant des muficiens nômes,
loisy modèles. Ibid. 894. a. Effets furprenâps attribués à ces
airs pour animer ou calmer les pallions. Réflexions fur ces
• * • Lai — r /•‘V . I. . . . .v il :j U
j ubc. x .uuc a turrigur uuio tvi nnitic uc
Suppl. III. 62. a. ■
F lû t e . ( Mufiq. inflr. des anc. ) Pour qu’une flûte produiie
un fon, il faut qu’elle ait une embouchure, un bocal, us
bifeau, ou enfin une anche. Suppl. III. 3.8. a. L’auteur fe
propofe ici de montrer que les anciens n’avoient que dÇ*
flûtes à anches. Les anciens appelloient flûte un tuyau perce
de plufieurs trous latéraux, qu’on bouchoit avec les doigts.,
ou autrement, & qui fervoient à produire différens tons.
La flûte traverfiere ne paroît pas avoir été connue des
anciens. Efpecc de flûte que les Grecsnommoienr plagíame,
& les latins curva-tibia. Obfervations fur deux bas-reuets
antiques où l’amour eft repréfenté jouant d’un inltrumen
qui paroît être un fifre. A id . b. L’auteur montre ici par
divers raifonnemens, & prouve par plufieurs citauons, qu
}$s flûtes des anciens ne pouvoient être ni des flûtes a bocai,
F L U F L U 747
oü cornets ", ni des flûtes traverfieres, ni des flûtès douces »
8c que par conféquent il falloit néceflairement qu’elles fuflent
k miches. Ibid. 39. a. Il fait voir enfuite qu’elles.étoient de
deux fortes; l’une ayant l’anche à découvert, comme nos
hautbois; l’autre ayant l’anche cachée , à-peu-près comme
font les trompettes d’enfàns. Ibid. 60. a. Réponfes à quelques
objeétions contre le fyftême de l’auteur. D e l’étymologie
du mot latin tibia. Ibid. b. Explication de quelques difficultés
qui regardent les flûtes des anciens. Ibid. 6 1 . a. Tableau
d’Herculanum qui répréfente Marfyas donnant leçon de flûte
à Olympe encore enfant. Flûtes entourées d’anneaux qu’on ;
trouve fur les anciens monumens. Morceaux de flûte d’yvoire
revêtus d’une plaque d’argent qu’on déterra il y a plufieurs ■
années à Rome. Il paroît que cette multitude de noms que
les anciens donnoient à leurs flûtes n’étoient que des épithetes.
ib id .b . ;
Flûte. Partie-inférieure des flûtes des anciens. Suppl. II. 488. ,
a. Flûtes daâyliques, flûtes fpondaiques. IV. 610. b. Suppl. \
IV . 826. a. Petites flûtes ou fiftules. V I. 831. é. Ufage que
les orateurs & les comédiens faifoient de la flûte pour la j
déclamation. IV . 690. b. Airs de flûtes des anciens : nommées
polycéphale, XII. 933. b. fchoenion. XIV. 769. a. Défenfe
aux joueurs de flûte d’entrer dans le temple de Ténédos.
XVI. 134.8t.
Articles tirés des Supplémens. Flûtes des Grecs appellées
athena, Suppl. I. 669. a. cy thariftérienne, Suppl. IL 074. a.
diopi, 723. b. diaule, 719. a. éléphandne, 684. b. c lyme ,
792 y a , b. embatérienne g 800. a. gingras , Suppl. III. 226.
a . hémiope, 322. b. hippophorbe, 488. a. lotihe, 784. b.
lyfiodc, 828. b. magade, 830. b. mélététique, 893. a. mo-
naule, 934. b. palæomagade, Suppl. IV. 219.*:. paratrete,
13 8. b. flûte de Pan, voyez Syrinx & Sifflet, flûte pariambe,
Suppl. IV. 239. a. paroenie, 24 t. a. parthénienne, voyez
virginale, flûte photinge, Suppl. IV. 343. a , b. pithantique,
387. a. plagiaule, 390. a. polyphtongue, 472. b. præcento-
rienne, 323. a. puérile, 3 31. b. pyenos, 334. b. pythique,
336 b. faranne, 739. a. thrénétique, 941. a. thuraire, Ibid.
tityrine, 948. a. tragique, 963. b. virginale, 988 .b . v irile,
989. a. zygie. 1004. b. Flûte des Hébreux appellée chai il.
Suppl. IL 310. b. Ufage que les Grecs faifoient de la flûte
dans les marches militaires & les combats. Suppl. III. 912.
b. Concert de flûtes dans la mufique ancienne. Suppl. IV.
*SZ- b‘
FLUTE double. ( Inflr. de mufiq. ) Defcription de cette flûte
qui étoit en ufage chez les anciens. Symphonie qui pouvoir
en réfulter. Quel futl’invcnteur de cet inftrument: VI. 893. a.
Flûte des facrifices. V I. 893. a.
F lUTE tyrrhinienne. ( Muflq. inflr. anc. ) Sa defcription.
Suppl. III. 63. a.
Flûte d'accords. VI. 893. a.
F lû te . (£«té .) Defcription des flûtes ou flageolets des
negres. Suppl IIl. 6 2.a. v o y e z pl. 3. de' luth. Suppl.
FLUTE de peau. ( Luth.) V oyez Sifflet de peau.
Flûte allemande ou traverfiere. Defcription & ufage de cet
Inftrument: maniéré d’en jouer. VI. 893. a. Détails fur la
tablature & l’étendue de la flûte traverfiere. Comment fe
fait le fon des principales notes. Ibid. 896. a. U y a d’autres
flûtes plus grandes ou plus petites qui ne différent de celle-ci
que par la partie qu’elles exécutent. Inftruéiion fur les cadences
£c la maniéré de les exécuter, fur les coups de langue, les
ports-de-voix, les accens, les doubles cadences, les flatemens,
battemens, Oc. Ibid. b. Tablature de la flûte allemande ou
‘ traverfiere. Ibid. 897. a, b. Cadences de la flûte allemande. Ibid.
898, a.
F lUTE traverfiere. ( Luth. ) Dans une partie de l’Allemagne,
& particulièrement en Pruffe , cette efpece de flûte eft
conftruite autrement qu’il n’eft rapporté dans l’Encyclopédie.
Ces changemens font dus à M. Quantz, muficien de la
chambre.au roi de Pruffe: en quoi ils confiftent. Suppl. III.
62. a. Raifons qui les ont fait adopter. Ibid. b. L’auteur de
l ’article Flûte traverfiere de l’Encyclopédie prétend qu’il faut
plus de vent pour les tons aigus que pour les graves. Cette
erreur réfutée. Tablature pour la flûte traverfiere à deux
clefs. Ibid. 63. a. -
Flûte traverfiere. Lieu de la France où l’on foit les meilleures
flûtes. Suppl. UI. 678. a. Baffe de cet inftrument. II.
120. b. Deflùs. IV . 896. a. Quinte. XIII. 721. a. Traverfiere
à bec. XVI. 371. b. Ouvrage à confulter fur l’art de jouer
de la flûte traverfiere. Ibid.
F lû te A l l em a n d e , ( Jeu d ’orgue) VI. 899. a . .
F lUTE , ( Jeu d'orgue ) voye[ JEUX D’ORGUE.
Flûte douce ou à bec. Description de cet inftrument. D étails
fur la maniéré de le fabriquer. V I. 899. a. Inftruétion
fur l’art d’en foire ufage. Ibid. b.
Tablature de la flûte douce ou à bec. Suite des cadences de
çet inftrument. VI. 901. a. n tt
Flûte douce ou à bec, baffe de cet inftrument. II. 120. a , b.
Deflùs. IV . 896. a. Haute-contre. VUL 7 1 . a. Quinte. XIII.
.721. a.
FtUTE de tambourin ou à trois trous. ( L u th .) Tablature dd
cet inftrument. Détails fur fon ufage. VL 901. b.
F l û t e , ( Marine) Defcription de ce bâtiment. VI. 90** b.
Ce qu’on entend en France par un vaifleaU armé en flûte.
Dimenfions les plus .ordinaires des flûtes. Des proportions
des différentes pièces de ce bâtiment; Ibid. 902. a.
Flûte y article fur ce bâtiment. XUL 790. a. Petite flûte.
II. 340. a. Flûte repréfentée, vol. VIL des planch. Marine,
planche z 3.
Flûte , ( Tapiff. ) efpece de navette dont fe fervent les
bafleTliffiers..VI. 902. a . . ..
F lûte , ( Greffer en ) voyez G reffer.
F LU T Ë , fons flûtés. X V . 347. a t b.
FLU TEU R , automate de Vaucanfon. I. 448. b.
FLUVIALIS , ( Botan. ) genre de plante aufli nommé
najasrnaide. XI. 7. a.
FLUX & REFLUX, ( P h y f .O Hydrographe) Pendant le
fllux, les eaux des fleuves s’enflent vers leur embouchure i
pendant' lé reflux clle.recommencent à couler. C e qu’on appelle
haute & baffe mer : trois périodes ordinaires, à la marée,
la journalière , la menftruelle, l’ annuelle. Durée.de la première.
VI. 902. a. Connexion du flux & reflux avec le mouvement
de 1a lune & avec celui de la terre ou du foleil.
Phénomènes obfervés . ordinairement dans la période journalière
; dans la période menftruelle ; dans la période annuelle.
Explication de ces phénomènes. Les anciens avoient déia
conclu :que le foleil oc la lune en étoient la caufe. Galilée
jugea que le flux & reflux étoit une preuve du double mouvement
de la terre par rapport au. foleil. Ibid. b. Hypothefe
imaginée par Defcartes, pour expliquer Ces phénomènes.
Défauts de cette hypothefe. Explication du flux & reflux
par le. principe de la gravitation. Ibid. 903. a. Kepler avoit
conjeduré que la gravitation des parties de la terre vers la
lune & vers le lo le i l, étoit la caufe du flux & reflux.
Théorie des marées. Ibid. b. Pourquoi l’élévation & l’abaif-
fement des eaux de la mer fe fait aux mêmes inftans dans
les points oppofés d’un même méridien. Le mouvenfent des
eaux ne provient point de l’aélion totale du foleil & de la
lune; mais de la différence êotre l’attion de ces aftres fur
le centre de la terre , & leur aélion fur.le fluide tant fupé-
rieur qu’inférieur. Seloif Newton, l’aélion folaire eft à la
pefanteur, comme un à 128682000 : l’aâion lunaire eft environ
quadruple de celle du foleil. Ibid. 904. a. Il eft évident,
d’après les. principes pofés, que l’élévation des eaux en un
même endroit, doit être fujette à de grandes variétés, foit
pour la quantité, foit pouç l’heure à laqu sUÉglle arrive. Pour-
; .quoi, les plus grandes marées arrivent, dans les fyzygies, &
les plus baffes dans les quadratures. Pourquoi les marées que
. caule le foleil font beaucoup moins, grandes que celles que la
lune çaufè. Les périgées du foleil & de la lune .rendent aufli
les marées plus grandes. La force.d’inertie des eaux doit avoir
deux effets, celui de retarder l’heure, de la Haute marée, &
celui de diminuer en général l’élévation des eaux. Ibid. b.
Pourquoi après le flux1 & le reflux, la mer eft un peu de
tems.fans defeendre ni monter. Le flux doit arriver plutôt
aux rades orientales qu’aux rades occidentales. Pourquoi la
navigation eft en général plus prompte vers l’occident que
yers l’orient. Une des principales caufcs des vents alizés.
Quelle eft la raifon qui fait que près: des pôles & à la latitude
-de'63 degrés, le flux & reflux n’eft pas fenfible. Pour- 3uoi en général, en allant vers le pôle.boréal , les marées
e deflùs font plus grandes, quand la lune eft dans l'hémif-
phere boréal, & celles de deuous plus petites. Pourquoi en
s’avançant plus loin vers le pô le, il ne doit plus y avoir
qu’un flux & reflux dans l’efpace de 24 heures. Ibid. 903. a.
Quand l a lune va des fyzygies aux quadratures, l’élévation
la plus grande des eaux doit fe foire plus au couchant de la
lune ; c’eft le contraire quand la lune va des quadratures aux
fyzygies. La marée lunaire eft changée tant foit peu par l’action
du foleil, & ce changement doit varier chaque jour. Pourquoi
les plus hautes marées n’arrivent pas précifément dans la
conjonélion & dans l’oppofition de la lune. Pourquoi les marées
du folftice d’hiver font un peu plus grandes que celles du
folitice d’été. Autres phénomènes qu’on ne peut prouver que
par le calcul. Ouvrage de M. Daniel Bernoulli, à confulter fu r
le flu x O reflux de la mer. Les réglés qu’on a établies fur les
grandes marées des équinoxes, n’ont lieu, quand la lune eft
dans l’équateur, que pour les eaux fituées fous l’équateur
même. Ibid. b. Particularités & inégalités des côtes, largeur,
profondeur des canaux, regardées comme caùfe de la grande
variété que l’on remarque dans les hauteurs des marées.
Diverfes côtes où ces effets font fenfibles. Les bas-fonds 8c
les continens qui entrecoupent la mer, font caufe en partie
que la haute marée n’arrive point en plein océan dans le tems
que la lune s’approche du méridien ; mais quelques heures
après. Altération des phénomènes du flux & du reflux par
les vents & les courans irréguliers. Pourquoi les mers Caf-
pienne, Méditerranée, Blanche & Baltique n’ont point de
marées fenfibles. Pourquoi la marée eft plus fenfible dans