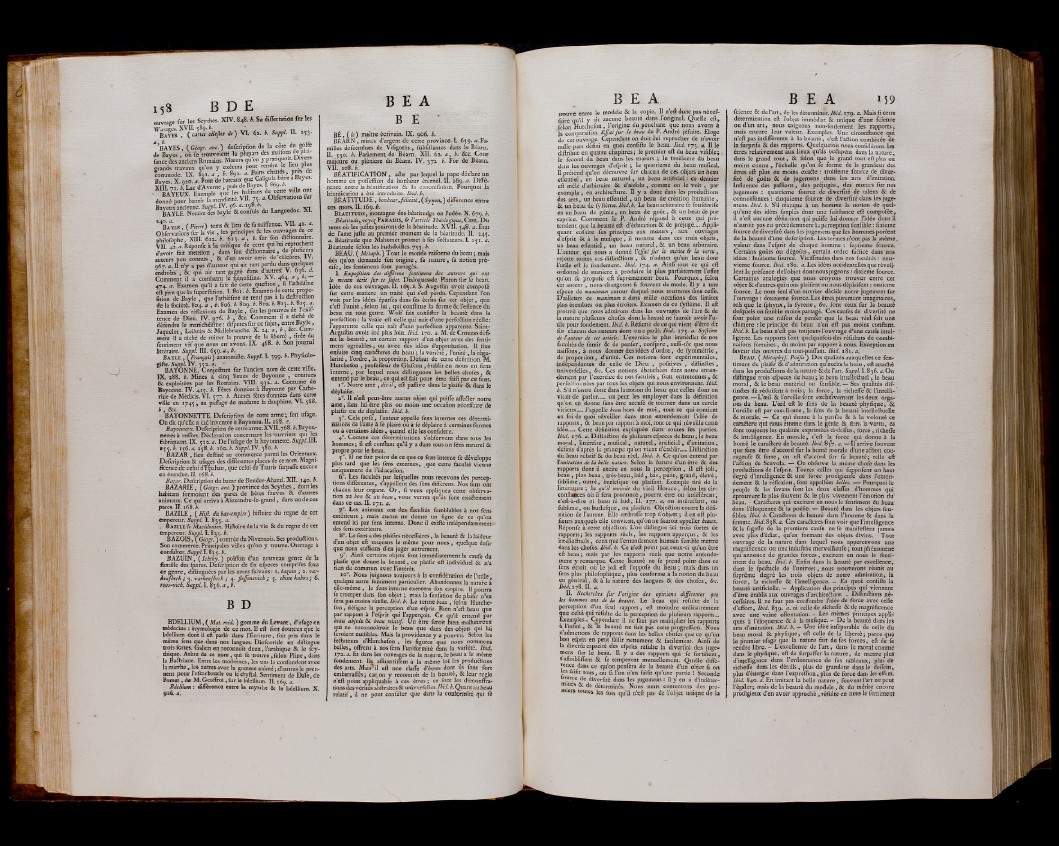
i j 8 B D E
ouvrage fur les Seythes. XIV. 848. 4. Sa diflertaâon fur les
WBaIER b‘ ‘ u? ” * § V1' ¡ f 4- P P B ‘’ ’b a y e s , ( Ge’ogr. une.) defeription de la côte du golfe
de Bayes , on fe trouvoient la plupart des marions de plai-
fance des anciens Romains. Moeurs qu'on j a M B g g B
grands trnvan* ju'on y
cômmodêT IX. f c i . a Bayedsc.
Bayes. X. 010. a. Pont de bateaux que Caloeula batir a
II. m IL a c d'Aveme , près de Bayes K de cene ville ont
donnéVÎTVU. „ mObfervattonsfur
^ A Y L E N o a i^ ib a y i e ¿conduis du Languedoc. XI.
24Bayle ( Pierre) tems & lieu de fanaiffance. VIL 4*- *•
Obfervatiôns fur la vie , les principes 8c
philofophe, xm. 612. ¿. 613. a , b. fur fon B g B f a g g
Vil 42. a. Réponfe à la critique de ceux qui lui reprochent
d’avoir fait mention , dans ton Æaionnairc, de plufieure
auteurs peu connus , & d’en avoir omis de celebres. 1Y.
067. a. Ú n’y a pas d’auteur qui ait tant perdu dam quelques
endroits , & qui ait tant gagné dans d^autresi V. 636. d.
Comment il a combattu le fpinofifme. XV. 464. a , A —
474. a. Examen qu’il a fait de cette quefuon, fi 1 athéume
eft pire que la fuperftirion. 1.801. b. Examen de cette propo-
fition de Bayle , que l’athéifme ne tend pas a la deftruction
de la fociété. 804. a , b. 806. b. 809. b. 8i<x b. 813. b. 815. a.
Examen des réflexions de Bayle, fur les preuves de lexii-
tence de Dieù. IV. 976. b , &c. Comment il a taché de
défendre le manichéifme : difputes fur ce fujet, entre Bayle ,
Jaquelot, Leibnits & Mallebranche. X. 24. f > * > &c; 7 0*?“
ment il a tâché de ruiner la preuve de la liberté -, tirée du
fentiment vif que nous en- avons. IX. 468. b. Son journal
littéraire. Suppl. III. 659. a, b.________________.
Ba yle , (Franjo«) anatomifte. Suppl. L 399. b. rhyuolo*
gifle. Suppl. IV. 3 <2. a. •
BAYONNE. Conje&ure fur l’ancien nom de cette ville.
IX. 288. b. Mines à cinq, lieues de Bayonne , connues
& exploitées par les Romains. VIII. 93 a~ Coutume de
Bayonne. IV. 41?. b. Fêtes données à Bayonne par Catherine
de Médicis. VI. 377. b. Autres fètes données dans cette
vtile en 1745 , au paflage de madame la dauphine. V I. 588.
b , &c. _____ r g
BAYONNETTE. Defeription de cette arme ; fon ufage.
On dit qu’elle a été inventée à Bayonne. II. 168. a.
Bayonnettc. Defeription de cette arme.XVII. 768. é.Bayon-
nettes à reflort. Déclaration concernant les ’ouvriers qui les
fabriquent.IX. 512.a. De l’ufage de la bayonnette.Suppl.Mi.
«3 3. b. 136. a. 138. b. 160. b. Suppl.YV. 30O. b.
BAZAR, lieu defliné au commerce parmi les Orientaux.
Defeription & ufage s des différentes places de ce nom. Magnificence
de celui dTipahan, que celui aeTauris furpaffe encore
en étendue. II. 168. b.
Baçar. Defeription du bazar de Bender-Abazzi. XII. 140. b.
BAZARIE, ( Géogr. anc. ) province des Scythes, dont les
hafcitans formoient des parcs de bêtes fauves & d’autres
animaux. Ce qui arriva à Alexandre-le-grand, dans un de ces
parcs. U. 168. b.
BAZILE, y g j j du bas-empire) hiftoire du regne de cet
empereur. Suppl. I. 83 3. a.
. B a z ile le Macédonien. Hiftoire de la vie & du regne de cet
empereur. Suppl. L 833. b.
BAZOIS, (Géogr?) contrée du Nivemois. Ses productions.
Son commerce. Principales villes qu’on y trouve. Ouvrage à
confuker. Suppl. L 83 3. b.
BAZUIN, ( Icht/iy. ) poiifon d’un nouveau genre de la
femille des fpares. Defeription de fix efpeces comprifes fous
ce genre, diftinguées par les noms fiiivans: 1. baçuin ; 2. var-
keafbeck ; 3. varkenfbeck ; 4. Jleffensvich ; 3. chine, kabos ; 6.
roos-vich. Suppl. I. 036. a , b.
B D
BDELLIUM, (Mat. méd. ) gomme du Levant, d’ufage en
médecine : étymologie de ce mot. Il eft fort douteux que le
bdellium dont il eft parlé dans l’Écriture, foie pris dans le
meme fens que dans nos langues. Diofcoride cri diftingue
trois fortes. Galien en reconnoit deux, l’arabique 8t le fcy-
thique. Arbre de ce nom, qui fe trouve, félon Pline, dans
la Baclriane. Entre les modernes, les uns le confondent avec
la mirrhe, le» autres avec la gomme animé ; d’autres le prennent
pour i’efcarboucle ou le rtyftal. Sentiment de Dale, de
Pomet, de M. Geoffroi, fur le bdellium. II. 169. a.
Bdellium : différence entre la myrrhe 8c le bdellium. X.
916. a.
BEA
B E
BÉ, {le) maître écrivain. IX. 906. b.
BÉARN , mines d’argent de cette province. L 6<t 9. a. Fa*
milles defeendues de Vmgoths, fubnftantes dans le Béarn.
H. 330. b. Parlement de Béarn. XII. 62. a, b. &c. Cour
majeure ou pléniere du Béarn. IV. 372 b. For-de Béarn.
VU. 108. b.
BÉATIFICATION, aCte par lequel le pape déclare un
homme en pofleflion du bonheur éternel'. II. 169. a. Différence
entre la béatification & la canonifation. Pourquoi la
béatification a été introduite. Ibid. b.
BÉATITUDE , bonheur, félicité,{Synon,) différence entre
ces mots. U. 169. b.
B é a t i t u d e , montagne des béatitudes en Judée. X. 679. b.
Béatitude, voye^PARADlS, & Varticle Théologique, Ciel. Du
tems où les juftes jouiront de la béatitude. XVll. 348. a. État
de l’ame jufte au premier moment de la béatitude-. II. 243.
a. Béatitude que Mahomet promet à fes feébteurs. I. 231. a.
Béatitude félon les budsdoïftes.753. b.
BEAU. ( Métaph. ) Tout le moride raifonne du beau ; mais
dès qu’on demande fon origine, fa nature, fa notion pré-
cife, les femimens font partagés.
1. Expojhion des différens J'entimens des auteurs qui ont
le mieux écrit fur ce fujet. Dialogues*de Platon fur le beau.
Idée de ces ouvrages. II. 169. b. S. Auguftin avoit compofè
fur cette matière un traité qui s’eft perdu. Cependant l’on
voit parles idées 'éparfes dans fes écrits fur cet objet, que
c’eft l’unité, félon lui, qui conftitue la forme & l’effence du
beau en tout genre. Wolf fait confifter la beauté dans la
perfection : la vraie eft celle qui naît d’une perfection réelle :
l’apparente celle qui naît d’une perfection apparente. Saint-
Auêuftin avoit été plus loin. Ibid. 170. a. M. de Crouzas défi*
ait la beauté, un certain rapport d’un objet avec des fenti-
mens 'agréables, ou avec des idées d’approbation. Il fixe
enfuite cinq caraâeres du beau ; la variété, l’unité, la régularité
, l’ordre, la proportion. Défaut de cette définition.M.
Hutcbefon , profeffeur de Glafcou, établit en nous un fens
interne, par lequel nous diftinguons les belles choies, &
entend par le beau, ce qui eft fait pour être faifi par ce fens.
i°. Notre ame , dit-il, eft paifive dans le plaifir 8c dans le
dèplaifir.
a°. U n’eft peut-être aucun objet qui puifle affeCler notre
ame, fans lui être plus ou moins une occafion nécefiaire de
plaifir ou de dêplaiiir. Ibid. b.
30. Cela pofé, l’auteur appelle fens internes ces déterminations
de l’ame à fe plaire ou à fe déplaire à certaines formes
ou à certaines idées, quand elle les confidere.
4°. Comme ces déterminations s’obfervent dans tous les
hommes ; il eft confiant qu’il y a dans tous un fens naturel 8c
propre pour le beau.
5U. 11 ne fuit point de ce que ce fens interne fe développe
plus tard que les fens externes, uque cette faculté vienne
uniquement de l’éducation.
6°. Les facultés par Icfquelles nous recevons des perceptions
différentes, s appellent des fens différens. Nos fens ont
chacun leur organe. O r , fi vous appliquez cette obferva-
tion au bon & au beau, vous verrez qu’ils font exactement
dans ce cas. Q. 171. a.
70. Les animaux ont des facultés femblables à nos fens
extérieurs ; mais aucun ne donne un figne de ce qu’on
entend ici par fens interne. Donc il exifte indépendamment*
des fens extérieurs.
8°. Le fens a des plaifirs néceffaires, la beauté & la laideur
d’un objet eft toujours le même pour nous , quelque defir
que nous eufftons d’en iuger autrement.
90. Ainfi certains objets font immédiatement la caufe du
plaifir que donne la beauté, ce plaifir eft individuel & n’a
rien de commun avec l’intérêt.
zo°. Nous joignons toujours à la confidération de Futile ,*
quelque autre fentiment particulier. Abandonnez la nature à
elle-même, le fens interne exercera fon empire. Il pourra
fe tromper dans fon objet ; mais la fenfation de plaifir n’en
fera pas moins réelle. Ibid. b. Le terme beau , félon Hutche-
fon, défigne la perception d’un efprir. Rien n’eft beau que
par rapport à l’efprir qui Fapperçoit Ce qu’il entend par
beau abjolu & beau relatif, tin être feroit bien malheureux
qui ne reconnoitroit le beau que dans des objets qui lui
feroient nuifibles. Mais la providence y a pourvu. Selon les
feâateurs d’Hutchefon , les figures que nous nommons
belles, offrent à nos fens l’uniformité dans la variété. Ibid.
171. a. Et dans les ouvrages de la nature, le beau a le même
fondement. Us affujettiuent à la même loi les productions
des arts. Mais* il eft une claffe d’êtres dont ils font fort
embarraffés; car.on y reconnoit de la beauté, & leur réglé
n’eft point appliquable à ces êtres ; ce font les démonftra-
tions des vérités abftraites & univerfelles. Ibid. b. Quant au beau
relatif, il ne peut confifter que dans la conformité qui fe
BEA B E A M 9
trouve entre le modèle & la copie, Il n’eft donc pas nécef-
ire qu’il y ait aucune beauté dans l’original. Quelle eft,
félon Hutcbefon, l’origine du penchant que nous avons à
la comparaifon. Éjfai Jur le beau du P. André jéfuitc. Eloge
de cet ouvrage. Cependant on doit -lui reprocher de n’avoir
nulle part défini en quoi confifte le beau. Ibid. 173. a. Il le
diftribue en quatre chapitres; le premier eft du beau vifible;
le fécond du beau dans les moeurs ; le troifieme du beau
dans les ouvrages d’efprit ; le quatrième du beau mufical.
Il prétend qu’pn découvre fur chacun de ces objets un beau
eflèntiel, un beau naturel, un beau artificiel : ce dernier
eft mêlé d’arbitraire & d’abfolu, comme on le v o it, par
exemple , en architeClure. Il y a donc dans les productions
des arts, un beau eifentiel, un beau de création humaine ,
& un beau d,e iyftème. Ibid. b. Le beau arbitraire fe foufdivife
en un beau de génie, un beau dé goût, & un beau de pur
caprice. Comment le P. André repond à ceux qui prétendent
que la beauté eft d’éducation & de préjugé.... Appliquant
enfuite fes principes aux moeurs , aux ouvrages
d’efprit & à la muhque, il montre dans ces trois objets,
un beau effentiel, un beau naturel, 6c un beau arbitraire.
L’auteur qui nous a donné Vcjfai fur le mérite 6* la vertu ,
rejette toutes ces diftinCtions , 6c n’admet qu’un beau dont
l ’utile eft le fondement. Ibid. 174. a. Ainfi tout ce qui eft
ordonné de maniéré à produire le plus parfaitement l’effet
qu’on fe propofe eft fuprêmement beau. Pourquoi, félon
cet auteur , nous changeons fi fouvent de mode. Il y a une
efpece de maximum autour duquel nous tournons fans cefle.
D ’ailleurs ce maximum a dans mille occofions des limites
plus étendues ou plus étroites. Examen de ce fyftême. Il eft
prouvé que nous admirons dans les ouvrages de l’art 6c de
la nature plÿfieurs chofes dont la beauté ne fauroit avoir l’utile
pour rondement. Ibid. b. Réfumé de ce qui vient d’être dit
fur chacun des auteurs dont on a parlé. Ibid. 173. a. Syftéme
de Hauteur de cet article. L’exercice le plus immédiat de nos
facultés de fentir 6c de peufer, confpire, aufli-tôt que nous
naiffons, à nous ‘donner des idées d’ordre, de fymmétrie ,
de proportion, d’unité. Ces notions-font expérimentales,
^dépendantes de celle de Dieu , pofitives , diftinCles,
univerfelles, &c. Ces notions ébauchées dans notre entendement
par l’exercice de nos facultés, font entretenues, 6c
perfectionnées par tous les objets qui nous environnent. Ibid.
b. S’il n’entre donc dans la notion du beau que celles dont on
vient de parler on peut les employer dans la définition
qu’on en donne fans être accufé de tourner dans un cercle
vicieux J’appelle beau hors de moi, tout ce qui contient
«n foi de quoi réveiller dans mon entendement L’idée de
rapports, 6c beau par rapport à moi, tout ce qui réveille cette
idée Cette définition expliquée dans' toutes fes parties.
Ibid. 176. a. Diftinétion de plufieurs efpeces de beau ; le beau
moral, littéraire, mufical, naturel, artificiel, d’imitation,
définis d’après le principe qu’on vient d’établir Diftinétion
du beau relatif 6c du beau réel. Ibid. b. Ce qu’on entend par
l'imitation de la belle nature. Selon la nature d’un être 6c des
rapports dont il excite en nous la perception, il eft joli,
beau , plus beau, très-beau, laid, bas, petit, grand, élevé,
fubliine, outré, burlefque ou plaifant. Exemple tiré de la
littérature ; le qu'il mourût du vieil Horace, félon les cir-
conftaaces où il fera prononcé, pourra être ou indifférent,
c’eft-à-dire ni beau ni laid, II. 177. a. ou intéreifant, ou
fublime, ou burlefque, ou plaifant. Objeâion contre la définition
de Fauteur. Elle embraffe trop d’objets ; il en eft plufieurs
auxquels elle convient, qu’on ne fauroit appeller beaux.
Réponfe à cette objeCtion. L’on diftingue -ici trois fortes de
rapports ; les rapports réels, les rapports apperçus, 6c les
intelle&uels, ceux que l’entendement humain femble mettre
dans les chofes. Ibid. b. Ce n’eft point par. ceux-ci qu’un être
eft beau ; mais par les rapports réels que notre entendement
y remarque. Cette beauté ne fe prend point dans ce
fens étroit où le joli eft l’oppofé du beau ; mais dans un
fens plus philofophique, plus conforme à la notion du beau
en général, 6c à la nature des langues 6c des chofes, &c.
Ibid. 178. II. a.
II. Recherches fur l'origine des opinions différentes que
les hommes ont de la beauté. Le beau qui refulte de la
perception d’un feul rapport, eft moindre ordinairement
que celui qui réfulte de la perception de plufieurs rapports...
“ firôpîps... Cependant il ne faut pas multiplier les rapports
à Tinuni, 6c la beauté ne fuit pas cette progreflion. Nous
n’admettons de rapports dans les belles chofes que ce qu’un
bon efprit en peut faifir nettement 6c facilement. Ainfi de
la diverfe capacité des efprits réfulte la diverfité des juge-
^ur k beau. Il y a des rapports qui fe fortifient,
saffoibliffent 8c fe temperent mutuellement. Quelle différence
dans ce qu’on penfera de la beauté d’un objet fi on
«s faifit tous, ou fi Fon n’en faifit qu’une partie l Seconde
lource de diverfité dans les jugemens : il y en a d’indéterminés
& de déterminés. Nous nous contentons des premiers
toutes les fois qu’il n’-eft pas de l’objet unique de la
fcienceSc de l’art, de les déterminer. Ibid. 179. a. Mais fi cetre
détermination eft l’objet immédiat 8c unique d’une fcience
ou d’un art, nous exigeons non-feulement les rapports 1,
mais encore leur valeur. Exemples. Une circonftance qui
n’eft pas indifférente à la beauté, c’eft l’aâion combinée de
la furprife 6c des rapports. Quelquefois nous confidèrons les
êtres relativement aux lieux qu’ils occupent dans la nature,
dans le grand tout , 6c félon que le grand tout eft plus ou
moins connu , l’échelle qu’on le forme de la grandeur des
êtres eft plus ou moins exaâe : troifieme fource de diverfité
de goûts 6c de jugemens dans les arts d’imitation.
Influence des pallions, des préjugés, des moeurs fur nos
jugemens : quatrième fource de diverfité de talens 6c- de
connoiffanees : cinquième fource de diverfité dans les jugemens.
Ibid. b. S’il manque à un homme la notion de quelqu’une
des idées fimples dont une fubftance eft compofée ,
il n’eft aucune définition qui puifle lui donner l’idée dont il
n’auroit pas eu précédemment la perception fenfible : fixieme
fource de diverfité dans les jugemens que les hommes portent
de la beauté d’une defeription. Les-termes n’ont pas la même.
valeur dans l’efprit de chaque homme : feptieme fource.
Certains goûts ou dégoûts, certain ordre faétice dans'nos
idées : huitième fource. Viciflitudes dans nos facultés : neuvième
fource. Ibid. 180. a. Les idées accidentelles que réveillent
la préfence de l’objet dont nous jugeons : dixième fource.
Certaines analogies que nous croyons trouver entre cet
objet 6c d’autres qui nous plaifent ou nous déplaifent : onzième
fource. Le nom feul d’un ouvrier décide notre jugement fur
l’ouvrage : douzième fource. Les êtres purement imaginaires,
tels que le lphynx, la fyrene, &c. font ceux fur la beauté
defquels on lemble moins partagé. Ces caufes de diverfité ne
font point une raifon de penter que le beau réel foit une
chimere : le principe du beau n’en eft pas moins confiant.
Ibid. b. Le beau n’eft pas toujours l’ouvrage d’une caufe intelligente.
Les rapports l'ont quelquefois des réfultats de combi-
naifons fortuites, du moins par rapport à nous. Exception en
faveur des oeuvres du tout-puiffant. Ibid. 181. a.
B e a u . ( Mctaphyf. Poéfie ) Des qualités auxquelles ce fentiment
de plaifir & d’admiration qu’excite le beau, eft attaché
dans les productions de la nature 6cde l’art. SuppL\. 83S. a. On
diftingue trois efpeces de beau ; le beau intelleéluel, le beau
moral, 6c le beau matériel ou fenfible. — Ses qualités dif-
• tinétes fe réduifent à trois ; la force, la richefle 6c l’intelligence.—
L’oeil 6c l’oreille font exclufivement les deux organes
du beau. L’oeil eft le fens de la beauté phyfique, &
l’oreille eft par excellence, le fens de la beauté intellectuelle
6c morale. — Ce qui donne à la penfée 6c à la volonté ce
caraétere qui nous étonne dans le génie 6c dans la vertu, ce
font toujours les qualités exprimées ci-deflùs, force, richefle
6c intelligence. En morale, c’eft la force qui donne à la
bonté le cara&ere de beauté. Ibid. 83*7. a. — Il arrive fouvent
que fans être d’accord fur la bonté morale d’une aCtion cou-
rageufe 6c forte, on eft d’accord fur fa beauté; telle eft
Faction de Scevola. — On obferve la même chofe dans les
productions de Fefprit. Toutes celles oui fuppofent un haut
degré d’intelligence 8c une force proaigieufe dans l’entendement
6c la réflexion, font appeliées belles. — Pourquoi le
peuple 6c les favans font les deux claffes d'hommes qui
éprouvent le plus fouvent 6c le plus vivement l’émotion du
beau. - CaraCteres qui excitent en nous le fentiment du beau
dans l’éloquence 6c la poéfie. — Beauté dans les objets fen-
fibles. Ibid. b. CaraCteres de beauté dans l’homme 6c dans la
femme. Ibid. 838. à. Ces caraCteres font voir que l’intelligence
6c la fageffe de la première caufe ne fe manifeftent jamais
avec plus d’éclat, qu’en formant des objets divins. Tout
ouvrage de la nature dans lequel nous appercevons une
magnificence ou une induftrie merveilleufe ; tout phénomène
qui annonce de grandes forces, excitent en nous le fentiment
du beau. Ibid. b. Enfin dans la beauté par excellence,
dans le fpeCtacle de l’univers, nous trouverons réunis au
fuprême degré les trois objets de notre admiration, la
force, la richefle 6c l’intelligence. - En quoi confifte la
beauté artificielle. - Application des principes qui viennent
d’être établis aux ouvrages d’architeCture. - DiftinCtions né-
ceffaires. Il ne faut pas confondre l’idée de' force avec celle
d’effort, Ibid. 839. a. ni celle de richefle 6c de magnificence
avec une vaine oftentation. - Les mêmes principes appliqués
à l’éloquence'8c à la mufique. - De la beauté dans les
arts d’imitation. Ibid. b.. - Une idée inféparable de celle du
beau moral 6c phyfique, eft celle de la liberté; parce quç
le premier ufage que la nature fait de.fes forces, eft de fe
rendre libre. - L’excellence de l’art, dans le moral comme
dans le phyfique, eft de furpafler la nature, de mettre plus
d’intelligence dans l’ordonnance de fes tableaux, plus de
richefle dans les détails, plus de grandeur dans le deffein,
plus d’énergie dans Fexpreflion, plus de force dans les effets.
Ibid. 840. a. En imitant la belle nature, fouvent l’art ne peut
l’égaler; mais de la beauté du modèle, 8c du mérite encore
prodigieux d’en avoir approché, réfulte en nous le fentiment