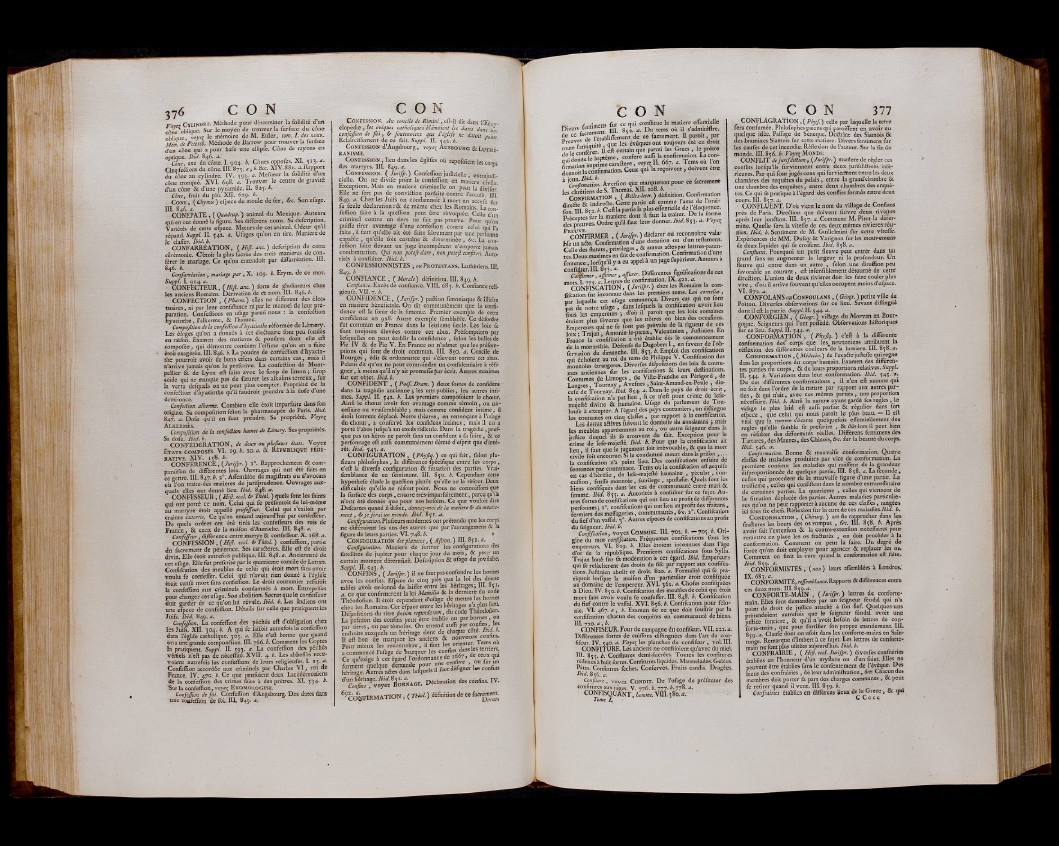
376 C O N
y C y l in d r e . Méthode pour déterminer la folidité d’un
cône oblique. Sur le moyen de trouver la furfoce du cône
oblique» voye[ le mémoire de M. Euler, tom. I. des nouv.
Mem. de Petersb. Méthode de Barrow pour trouver la furfoce
<Tun cône qui a pour bafe une ellipfe. Cône de rayons en
optique, lbid. 846. a. V T _
Cône, axe du cône. I. 904. b. Cônes oppoles. XI. <13. a.
Cinqfeélions du cône. III. 875.| , b. &c. XIV.881. ¿.Rapport
du cône au cylindre. IV. 593. ¿. Mefurer la folidité dun
cône tronqué. XVI. 698. ¿. Trouver le centre de gravité
d’un cône & d’une pyramide. II. 825. b.
Cône, fruit du pin. XII. 629. b.
Cone, ( Chymie) efpece de moule de fer, &c. bon ulage.
ï 11- 846. £ . j , . «
CONEPATE, ( Quadrup. ) animal du Mexique. Auteurs
qui en ont donné la figure. Ses différens noms. Sa defeription.
Variétés de cette efpece. Moeurs de cet animal. Odeur qu’il
répand. Suppl. II. 542. a. Ufages qu’on en tire. Maniéré de
le claffer. lbid. b.
CONFARRÉATION, ( Hifi. anc.) defeription de cette
cérémonie. C’étoit la plus facrée des trois maniérés de conférer
le mariage. Ce qu’on entendoit par diffarréation. III.
846. b. ,
Confarrêation , mariage par, X. 109. b. Etym. de ce mot.
ÎU& N FÉ C T EU R , (Hifi. anc.) forte de gladiateurs chez
les anciens Romains. Dérivation de <?t nom. 1U. 846. b.
CONFECTION , ( Pharm.) elles ne différent des élec*
tuaires, ni par leur confiftance ni par le manuel de leur pré-
naration. Confeélions en ufage parmi nous : la confeélion
lyacinthe, l’alkerme, & l’hamec. _
C
Composition delà confeflion d'hyacinthe reformee de Lémery.
Les éloges qu’on a donnés à cet éleétuaire font peu fondés
en raifon. Examen des matières & poudres dont elle eft
compofée, qui démontre combien l’eftime qu’on en a faite
¿toit exagérée. III. 846. b. La poudre, de confeélion d hyacinthe
pourroit avoir de bons effets dans certains cas, mais il
n’arrive jamais qu’on la preferive. La confeélion de Montpellier
& de Lyon eft faite avec le firop de limon ; firop
acide qui ne manque pas de faturer les alkalins terreux, fur
la vertu defquels on ne peut plus compter. Propriété de la
confeélion d’hyacinthe qu’il foudroit prendre à la dofe d une
demi-once. .
Confection alkerme. Combien elle étoit imparfaite dans fon
origine. Sa compofition félon la pharmacopée de raris./wa.
847. a. Dofe qu’il en fout prendre. Sa propriété. Voye^
Alkermès. ' , , , _ . . .
Compofition de la confection hamec de Lémery. Ses propriétés.
Sa dofe.- lbid. b. __
C O N F É D É R A T IO N , de deux ou plufieurs états. Voyez
É t a t s composés. VI. 19. b. 20. a. & R ép u b liq u e fé d é r
a t i v e . XIV. 158. ^
CONFÉRENCE, (Jurifpr. ) i°. Rapprochement &com-
paraifon de différentes loix. Ouvrages qui ont été foits en
ce genre. 111.847. b. a0. Affemblée de magiftrats ou d’avocats
©ù l’on traite-des matières de jurifprudence. Ouvrages auxquels
elles ont donné lieu. lbid. 848. a.
CONFESSEUR, ( Hifi. eccl & Théol. ) quels font les faints
qui ont porté ce nom. Celui qui fe préfentoit de lui-même
au martyre'étoit appellé profeffeur. Celui qui s’exiloit par
crainte extonis. Ce qu’on entend aujourd’hui par confeffeur.
De quels ordres ont été tirés les confeffeurs des rois de
France , & ceux de la maifon d’Autriche. III. 848. a.
Confeffeur , différence entre martyr & confeffeur. X. 168. a.
CONFESSION, (Hifi. eccl. & Théol.) confeffion, partie
du facrement de pénitence. Ses earaéleres. Elle eft de droit
divin. Elle étoit autrefois publique. IIL 848. a. Ancienneté de
cet ufage. Elle fut preferite par le quatrième concile de Latran.
Confifcation des meubles de celui qui étoit mort fans avoir
voulu fe confefler. Celui qui n’avoit rien donné à l’églife
étoit cenfé iport fans confeflion. Le droit coutumier refuioit
la confeflion aux criminels condamnés à mort. Entreprifes
pour changer cet ufage. Son abolition. Secret que le confeffeur
doit garder de ce qu’on lui révélé. lbid. b. Les Indiens ont
une efpece de confeflion. Détails fur celle que pratiquent les
Juifs, lbid. 849. a.
Confeffion. La confeffion des péchés eft d obligation chez
lés Juifs. XII. 304. b. A qui fe foifoit autrefois la confeffion
dans l’églife catholique. 30 ç. a. Elle n’eft bonne que quand
on a une grande compon&ion. III. 766. b. Comment les Coptes
la pratiquent. Suppl. II. 593.’ a. La confeffion des péchés
véniels n’eft pas de néceffite. XVII. 4. b. Les abbeffes rece-
voient autrefois les confeffions de leurs religieufes. I.
Confeffion accordée aux criminels par Charles V I , roi de
France. IV. 470. b. Ce que penfoient deux Lacédémoniens
de la confeffion des crimes faite à des prêtres. XL 334. b.
Sur la confeffion, voy^z Ex omolog e se.
Confeffion de foi. Confeffion d’Augsbourg. Des dates dans
une coafeffio'n de foi. Hl, 849. a.
C O N
CONFESSION. Au concile de Rimini, eft-il dit dans PEccv
clopédie , les évêques catholiques blâmoient les dates dans un
confeffion de fo i, & foutenoient que l’églife ne datoit point
Eclairciffement de ce fait. Suppl. II. <42. b.
C o n fe s s io n d’Augsbourg, voye^ A u sb o u r g & Lvthk
ranisme.
C o n fe s s io n , lieu dans les églifes où repofoientlescoms
des martyrs. III. 849. a. ^
C o n fe s s io n . ( Jurifp.) Confeffion judicielle, extraiudi-
cielle. On ne divife point la confeffion en matière civile
Exceptions. Mais en matière criminelle on peut la divifer
Elle ne fert pas de conviélion parfaite contre l’accufé. III
849. a. Chez les Juifs on condamnoit à mort un accufé fur
fa feule déclaration :& de même chez les Romains. La confeffion
faite à la queftion peut être révoquée. Celle d’un
criminel contre un tiers ne foit pas preuve. Pour qu’on
puiffe tirer avantage d’une confeflion contre celui qui pa
foite, il fout qu’elle ait été faite librement par une perfonne
capable, qù’elle foit certaine & déterminée, &c. La confeffion
foite devant un juge incompétent n’emporte jamais
condamnation. Qui non potefl dare , non potefl confiteri. Autorités
à confulter. lbid. b.
CONFESSIONNISTES , ou P ro te s ta n s . Luthériens. III
849. é
CONFIANCE , (Morale) définition.III. 849. b.
Confiance. Excès de confiance. VIIL 683. b. Confiance reli-
gieufe. VII. 7. b.
CONFIDENCE, (Jurifpr.) paôion fimoniaque & illicite
en matière bénéficiaie. On dit communément que la confidence
eft la fceur de la fimonie. Premier exemple dè cette
confidence en 928. Autre exemple femblable. Ce défordre
fut commun en France dans le leizieme fiecle. Les loix fe
font toujours élevées contre cet abus. Préfomptions par
lefquelles on peut établir la confidence , félon les bulles de
Pie IV & de rie V. En France 011 n’admet que les préfomptions
qui font de droit commun* III. 850. a. Concile de
Bourges , ¿dit & ordonnance qui s’élèvent contre cet abus.
Peleus dit qu’on ne peut contraindre un confidentiaire à réft-
gner, à moins qu’il n’y ait promefle par écrit. Autres maximes
fur cet objet. lbid. b.
CONFIDENT , ( Poêfi Dram. ) deux fortes de confidens ~
dans la tragédie ancienne ; les uns publics, les autres intimes.
Suppl. II. 542. b. Les premiers compofoient le choeur.
Ainfi le choeur avoit fon avantage comme témoin, ou né-'
ceffaire ou vraifemblable ; mais comme confident intime, il
étoit fouvent déplacé. Notre théâtre, en renonçant à l’ufage
du choeur, a confervé les confidens intimes ; mais il en a
porté l’abus jufqu’à un excès ridicule. Dans la tragédie, pref-
que pas un héros ne paroît fans un confident à fa fuite, & ce
perfonnage eft aufli communément dénué d’efprit que d’intérêt.
lbid. 543. a.
CONFIGURATION, ( Phyfiq.) ce qui foit, félon plufieurs
philofophes, la différence foecifique entre les corps , ■
c’eft la diverfe configuration & fituation des parties. Vrai-
femblance de ce fentiment. III. 850. b. Cependant cette
hypothefe élude la queftion plutôt qu’elle ne la réfout. Deux
difficultés qu’elle ne réfout point. Nous ne counoiffons que
la furfoce des corps, encore très-imparfoitement, parce qu ils
n’ont été donnés que pour nos befoins. Ce que vouloir-dire
Defcartes quand il difoit, donneç-moi de la matière & du mouvement
, & je ferai un monde, lbid. 851. a.
Configuration. Plufieurs modernes ont prétendu que les corps
ne différaient les uns des autres que par l’arrangement & la
figure de leurs parties. VI. 748. b.
C o n f ig u r a t io n desplanetes, ( Afiron. ) III. 851. a.
Configuration. Manière de former les configurations des
fatellites de jupiter pour chaque jour du mois, & pour un
certain moment déterminé. Defeription 8c ufage du jovilabe.
^O N f/n ^ , ( Jurifpr. ) il ne fini pas confondre les bornes
avec les confins. Efpace de cinq pies que la loi des douze
tables avoit ordonne de laiffer entre les héritages; III. 05:u
a. ce que confirmèrent la loi Mamilia & la derniere du co p
Théodofien. Il étoit cependant d’ufage de mettre les bornes
chez les Romains. Cet efpace entre les héritages n a plus heu.
Difpofitions du titre finium regundorum, du code Theodouen.
La pofraon des confins peut être établie ou par bornes, ou
par titres, ou par témoins. On entend auffi par confins,
endroits auxquels un héritage tient de chaque côte. J t . . .
Il eft bon de marquer les anciens & nouveaiw. ^ ÏL
Pour mieux les reconnaître, il fout les ^ "'ues terriers
a commencé l’ufage de Marquer les j S Q B p de ce ,x QUj
Ce qu’exige à cet égard l’ordonnance d e 1667, ^ceuxqrn
forment quelque demande P“ "j. défrgner 1« confins
héritage. Autres aôes dans lefquels n « &
f v o y Î ^OKKAGE. Déclaration des confins. IV.
^COfiFlRM ATION, ( Thial. ) définition de ce fecremenu
C O N C O N
-• fur ce qui conftitue la matière efïerttîellé
fJivcrs fonti _ ^ g a Du tems où il s’admirtiftre.
de ce facre tUfoh<;(renl^ g ^ g ce faCrement. Il paroît , par
Preuves ^té leg ¿véquescjnt toujours été en droit
Mfe S r e r t II,eft certain que parmi les Grecs, le prêtre
<le. , -7 t* Kantême. conféré auffi la confirmation. La cond
& & S S 8 m m r & k g 1 Tr o“ }'on donnoit làconfirmation. Ceux qrn lareçmvent, doivent etre
à ' S f t S o n . Avcrfion qnemarquerent pour ce facrement
f o „ 1 n % ia i .rC e f t ? p à X “ p l u s e S
Préceptes for la maniéré dont il font la traiter De la forme
des preuves. Ordre qu'il fout leur donner./W. 8 î3 . m VayK
PBrnmlRMF.R t jurilbr. ) déclarer où reconnoitre vala-
tl'e rm ™ o „ f irm a d “n d'une donation ou d'un teftament.
CeUe des ftatnts, privilèges , & autres aftespar lettres-pa«nr
tes Deux maximes en fait de confirmation. Confirmation d une
fentence,; lorfqu'il y a eu appel à un juge fupèneur. Auteurs a
Différentes lignifications de ces
mots i 77 t. a. Lettres de confirmation. IX.4ÇI. a.
C O N F I S C A T IO N , ( Jurifpr.) chez les Romanis la confifcation
fut inconnue dans les premiers tems. Loi crrmrha ,
. par laquelle cet ufage commença. Divers cas qui ne font
pas de notre ufage , dans lefquels la confifcation avoit heu
fous les empereurs ; d’où il paroît que les loix romaines
étoient plus féveres que les nôtres en bien des occafions.
Empereurs qui ne fe font pas préva u de la rigueur de ces
loix • Traian, Antonin-le-pieux, Valemimen , Juftimen. En
France la confifcation a été établie dès fe commencement
de la monarchie. Défenfe de DagobertI, en faveur de lob-
fervarion du dimanche. III. 8,3. 4. Emplot des confifeanons
qui échoient au roi du tems de Philippe V. Confifcation des
monnoies étrangères. Diverfes; difpofiuons des loix & coutumes
anciennes fur les confifcmoris & leurs deftmatious.
Coutumes de Limoges, de Ville-Franche en Périgord , de
Laneres Tournay, Avefnes , Saint-Amand-en-Peule , dio-
cefe de Tournay. lbid. 8ç4- Dans le pays de droit écrit,
la confifcation n’a pas lieu , fi ce n’eft pour crime de lefe-
maiefté divine & humaine. Ufage du parlement de Tou-
ioufe à excepter. A l’égard des pays coutumiers, on iffingue
les coutumes en cinq claffes, par rapport à la confifcation.
Les dettes aâives luivent le domicile du condamné ; mais
les meubles appartiennent au roi, ou autre feigneur dans la
iuftice duquel ils fe trouvent de fait. Exception pour le
crime de lefe-majefté. lbid. b. Pour que a confifcation ait
lieu il fout que le jugement foit irrévocable, & que la mort
civile foit encourue. Si le condamné meurt dans la prifon , . . .
la confifcation n’a point lieu. Des confifeanons enfuite de
fentences par contumace. Tems ou la confifeauon eft acquife
en cas d’héréfie, de lefe-majefté humaine , péculat: , con-
euffion, feuffe monnoie, facrüege , apoftafie. Quels font les
biens confifqués dans les cas de communauté entre mari &
femnie. lbid. 855. ¿. Autorités à confulter fur ce fujet. Autres
fortes de confifcations qui ont lieu au profit de différentes
perfonnes; i°. confifcations qui ont lieu au profit des traitans,
fermiers des meffageries, communautés, 6^. 2°. Confifcation
du fief d’un vaffal. 30. Autres efpeces de confifeanons au profit
du feigneur. lbid. b. .
Confifcation, Voyez Commise. III. 702. b. - 7 0 ç.ê. On-
sine du mot confifcation. Fréquentes confifcations fous les
empereurs. VI. 819. b. Elles étoient inconnues dans l’âge
d’or de la république. Premières confifcations fous Sylla.
Trajan loué fur fa modération à cet égard, lbid. Empereurs
qui fe relâchèrent des droits du fife par rapport aux cônfifca-
tions. Juftinien abolit ce droit. 820. a. Formalité qui fe: pra-
tiquoit lorfque la maifon d’un particulier étoit confifquée
au domaine de l’empereur. XVI. 361. a. Chofes confifquées
à Dieu. IV. 850. b. Confifcation des meubles de celui qui étoit
mort fans avoir voulu fe confefler. III. 848. b. Confifcation
du fief contre le vaffal. XVI. 85 6. b. Confifcation pour félonie.
VI. 467. a , b. Examen de ce que doit foutfrir par la
confifcation chacun des conjoints en communauté de biens.
III. 720. a , b.
CONFISEUR.Four de campagne du confifeur. VII. 222.a.
Différentes fortes de cuiffons diilinguées dans l’art du confifeur.
IV. 540. a. Voye^ les planches du confifeur , vol. III.
CONFITURE. Les anciens ne confifoient qu’avec du miel.
III. 855. b. Confitures demi-fucrées. Toutes les confitures
réduites à huit fortes. Confitures liquides. Marmelades. Gelées.
Pâtes. Confitures feches. Conferves. Fruits candis. Dragées.
lbid. 856. a.
Confiture, vovez C o n d it. De l’ufage de préfenter des
confitures aux iùees. V. 776. b. 777. b. 778. a.
CONFISQUANT. homme. V u l. 180. a..
377
CONFLAGRATION, ( Phyf. ) celle pat laquelle la telre
fera confumée. Philofophes païens qui paroiffent en, avoir eu
quelque idée. Paflage de Séneque. Do&rine des Siamois &
des bramines Siamois fur cette matière. Divers fentimens iur
les caufes de cet incendie. Réflexion de l’auteur; Sur la fin du
monde. III. 8<6. b. Voyez Monde.-
CONFLIT de jurifdiClton, (Jurifpr:) manière de régler ces
conflits lorfqu’ils furviennent entre deux jurifdiélions inférieures.
Par qui font jugés ceux quifurvierment entre les deux
chambres des requêtes du palais, entre la grand’ehambre &
une chambre des enquêtes, entre deux chambres des enquêtes.
Ce qui fe pratique à l’égard des conflits formés entre deux
cours. III. 857. ¿4
CONFLUENT. D’où vient le nom du village de Conflans
près de Paris. Direâion que doivent fuivre deux rivi.ei’es
après leur jonôion. III. 837. a. Comment M. Pitot la détermine.
Quelle fera la vîtefîe de ces deux mêmes rivières réu*
nies. lbid. b. Sentiment de M. Guillelmini fur cette vîteffe.
Expériences de MM. Dufoy & Varignon furies mouvemens
de deux liquides qui fe croifcnt. lbid. 858. a.
Confluent. Pourquoi un petit fleuve peut entrer daiis lin
grand fans en augmenter la largeur ni la profondeur. Un
fleuve qui entre dans un autre , félon une direétion peu
favorable au courant, eft infenfiblement détourné de cette
direâion. L’union de deux rivieres doit les foire coulerplùs
vite, d’où il arrive fouvent qu’elles occupent moins d’cfpace.
VI. 872. a.
CONFOLANS¿ « C o n fo u la n s , (Géogr.)petite viUe du
Poitou. Diverfes obfervations fur ce lieu. Savant diftingué
dont il eft la patrie. Suppl. II. 544. a.
CONFOÉGIEN, Y Géogr. j ’village dù Morvan en Bourgogne.
Seigneurs qui l’ont poflédé. Obfervations hiftoriquei
fur ce lieu. Suppl. II. 544. a.
CONFORMATION , ( Phyfiq. ) c’eft à la différente
conformation des* corps que les# newtoniens attribuent la
réflexion des différentes couleurs de la lumière. III. 8ç8. a.
C o n fo rm a t io n , (Médecin.) de l’exaôejufteffe quiregne
dans les proportions du corps’ humain. Examen des différentes
parties du corps, & de leurs proportions relatives. Suppl.
II. 544. b. Variations dans leur conformation. lbid. 543-
De ces différentes conformations , il n’en eft aucune qui
ne foit dans l’ordre de la nature par rapport aux autres parties
, & qui n’ait, avec ces mômes parties, une proportion
néceffaire. lbid. b. Ainfi la nature ayant gardé fes réglés, le
vifage le plus laid eft auffi parfait & régulier dans fon
efpece , que celui qui nous paroît le plus beau. — Il eft
vrai que la nature s’écarte quelquefois effentiellement des
réglés qu’elle femble fe preferire , & dès-lors il peut bien
en réfulter des difformités réelles. Différens fentimens des
Tartares, des Maures, des Chinois, &cî fur la beauté du corps.
lbid. 546. a. . ,
Conformation. Bonne 6c mauvaife conformation. Quatre
claffes de maladies produites par vice de conformation. La
première contient les maladies qui naiflent de la grandeur
difproportionnée de quelque partie. III. 858. a. La fécondé ,
celles qui procèdent de la mauvaife figure d’une partie. La
troifieme , celles qui confiftent dans le nombre extraordinaire
de certaines parties. La quatrième , celles qui viennent de
la fituation déplacée des parties. Autres maladies particulières
qu’on ne peut rapporter à aucune de ces claffes, rangées
ici fous fix chefs. Réflexion fur la cure de ces maladies Jbid. bu
C o n fo rm a t io n , ( Chirurg. ) art de rapprocher dans les
fraélures les bouts des os rompus , &c. IIl. 858. b. Après
avoir foit l’extenfion & la contre-extenfion nêdeffaires pour
remettre en place les os fraéturés , on doit procéder à la
conformation. Comment on peut la foire. Du degré de-
force qu’on doit employer pour agencer & replacer'lesos.
Comment on finit la cure quand la conformanon eft foite.
^CONFORMISTES * (non) leurs affemblées à Londres;
^CONFORMITÉ, rtjfemblanct. Rapports 8c différences entre
ces deux mots. III. 8ro. ¿.
CONFORTE-MAIN , (Junfpr.) lettres de conforte-*
main. Elles font demandées par un feigneur Féodal qui n’a
point de droit de juftice attaché à fon fief. Quelques-uns
prétendoient autrefois que le feigneur féodal avoit une
iuftice foncière, 8c qu’il n’avoit befoin de lettres de con-
forte-main, que pour fortifier fon propre mandement. III.
8«o. a. Claufe dont on ufoit dans les conforte-mains en Sain-
tonge. Remarque d’Imbert à ce fujet. Les lettres de conforte-
main ne font plus ufitées aujourd’hui. lbid. b.
CONFRAIRIE, ( Hifi. eccl. Jurifpr. ) diverfes confrairies
établies en l'honneur d’un myftere ou d’un feint. Elles ne
peuvent être établies fans le cônfentement de l’évêque. Des
biens des confrairies , deleuradminiftration, 8*« Chacun des
membres doit porter fa part des charges communes, 8c peut
fe retirer quand il veut. III. 859. b. _ 0
Confrairies établies en- différens lieux de la Grece, 8c qui
C C c c c.