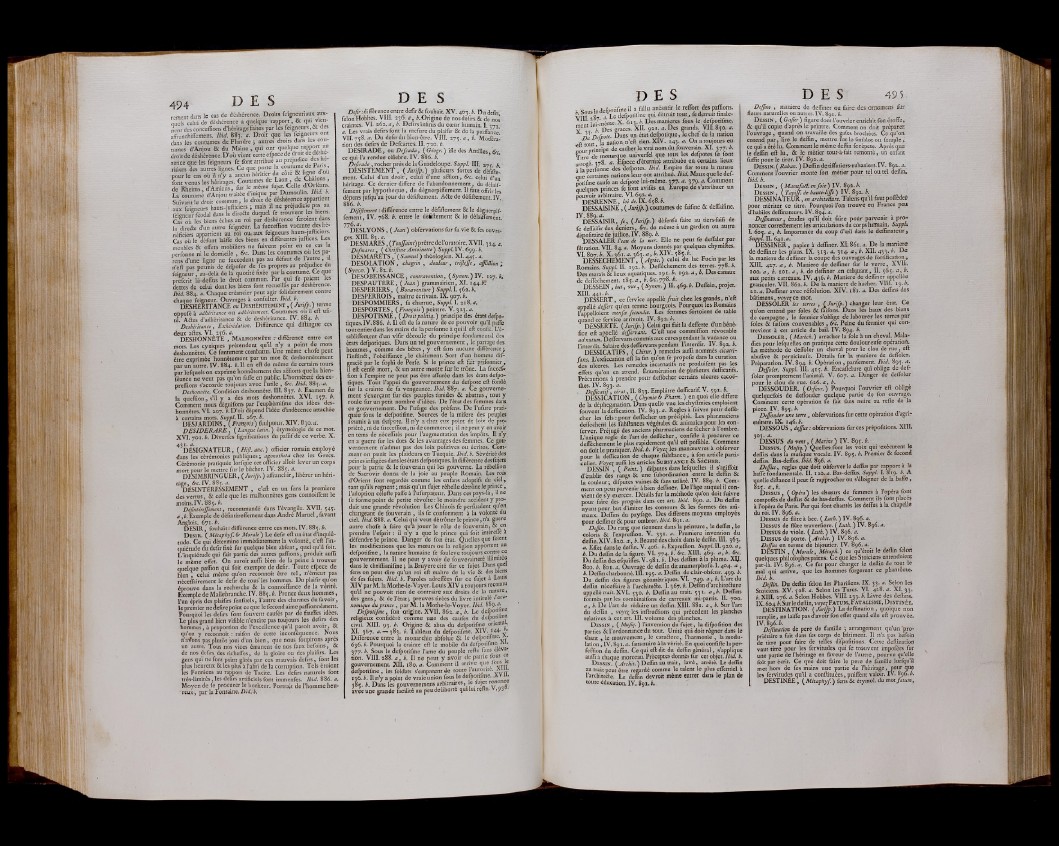
494 D E S
■ mem dans le cas de déshérence. Droits feigneuriaux aux- ,
quels celui de déshérence a quelque rapport, & qui viennent
des concevions d’héritage faites par les feigneurs,« des
affmnehiffemens. Ibid. 883. a. Droit que les feigneurs ont
dans les coutumes de Flandre ; autres droits dans les coutumes
d’Anjou & du Maine , qui onr quelque rapport au
droit de déshérence. D’où vient cette efpecc de droit de dèsne-
rence que les feigneurs fe font attribué au préjudice des i -
ritiers des autres6 lignes. Ce que porte la
pour le cas où il n’y a aucun hérmer du côte 8C Inmedou
font venus les héritages. Coutumes de Laon , de Chalons,
de Rheims, d’Amiens, fur le même fu(et. Celle dOriéans.
La coutume d’Aniou traitée d’imque par Dumoulin. Ibid. b.
Suivant le droit commun, le droit de déshérence appartient
aux feigneurs hauts-iuiliciers ; mats il ne préjudtcte pas au
feigneu? féodal dans la direflê duquel fe trouvent les biens.
'Cm où les biens échus au roi par déshérence ferment dans
la direâe d’un autre feigneur. La fucceffion vacante des bénéficie
« appartient au roi ou. aux feigneurs hauts-jufticicrs.
Cas où le défunt laiffe des biens en différentes juftices. Les
meubles 8c effets mobiliers ne fuivent point en ce cas la
«erfonne ni le domicUe , &c. Dans les coutumes ou les pa-
rens d’une ligne ne fuccedent pas au défaut de 1 autre, il
n’eft pas permis de difpofer de fes propres au préjudice du
feigneur , au-delà de là quotité fixée parla coutume. Ce que
preferit là-deffus le droit commun. Par qui fe paient les
dettes de celui dont les biens font recueillis par déshérence.
Ibid. 884. a. Chaque créancier peut agir folidairement contre
chaque feigneur. Ouvrages à confultcr. Ibid. b.
DESHÉRITANCE ou D e s h é r i t em e n t , ( Jurifp.) terme
oppoféà adhéritance ou adhéritement. Coutumes ou il eft uh-
té. Ailes d’adhéritance & de deshéritance. IV. 884. b.
Deshiritance, Exhérédation. Différence qui diflingue ces
deux ailes. V T .y ô . a.
DESHONNÊTE , M a lh o n n ê t e différence entre ces
mots. Les cyniques prétendent qu’il n’y a point de mots
deshonnêtes. Ce fcntiment combattu. Une même chofe peut
être exprimée honnêtement par un mot & deshonnêtement
par un autre. IV. 884. b. Il en eft de même de certains tou«
par lefquelson exprime honnêtement des a&ions que la bien-
féance ne veut pas qu’on faffe en public. L’honnêteté des ex-
preffions s’accorde toujours avec l’utile , Oc. Ibid. 885,.va.
Deshonnite. Condition deshonnête. III. 837. b. Examen de
la queftion, s’il y a des mots deshonnêtes. XVI. 157. b.
Comment nous déguifons par l’euphémifme des idées deshonnêtes.
VI. 107. b. D’où dépend l’idée d’indécence attachée
à certains mots. Suppl.11. 267. b. ’ r'
DESJARDINS, ( François) fculpteur.XIV. 830.fi.
DESIDERARE, ( Langue latin. ) étymologie de ce mot.
XVI. 701. b. Diverfes fignifications du palfif de ce verbe. X.
43DÉSIGNATEUR, ( Hift.anc.) officier romain employé
dans les cérémonies publiques; agonotheta chez les Grecs.
Cérémonie pratiquée lorfque cet officier alloit lever un corps
mort pour le mettre fur le bûcher. IV. 885. a.
DESIMBRINGUER, ( Jurifp. ) affranchir, libérer un héritage,
Oc. IV. 885. a.
JDÉSINTÉRESSEMENT , c’eft en un fens la première
des vertus, & celle que les malhonnêtes gens connoiffent le
moins. IV. 885. b.
Défintéreffement, recommandé dans 1 évangile. XVll. 345.
a, b. Exemple de défintéreiTement dans André Maruel, favant
Anglois. 671. b.
DESIR, fouhait : différence entre ces mots. IV. 883. b.
D é s i r . ( Métaphyf. 6* Morale ) Le defir eft un état d inquiétude.
Ce qui détermine immédiatement la volonté, c’eft l’inquiétude
au defir fixé fur quelque bien abfent, quel qu’il foit.
L’inquiétude qui fait partie des autres pallions, produit auffi
le même effet. On auroit auffi bien de la peine à trouver
quelque paffion qui foit exempte de defir. Toute efpece de
bien , celui même qu’on reconnoît être tel, n’émeut pas
néceffairement le defir de tous* les hommes. Du plaifir qu on
éprouve dans la recherche 8c la connoiffance de la vérité.
Exemple de Mallebranche. IV. 885. b. Prenez deux hommes.
l’un épris des plaifirs fenfuels, l’autre des charmes du favoir,
le premier ne defire point ce que le fécond aime paffionnément,
Pourquoi les defirs font fouvent caufés par de faillies idées.
Le plus grand bien vifible n’excite pas toujours les defirs des
hommes, à proportion de l’excellence qu’il paroît avoir, &
qu’on y reconnoît : raifon de cette inconléquencc. Nous
n’avons pasplutôt joui d’un bien, que nous {oupirons après
un autre. Tous nos vices émanent de nos faux befoins, &
de nos defirs des richefTcs, de la gloire ou des plaifirs. Les
gens qui ne font point gâtés par ces mauvais defirs, font les
{»lus heureux 8c les plus à l’abri de la corruption. Tels étoient
es Fenniens au rapport de Tacite. Les aefirs naturels font
très-limités, les defirs artificiels font immenfes. Ibid. 886. a,
Moyen de fe procurer le bonheur. Portrait de l’homme heu-
■ reux, par la Fontaine. Ibid. b.
D E S
Defir : différence entre defir & fouhait. XV. 403. b. Du defir
félon Hobbes. VIII. 236. a, ¿..Origine de nos defirs 8c de nos
craintes. VI. 262. a, b. Defirs infinis du coeur humain. 1. 1||§
Les vrais defirs font la mefere du plaifir 8c de la puiffance!
. il. 758. a. Du defir du bien-être, v III. 273. a , b. Modération
des defirs de Defcartes. II. 720. b.
D ESI RADE, ou Defcada, { Géogr. ) ifle des Antilles, &c.
ce qui l’a rendue célébré. IV. 886. b.
Defirade, rocherprès de la Guadeloupe. Suppl. III. f | f | m
DÉSISTEMENT, ( Jurifp.) plufieurs fortes de délifte-
ment. Celui d’un droit, celui d’une aftion, Oc. celui d’un
héritage. Ce dernier diffère de l’abandonnement, du délaif-
fement par hypothéqué, du déguerpiffement. Il faut offrir les
dépens jufqu au jour du défiftement. Afte de défiftemenr. IV.
b.
Défiftement : différence entre le défiftement 8c le déguerpif-
fement, IV. 768. b. entre le défiftement 8c le délaiffement.
776. a.
DESLYONS, ( Jean ) obfervations fur fa vie 8c fes ouvrages.
XIII. 83. a.
DESMARES, ( Toujfdini) prêtre de l’oratoire. XVII. 3 24. a.
Defimares, (ChrifiineAntoinette) Suppl.IV .699. b.
DESMARÊiS, ( Samuel) théologien. XI.445. a.
DESOLATION , chagrin , douleur , triftéjfe , affliQion ;
( Synon.) V. 82. b.
DESOBEISSANCE, contravention, {Synon.) IV. 127. bt
DESPAUTÉRE, {Jean) grammairien, XI. 144.#
DESPERIERS, ( Bonaventure ) Suppl. 1. 562. b.
DESPERROIS, maître écrivain. IX. 007. b.
DESPOMMIERS, fa charrue, Suppl. I. 218.4.
DESPORTES, {François) peintre. V .323.a.
DESPOTISME, ( Droit politiq. ) principe des états defpo-
tiques.IV.886. b. Il eft de fa nature ae ce pouvoir qu’il paffe
tout entier dans les mains de laperfotme à qui il eft confié. L’c-
tabliffement d’un vifir découle du principe fondamental des
états defpotiques. Dans un tel gouvernement, le partage des
hommes, comme des bêtes, y eft fans aucune différence;
l’iniHnét, l’obéiffance, le châtiment. Sort d’un homme disgracié
par le fophi de Perfe. Si le prince eft hit prifonnier,
il eft cenfé mort, 8c un autre monte fur le trône. La fuceef*
fion à l’empire ne peut pas être afTuréc dans les états defpotiques.
Tout l’appui du gouvernement du defpote eft fondé,
fur la crainte de fa vengeance. Ibid. 887. a. Ce gouvernement
s'exerçant fur des peuples timides 8c abattus,• tout y
roule fur un petit nombre d’idées. De l’état des femmes dans
ce gouvernement. De l’ufage des préfens. De l’ufure pratiquée
fous le defpotifme. Sources de la mifcrc des peuples,
fournis à un defpote. Il n’y a chez eux point de loix de propriété
, ni de fucceffion, ni de commerce ; il ne peut y en avoir
en tems de néceffités pour l’augmentation des impôts. Il n’y
guere fur les dots 8c les avantages des femmes. Ce gou-
ement n’admet pas des loix pofitives ou écrites. Com-
on punit les plaideurs en Turquie. Ibid.b. Sévérité des
s infligées dans les états defpotiques. Indifférence desfujets
en a
vernement
ment
pour la patrie 8c le fouverain qui les gouverne. La rébellion
de Sacrovir donna de la joie au peuple Romain. Les rois
d’Orient font regardés comme les entans adoptifs du ciel,
tant qu’ils régnent ; mais qu’un fujet rébelle détrône le prince,
l’adoption celefte paffe à l’ufurpateur. Dans ces pays-là, il ne
fe forme point de petite révolte : le moindre accident y produit
une grande révolution Les Chinois fe perfuadent qu’en
changeant de fouverain , ils fe conforment à la volonté du
ciel. Ibid. 888. a. Celui qui veut détrôner le prince, n’a guere
autre chofe à faire qu’à jouer le rôle de fouverain, 8c en
prendre l’efprit : il n’y a que le prince qui foit intéreffé à
défendre le prince. Danger de fon état. Quelles que foient
les modifications que les moeurs ou la religion apportent au
defpotifme, la nature humaine fe foulcVe toujours contre ce
gouvemëment. Il ne peut y avoir de fouveraineté illinutce
dans le chriftianifme ; la Bruyere cité fur ce fujet. Dans quel
fens on peut dire qu’un roi eft maître, de la vie 8c des biens
de fes fujets. Ibid. b. Paroles adreffées fur ce fujet à Louis
XIV par M. la Mothe-le-Vayer. Louis XIV a toujours reconnu
qu’il ne pouvoit rien de contraire aux droits de la nature,
des gens, 8c de l’état; preuves tirées du livre intitulé l'aco-
nomique du prince, par M. la Mothe-le-Voyer. Ibid. 889.4;
Defpotifme, fon origine. XVII. 862. a , b. Le defpotifme
religieux confidéré comme une des caufes du dcipotifm®
civil. Xffl. 93. b. Origine 8c abus du defpotifme ori<
iental,
XI. 367. <*. — 383. b. Tableau du defpotifme. XIV. I44-
Différence entre la monarchie abfolue 8c le defpotifme. A.
636. b. Pourquoi la crainte eft le mobile du defpotifme. X .
377. b. Sous le defpotifme l’ame du peuple refte fans élévation.
VIII. 288. a , b. Il ne peut y avoir de patrie fous c
gouvernement. XII. 180. a. Comment il arrive que 1 y itt
defpotifme, les foldats s’emparent de toute {autorité. X -
136. b. 11 n’y a point de vraie union fous le delpotiime. A *
•¿85. b. Dans les gouvememens arbitraires, le fujet r^j}° „
avec une grande facilité au peu de liberté qui lui rçfte. , 93
D E S D E S 4 9 5
i Sons le (lclîjorifme il anisntir le refforl des paffions.
vm îs-7 a Le defpotifme qui détruit tout, fe détruit finale-
v iu . 207. • ; Des maniérés fous, le: defpotiûne.
ment l u i - m e m c . - o r - ----- j- x r t f o__ .
X.
de cacher le vrai nom du Jouyerain. XI. 377. b.
V,tre de monarque univerfel que tous les defpotes le font
a r ro g é. 378. a. Efpece d’éternité attribuée en certains lieux
à la perfonne des defpotes. Ibid. Empire fur toute la nature
que certaines nations leur ont attribué. Ibid. Maux que le defpotifme
caufe au defpote lui-même. 377. a. 379. a. Comment
quelques princes fe font avifés en Europe de s’attribuer un
pouvoir arbitraire. VL 69,2. a.
DESRENNE, loide.lX.6.^6.b. n
DESSAISINE, ( Jurifp. ^ coutumes de faifine 8c deflamne.
^D^SAISIR, f e , {Jurifp.) défenfe faite au tiers-faifi de
fe deffaifir des deniers, &c. de même à un gardien ou autre-
dépositaire de juftice» IV. 889. b.
DESSALER Peau de la mer. Elle ne peut fe deffaler par
filtration. VII. 84. a. Moyens donnés par quelques chymiftes.
VI. 807. é. X .j6 i. a .j6 y a ,b . XIV. <85.b.
DESSECHEMENT, {Ame.) celui du lac Fucinparles
Romains. Suppl. II. 192. b. Defféchement des terres. 778. b.
Des marais oc lieux aquatiques. 191. b. 192. a , b. Des canaux
de defféchement. 183. a, b.&c.778. b.
DESSEIN, but, vue y {Synon.) II. 469.b. Deflein, projet.
XIII. 44i-*- „ . , ,
DESSERT, ce fervice appellé fruit chez les grands, neft
appellé deffert qu’en terme bourgeois. Pourquoi les Romains
fappelloient menfa fecunda. Les femmes fortoient de table
quand ce fervice arrivoit, IV. 892. b.
DESSERTE, {jurifp.) Celui qui fait la defferte d un bénéfice
eft appellé deffervant. C'eft une commiffion révocable
ad nutum. Déffervans commis aux cures pendant la vacance ou
l’interdit. Salaire des deffervans pendant l’interdit. IV. 892. b.
DESSICATIFS, ( Chirur. ) remedes auifi nommés cicatri-
fans. L’exficcation eft la fin qu’on fe propofe dans la curation
des ulcérés. Les remedes incarnatifs ne produifent pas les
effets qu’on en attend. Énumération de 'plufieurs deflicarifs.
Précautions à prendre pour deffécher certains ulcères cacoë-
thes. IV. 893, a.
V Deficatif, cérat, II. 833. Emplâtre deflicatif. V . 391. b.
DESSICATION, {Chymie & Pharm. ) en quoi elle différé
de la déphegmation. Dans quelle vue leschyftmies emploient
fouvent la déification. IV. 893. a. Réglés à fuivre pour deffécher
les fois : pour deffécher un précipité. Les pharmaciens
deffechent les fubftances végétales 8c animales pour les con-
forver. Préjugé des anciens pharmaciens de fécher à l’ombre.
L’unique réglé de l’art de deffécher, confifte à procurer ce
defféoiement le plus rapidement qu’il eft poffible. Comment
on doit le pratiquer./¿¿¿. b. Voyerles manoeuvres à obforver
pour la déification de chaque fubftance, à fon article particulier.
Voyez auifi les articles S u b s t a n c e 8c S e c h e r .
DESSIN , ( Peint.) difputcs dans lefquelles il s agiffoit
d’établir des rangs 8c une fubordination entre le deflin 8c
la couleur; difputes vaines 8c fans utilité. IV. 889. b. Comment
on peut parvenir à bien deifiner. De l’âge auquel il convient
de s’y exercer. Détails fur la méthode qu’on doit fuivre
pour faire des progrès dans cet art. Ibid. 890. a. Du deifin
ayant pour but d’imiter les contou« 8c les formes des animaux.
Deffins du payfage. Des différens moyens employés
pour deifiner 8c pour ombrer. Ibid. 891. a.
Deffin. Du rang que tiennent dans la peinture, le deifin, le
coloris 8c l’expreffion. V. 331. a. Première invention du
deifin.XIV. 820. a, b. Beauté des choix dans le deifin. III. 363,
a. Effet dans le deifin. V. 406. b. Expreflion. Suppl. IL 920. a
b. Du deifin de la figure. VI. 774. b. &c. XIII. 469. a, b.&c.
Du deifin des efquiiies. V. 98 x. b. Des deffins à la plume. XIJ.
800. b. 801. d. ôuvrage de deffin dit anamorphofe. 1.404. a .
b. Deffin charbonné. UuL 193. a. Deffin de clair-obfcur. 499. b.
Du deifin des figures géométriques. VI. 749. a, b. L’art du
deffin néceffaire a l’arcnitefte. I. 367. ¿. Deffin d’architefture
appellé trait. XVI. 330. b. Deffin au trait. 331. £ , b. Deffins
formés par les combinaifons de carreaux mi-partis. II. 700.
a y b. De l’art de réduire un deffin. XIII. 881. a, b. Sur l’art
du deffin , voye[ les inftru&ions qui précèdent les planches
relatives à cet art. III. volume des planches.
D e s s in , ( Mufiq. ) l’invention du fujet, la difpofition des
parties 8c l’ordonnance du tout. Unité qui doit régner dans le
chant , le mouvement, le caraétcre, 1 harmonie , la modulation
, IV. 891. a. fans nuire à la vérité. En quoi confifte la per-
feétion du deffin. Ce qui eft dit du deffin général, s’applique
auffi à chaque morceau. Préceptes donnés for cet objet. Ibid. b.
D e s s in . {Archit.) Deffin au trait, lavé, arrêté. Le deffin
au trait peut être regardé comme le talent le plus effentiel à
l’architeûc. Le deffin devroit même entrer dans le plan de
toute éducation. IV. 891. b.
Deffins y maniéré de deifiner ou faire des ornemens fur
fieu« naturelles ou autres. IV-. 891. b.
D e s s in , ( Gafier ) figure dont l’ouvrier enrichit fon étoffe*
8c qu’il copie d’après le peintre. Comment on doit préparer,
l’ouvrage, quand on travaille des gaies brochées. Ce qu’oa
entend par, lire le deffin, mettre for le fimblot ou fomple,
ce qui à été lu. Comment le même deifin fe répète. Après que
le deifin eft lu, 8c le métier tout-à-fait remonté, un enfant
fuffit pour le tirer. IV. 892. a.
Dessin. {Ruban. ) Deifin deriffutiers-rubaniers.IV. 892. a.
Comment l’ouvrier monte fon métier pour tel ou tel deffin.
Ibid. b.
D e s s in , {Manufafl.cnfoie) IV. 892. k
D e s s in , ( Tapiifl de haute-liffi) IV. 892. b.
DESSINATEUR * en architeflure. Talens qu’il faut pofféde*
ponr mériter ce titre. Pourquoi l’on trouve en France peu
d’habiles deifinateurs. IV. 894. a.
Deffinateur y études qu’il doit faire poür parvenir à pro»
noncer correôement les articulations du corps humain. SuppL
603. a t b. Importance du coup d’oeil dans le deffinateur,
Suppl. II. 641. a.
DESSINER, papier à deifiner. XI. 861. a. De la maniéré
de deifiner les plans. IX. 313. a. 314. a , b. XII. 433. b. De
la maniéré de deifiner la coupe des ouvrages de fortification,
XIIL 427. a y b. Maniéré de deifiner fur le verre, XVII.
100. a y b. xox. a , b. de deifiner -en calquant, II. 363. a y b.
aux petits carreaux. IV. 436. b. Maniéré de deifiner appellée
graticuler. VII. 862. b. De la maniéré de hacher. Vlll. 19. b,
21» a. Deifiner avec réfoludon. XIV. 181. a. Des deffins des
bâtimens, voyez ce mot.
DESSOLER Us terres , ( Jurifp.) changer leur état. Ce
qu’on entend par foies 8c iaifons. Dans les baux des biens
de campagne, le fermier s’oblige de labourer les terres par
foies 8c faifons convenables, &c. Peine du fermier qui contrevient
à cet article du bail. IV. 894. b.
D è s s o l e r , ( Maréch. ) arracher la foie à un cheval. Maladies
pour lefquelles on pratique cette douloureufe opération.
La méthode de deffoler un cheval pour le clou de rue, eft
abufive 8c pernicieufe. Détails fur la maniéré de deffoler.
Préparation. IV. 894. b. Opération, panfoment. Ibid. 893. a.
DeffoUr. Suppl. III. 413. b. Encaftelure qui oblige de deffoler
promptement l’animal. V. 607. a. Danger dé deffoler
pour le clou de rue. 626. at b.
DESSOUDER. (Orfevr.) Pourquoi l’ouvrier eft obligé
quelquefois de deffouder quelque partie de fon ouvrage.
Comment cette opération fe fait fans nuire au refte de la
piece. IV. 893. b. . « •
Deffouder une terre, obfervations fur cette opération d agre
culture. IX. 146. ¿.
DESSOUS, dejfus: obfervations fur ces prépofitions. XIIL
De ssu s du venty (Marine) IV. 893.
D e s su s . {Mufiq.) Quelles^font les voix qui exécutent te
deffus dans la muuque vocale. IV. 893. b. Premier 8c fécond
deflùs. Bas-deffus. Ibid. 896. a.
Dejfus y réglés que doit obferver le deffus par rapport à la
baffe fondamentale. II. tdo.a. Bas-deffus. Suppl. I. 819. b. A
quelle diftance il peut fe rapprocher ou s’éloigner de la baffe,
§23. - , « r
D e s su s , f Opéra ) les choeurs de femmes à 1 opéra font
compofés de deifus 8c de bas-deffus. Comment ils font placés
à l’opéra de Paris. Par qui font chantés les deffus à la chapelle
du roi. IV. 896. a.
D e s su s de flûte à bec. ( Luth. ) IV. 896. a.
D e s su s de flûte traverfiere. ( Luth. ) IV. 896. a.
D e s s u s de viole. (Luth.) Iv . 896. a.
D e s su s de porte. ( Archit. ) IV. 896. a.
Dejfus en terme de bijoutier. IV. 896.4. r . .
DESTIN , ( MoraU, Métaph.) ce qu’étoit le deftin félon
quelques philofophes païens. Ce que les Stoïciens entendoient
par-là. I p 896. a. Ce fut pçur charger te deftin de tout le
mal qui arrive, que tes nommes forgèrent ce phantôme.
Ibid. b. .
Deftin. Du deftin félon tes Pharifiens,IX. 33.a. Selon tes
Stoïciens. XV. 328. a. Selon tes Turcs. VI. 428. a. XI. 33.
b. XIII. 276.4. Selon Hobbes. VIII. 233. b. Livre des deftins.
IX. 604. ¿.Sur 1e deflin, vûyrç F a tum , F a t a l i sm e , D e s t in é e .
DESTINATION. {Jurifp.) Ladeftination, quoique noil
remplie, ne laiffe pas d’avoir fon effet quand elle eft prouvée.
IV. 896. b.
Deftination de pere de famille ; arrangement qu’un ‘propriétaire
a fait dans fes corps de bâtiment. Il n’a pas befoin
de titre pour foire de telles difpofitions. Cette deftination
vaut titre pour les fervitudes qui fe trouvent impofées for
une partie de l’héritage en faveur de l’autre, pourvu qu’elle
foit par écrit. Ce que doit foire le pere de famille lorfqy’il
met hors de fes mains une partie de l’héritage, pour quç
les fervitudes qu’il a conltituées, puiffent valoir. IV. 896. b.
DESTINÉE, {Métaphyf.) fens 8c étymol. du mot fatum,