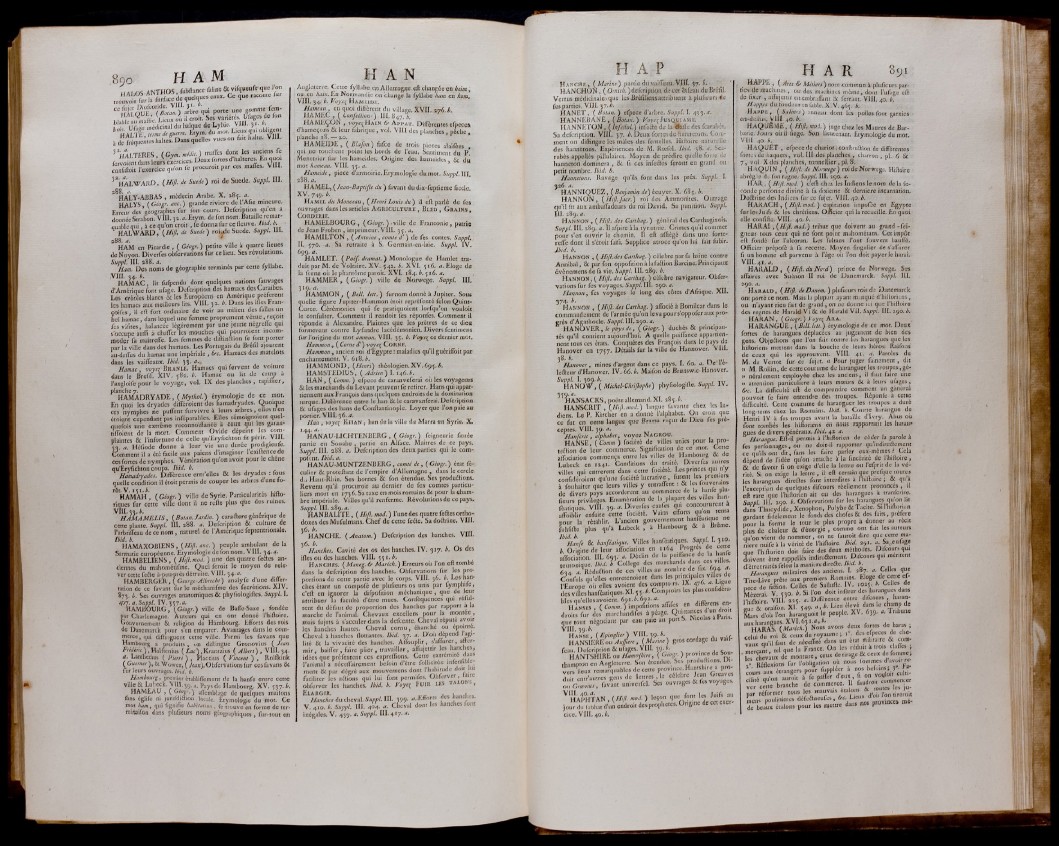
H A M
h a r / ) S A N TH O S , fulMlance fallne 8c vifqucu.fc’ quel'on
S r i , W m de quelques eau*. C e que raconte fur
trouvoit fur M V t ' , /,
I V tir,™ médicinal du laïque de Lybic. VIII. 3 - “ •
* H A L t | " ¿ y - - du i l« .L i e u * q iu obtemn
vue» OU fait Julie. VIII.
5 HALTERES , (G ym . m ld k .) martes dont le» ancien» fe
fervoiimt dan» leur» « e r c ic e , lieu« *> « « d'hal^reiu En ^ o .
confiûoit l’exercice qu’on fe procura« par ce» marte». VIII.
32H A LW A R D , (O l f t . de S u td e ) roi de Suède. Suppl. III.
^ H A L Y -A B B A S , médecin Arabe. X . 285. a.
HALYS C c W . anc. ) grande rivière de l’A fic mineure.
Erreur des géographes fur Ion cour». Dcfcription qu en a
donnée Strabon. VIII. 31. a. E tym. de fou nom. B a t a i l le remarquable
q u i, it ce qu’on c r o i t , fe donna fur ce fleuve. ¡but. b.
H A L w A R D , & ß iß . de S u t d i ) r o i j c Suède. Suppl. Ul.
»811. a. .
HAM en Picardie, ( .G lo e r . ) petite v ille it quatre lieue»
de Noyoïi, Divcrfe» obfervatton» fur ce lieu. Se» révolution».
Suppl. III. »88. a. . h 1
Hum. De» nom» de géographie terminé» par cette fyllabe.
VIII. 34. b. ,
H A M A C , lit fufpcndu dont quelque» nation» fauvage»
d’Amérique font ufage. Dcfcription des hamac» de» Caraïbe».
Le» créole» blanc» & le» Européen» en Amérique préfèrent
le» hamac» aux meilleurs lit». V I I I . 3». b. Dan» les ifle» Fran-
çoife», il crt fort ordinaire de vo ir au milieu des lalle» un
bel hamac, dan» lequel une femme proprement v e tu c , reçoit
fe» vifite», balancée légèrement par une |eune négrcflc qui
»’occupe atifli à charter le» mouche* qui pourraient mcom-
moder fa maitreffe. Les femmes de diftinttion fe font porter
par la ville dan» de* hamac». Le» Portugal» du Bréfll ajoutent
au'dcflus du hamac une impériale, b c . Hamacs des matelots
dans les vaifleaux. lb id . 33. //..
Hamac voyez B r a n l e . Hamacs qui fervent de voiture
dans le Brefii. X IV . I f g j b. Hamac ou lit de camp a
l’angloife poür le v o y a g e , v o l. IX des planches, tapuiicr,
planche 7 . . , - ' , \
H A M A D R Y A D E , ( M y th o l. ) étymologie de ce mot.
En quoi les dryades différoient de» hamadryades. Qu oiqu e
ces nymphe» ne puffent furv iv re à leurs arbres, elles n en
étoient cependant pas inféparablcs. Elles témoignoieiu quelquefois
une extrême reconnoiflance à ceux qui les garan-
tiftbicnt de la mort. C om m e n t O v id e dépeint les complaintes
ÔC l’infortune de celle qu Lryfichton ht périr. VIII.
31. a. Héfiodc donne à leur v ie une durée prodigieufc.
Comment il a été facile aux païens d’imaginer Icx iftch c cd c
ces fortes de nymphes. Vénération qu on avoit pour le cnene
qu’Eryfichton coupa, lbid . b. r
Hamadryades. Différence entr’ellcs 6c les dryades : fous
quelle condition il étoit permis de couper les arbres d une ro-
TÉ H AM ^H , ( Géogr. ) v ille de Sy r ie. Particularités hifto-
ricjues fur cette v ille dont il ne refte plus qüc des ruines.
H a I iÀ M E L I S , (B o lu n . Jardin. ) «traitera générique de
cette plante. Suppl. 111. a88. e . Dcfcription & culture de
l’arbriffeau de c e n om , naturel de l’Amérique fcptcntnonalc.
Ibid. b. , .
H AM A X O B IE N S , {H i ß . anc. ) peuple ambulant d e là
Sarmatie européenne. Etymologie de fon nom. V I I I . 34* 4*
H AM B E LIENS, ( H ifl. mod. ) une des quatre fettes anciennes
du mahométifme. Q u e l feroit le m o y en de rclc*
v er cette fette à-peu-près détruite. V I I I . 34. a.
HAMBERGLtt,, ( George-Albrccht ) analyfe d’une differ-
tation de ce favant fur le méchanifme des fecrétions. X IV .
873. L. Scs ouvrages anatomiques Ôc phyfiologiftcs. Suppl. I.
407. a. Suppl. IV . 357.a .
H AM B O U R G , (G éo g r .) ville de Baffe-Saxe , fondée
p'ar Charlcmagne. Auteurs qui en ont donné l’hiftoire.
Gouvernement 8c religion de Hambourg. Efforts des rois
de Dancmarck pour s en emparer. Avantages dans le commerce
, qui diftmguent cette ville . Parmi les favans que
Hambourg a produits, un dif lingue Gronovius ( Jean
Frédéric ) |Holitenius ( L u c ) , Krantzius ( Albert ) , V I I I . 34.
a . Lambceius ( Purré ) , Placcius ( Vincent ) , R o lfkw k
( Guerrier ) , tk W ower, ( /r<j/ï). Obfcrvationsfur ces favans 6c
fur leurs ouvrages, lbid. b.
Hambourg, premier établiffement de la hanfe entre cette
ville 6c Lübeck. V 111.39. a. Pays de Hambourg. X V . 537. b.
HAMEAU , Ç v g f # ) affemblage de quelques mailons
fans églife ni uirifdiftton locale. Etymologie du mot. Ce
mot ham, qui lignine habitation, <c trouve eu forme de ter*
minjifon dan» plufieur» nom» géographique», fur-tout en
H A N
Angleterre, Ce tte fyllabe en A llemagne eft changée en h eim ,
ou eu haut. En Normandie 011 change la fyllabe ham en hom.
VIII. 34; b. V o y c [ Ham l id i ;.
Hameau , en quoi différent du village. X V I I . 176 . b.
H A M E C , ( Confetlion- ) 111. 847, b.
H AM E Ç O N , voyrç H Ain & A p p â t . Différentes efpcccs,
d’hameçons 6c leur fabrique, v o l. V I I I des planches, pêch e,
planche 18. — ao,
H AM E ID E , ( B la fo n ) fafec de trois pièces alaifées »
qui n e touchent point les bords de l’eau. .Sentiment du P.
Mcnetricr fur les hameides. Origine des lianicidc», & du
mot hameau. V l l l . 35. a.
Hameide, pièce d’armoiric. E tymologie du mot. Suppl. III.
2.88. a.
H AME L, ( Jean-Baptifle du ) favant du dix-fcpticme ficclc.
X V . 749. b.
H am v .l du Moncea u , ( Henri Louis du ) il eft parlé de fes
ouvrages dans les articles A g r ic u l t u r e , B led , G r a in s ,
C o rd e r ie ,
H AM E L B O U R G , ( Géogr. 'j ■ v ille de Franconic, patrie
de Jean F ro b cn , imprimeur. V l l l , 3 c. a.
H AM IL TO N , (A n to in e y comte a ) de fes contes. Suppl,
II. 570. a. Sa retraite à S. Gcrmain-en-laie. Suppl. IV .
699. a.
H AM L E T . ( P o é f. dramat. ) Monologue de Hamlet traduit
par M. de Voltaire. X V . 54a. b. X V I . 316. //.Eloge de
la feenje où lcphantômepatoit. X V I . 184. b. 516. a.
H A M M E R , ( Géogr. ) v ille de Norwcge. Suppl. III.
3 " I î a m m o n , ( B e ll. leu . ) furnom donné à Jupiter. Sous
quelle figure Jupiter-Hammon étoit repréfenté félon Quint-
Curce. cérémonie s qui fe pratiquoient lorfqu’on vouloie
le confulter. Comment il rendoit fes réponfes. Comment il
répondit à Alexandre. Plaintes que les prêtres de ce dieu
formèrent contre Lyfandrc lacéoémonicn. D iv er s fentimens
fur l’origine du mot amrnon. VIII. 35. b. V o y t{ ce dernier mot.
Harnmon, ( Corne d ") voyc{ C o r n e .
Hammon, ancien roi d’E gypte : maladies qu’il guériffoit par
enchantement. V . 618. b.
H A M M O N D , (H e n r i) théologien. X V .693. é.
H AM S T E D IU S , ( Adrien ) 1. 146. b.
H A N , ( Lu mm. ) cfpecc de caranvefcrai oh les voyageurs
6c les marchands du Levant peuvent fe retirer. Hans qui appartiennent
aux François dans quelques endroits de la domination
turque. Différence entre le han 6clccaravanfcrai.Dcfcri|)tion
6c ufages des hans de Conffantinople. L o y e r que l’on paie au*
portier. V I I I . 3 6 . a.
H a n , v o y t{ K h a n , han de la v ille de Marra en Syrie. X .
144. a.
H A N A U -L 1CH T EN B E R G , ( Géogr. ) feigneurie fituée
partie en Souabc , partie en A lfa cc. Maîtres de ce pays.
Su po l. III. 288. a . Dcfcription des deux parties qui le com-
poicnt. lbid . a.
H A N A U -M U N T Z E N B E R G , comté d e , (G é o g r .) état fé-
culier 6c proteftant de l’empire d’A llemagne , dans le cercle
du Haut-kliin. Ses bornes 6c fon étendue. Scs produttions.
Revenu qu’il procuroit au dernier de fes comtes particuliers
mort en 1736. Sa taxe en mots romains 6c pour la chambre
impériale. V ille s qu’il renferme. Révolutions de ce pays.
Suppl. I II. 289. a.
H A N B A L IT E , ( H ifl. mod. ) l’une des quatre fettes orthodoxes
des Mufulmans. C h e f de cette fette. Sa doftrinc. VIII.
3Ô. b• „
H A N CH E . (A n a tom . ) Dcfcription des hanches. VIII.
3 6 . b, ,
Hanches. Ca vité des os des hanches. IV . 3 17 . b. O s des
tflcs ou des hanches. V I I I . 331. b.
H an ch e s . (M a n cg . (/ Ma r éch.) Erreurs où l’on eu tombé
dans la dcfcription des hanches. Obfcrvations fur les proportions
de cette partié avec le corps. VIII. 3C. b. Les han*
cites étant un compofé de plufteurs os unis par fymphtfc,
c’cft en ignorer la difpofttion méchanique, que de leur
attribuer la faculté d’étre mues. Conféqucnccs qui réful-
tent du défaut de proportion des hanches par rapport «1 la
marche de l’animal. Chevaux cxccllcns pour la m o n té e ,
mais fuiers à s’acculer dans la defeente. Cheva l répute avoir
les hanches hautes. Cheva l co rn u , éhanihé ou épomre.
Ch e va l à hanches flottantes. lbid . 37. a. D'où dépend 1 agilité
6c la v ivacité des hanches. A ffou plir, t> affurer, afferm
ir , baiffer, faire p lie r , tra vailler, affujettir les hanches,
idées que préfentent ces exprefftons. Ce tte extrémité dan*
l’animal a néccffaircment befoin d’étre follicitce infcnno t -
ment 6c par dégré aux mouvemens dont 1 habitude d o i t tu
faciliter les attions qui lui font permife». O b fc rv e r , rairc
obferver les hanches, lbid . b. Voy c{ F u ir les - »
E l a r g ir . . u— l—
Hanches du cheval. Suppl. 111. 399. //.’Efforts
V . 410. b. Suppl. 111. 404. a. Cheval don» te» hanche» font
inégales. V . 439. a, Suppl. III. 417- u,
H A P
H a n c h e » (M a r in e ) partie du.vaiffeau.VJÏÎ. 37. é,
M A N CH O N , ( Orn'tth. ) dcfcription. de cet frifeau du Bréfll.
Vertus médicinales que les Bréûliensattribuent àplulieursde
fes parties, VIII. 37* v.
H AN E T , ( Botan. ) cfpecc d’arbre. Suppl. t. 43 3. <z.
H A N N E B A N E , (B o ta n . ) V o y c ç JusquiaME.
H A N N E T O N , ( In fe iîo l.) infette de l a d e s f e a r a b é s .
Sa dcfcription. VIII. 37. b. Deux fortes de hannetons. Comment
on diffingue les mâles des femelles. Hiltoirc naturelle
des ltannctons. Expériences de M. Kccfei. IbiiL 38. //. Sca-
rabés appellés pillulaircs. Moyen de prédire quelle forte de
hanneton dominera, 6c fi ces infette» feront en grand ou
petit nombre. Ibid. b.
Hannetons. Ravage qu’ils font dans les prés. Suppl. 1.
3,26 a.
H A N N IQ U E Z , ( Benjamin d e ) écuyer. X . 683. b.
H A N N O N , ( H ijl.J a c r .) roi des Ammonites. Outrage
qu’ il fit aux ambaffadeurs du rot David. Sa punition. Suppl.
U L 289. a. r
H a n n o n , ( H iß . des Cariftag. ) général des Carthaginois.
Suppl. LIE 289. a. Il afpirc à la tyrannie. Crime» qu'il commet |
pour »’en ouvrir le clicmin. il eft afftégé dans une forte- I
reffe dont il s’étoit faifi. Supplice atroce qu’on lui fait fubir.
J bid . b. >t
H an n o n , (H i f l . des Carthag.) célébré par fa haine contre
A n n ib al, ôc par fon oppofitionâlafattionBarcinc.Principaux
événemens de fa vie. Suppl. III. 289. b.
Ha n n o n , ( H iß . des C ar thag .) célèbre navigateur. Obfcr-
vation» fur fes voyage». Suppl. III. 290. a.
H a n n on , fes voyage» le long des côtes d’Afrique. XII.
374. b.
Ha n n o n , (H i fl. des Carthag. ) affocié à Bomilcar dans le
commandement de l’armée qu’on leva pour s’oppofer aux progrès
d’Agnthocle. Suppl. IIL290. a.
H A N O V E R , le pays d e , ( Ç é o g r . ) duché» 8c principautés
qu’il contient aujourd’hui. A quelle puiffance appartiennent
tou» ces état». Conquêtes de» François dans le pays de
Hanover en 1737* Détail» fur la ville de Hannover. VIII.
H a n o v e r , mines d’argent dans ce pays. I. 60. a. D e l’é-
Ictteur d’Hanover. IV . 66. b. Mai fon de Brunswic-Hanover.
“Ô aN Ü 3« ? ’ ( Michtl-Chrïflophe) pliyfiologiftc. Suppl. IV .
3 39. d.
H A N S A C K S , poëtc allemand. X I. 283.b.
H A N SC R IT , (H i f l . mod.) langue fa vante chez les Indiens.
Le P. Kircher en a donné l’alphabet. On croit que
c e fut en cette langue que Brama reçut de Dieu fes préceptes.
V I I I . 39. a.
Han fe r u , alphabet, v o y e z NAGROU.
H A N S E , (C o r nm ) fociété de villes unies pour la pro-
teftion de leur commerce. Signification de c e mot. Cette
affociation commença entre les villes de Hambourg 6c de
Lübeck en 1241. Conditions du traité. Diverfes autres
ville» qui en trèrent dan» cette fociété. Le s princes qui 11 y
confidéroiem qu’une fociété lucrative , forant te» premier,
à fouhaiter que leur» ville» y entraient : & le»
,1c diver» pays accordèrent au commerce de la hante pin
fleurs privUcgc». Enumération de la plupart des villes han-
féiitinue*. V U l. 39. u. Divcrfe» (califes qui concoururent a
artoiblir enfuite cette fociété. Vain»
pour la rétablir. L ’ancien gouvernement han»atltme ne
fubfifte plus qu’i L ü b e c k , it Hambourg & | Brème.
J i ‘H a à j î & Villes hanféatique». Suppl. I. 310.
b. Origine de leur affociatian en 1164 rtrogrè» de cette
affociation. 111. «93- a. Déelin de la puiflànce de la hanfe
teutonique. Ibid. b College des marcharid« dan» ce» villes.
Î3 4 . a iUduflion de ce» ville» au nombre de fi*. «94. a.
A n f o l t qu’elle, entretenoient dan» le» W l> a t e » ville» de
l’Europe où elle» avoicnt de» compto r». IX. 476. e. Lieue
de» ville* hanféatique». X I. 5 y. b. Comptoirs tes plu» confidéra
hic» qu’elle» avoicnt. 691. te 691. a. Jifféren» cn-
H a n s e s , ( Cotnm. ) impofition» affile» en dilttrcn» en
droit» fur de» marehandife» 4 péage.
que tour négociant par eau paie au portS. Nicala» »Parts,
VIII. 39 .b.
H a n s e , (E p in g lie r ) V I I I . 3 9 * , » •/•
HANSIEKEoti Aujftere, ( Ma r ine) gros cordage du vaif-
feau. Dcfcription & ufage». V III. 39. b.___________
ou « r a v ie ! ; favant univcrfel. Se» ouvrage»Ht fe»voyage».
V IH a I ° IT A N , ( H ' ß ) leçon que font le*
jour du fiibbar d’un endroit des prophète». Origine de cet exe -
cite . V I I I . 40. b.
H A R 891
f , ( A n s & Mé tier s) nom comm un à plufieur» parne*
» de mach hic» , ou des machin es même, dont l’ufiige eft
de- fixer , iiffujcitir enembr.iffmt 6c ferrimi, VIII. 40. b.
H tp p e s du fond/nr en fable, X i V. 463. b.
H a rp e , t Sr i fines ) anneau dont ics poiles fout garnies
en-dcii'ti>». V 111 40. b.
HAQUÊM.E , C H if l. m od .) juge chez les Maures de Barbarie
Jour» où il liege. Son lieutenant. Etymologie du mot.
V l l l 40,;//, 7 b
H A Q U E T , cfpecc de chariot ; conftruttion de différentes
i forte» de baquets, vol. 111 des planches, charron, pl. 6 ôc
7 , vol X des planches, tonne Hier, pl. 8,
H A Q U 1N , ( H ifl. de Norwcge ) roi de N o rvè g e, Hiftoirc
s abrégée de fon regne, Suppl. 111. 290. a.
H A R , ( Hifl. mod. ) c efi- chez les Indiens le nom de la feconde
perfonne divine à fa dixième & derniere incarnation.
Dottrine de» Indien» fur ce fujet. VUE 4o h.
H A K A C H , ( H ifl. mod. ) capitation irnpofée en Egypte
fur le» Juifs 6c les chrétiens. Omcier qui la recueille. En quoi
elle confifte, VUE 40. b.
H A R A I , (H iß . mod.) tribut que doivent au grand -fei-
gneur tous ceux qui ne font point mahométans. C e t impôt
eft fondé fur l’alcpran. Les fuirait» l’ont fottvent hauffé.
Officier prépofé à fa recette. Moyen finenlier de s’affnrer
fi un homme eft parvenu à l’âge où l’on doit payer le barai.
V l l l . 41.*/.
H A R A L D , (H i f l . du N o r d ) prince de Norwcge. Ses
affaires avec Suénon 11 roi de Dancmarck. Suppl. 111.
j 290. a. '
H a r a l d , (H i f l . dcDanem. ) plufteurs rois de Dancmarck
ont porté ce nom. Mais l.i plupart ayant manqué d’h ifloritns, j ou n’ayant rien fait de grand, on ne donne ici que l’hiftoire
des régnés de Harald V t 6c de Harald \ l \ . Suppl. 111. 290. b.
HA Î<AN, f Géogr. ) Foye/ A r a .
H A R A N G U E , (B e l l. le u ! ) étymologie de c e mot. Deux
fortes de harangues déplacées au jugement de bien des
gens. Objcttions que l’on fait courte les harangue» que les
niftoricn» mettent dan» la bouche de leur» héros: Iuifons
de ceux qui les approuvent. V ll l. 41. a. Paroles de
M. de Vcrtot fur ce fujet. « Pour juger fainement, dit
» M- Rolliti, de cette coutume de haranguer les troupes, gé-
» néralemcnt employée chez les anciens, il faut faire une
» attention particulière à leurs moeurs 6c à leurs ufages,
b c . La difficulté eft de comprendre comment un général
pouvoit fe faire entendre des troupes. Réponfe à cette
difficulté. Cette coutume de haranguer les troupe» a duré
long-tcim chez les Romain», lbid. h. Courte harangue do
Henri IV à fe# troupes avant la bataille d’ iv r y . Abus ou
font tom b és le s hiftoriens en nous rapportant les harangues
de divers généraux. Ibid. 42 a. . . . . .
Harangue. Eft-il permis à l’iurtoricn d e c éd e r la parole à
fes personnages, ou ne doit-il rapporter qu’indircélcmcne
ce qu’il» ont dit, fans les faire parler eux-mémes ? Cela
dépend de l’idée qu’on attache à i a ftncérite de 1 hiftoirc,
8c de favoir fi on exige d’elle la lettre ou l’cfprit de la v é rité.
Si on exige la le tt re , il eft certain que prcfque toute»
les harangues dirette» font interdites à 1 hiftoirc; 8c q u à
l'exception de quelques difeours réellement prononcés , il
eft rare ique l’hiftortcn ait eu de» harangues à tranfcrtre.
Suppl. II I. 290. b. Obfcrvations fur les harangues qu on ht
dan» Thucydide, Xcnophon, Polybe & Tacite. Si lh.ftorien
cardant fidèlement le fond» de» choie» 8c de» fous, préfère
pour la forme le tour te pliis propre S donner au récit
plus de chaleur 6c d’én e rg ie, comme ont fait les auteurs
au'on vient de nommer, on ne fauroit dire que cette maniere
nuife à la vérité de l’hiftoirc. lbid. 201. a .S » 0c ufage
que l'h.ftorien doit faire des deux méthodes. Difcoursqui
rloivent èrre rappellé» ¡»dlretomeoL Dlfcour. qui méritent
d’étre traité» félon la maniere direfle. lbid. b.
H a nm a la militaire* de» ancien». I. aSy. a. Lellc» que
T iic -L iv e prête au* premier» Romain». Eloge de cene cf-
nccc de fiction. Celle» de Salluftc. IV . 10 « . b. C e lle, de
Llérarai. v . 530. b. Si l’on doit inférer de» harangue» dan»
l'hiftoirc V l l l . a i t . a. Différence entre difeour» , barant
e 8c oraifon. XI. 349- Ë l Liei. a w é dan. le champ dc
.dar» d'où l’on haranguoit 1c peuple. X V . 63Î). | Irmune
al,H A N o ’u» avon» deti* forte» de haras ;
celui du roi 8c ceux du royaume ; 1 H ;|SlÉ;âi 1 Â. de»i cffpefcei« dde »clrie;- ' S c r a S de monture| ceux de tirage 8c ceux de fomnte;
“ Réflexion, fur l’obligation ou non.
‘ T é o T o n ‘ S ‘ àP f ë rp.rt5? ff«u* X o f ï Z t i m
" e S e b r a S de eSm m e« . Il f o n d r a i . g g g l
par réformer M tirerait
...en»: poul uiere. dèfeûueufe», fo: .h , c u * lou ^
de beaux étalons pour le» mcitrc oan» w y