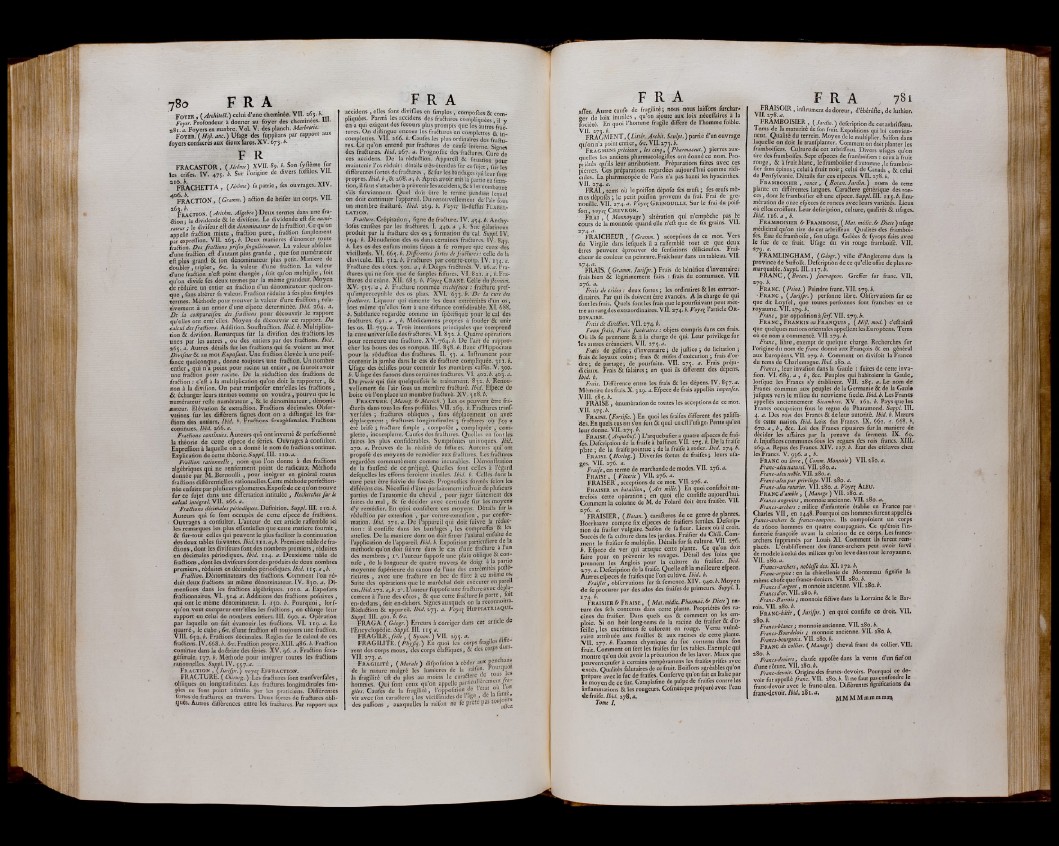
780 F R A
F o y e r , ( ArchittB. ) celui d’une cheminée. VII. 263. b.
Foyer. Profondeur, à donner au foy er des cheminées, lll .
281. a. Foyers en marbre. V o l. V . des planch. Marbrerie.
F o yer .(H i f i.a n c .) Ufage des fupplians par rapport aux
foy ers conucrés aux dieux lares. X V . 673. b.
F R
F R A C A S T O R , ( Jérôme) XVII. 89. h Son fyftômefjir
les crifes. IV . 475. b. Sur l’ongmc de divers foifiles. VII.
F R A C H E T T A , (Jérôme) fa patrie, fes ouvrages. XIV.
^ F R A C T IO N , ( Gramm. ) aélion de brifer im corps. VII.
F r a c t i o n . ( Arithm. Algèbre) Deux termes dans une fraélion
• le dividende 8c le divifeur. Le dividende eft dit numérateur
; le divifeur eft dit dénominateur de la fraélion. Ce qu’on
appelle fraélion mixte , fraélion pure, fraérion funplement
par expreïïion. VII. 263. b. Deux maniérés d’énoncer toute
fraélion. De s /rallions prifes finguliérement. La valeur abfoluc
d’une fraélion eft d’autant plus grande , que fon numérateur
eft plus grand 8c fon dénominateur plus petit. Manière de
, doubler, tripler, & c . la valeur d'une fraéliôn. La valeur
3u’on d’une fraélion n’eft point changée, foit qu’on multiplie , foit divife fes deux termes par la même .grandeur. M oyen
e réduire un entier en fraélion d’un dénominateur quelconque
, fans altérer fa valeur. Fraélion réduite à fes plus fimplcs
termes. Méthode pour trouver la valeur d’une fraélion , relativement
à un entier d’une efpcce déterminée. Ibid. 264. a.
D e la comparai/on des/rallions pour découvrir le rapport
qu’elles ont entr’ellcs. Moyen de découvrir ce rapport. D u
calcul des /rallions. Addition. Souftraélion. Ibid. b. Multiplication
& divifion. Remarques fur la divifion des fraélions les
unes par les autres , ou des entiers par des fraélions. Ibid.
265. a. Autres détails fur les fraélions qui fe voient au mot
Divi/eur8c au mot Expo/ant. Une fraélion élevée à une puif-
fance quelconque, donne toujours une fraélion. Un nombre
entier, qui n’a point pour racine un entier, ne fauroit avoir
nnc fraénon pour racine. De la réduélion des fraélions de
fraélion : c’cft à la multiplication qu’on doit la rapporter, &
non à la ditifion. On peut tranfpofer entr’elles les fraélions,
& échanger leurs termes comme on voud ra, pourvu que le
numérateur relie numérateur / 8 c le dénominateur, dénominateur.
Elévation 5c extraélion. Fraélions décimales. Obfer-
vations fur les différens Agnes dont on a diftingué les fraélions
des entiers. Ibid. b. Fraélions fexagéfimales. Fraélions
continues. Ibid,. 26 6 . a. ' .
Fraélions continues. Auteurs qui ont inventé 8c perfeéhonné
la théorie de cette efpecc de fériés. OuVrages à confulter.
Expreflion à laquelle on a donné le nom de fraélion continue.
Explication de cette théorie. Suppl. III. 110. a.
Fraélion rationnelle , nom que l’on donne à des fraélions
algébriques qui ne renferment point de radicaux. Méthode
donnée par M. Bernoulli , pour intégrer en général toutes
fraélions différentielles rationnelles. Cette méthode perfeélion-
née enfnite par pluficursgéometrcs.Expoféde ce qu’on trouve
iu r ce fujet dans une differtation intitulée , Recherches /ur le
calcul intégral. V II. 266. a. i
Fraélions décimales périodiques. Définition. Suppl. III. 110. b.
Auteurs qui fe font occupés de cette efpece de fraélions..
Ouvrages à confulter. L’auteur de cet article raffemble ici
les remarques les plus effenticllcs que cette matière fournit,
& fur-tout celles qui peuvent le plus faciliter la continuation
des deux tables fui vantes. Ibid. m . a , b . Première table de frayion
s , dont les divifeurs font,des nombres premiers, réduites
en décimales périodiques. Ibid. 114. a. Deuxième table de
fraélions, dont les divifeurs font des produits de deux nombres
premiers, réduites en décimales périodiques. Ibid. 1 z 3. a , b.
Fraélion. Dénominateurs des fraélions. Comment l’on réduit
deux fraélions au même dénominateur. IV . 830. a. Di-
menfions dans les fraélions algébriques. 1010. a. Expofans
fraélionnaires. VI. 314. a. Additions des fraélions pofitives ,
qui ont le même dénominateur. I. 130. b. Pourquoi, lorf-
qu’on veut comparer entr’elles les fraélions , on change leur
rapport en celui de nombres entiers. III. ¿90. a. Opération
par laquelle on fait évanouir.les fraélions. V I . xio . a. Le
quarré , le cube , &c. d’une fraélion eft toujours une fraélion.
VIII. 652. b. Fraélions décimales. Réglés fur le calcul de ces
fraélions. IV . 668. b. b c . Fraélion propre.XIII. 486. b. Fraélion
continue dans la doélrinc des fériés. X V . 96. a. Fraélion fexa-
géfimale. 137. b. Méthode pour intégrer toutes les fraélions
rationnelles. Suppl. IV . 337.a.
F ra c t io n , ( Juri/pr. ) voyez Ef fr a c t io n .
FRA CTU RE. ( Ghirurg. ) Les fraélurcs font tranfvcrfales,
obliques Ou longitudinales. Les fraélurcs longitudinales Amples
ne ‘font point admifes par les praticiens. Différentes
lortes de fraélurcs en travers. Deux fortes de fraélurcs obliques.
Autres différences entre les fraélurcs. Par rapport aux
F R A
accidcns, elles font diyifées en Amples , compofées 8c compliquées.
Parmi les accidcns des fraélurcs compliquées il y
en a qui exigent des fccours plus prompts que les autres’ frac-
tures. On diilinguc encore les fraélurcs en complcttcs 8c in-
complettcs. VII. 266. b. Caufes les plus ordinaires des fraélu-
res. Ce qu’on entend par fraélurcs de caufe interne. Sien«
des fraélurcs. Ibid. 267. a. Prognoftic des fraélurcs. Cure de
ces accidens. D e la réduélion. Appareil 8c Atuation pour
maintenir l’os réduit : détails très-étendus fur ce fujet fur les
différentes fortes defraélurès , 8c fur Ici bandages qui leur font
propres. Ibid. b , 8c 268. a» b. Après avoir mis la partie en Atuation,
il faut s’attacher à prévenir les accidcns, 8c à les combattre
s’ils furvicnncnt. Qu el doit être le terme pendant lequel
on doit continuer l’appareil. Du renouvellement de l’air tous
un membre fraéluré. Ibid. 269. b. Voye? là-dcffus F la bel-
LATION.
FràHure. Crépitation, Agne de fraélure. IV. 434. b. Anchy-
lofes caufées par les fraélurcs. I. 440. a , b. Suc gélatineux
produit par la fraélure des os ; formation du cal. Suppl. IV.
194. b. Dénudation des os dans certaines fraélurcs. IV. 8149.
b. Les os des enfans moins fujets à fe rompre que ceux des
vieillards. V I . 663. b. Différentes fortes de friitlures : celle de la
clavicule. III. 312. b. Fraélurcs par coiïtlc-coup. IV . 134. a.
Fraélure des côtes. 302. a , b. Doigts fraélurés. V. i6 . a. Fra-
élurcs qui ne font que de Amples hffurcs. VI. 821. a , b. Fraélurcs
du crâne. XII. 683. b. Voyc{ C r â n e . Celle du flernunt.
X V . 313. a , b. Fraélure nommée t'richi/m'os : fraélure pref-
qu’impcrceptiblc des os plats. XVI. 633. b. D e la cure des
fraélurcs. Liqueur qui cimente les deux extrémités d’un os,
lors même qu’elles font à une diftance confidéràble. XI. 688.
b. Subftancc regardée comme un fpécifiqué pour le cal des
fraélurcs. 691. a , b. Médicamens propres à fonder 8c unir
les os. II. 739. a. Trois intentions principales que comprend
la cure univerfellc des fraélurés. VI. 832. b. Quatre opérations
pour remettre une fraélure. X V . 764. b. De l’art de rapprd-
cher les bouts des os rompue. 111. 838. b. Banc d’Hippocrate
pour la réduélion des fraélurés. II. 33. a. Infiniment pour
contenir la jambe dans le cas de fraélure compliquée. 311. b.
Ufage des écliffes pour contenir les membres caffés. V . 300.
b. Ufage des fanons dans certaines fraélurés. VI. 402. b. 403. à.
Du prurit qui fuit quelquefois le traitement. 832. b. Renouvellement
de l’air fous un membre fraéluré. Ibid. Efpece de
boite où l’on place un membre fraéluré. X V . 318 .b.
F r a c t u r e . (Maneg. 6* Maréch. ) Les os peuvent être fraélurés
dans tous les fens poftiblcs. V II. 269. b. Fraélurcs tranfvcrfales
; fraélurcs obliques , fans déplacement ou aveb
déplacement ; fraélurcs longitudinales ; fraélurés où l’os a
été brifé ; fraélure Ample , compoféc , compliquée, complexe
, incomplcttc. Caufes des fraélurcs. Quelles en font les
fuites les plus confidérablcs. Symptômes univoques. Ibid.
270. a. Preuves de la réalité de nflurcs. Auteurs qui' ortc
propofé des moyens de remédier aux fraélurcs. Les fraélurcs
regardées communément comme incurables. Démonftration
de la fauffeté de ce préjugé. Quelles font celles a l'égard
defquelles les efforts leroient inutiles. Ibid. b. Celles dont la
cure peut être fuivie du fuccès. Prognoftics formés félon les
différons cas. Néceiïité d’être parfaitement inftruit de pluAeurs
parties de l’anatomie du cheval , pour juger fainement des
fuites du mal, 8c fe décider avec certitude fur les moyeris
d’y remédier. En quoi confident ces moyens. Détails lur la
réduélion par cxtenfion , par contrc-cxtcnfion , par conformation.
Ibid. 271 .a . D e 1 appareil qui doit fuivre la réduction
: il confiftc dans les bandages , les compreffcs & les
attelles. De la maniéré dont on doit Atuer l’animal enfuitc de
l’application de l’appareil. Ibid. b. ExpoAtion particulière de la
méthode qu’on doit fuivre dans le cas d’une fraélure à 1 un
des membres ; i ° . l’auteur fuppofe une plaie oblique 6c con-
tufe , de la longueur de quatre travers de doigt à la pari*?
moyenne fupéricurc du canon de l’une des extrémités pollé-
ricures , avec une fraélure en bec de flûte à ce même os.
Suite des opérations que le maréchal doit exécuter en Par.cl
cas .Ibid. 272. a , b. 20. L’auteur fuppofe une fraélure avec déplacement
à l’une des côtes, 8c que cette fraélure fe porte, foit
en-dedans, foit en-dehors. Signes auxquels on la reconnoitra.
Réduélion 8c appareil. Ibid. 273. a. Voyc{ HlPPIATRlAQUE.
Suvpl. 111. 401. b. &c. . | ,
FR AG A . ( Géogr.) Erreurs h corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. III. 113 a.
F K A G IL E ,fr ê le , (S y n o n .) V II. 293. <1.
FRAGILITE. ( Phy/iq. ) En quoi les corps fragile* mitèrent
des corps mous, des corps élaftiques, 8c des corps
V IL 273 . a. 1 <
F r a g i l i t é , (M o r a le ) difpofition à c é d e r aux pcnc an
de la nature malgré les lumières de la rai fon* r 1.
la fragilité eft du plus au moins le caraélerc de
hommes. Qu i font ceux qu’on appelle parlicu lé cm e t Ira
giles. Caufes de la fragilité, PoppoAtion de 16 ta t ° r ■
vit avec fon caraélcrc ; les viciflitudcs de 1 âge , .
des paflions , auxquelles la raifon ne fc pas
F R A
affez. Autre caufe de fragilité ; nous nous laiffons furchar-
ger de loix inutiles , qu’on ajoute aux Ioix néceffaires à la
société. En quoi l’homme fragile diffère de l’homme foiblc.
VII. 273. b.
FRAGMENT, ( Littir . Archit. Sculpt. ) partie d un ouvrage
qu’on n’a point entier, &c. VII. 271 .b.
F r a GMENS précieux, les cinq, ( Pharmaceut. ) pierres auxquelles
les anciens pharmacologiftcs ont donné ce nom. Propriétés
qu’ils leur attribuoient. Préparations faites avec ces
piérres. Ces préparations regardées aujourd’hui comme ridicules.
La pharmacopée de Paris n’a pas banni les hyacinthes.
,VII. 274. a.
FR A I , tems où le poiffon dépofe fes oeufs ; fes oeufs mêmes
dépotés ; le petit poiffon provenu du frai. Frai de grenouille.
VII. 274. a. Voyc{ G r e n o u il l e . Sur le frai du poif-
"fon, voye{ CHEVRON.
F r a i , ( Monnoyage ) altération qui n’empêche pas le
cours de la monnoie quand elle n’eft que de Ax grains. VII.
^FRAICHEUR, ( Gramm. ) acceptions de ce mot. Vers
de Virgile dans leiqucls il a rafiau blé tout ce que deux
êtres peuvent éprouver de fenfations délicieufcs. Fraîcheur
de couleur en peinture. Fraîcheur dans un tableau. VII.
274. a.
FRAIS. (Gramm. Juri/pr.) Frais de bénéfice d’inventaire:
frais bien 8c légitimement Faits : frais de contumace. VII.
276. a.
Frais de criées : deux fortes ; les ordinaires 8c les extraordinaires.
Par qui ils doivent être avancés. A la charge de qui
font les frais. Quels font les frais que le pourfuivant peut mettre
au rang des extraordinaires. VII. 274. b. Voye{ l’article O r d
in a ir e .
Frais de direllion. VII. 274. b.
Faux fra is . Frais funéraires : objets compris dans ces frais.
Où ils ic prennent oe.à la charge de qui. Leur privilège fur
les autres créanciers. VII. 273. <1.
Frais de géfine ; d’inventaire ; de juftice ; de licitation ;
frais 8c loyaux coûts; frais 8c mifes d’exécution ; frais d’ordre
; de partage ; de pourfuite. VII. 273. a. Frais préju-
diciaux. Frais 8c falaircs ; en quoi ils différent des dépens.
Ibid. b,
Frais. Différence entre les frais 8c les dépens. IV . 837. a.
Mémoire des frais. X. 3 29. a. Efpcce de frais appcllés impen/es.
V I I I . H t b.
FRAISE, énumération de toutes les acceptions de ce mot.
V I I . 273. b. - -te
F r a is e . (Fortifie. ) En quoi les fraifes différent des pahfla-
des. En quels cas on s’en fert 8c quel en eft l’ufage. Pente qu on
leur donne. V IL 273. é. .
F r a is e . (Arquebuf. ) L’arquebufier a quatre cibcces de trai-
fes. Dcfcriptiou de la traife à baflinet. VII. 273. b. D e la fraife
plate ; de la fraife pointue ; de la fraife à roder. Ibid. 274. b.
F r a is e . (Hor log .) Divcrfes fortes de fraifes; leurs ufa-
gcs. VII. 276. a.
Frai/e f en terme de marchande de modes. V II. 276. a.
F r a ise , ( Vénerie) VII. 276. a.
FRAISER , acceptions de ce mot. VII. 276. a.
F r a is e r un bataillon, (A r t milit. ) En quoi confiftoitautrefois
cette opération ; en quoi elle confifte aujourd nui.
Comment la colonne de M. de Folard doit être fraifée. V il.
^ FR A IS IE R , ( Botan. ) carafteres de ce genre de plantes.
Bocrhaavc compte fix elpeces de fraifiers fertiles. Defcrip*
lion du fraifier vulgaire. Saiibn de fa fleur. Lieux ou il croit.
Succès de fa culture dans les jardins. Fraifier du Chili. Comment
le fraifier fc multiplie. Détails fur fa culture. V II. 276.
b. Efpece de ver qui attaque cette plante. Ce qu on doit
faire pour en prévenir les ravages. Détail des foins que
prennent les Anglois pour la culture du fraifier. Ibid.
277.4. Dcfcription de la fraife. Quelle eft la meilleure efpece.
Autres elpeces de fraifes que l’on cultiv e .Ib id . b.
Fraifier, obfervations fur fa fcmcncc.XIV. 940. ¿. Moyen
d e fe procurer par des ados des fraifes de primeurs. Suppl. I.
^Fr a is ie r 6* F r a is e , ( Mat.médic. Pharmac. 6* Dicte ) nature
des fels contenus dans cette plante. Propriétés des racines
du fraifier. Dans quels cas & comment on les emploie.
Si on boit long-tcms de la racine de fraifier 8c d’o-
ie ille , les excrémens fe colorent en rouge. Vertu vulnéraire
attribuée aux feuilles 8c aux racines dp cette plante.
V I I . 277. b. Examen chymique du fuc contenu dans fon
fruit. Comment on fert les fraifes fur les tables. Exemple qui
montre qu’on doit avoir la précaution de les laver. Maux que
peuvent catffer à certains tempéramens les fraifes prifes avec
excès. Qualités falutaires de ce fruit. Boiffons agréables qu’on
prépare avec le fuc de fraifes. Conferve qu’on fait en Italie par
le moyen de ce fuc. Cataplafmc de pulpe de fraifes contre les
inflammations 8c les rougeurs, Cofméüque préparé avec lcau
de fraife. Ibid. 278, a.
Tome I ,
F R A 7 8 1
» infiniment de doreur, d’ébénifte. de luthier.
VII. 278. a.
FRAMBOISIER , (Jardin.) dcfcription de cet arbrifleau.
I ems de la maturité de fon fruit Exportions qui lui conviennent.
Qualité du terrein. Moyen de le multiplier. Saifon dans
laquelle on doit le tranfplantcr. Comment on doit planter les
framboifiers. Culture de cet arbrifleau. Divers ufiigcs qu’on
tire des framboifes. Sept efpeces de framboifiers : ceux à fruit
rouge, 8c à fruit blanc, le framboificr d'automne ,1c framboi*
fier fans épines ; celui à fruit noir ; celui de Canada , 8c celui
de Penfylvanie. Détails fur ces eipeces. V IL 278. b.
F r a m b o i s ie r , ronce, (B o ta n . Jardin.) noms de cette
plante en différentes langues. Caraélere générique des ronces
, dont le framboificr eft une efpecc. Suppl. III. n e .b . Enumération
de onze efpeces de ronces avec leurs variétés. Lieux
où elles croiflent. Leur dcfcription, culture, qualités 8c ufages.
Ibid. 1 16 . a , b.
F r am b o i s i e r 6* F r am b o is e , (Ma t. médic.6» D ic te ) ufage
médicinal qu’on tire de cet arbrifleau Qualités des framboifes.
Eau de framboife, fon ufage. Gelées 8c fyrops faits avec
le fuc de ce fruit. Ufage du vin rouge framboifé. V II.
IkÂM L IN G H AM , (Géogr.) ville d’Angleterre dans la
province de Suffolk. Dcfcription de ce qu’elle offre de plus remarquable.
Suppl. III. 117. b.
F R AN C , ( Botan. ) fauvageon. Greffer fur franc. VII,
279. b.
F r a n c , (P e in tA Peindre franc. V II. 279.b.
- F r a n c , (Juri/pr.) perfonne librç. Obfervations fur ce
que dit L oyfel, que toutes perfonnes font franches* en ce
royaume. V il. 279. b.
Franc, par oppofition à fer/. VII. 279. b.
F r a n c , F r a n k i s ouF r a n q u is , ( Hifi. modA c’cft aînli
que quelques nations orientales appellent les Européens. Tems
où ce nom a commencé. V II. 270. b.
Franc, libre, exempt de quelque charge. Recherches fur
l’origine du nom de franc donné aux François 8c en général
aux Européens. VII. 279. b. Comment on divifoit la France
du tems de Charlcmagnc. Ibid. 280. a.
Francs, leur invafion dans la Gaule : fuites de cette inva*
fion. VI. 689. a , b , 8cc. Peuples qui habitoient la Gaule,
lorfque les Francs s’y établirent. VII. 283. a. Le nom de
Francs commun aux peuples de la Germanie 8c de la Gaule
jufques vers le milieu au neuvième fiecle. Ibid. b. Les Francs
appellés anciennement Sicambres. X V . 162. b. Pays que les
Francs occupoicnt fous le règne de Pharamond. Suppl. III.
4. a. Des rois des Francs 8c de leur autorité. Ibid. b. Moeurs
de cette nation. Ibid. Loix des Francs. IX. 661. a. 668. b.
670. a , b , 8cc. Loi des Francs ripuaires fur la manière de
décider les affaires par la preuve du ferment. IX. 69.-
b. Injufticcs communes fous les régnés des rois francs. XllL-
269. a. Repas des Francs. X IV. 127. b. Etat des cfclaves chez
les Francs. V. 936. a , b.
FRANC ou livre, ( Comm. Monnoie ) VII. 280. a.
Franc-aleu naturel. VII. 280. a.
Franc-dieu noble. VII. 280. a.
Franc-aleu par privilège. VII. 280. a.
Franc-aleu roturier. VII. 280. a. Viytg. A lEU.
F r a n c d’amble , ( Manege ) VII. 280. a.
Francs angevins, monnoie ancienne. VII. 280. a.
Francs-archers : milice d’infanterie établie en France par
Charles V I I , en 1448. Pourquoi ces hommes furent appellés
francs-archers 8c francs-taupins. Ils compofoicnt un corps
de 16000 hommes en quatre compagnies. Ce qu’étoit l’infanterie
françoife avant la création de ce corps. Les francs-
archcrs fupprimés par Louis XI. Comment ils furent remplacés.
Létabliflcmcnt des francs-archers peut avoir fervi
de modèle à celui des milices qu’on levé dàns tout le royaume.
VII. 280.4.
Francs-archers t noblejfe des. XI. 172. b.
Franc-argent : en la châtellenie de Montereau lignifie la
même choie que francs-deniers. VII. 280. b.
Francs d’argent, monnoie ancienne. VII. 280. b.
Francs £ or. VII. 280. b. . o i t »
Franc-Barrois ; monnoie fiftive dans la Lorraine 8c le Bar-
rois. VII. 280. b. .
F r a n c -bâtir» ( Juri/pr. ) en quoi confifte ce droit. VII.
Francs-blancs ; monnoie ancienne. VII. 280. b.
Francs-Bourdelois ; monnoie ancienne. VII. 280. b.
Francs-bourgeois. VII. 280. b.
F r a n c du collier. (Manege) cheval franc du collier. V II;
1 ^Francs-deniers, daufe appofée dans la vente d’un fief ou
d’une rôturc. VII. 280. b. _ . ,
Franc-devoir. Origine des francs-devoirs. Pourquoi ce devoir
fut appcllé franc. VII. 280. b. 11 ne faut pas confondre le
franc-devoir avec le franc-alcu. Différentes lignifications du
franc-devoir. Ibid, 281. a, H |
M M M M m m m m m