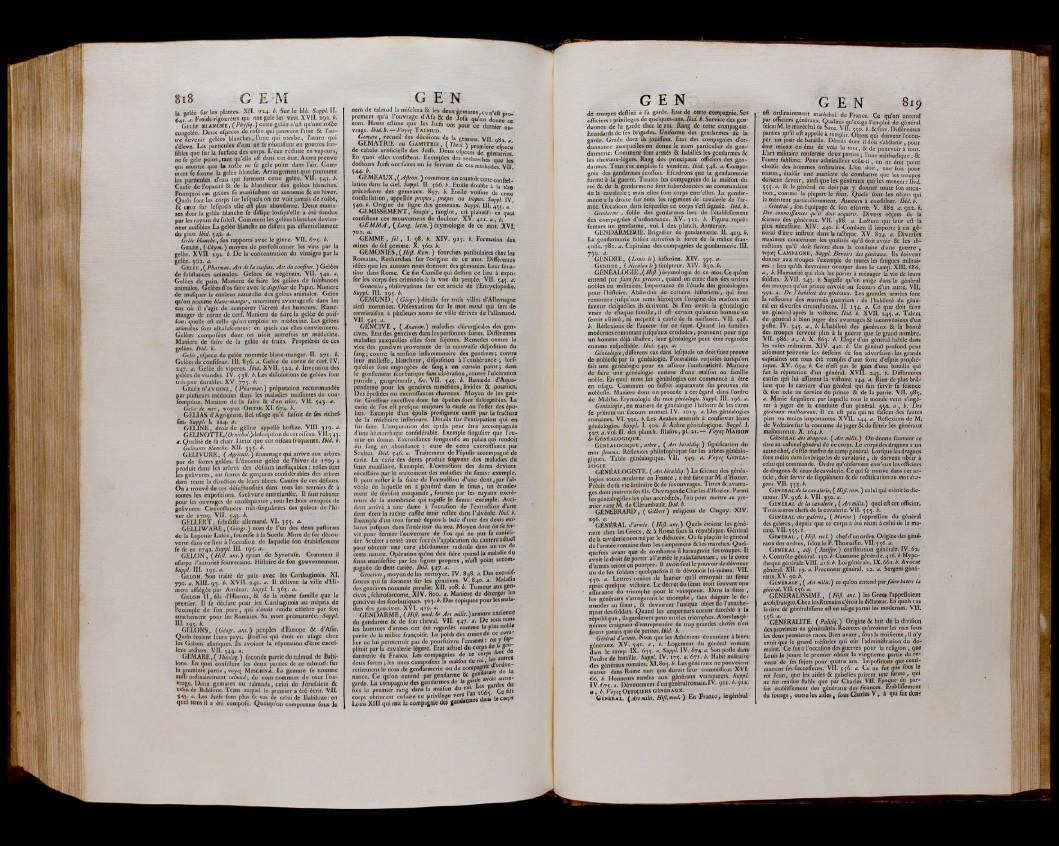
i ü GE-M G E N
la gelée fur le* plante*. XII. 724. b- Sur le blé. Suppl. II.
tU ° a. Froid* rigoureux qui ont gelé les vins. XVII. 291. b.
GpjJia BLANCHE, ( Phyfiq. ) cette gelée n'ert qu’une rofée
'congelée. Deux eCpeces de rofée qui peuvent l’une fie l’autre
devenir gelée* blanche*, l’une qui tombe, l'autre qui
•’élève. Le* particule* d’eau ne le réunifient en goutte* fen-
Able* que fur la furfocc de* corn». L ’eau réduite en vapeur»,
ne fe gclc point, tant qu’elle cft dan» cet état. Autre preuve
qui montre que la rofée ne fe gclc point dan* l’air. Comment
fe forme la gelée blanche. Arrangement que prennent
les particule» d'eau qui forment cette gelée. V II. 541. b.
Caufe de l’opacité fie de la blancheur des gelée* blanche».
Pourquoi ce» gelées fe manifeftent en automne fie en hiver.
Quels font les corps fur lefuucls on ne voit jamais de rofée,
& ceux fur lefqucls elle eu plus abondante. Deux manière*
dont la gelée blanche fe diflipc lorfqu’elle a été fondue
par les rayons du foleil. Comment les gelées blanches deviennent
nuiiibles. La gelée blanche ne diffère pas cficntiéllement
du givre, Ibid. 542-. a.
Gelée blanche, fe* rapport* avoc le givre. VII. 675. b.
G e lé e , ( Chym, ) moyen de perfectionner le* vins par la
gelée. X VU . 292. b. De la concentration du vinaigre par la
gelée. 302. a,
G ele e , ( Pharmac. A r t de la cuifine. A n du confiiur. ) Gelées
de fubftancc* animales. Gelée* de végétaux. VII. 542. a.
Gelées de pain. Maniéré de faire les gelées de fubfiances
animale». Gelées d’os faite avec le digejleur de Papin. Manière
de mafquer la couleur naturelle des gelées animales. Gelée
qu’on nomme blanc-manger, nourriture avantageufe dans le*
cas oii il s'agit de tempérer l’âcrcté des humeurs. Blanc-
manger de corne de cerf. Maniéré de faire la gelée de poif-
fon : quelle oit celle qu'on emploie en médecine. Les gelées
animales font alkalcfccntcs : en quels cas elles conviennent.
Gelées compofées dont on ufoit autrefois en médecine.
Maniéré de faire de la gelée de fruits. Propriétés de ces
gelées. Ibid, b.
Gelée,efpece de gelée nommée blanc-manger. II. 271. b.
Gelées de confifeur. III. 856. a. Gelée de corne de cerf. IV.
247. a. Gelée de vipère*. Ibid. XVII. 322. b. Invention de*
gelées de viandes. IV. 538. b. Les difiolutions de gelées font
très-peu durables. X V . 7 7 5 . b.
G elée d'a v o in e , (Pharmac.) préparation recommandée
par plufieurs médecins dans les maladies nuifiantes de con-
fomption. Maniéré de la faire fie d'en ufer. V i l . 343. a.
Gelée de mer, vo y ez O rtie. XI. 674. b.
GELIAS d’Agrigcntc. Bel ufage qu’il faifoit de fe* richcf*
fe». Suppl. I. 224. a.
GELTN'E, droit de géline appcllé hoftize. VIII. 319. a.
GELINOT TE,(Ornitho l.)d eCcnption de c et oifeau. V II. 3 43.
a. Qualité de fa chair. Lieux que cet oifeau fréquente. Ibid, b.
Gelinotte blanche. XII. 233. b.
GELIVUR E, (A g r icu lt.) dommage qui arrive aux arbres
par de fortes gelée». L ’énorme gelée de l’hiver de 1700 a
produit dan* les arbres des défauts ineffaçable» : telles font
les gelivures, ou fentes fic gerçure» confidérables des arbres
dans toute la direction de leurs fibre*. Caufe* de ces défauts.
On a trouvé de ces défeéluofités dans tous les terroirs 6c h
toutes les expofitions. Gelivure entrelardée. Il faut rebuter
pour les ouvrages de conféqucnce, tous les bois attaqués de
gelivure». Circonftancc* très-Angulicres des gelée» de l’hiver
de 1709. VII. 543. b.
G EL LER T, fabulifte allemand. V I. 353. a.
G E L L IW A R E , (G éo g r .) nom de l’un de» deux paftorats
de la Laponie Lulée,foumife à la Suède. Mine de fer découverte
dan» ce lieu «1 l’occafion de laquelle fon établiffcmcnr
fe fit en 174a. Suppl. III. 193. a.
G E LO N , ( HiJl. anc.) tyran de Syracufe. Comment il
ufurpa l’autorité fouverainc. Hiiloirc de fon gouvernement.
Suppl. III. 193. a.
G elon. Son traité de paix avec les Carthaginois. XI.
770. a, XIII. 93. b. X V IL 242. a. Il délivre la ville d’Hi-
mere artiégée par Amilcar. Suppl. I. 363. a.
G elon i l . fils d'Hieron, fit de la même famille que le
premier. 11 fe déclare pour les Carthaginois au mépris de
l’exemple de fon p e re , qui s’étoit rendu célébré par fon
attachement pour les Romains. Sa mort prématurée., Suppl.
III. 193. b.
GELONS, (Géogr. a nc.) peuple* d’Europe fit d’Afte.
Quels étoient leurs pays, ¡ioiffon qui ¿toit en ufage chez
les Gelons afiatiques. Ils avoient la réputation d'étre excellent
archer*. VII. 344. a.
G EM AR Ë,( Théolog.) fécondé partie du tnlmud de Babi-
lone. En quoi confident les deux parties de ce tnlmud; fur
la première partie, voy«{ M isch na. La gemare fe nomme
suffi ordinairement talmud ; du nom commun de tout l'ouvrage.
Deux gemarcs ou talmud», celui de Jérufalcm fit
celui de Babilone. Tcms auquel le premier a été écrit. VII.
343. «■ Les Juifs font plus de cas de celui de Babilone: en
quel tems il a été compofé. Quoiqu'on comprenne fou» le
nom de talmud la miichiin & les deux gemares, co n’.f t & » '
prement q u i l W j g e tl’A fr & de J o li qu'on d o n n foe
nom. Hnutc oflime que 1« Juif. o „ , pour ce dernier o“
vrage. Jbtd.b, — Voye^ T a lm u o ,
™ ï ï rl V r„e.Co eil d4“ f,on5 d? '» B‘ mare. VII. 981. ,
G EM A T R I t ou G am e tb ie (T m . ) première efpeci
de cabale nrr,ficelle des lu ife Ucux cfpcce.de gi,mûrie».
En quoi elles confident. Exemple, des rccherch<5 que le»
docteurs Juifs ont faites en lu lervant du ces méthodes VU
344. b.
G EM EAU X , ( Aflrori. ) comment on connolt cette conftel-
lation dans lu ciel. Suppl. 11. 3 66. b. Etoile double à la ^
précédente des gemeaux. 897. b. Etoile voifinc de cette
conftcllation, appellée propus, prapes ou tropus. Suppl. IV.
340. b. Origine du figne dus gemeaux. Suppl. 111,433, t ‘
GEMISSEMENT, foupir, limglot, cri plaintif: en quoi
confifient ces tnouvemens de douleur. XV . 411, a , b.
G E M M A , ( Long, latin. ) étymologie de eu mot. XVI.
702. a.
GEM ME , f e l , I. 98. b. X IV . 913. b. Formation des
mines du fel gemme. X. 360. b.
GEMONIES, (H i f l . Rom. ) fourches patibulaires chez les
Romains. Recherches fur l'origine de c e mot. Différentes
idées que les auteurs nous donnent des gémonies. Leur fitua-
tion dans Rome. Ce fut Camille qui defiina ce lieu à expo-
fer les corps des criminels à la vue du peuple. VU. 343. a.
Gémonies, obfervations fur cet article do l'Encyclopédie.
>pl. III. 193. b.
urEMUND, (Géogr.)détails fur trois villes d'Allemagne
ainft nommées. Oblervations Air le mot mund qui fert de
terminaifon à plufieurs noms de ville dérivés de l'allemand.
V H .m - 4. ■ . . .
GENCIVE , (A n a tom .) maladies chirurgicalos des gencives.
s%
Etat des gencives dans les perfonnes faines. Différente»
maladies auxquelles elles font fujetres. Rcmedes centre le
vice des gencives provenant de la inauvaife difpofuion du
fang; contre la tenfion inflammatoire des gencives; contre
leur mollcftc, blancheur, difpofuion à l’exubérance ; lorf-
qu'elles font engorgées de fang à un certain point ; dans
le gonflement feorbutique fans ulcération,contre l’ulcération
putride, gangréneufe, Grc. VII. <43. b. Remede d'Aqua- .
pendente pour les gencives tuméfiées, livides fie pourries;
Des épulides ou excroifiances charnues. Moyeu de les guérir.
Grofieur cxcefiivc dont les épulies font fufceptiblcs. La
carie de l'os cft prefque toujours la caufe ou l'effet des épulies.
Exemple d’un épulis prodigieux caufé par la fraéhire
la mâchoire inférieure. Détails fur l’extirpatioi
de la l’extirpation qui en
fut faite. L’amputation des épulis peut être accompagnée
d'une héinorrhagic confidérable. Exemple ftngulier que l’auteur
en donne. Excroifiance fongueufe au palais qui rendoit
du fang en abondance ; cure de cette cxcroiffance par
Scultct. Ibid. 346. a. Traitement de l’épulis accompagné de
carie. La carie des dents produit fouvent des maladies du
Anus maxillaire. Exemple. L’extraélion des dents devient
nécefiaire par le traitement des maladies du Anus : exemple.
Il peut relier & la fuite de l’extraélion d'une dent,par ('alvéole
de laquelle on a pénétré dans le Anus, un écoulement
de férofité muqueufe, fournie par les tuyaux excréteurs
de la membrane qui tanifie le Anus : exemple. Accident
arrivé à une dame à l’occafion de l’extraérion d'una
dent dont la racine caffée étoit reliée dans l’alvéole. Ibid. b.
Exemple d’un trou formé depuis la bafe d’une des dents molaires
jufques dans l’intérieur du nez. Moyen dont 6n fe fer-
vit pour fermer l’ouverture de l’os qui ne put fc confoli-
dcr. Scultct a tenté avec fuccés l’application du cautere néluet
pour obtenir une cure abfolument radicale dans un cas de
cette nature. Opération ‘qu’on doit faire quand la maladie du
Anus manifefféc par les lignes propres , n’eft point accompagnée
do dent cariée. Ibid. 347. a.
Gencives. moyen de les nettoyer. IV. 848. a. Des cxcroif-
fances qui le forment fur les gencives. V . 840. a. Maladie
des gencives nommée parulic. XII, 108. b. Tumeur aux genc
ive s , fclcrofarcomc., X IV . 800. a. Maniéré de déterger les
gencives des feorbutique». 303. b. Des topique» pour le» maladies
des gencives. X V I . 419* 4* . .
G EN DA RM E , ( Hifl. mod. 6r A r t milit.) armure ancienne
du gendarme fie de fon cheval. VII. 347. a. De tous tcms
les homme» d’arincs ont été regardés comme la plu* noble
partie de la milice françoife. Le poids dos armes de ce cava^
lier ne lui permettoit pas de pourfuivre l’ennemi : on y jup-
pléoit par la cavalerie légère. Etat aétuel du corps de la g
darmcric de France. Les compagnies de ce corpj
deux fortes ; les unes compofcnt Ta maifon du roi, j .or(jon.
retiennent le nom de gendarmerie ou de eonipâgn ^ , .
nanec. C e qu'oe entend par gendarme & .m e -
gardo. La compagnie des gendarme, de I. g« . s du
foi» le premier rang dans la maifon du ro» . 6 Ce Alt
eorpa obtinrent enfuite ce privilège ver’ ¿ A l€ CKpi
Louis XIII qui mit la compagnie de» gendarme, dan» r
G E N
de troupes deftiné à fa garde. Etat de cette compagnie. Ses
officiers : privilèges de quelques-uns. Ibid. b. Service des gendarmes
de la garde chez le roi. Rang de cette compagnie.
Etendards de fe» brigades. Uniforme des gendarmes de la
garde. Grade dont ils jouiffent. Etat des compagnies d’or*
donnancc auxquelles on donne le nom particulier de gendarmerie.
Comment font armé* fie habilles les gendarmes &
les clic vau x-légers. Rang des principaux officier* des gendarmes.
Tous ces emplois fc vendent. Ibid. 348. a. Compagnie
des gendarmes écofibis. Efcadrons que la gendarmerie
forme à la guerre. Toutes lus compagnies de la maifon du
roi fie de la gendarmerie font fubordonnées au commandant
de la cavalerie ; mais elles font corps cntr’cllcs. La gendarmerie
a la droite fur tous les régimens de cavalerie de i'ar-
méc. OccaAons dans lefquelles ce corps s’eft fignalé. Ibid. b.
Gendarme , folde dus gendarmes fors de rétabliftemcnt
des compagnies d’ordonnance. X V . 3x1. b. Figure repré-
Tentant un gendarme, vol. 1 des planch. Armurier.
GENDARMERIE. Brigadier de gendarmerie. II. 410. b.
La gendarmerie faifoit autrefois la force de la milice fran-
çoiiu. 781. a. Capitaine des compagnies de gendarmerie. III.
739. a.
G ENDRE, (Louis l e ) hifforien. XIV. 393. a.
G endre, (N ico la s le ) fculptcur. XIV. 830. b.
G ÉNÉALO GIE, ( Hiji. ) étymologie de ce mot. Ce qu’on
entend par faire fe s preuves, quand on entre dans des ordres
nobles ou militaires. Importance de l'étude des généalogies
pour l'hiftoirc. Abfurdité de certains hifforien», qui ton t
remonter jufqu’aux tcms héroïques l'origine des maifons en
faveur defquelles ils écrivent. Si l’on avoit la généalogie
vraie de enaque famille, il cft certain qu'aucun nomme ne
feroit effimé, ni méprifé à caufe de fa naiffance. VII. 348.
b. Réflexions de l’auteur fur ce fujet. Quand les familles
modernes remontant jufqu’aux croifaacs, prennent pour tige
un homme déjà ¡Huître, leur généalogie peut être regardée
comme refpcétable. Ibid. 349. a.
Généalogie, différons cas dans lefqucls on doit faire preuve
de noblcfie par fa généalogie. Formalités requifes lorsqu'on
fait une généalogie pour en afiurcr l’authenticité. Manière
de faire une généalogie entière d’une maifon ou famille
noble. En quel tems les généalogies ont commencé à être
en ufage. Comment on faifoit auparavant fes preuves de
noblcffc. Manière dont on procédé à cet égard dans l’ordre
de Malthe. Etymologie du mot généalogie. Suppl. III. 196. a.
Généalogie, en matière de généalogie l’hiftoirc fie les titres
fe prêtent un fccours mutuel. IV. 1019. a. Des généalogies
romaines. VI. 391. /'.Les Arabes attentifs à confervcr leurs
généalogies. Suppl. I. 30a. b. Arbre généalogique. Suppl. I.
<27.a. vol.II. des planch. Blafon, pl. 2 1 .— Koye^ M aison
& G én é a lo g iq u e .
G én éalogique, arbre, (A r t héraldiq. ) AgniAcation du
mot jltmma. Réflexion philosophique fur les arbres généalogiques.
Table généalogique. VII. 349- a- Ipffl G énéalo
g ie .
GÉNÉALOGISTE. ( Art héraldiq. ) La fcicnce des généalogies
toute moderne en France, a été faite par M. d’Hozicr.
Précis de fa vie littéraire 8c de fes ouvrages. Titres 8c avantaÎ;
es dont jouirent fes fils. Ouvragesdc Charles d'Hozicr. Parmi
es généalogiftcs les plus accrédités, l’on peut mettre au premier
rang M. de Clerambault. Ibid. b.
GÉNEBRARD, (G ilb e r t ) religieux de Clugny. XIV.
29 6. a.
GÉNÉRAL d ’armée. (N i/ l. anç.) Quels étoient les généraux
chez les G recs, fieà Rome fous Ta république. Général
de la cavalerie nommé par le diébtcür. Où fc plaçoit le général
de l’armée romaine dans les campemèns 8c les marches. Quelquefois
avant que de combattre il haranguoit fes troupes. Il
avoit le droit de porter à l’armée le paludamentum, ou la cotte
d’armes teinte en pourpre. Il avoit feul le pouvoir de dévouer
un de fes foldats : quelquefois il fe dévouoit lui-même. VII.
«30. a. Lettres ornées de laurier qu’il envoyolt au fénat
après quelque viftoire. Le décret du fénat étoit fouvent une
afturance nu triomphe pour le vainqueur. Dan* la fu ite,
les généraux s’arrogèrent le triomphe, fans daigner le demander
au fénat, 8c devinrent l’unique objet de l’attache-
xtjcnt des foldats. Quand les empereurs eurent fuccédé à la
république, Ils gardèrent pour euxlcs triomphes. Alors le* çé*
néraux craignant "d’entreprendre de trop grandes chofes nen
¡firent jamais que de petites, Ibid. b.
Général d ’armée. Nom que les Athéniens donnoiew à leurs:
généraux. X V . 541. a , b. Logement du général romain,
dans le camp. IX. 635. a. Suppl• IV. 674.*. Son porte dans
l’ordre de bataille. Suppl. IV. 173. a. 671. b. Habit militaire
des généraux romains. XI.803. b. Les généraux nejjouvoienf
entrer dans Rome tant que duroit leur commiflion. XVI;
<56. b. Honneurs rendu» aux généraux vainqueurs. Suppl.
ÏV .673 . *. Dévouement d’un général romain. IV. 921. b.e) 42,
a , b. VoyetOFFICIERS GÉNÉRAUX. ,
G énéral, (A r t milit. Hifl,mod,). En France, legénéral
G E N 819
f ordmatroment martel,»! tic France. Ce qn'on entend
ÇY m f ” ^ , Qualités qu’exige l’emploi de général
félon M. le maréchal de Saxe. V il. r ,0? i . Scfrtiv. Diftfrentc.
part,« qu fi cil appe é à remplir, ô b je a qui doivent l’occu-
per un lourde batatle. Détail, dont il doit »'abftcnir ; pour
être mieux en état de voir le tout, & de pourvoir à tout.
L a n militaire renferme deux parties; l’une méthodique, 8c
1 autre fublime. Pour adminiflrcr celle-ci, on ne doit point
choifir des hommes ordinaires. L ’on doit, une fois pour
toutes, établir une maniéré de combattre que les troupes
doivent favoir. ainft que les généraux qui les mènent : Ibid.
333. a. 8c le général ne doit pas y donner toute fon attention
, comme la plupart le font. Quels font les objets qui
la méritent particulièrement. Auteurs à conAliter. Ibid. b.
Général, fon équipage & fon efeorte. V . 882. a. 922. b.
Des connoiffances qu i l doit acquérir. Divers objets de la
fcicnce des généraux. VII. 980. a. Lcélure qui leur cft la
plus néccftairc. XIV. 440. b. Combien il importe à un général
d’étre inftruit dans la taftique. X V . 824. a. Divcrfcs
maximes concernant les qualités qu’il doit avoir fie les di-
reélions qu’il doit fuivre dans la conduite d'une guerre ,
voye{ C am pagn e , Suppl. Devoirs des généraux. Us doivent
donner aux troupes l'exemple de toutes les fatigues militaires
: lieu qu’ils deyroient occuper dans le camp. XIII. 686.
a , b. Humanité qui doit les porter à ménager la vie de leurs
foldats. XVII. 243. b. Sagcrtc qu’on exige dans le général
des troupes qu’un prince envoie au fccours d’un autre. VII.
092. a. D e l'habileté des généraux. Les grandes armées font
la rcftource des mauvais guerriers : de l'habileté du général
en divcrfcs circonftanccs. II. 134. a. Ce que doit faire
un général après la viéloire. Ibid. b. XVII. 443. a. Talent
du général à bien juger des avantages Ôc inconvéniens d'un
porte. IV. 343. a , b. L’habileté des généraux 8c la bonté
des trouocs fervent nlus à la guerre que le grand nombre.
VIL 980. a , b. X. 863. b. Eloge d’un général habile dans
les rufes militaires. XIV. 440. b. Un général profond peut
aifément prévenir les defteins de fon adverfaire : les grands
capitaines ont tous été remplis d'une forte d’efprit prophétique.
X V . 694.. b. Ce n’eft pas le gain d’une bataille qui
fait la réputation d’un général. XVII. 243. b. Différentes
caufes qui lui afturcnt la viétoire. 244. a. Rien de plus brillant
que la carrière d’un général qui fait fervir fa fcience
fie fon zele au fcrvice du prince fie de la patrie. VII. 983.
a. Manie Anguliere par laquelle tout le monde veut s’ingérer
à juger de la conduite d’un général. 992. a , b. Des
généraux malheureux. Il en cft peu qui ne fartent des fautes
plus ou moins importantes. X v l l . 244. a. Réflexions de M,
de Voltaire fur la coutume de juger 8e de flétrir les généraux
malheureux. X. 164. b.
G énéral des dragons. ( A r t milit. ) On donne Couvent ce
titre au colonel général de ce corps. La corps des dragons a un
autre chef, c’crtïe mertre de camp général. Lorfque les dragons
font mêlés dans les brigades de cavalerie , ils doivent obéir à
celui qui commande. Ordre qu’obfervent entr’eux les officiers
de dragons fie ceux de cavalerie. Ce qui fe trouve dans cet article
, doit fervir de fupplétnent fie de rcéliftcation au mot dragons.
VII. 3 3 3. b.
G énéral de la cavalerie, ( Ni/l. rom. ) celui qui créoit le dictateur.
IV. 936. b. VII. 330. a.
G énéral de la cavalerie, ( A n milit.) quel eft cet officier.
Trois autres chefs de la cavalerie. VII. 335. b.
GÉNÉRAL des galeres, (Ma r in e ) fuppreffion du général
des galères, depuis que ce corps a été réuni à celui de la marine.
,V II.5S l f ..........................
G énéral , ( Hifl. e c c l.) chef dun ordre. Origine des généraux
des ordres, félon le r . Thomaftin. VII. 3 36. a.
G én é r a l , adj. (Ju r ijpr.) conftitution générale. IV .62;
b. Contrôle général. 130. b. Coutume générale. 416. é.Hypothèque
générale. VIII. 416. é. Loi générale. IX .661 .b. Avocat
général. XII. 19. a. Procureur général. 22. a. Sergons généraux,
X V . 90. b.
G énérale , ( A r t milit. ) ce qu’on entend par faire battre la.
général. VII. 336. a.
GÉNÉRALISSIME, ( Hifl. anc. ) les Grcos Pappclloient
archiflrattgos. Chez les Romains c’étoit le diétateur. En quels cas
le titre de généraliflime cft en ulagcparmi les modernes. V II.
<36. a.
GÉNÉRALITÉ. (P o lit iq .) Origine 8c but dé la divifion
des provinces en généralités. Recettes qu’avoient les rois fous
les deux premières races. Bien avant, tous la troificme. il n’y
avoit que le grand tréforier qui eût l’adminlftration du domaine.
Ce fut à l’occafion des guerres pour la religion, que
Louis le jeune le premier obtint la vingtième partie du revenu
de fes fujets pour quatre ans. Importions que continuèrent
fes fuccefteurs. VII. 336. a. C e ne fut que fous le
roi Jean, que les aides 8c gabelles prirent une Corme, qui
ne fut rendue ftablc que par Charles VII. Epoque du par-
feit établirtement des généraux des finance». Etabliflcment
du louage, outre les aides « fou» Charles V , à qui fut don*?