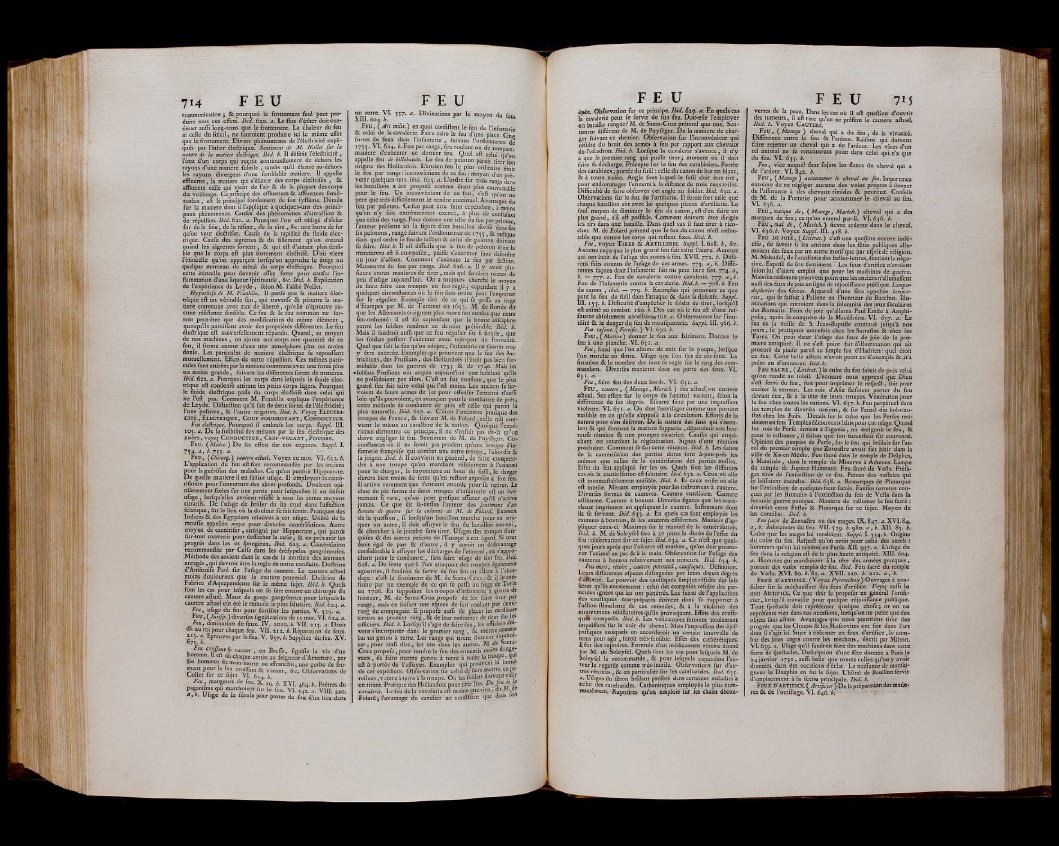
7 i 4 F E U F E U
communication ; & pourquoi le frottement fcul peut produire
tous ces effets, Ibid. 620. a. Le flux d’éther doit continuer
auffi long-tems que le frottement. La chaleur du feu
ni celle du foleil, ne {auraient produire ici le même effet
que le frottement. Divers phénomènes de l’éleâricité expliqués
par l’éther éleârique. Sentiment de M . Nollet fur la
nature de la matière elcttrique. Ibid. b. Il définit l’é leâricité,
l’état d’un corps qui reçoit continuellement de dehors les
rayons d’une matière fubtile , tandis qu’il élance au-dehors
les rayons divergens d’une femblable matière. Il appelle
effluente, la matière qui s’élance des corps• éleârifés , &
affluente celle qui vient de l’air & de la plupart des corps
du voifinage. Ce principe des effluences & affluences fimul-
tanées, eu le principal fondement de fon fyftême. Détails
fur la maniéré dont il l’applique à quelques-uns des principaux
phénomènes. Caufes des phénomènes d’attraâion &
de répulfion. Ibid. 621. a. Pourquoi l’on eft obligé d’ifoler
fur delà foie, de la réfine, de la cire , &c. une barre de fer
qu’on veut éleârifer. Caufe de la rapidité du fluide électrique.
Caufe des aigrettes 8c du fiflement qu’on entend
quand les aigrettes lortent, & qui eff d’autant plus fenfi-
ble que le corps eft plus fortement éleârifé. D ’où vient
l’étincelle qu’on apperçoit lorfqu’on approche le doigt ou
quelque morceau de métal du corps éleétrique. Pourquoi
cette étincelle peut devenir affez forte pour caufer l’inflammation
d’une liqueur fpiritueufe, &c. Ibid. b. Explication
de l’expérience de Le yde , félon M. l’abbé Nollet.
Hypothefe de M . Franklin. Il penfe que la matière électrique
eft un véritable feu , qui traverfe 8c pénètre la matière
commune avec tant de liberté, qu’elle n’éprouve aucune
réflftance fenflble. Ce feu 8c le feu commun ne for-
tent peut-être que des modifications du même élément ,
quoiqu’ils paroinent avoir des propriétés différentes. Le feu
éleétrique eft univerfellement répandu. Quand, au moyen
de nos machines , on ajoute aux corps une quantité de ce
feu, il forme autour d’eux une atmofphera plus ou moins
denfe. Les particules de matière éleétrique fe repou fient
mutuellement. Effets de cette répulfion. Ces mêmes particules
font attirées par la roatiere commune avec une foree plus
ou moins grande, fuivant les différentes fortes de matières.
Ibid. 6 22. a. Pourquoi les corps dans lefquels le fluide' électrique
eft condenfe attirent les petits corps légers. Pourquoi
le fluide éleétrique paffe du corps éleétrifé dans celui qui
ne l’eft pas. Comment M. Franklin explique l’expérience
de Leyde. Diftinétion qu’il fait de deux fortes de l’éleétricité;
l’une pofitive, & l'autre négative. Ibid. b. "Voye{ El e c t r i c
i t é , E l e c t r iq u e , C o u p f o u d r o y a n t , C o n d u c t e u r .
Feu éleétrique. Pourquoi il embrafe les corps. Suppl. III.
105. a. D e la fufibilité des métaux par le feu éleétrique des
nuées, voye{ C o n d u c t e u r , C er f -v o l a n t , F o u d r e .
F eu. ( Médec.) D e fes effets fur nos organes. Suppl. I.
754- 7S5- 11
Feu , ( Chirurg. ) cautere aétuel. Voyez ce mot. VI. 622. b.
L ’application du feu eft fort recommandée par les anciens
pour la guérifon des maladies. Ce qu’en penfoit Hippocrate.
D e quelle maniéré il. en fàifoit ufage. Il employoit -la cauté-
rifation pour l’ouverture des abcès profonds. Douleurs opiniâtrement
fixées fur une partie pour lefquelles il en fàifoit
ufage , lorfqu’ellcs avoient réfifté à tous les autres moyens
curatifs. De l’ufage de brûler.du lin crud dans l’affeétion
feiatique, fur le lieu où la douleur fe fait fentir. Pratiques des
Indiens & des Egyptiens relatives à cet ufage. Utilité de la
moufle appellée moya pour diverfes cautérîfations. Autre
moyen de cautérifer, enfeigné par Hippocrate, qui paraît
fur-tout convenir pour deffécher la carie, 8c en prévenir les
progrès dans les os fpongieux. Ibid. 623 . a . Cautérifation
recommandée par Celfe dans les éréfypeles gangréneufes.
•Méthode des anciens dans le cas de la morfure des ànimaux
enragés , qui devrait être la réglé de notre conduite. Doârine
d’Ambroife Paré fur l’ufage du cautere. Le cautere aâuel
moins douloureux que le cautere potentiel. Doârine de
Fabrice d’Aquapendente fur le même fujet. Ibid\ b. Quels
font les cas pour lefquels on fe fert encore en chirurgie du
cautere aâuel. Maux de gorge , gangréneux pour lefquels le
cautere aâuel eût été le remede le plus falutaire. Ibid. 624. a.
F eu , ufage du feu pour fortifier les parties. V . 529. a.
Feu , f Jurifp.) diverfes lignifications de ce mot. V I. 624. a.
Feu, diminution de feux. IV. 1010. b. VII. 213. a. Droit
du au roi pour chaque feu. VII. 212. b. Réparation de feux.
675’ È preuves par le feu> V - 837- b‘ Supplice du feu. X V .
Feu coiffant & vacant, en Brefle, lignifie la vie d’un
homme. Il eltdu chaque année au feigneur d’Artemare, par
fes hommes demain-morte ou affranchis, une gerbe de froment
pour le feu croiflànt & vacant, &c, Oblèrvations de
Collet fur ce fujet. VI. 624. b
F e u , mangeurs de feu. X. 29. b. XV I. 464. b. Prêtres du
paganifmeqm marchoient fur le feu. VI. § f § VIII. 220.
m b‘ U k Sc de k férule P°ur PO«« du feu d’un lieü.dans
^rYTUîre‘ Y 1, lÉ S a' divinations par le moyen du feu»
XIII. 604. b.
F eu , ( A r t miliu) en quoi confiftent le feu de l’infanterie
& celui de la cavalerie. Faire taire le feu d’üne place. Cinn
fortes de feux dans l’infanterie , fuivant l’ordonnance de
*75 î- VI. 624. b. Feu par rangs, feu roulant ou de rempart-
maniéré d’exécuter ce dernier feu. Quel eft celui qu’on
appelle feu de billebaude. Le feu de peloton paraît tir« fon
origine des Hollandois. L’ancien feu le plus ordinaire étoit
le feu par rangs : inconvéniens de ce feu : moyen d’en prévenir
quelques-uns. Ibid. 625. a. L’ordre fur trois rangs dans
les bataillons a été propofé comme étant plus convenable
pour le feu. Un inconvénient de ce feu , c’eft qu’on ne
peut que très-difficilement le rendre continuel. Avantages du
feu par peloton. C e feu peut être fujet cependant, à moins
qu’on n’y foit extrêmement exercé, à plus de confufion
que celui des rangs. Pour donner une idée du feu par peloton
l’auteur préfente ici la figure d’un bataillon divi'fé dans fes
fix pelotons , rangé fuivant l’ordonnance de 1755, & indique
dans quel ordre le feu de feâion 8c celui de peloton doivent
fe faire. Ibid. b. Il eft difficile que le feu de peloton dont la
manoeuvre eft fi compofée, puiffe s’exécuter fans défordre
un jour d’aâion. Comment s’exécute le feu par feâion.
Manoeuvre du feu par rangs. Ibid. 626. a. Il ÿ avôit plu-
fieurs autres maniérés de tirer, mais qui feraient toutes de
peu d’ufage aujourd’hui. On a toujours cherché le moyen
de faire faire aux troupes un feu réglé; cependant il y a
quelques circonftances où le feu fans ordre peut l’emporter
lur le régulier. Exemple tiré de ce qui fe • pnfla au fiege
d’Etampes par M. de Turcnne en 1652. M. de Bottée ait
que les Allemands craignent plus notre feu confus que notre
feu ordonné : il eft fur -cependant que la bonne difeipline
parmi les foldats rendrait ce dernier préférable. Ibid. b.
Mais il faudrait auffi que ce feu régulier fut fi fimplc, que
les foldats puflent l’exécuter avec très-peu de formalité.
Quel que foit le feu qu’on adopte, l’infanterie ne faurolt trop
y être exercée. Exemples qui prouvent que le feu des Autrichiens,
des Prufliens, des Hollandois n’étoit pas bien formidable
dans les guerres de 1733 & de 1740. Mais les
•foldats Prufliens ont acquis aujourd’hui une habileté qu’ils
ne poffédoient pas alors. C ’eft un fait confiant, que le plus
grand feu foit taire celui qui l’eft moins. Les anciens fe fer-
voient de leurs armes de jet pour offenfer l’ennemi d’aufli
loin qu’ils pouvoient, en avançant pour le combattre de prés;
cette méthode de combattre de près eft celle qui paraît la
plus naturelle. Ibid. 627. 0. C ’étoit l’ancienne pratique des
troupes de France, & fuivant M. de Folard, celle qui convient
le mieux au caraâere de la nation. Quoique l’expérience
démontre ce principe, il ne s’enfuit pas de-là qu’on
doive négliger le feu. Sentiment de M. de Puyfégur. Circonftances
ou il ne ferait pas prudent qu’une troupe d’in-
fonterie françoife qui combat une autre troupe, l’abordât &
la joignit. Ibid. b. Il convient en général, de faire comprendre
à une troupe qu’en marchant réfolument à l’ennemi
pour le charger, la bayonnette au bout du fufil, le danger
durera bien moins de tems qu’en reftant expofée à fon feu.
Il arrive rarement que l’ennemi attende pour fe retirer. Le
choc de pié ferme de deux troupes d’infanterie eft un événement
fi rare, qu’on peut prefque aflùrer qu’il n’arrivé
jamais. Ce que dit là-deflùs l’auteur " des fentimens d'un
homme de guerre fur la colonne de M . de Folard. Examen
de la queftiou, fi lorfqu’un bataillon ’marche pour en atta-
, quer un autre, il doit.eflùyer le feu du bataillon ennemi,
8c chercher à le joindre fans tirer. Ufages des troupes fran-
çoifes & des autres nations de l’Europe à cet égard. Si tout j étoit égal de part & d’autre, il y aurait un défavantage
confidérable à eflùyer les décharges de l’ennemi, en s’appro-
1 chant pour le combattre , fans foire ufage de fon feu. Ibid,
628. a. D e forte que fi l’on attaquoit .des troupes également
aguerries,il faudrait fe fervir de fon feu en allant à l'abordage
: c’eft le fentiment de M. de Santa-Crux : & il le confirme
par un exemple de ce qui fe paflà au fiege de Turin
en 1706. En fuppofant les troupes d’ihfanterie à quatre dè
hauteur', M. ’de Santa-Crux propofe de les faire tirer par
-rangs, mais en faifant une efpece de feu roulant par demi-
rang de compagnie. Il propole'aufli dé placer les meilleurs
■tireurs au premier rang, oc de leur ordonner de tirer fur ies
-officiers. Ibid. b. Lorfqu’il s’agit de faire feu , les officiers doivent
s’incorporer-dans le premier rang ', éc.-niettre comme
lui un genou à terre. Les rangs qui tirent doivent s’embol-
.■ter, pour ainfi dire, les uns dans les autres. M. de banta-
•Crux'propofe , pour rendre le feu des ennèniis moins aange-
-reux,-de faire mettre genou à terre à.tonie la troupe, gJL
eft à'portée de Tcflnyer. Exemples q u i prouvent la bont^
de cet expédient. Obfervation fur celui dé foire mettre en P?*
reil cas, ventre à terre à la troupe. Où les foldats
'en tirant.'Pratique des Hollandois pour iirerb'as. D u j f u ‘ ,■
cavalerie. Le feu delà ‘cavalerie elt moins qüe-rien, dit-^vt.
^Folard; l’avantage du cavalier ne confîûaôt que dans
F E U F E U 7 1 S
épée. Obfervation fur ce principe. Ibid. 6 1 9 . a. En quels cas
la cavalerie peut fe fervir de Ion feu. Doit-elle l’employer
en bataille rangée ?M. de SantarCrux prétend que non. Sentiment
différent de M. de Puyfégur. De la maniere de charger
fuivant ce dernier. Obfervation fur' l’inconvénient qui
réfulte du bruit des armes à feu par rapport aux chevaux
de l’efcadron. Ibid. b. Lorfque la cavalerie s’avance, il n’y
a que le premier rang qui puiffe tirer ; moment où il doit
foire fa décharge. Précepte fur le feu des carabiniers. Portée
des carabines.; portée du fufil : celle du canon de but en blanc,
8c à toute volée. Angle fous lequel le fufil doit être tiré ,
pour endommager l’ennemi à la diftance de trois cens toifes.
Difficulté de faire obferver cet angle au foldat. Ibid. 630. a.
Obfervations fur le feu de l’artillerie. Il ferait fort utile que
chaque bataillon eût avec lui quelques pièces d’artillerie. Le
feul moyen de diminuer le feu du canon, eft d’en foire un
plus grand, s’il eft pofiible. Comment doivent être dirigés
les tirs dans une bataille. Dans quel cas il fout tirer à ricochet.
M. de Folard prétend que le feu du canon n’eft redoutable
que contre les corps qui reftent fixes. Ibid. b.
Feu y voyez T i r e r & A r t i l l e r i e . Suppl. I. 618. b , &c.
Axiome reçu que le plus grand feu foit taire l’autre. Auteurs
qui ont écrit- de l’ufege des armes à feu. XVII. 772. b. Différons
faits connus de l’ufage de ces armes. 773. a , b. Différentes
façons dont l’infonterie fait ou peut faire feu. 774. a ,
b. — 777. a. Feu de cavalerie contre cavalerie. 777. a , b¿
Feu de l’infonterie contre la cavalerie. Ibid. b. — 778. b. Feu
du canon , ibid. — 779. b. Exemples qui prouvent ce que
peut le feu du fufil dans l’attaque 8c dans la défenfe. Suppl.
l l l . 135. b. Difficulté d’empêcher le foldat de tirer, lôrfqu’il
eft animé au combat. 160. b. Des cas où le feu eft d’une ref-
fource abfolument néceffairatjiôi. a. Obfervations fur l’inutilité
8c le danger du feu de moufqueterie. Suppl. III. 966. b.
Feu rafant. {Fortifie. ) VÍ. 630. b.
F e u , ( Marine') donner le feu aux bârimens. Donner le
feu à .une planche. VI. 631. a.
Feu y fanal que l’on allume de nuit fur la poupe, lorfque
l’on marche en flotte. Ufage que l’on fait de ces feux. La
fituation 6c le nombre des feux fe regle fur le rang des com-
mandans. Diverfes manieres dont on porte des feux. VI.
631. a.
Feu 9 foire feu des deux bords. V I . 631. a.
Feu , cautere , ( M a n è g e , Marêch. ) feu aâuel] ou cautere
aâuel. Ses effets fur le corps de l’animal varient, félon la
différence de fes degrés. Efcarre faite par une impreflion
violente. V I. 631. a. On doit l’envifager comme une portion
nuifible en ce qu’elle s’oppofe à'la circulation. Efforts de la
nature pour s’en délivrer. D e la nature des Jùcs qui s’écoulent
& qui forment la matière fuppurée, dépendent une heu-
reufe réunion & une prompte cicatrice. Caufes - qui empêchent
ou retardent la régénération. Signes d’une réunion
prochaine. Comment fe foit cette réunion. Ibid. b. Les fuites
de la cautérifation des parties dures font à-peu-près les
mêmes que celles de la cautérifation des parties molles.
Effet du feu appliqué fur les os. Quels font les différens
cas où la cautérifation eft falutaire. Ibid. 632. a. Ceux où elle
eft inconteftablement nuifible. Ibid. b. Et ceux enfin où elle
eft inutile. Métaux employés pour les inftrumens à cautere.
Diverfes formes de catéteres. Cautere cutellaire. Cautere
efliforme. Cautere à bouton. Diverfes figures que les maréchaux
impriment en appliquant le cautere. Inftrument dont
ils fe fervent. Ibid. 633. a. En quels cas font employés lés
eau teres à boutons, & les sauteres efiiformes. Maniere d’appliquer
ceux-ci. Maximes fur le manuel de la-cautérifation.
Ibid. b. M. deSoley-fel fixe à 27 jours ,1a durée de l’effet du
feu : obfervation fur ce fujet. Ibid. 634. a. Ce n’eft que quelques
jours après que l’efcarre eft tombée, qu’on doit promener
l’animal au-pas & à la main. Obfervation fur l’ufage des
cauteres à bouton relativement aux tumeurs. Ibid. 634. b.
Feu mort'y rètoire , cautere potentiel y cauftiques. Définition.
Leurs différentes efpeces diftinguées par leurs divers degrés
d’à&ivité. Le pouvoir des cauftiques fimples réfulte des tels
âcres qu’ils contiennent : celui des compofés réfulte des particules
ignées qui les ont pénétrés. Les fuites dé l'application
dos cauftiques non-préparés doivent donc fe rapporter à
l’aâion ftimulante de ces remedes, & à la violence des
•mouyemens ofcillatoires qu’ils- provoquent. Effets des caufti-
q u « compofés. Ibid. b. Les véficatoires feraient totalement
impuiffans fur le cuir du cheval. Mais l’ùnpreffion des épif-
paftiques auxquels on accorderait un certain intervalle de
tems pour agir, ferait très-fenfible. Effet des cathérétiques.
Effet des ruptoires. Formule d’un médicament rétoire donné
ar M. de ‘Soleyfel. Quels font les cas pour lefquels M. de
oleyfel le recommande, & pour lefquels cependant l’auteur
le regarde comme trèS-inütile. Obfervations fur d’autres
rétoires, & en particulier.fur leS cantharides. Ibid. 633.
a. Ufages du fêton brûlant préféré dans certaines maladies à
celui des cantharides. Cathérétiques employés le plus communément.
Ruptoires qu’on .emploie fur les chairs découvertes
de la peau. Dans les cas où il eft queftion d’ouvrir
des tumeurs, il eft rare qu’on ne préféré le cautere aâuel»
Ibid. b. V o y e z C a u t e r e .
F e u , ( Manege ) cheval qui a du f e u , de la vivacité.
Différence entre le feu & l ’ardeur. Raifons qui doivent
foire rejerter un cheval qui a de l’ardeur. Les vices d’un
tel animal ne fe rencontrent point dans celui oui n’a aue
du feu. V I. 633. b. - 4 n a q u e
Feu y vice auquel font fujets les flancs du cheval qui a
de l’ardeur. VI. 842. b.
F e u , ( Manege) accoutumer le cheval au feu . Importance
extrême de ne négliger aucune -des voies propres a donner
de l’aflurance à des chevaux timides & peureux. Confeils
de M. de la Porterie pour accoutumer le cheval au feu.
V I. 636. a.
F e\j., marque d e , ( Manege, Marich. ) cheval qui a des
marques de feu ; c e qu’on entend par-là. VI. 6 3 6 . A
Feu,»»«*/ de y ( Marich.') fievre ardenterdans le cheval.
V I. 636.b. Voyez Suppl. III. 418. b.
| F e u d e j o i e , ( Littirat. ) c’eft une queftion encore indé-1
cife , de favoir.fi les anciens dans les fêtes publiques allu-
moient des feux par un autre motif que par eforît de religion.
M. Mahudel, de l’académie des belles-lettres, foutientla négative.
Expofé de fon fentiment. Les feux d’artifice n’avoient
félon lui d’autre emploi que pour les machinés de guerre.
Mais fes raifons ne prouvent point que les anciens n’allumaflent
aufli des feux de joie en figne de réjouiffance publique. Lampa-
dophories' dès Grecs. Appareil d’une fête appellée lampte-
ries y qui fe feifoit à Pallene en l’honneur de Bàcchus. Illuminations
qui entraient dans la folemnité des jeux féculaires
des Romains. Feux de joie qu’alluma Paul Emile à Amphi-
polis, après la conquête de la Macédoine. VI. 637. a. L e
feu de la veille de S. Jean-Baptifte continué juiqu’à nos
jours, fe pratiquoit autrefois, chez les Sarrafins & chez les
Turcs. On peut dater l’ufoge des feux de joie de la pret-
miere antiquité. Il ne s’eft point foit d’illumination qui ait
procuré de plaifir pareil au fimple feu d’Hadrien : quel étoit
ce feu. Cette belle aâion n’avoit point eu d’exemple 8c m’a
point eu d'imitateur. Ibïd.b.
F e u - s a c r é , ( Littéral, f i e culte du feu fuiyit de près celui
qu’on rendit au foleil: L’écriture nous apprend que Dieu
s’eft fervi du feu, foit pour imprimer le re ip e â , foit pour
exciter la terreur. Les rois d’Afie faifoient porter du feu
devant eu x, 8c à la'tête dé' leurs troupes. Vénération pour
le feu chez toutes les nations. V I . .637. b. Feu perpétuel dans
les temples de diverfes nations, 8c fur l’aùtel des holocau-
ftes chez les Juifs. Détails fur le culte que les Perfes ren-
doient au feu. Temples découverts bâtis pour cet ufage. Quand
les rois de Perfe étoient à l’agonie, on éteignoit Te feu , 8c
pour le rallumer, il folloit que fon fucceffeur fût couronné.
Opinion des peuples de Perte, fur le feu qui bruloit fur l’autel
du premier temple que Zoroaftre avoit foit bâtir dans la
ville de Xis en Méaie. Feu facré dans le temple de Delphes,
à Mantinée, dans le temple de Minerve à Athènes. Lampe
du temple' de Jupiter Hammon: Feu-facré de Vefta. Préfo-
ges tirés de l’extinâion de ce feu. Peines -des -veftales qui
le laiffoient éteindre. ;Ibid. 638. a. Remarques de Plutarque
fur l’extinâioh’ de quelques feux focrés. -Fauffes terreurs conçues
par les Romains à Textinâion du feu de Vefta dans la
fécondé guerre punique. Maniera de rallumer le feu facré i
diverfité entre Feftus 8c Plutarque fur ce fujet. Moyen de
les concilier. Ibid. bi
Feu facré de Zoroaftre où des mages. IX. 847. a. XVI. 84.
a , ¿. Adorateurs du feu. VII. 329. b. 980. a , b. XII. 83. b.
Culte que les mages lui rendoient. Suppl. I. 334. b. Origine
du culte du feu. Refpeâ qu’on avoit pour celui des autels :
honneurs qu’on lui rendoit en Perfe. XII. 937. a. L ’ufage du
feu dans la. religion-eft dé.la plus haute antiquité. XIII. 604.
a. Hommes qui marchoierit- à la .tête des/armées grecques ,
portant des vafes remplis de feu. Ibid. Feu.facré du temple
de Vefta. X V l. 80. ¿. 81. «*. XVII. 210. ¿. 212. «*, b.
F e u x d ’a r t i f i c e . ( Voyez Pyrotechnie') Ouvrages à con-
fulter fur lé méchanifme dés feux d’artifice. ' Voyer^ aufli le
mot A r t i f i c e . Ce.que dbit'fe ’propofer en général l ’artificier
, lorfqu’il travaille pour quelque réjouiffance publique.
Tout fpéaacle doit repréfenter quelque chbfe; or on ne
jepréfente rien dans ces occafions, lorfqu’en né peint que des
objets fans aâion. Avantages que nous pourrions tirer de9
progrès que les .Chinois 8cles Mofcovites ont fait dans l’art
dont il s’agit ici. Sujet à exécuter en feux d’artifice , 1e combat
des bons anges contre lès méchans, décrit par Milton.
VI. 639. a. Ufage qu’il faudrait foire des machines dans cette
forte de fpeâades. Defcription d’une fête donnée à Paris le
24 janvier 1730, auffi belle que toutes celles qu’on y avoir
données dans des occafions d’éclat. La naiffance de monfei-
gnetir le Dauphin en fut le fujet. L’hôtel de Bouillon fervit
d’emplacement à la feene principale. Ibid. b. ,
F e u x .d ’a r t i f i c e . ( Artificier ) D e la préparation des matie-,
res 8c de l’outillage. V I. 640. b;-