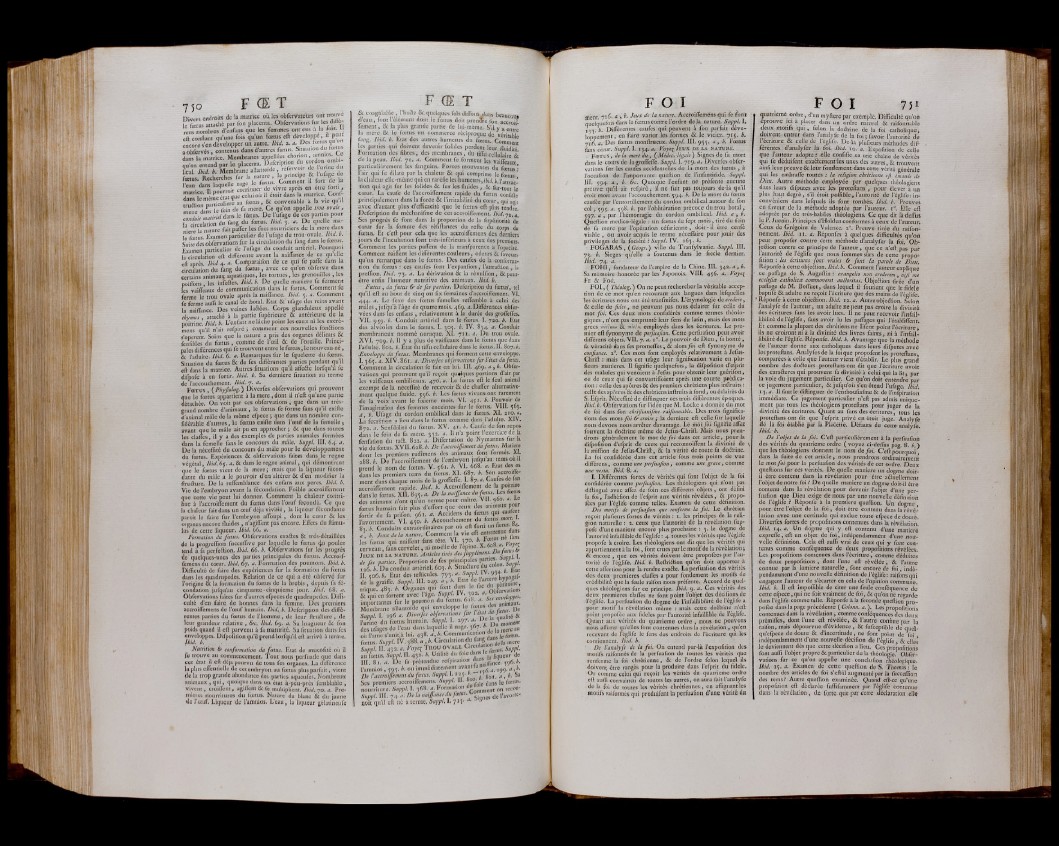
75o F OE T
Divers endroits de la matrice où les otfervmcurs ont trouvé
le foetus attaché par fou placenta. Obfervations fur les * 01-
rens nombres tl’eitfans que le. femmes ont eus à la fois, t
cil confiant qu’une fois qu’un foetus cft développé, it peut
encore s en développer un autre. Uid. a. u.. D » ; S »
aob fcrvés, contenus dans d autres foetus. Situation du r ■
d an sTm a ricc. Membranes apncllécs chonon , ajnmos. Ce
qquu' oonn eenntteenndd ppaarr _le_ ,
lical. Ibid. b. Membrane allantoidc, rci
^ . - R e c h e r c h e , fur la stature, ^ n n c ip e & h t û g de
, cau. g g R f i g S t in u c r de vivre après en être fort'.,
matrice. Il P . auc celui oii il ¿toit dans la matrice. Coni-
«¿tus; fc convenable à la vie ,,,'il
l i e la fdn de fa mcrc. Ce qu’on appelle trou ovale,
/ f m Lr iel dans le foitus. De l’ufage de ces parties pour
f^lvriilaiion du fang du foetus. Ibid. y a. De quelle maniéré
la nature fait paffer les focs; nourriciers de la meredans
le foetus. Examen particulier de 1 ufage du trou-ovale. Ibid. b.
Suite des obfervations fur la circulation du fang dans le foetus.
Examen particulier de l’ufage du conduit artériel. Pourquoi
la circulation cil différente ayant la naiffance de ce quelle
cil après. Ibid 4. «. Corfiparaifon de ce qui fe parte dans la
circulation du fang du foetus , avec ce au on obfervc dans
certains animau* aquatiques, les tortues, les grenouilles , les
poiiTons, les infeéles. Ibid. b. D e quelle manière fe ferment
les vaiffeaux de communication dans le foetus. Comment le
ferme le trou ovale après la naiffance. Ibid. 1 a. Comment
fe ferme aufll le canal de boni. Etat 8c ufage des reins avant
la naifTance. Des veines hélées. Corps glanduleux appel 6
thymus , attaché à la partie Amérieurc 8c antérieure de a
poitrine. Ibid. b. L’enfant ne lâche point les eaux ni les excré-
mens qu’il n’ait rcfpiré ; comment ces nouvelles fondions
s’opèrent. Soins que la nature a pris des organes délicats 8c
fcniiblcs du foetus, comme de 1 oeil 8c de l’oreille. Principales
différences qui fe trouvent entre le foetus, le nouveau-né,
6c l’adulte. Ibid. 6. a. Remarques fur le fquelette du foetus.
Situation du foetus 8c de fes différentes parties pendant qu’il
cft dans la matrice. Autres Situations qu’il affeéte lorfqu’il fe
difpofe k en fortir. Ibid. b. Sa dernière fituation au terme
de l’accouchement. Ibid. y . a.
F<etüs, ( Phyfiolog.) Diverfes obfervations qui prouvent
que le foetus appartient à la merc, dont il n’eft qu’une partie
détachée. On voit par ces obfervations, que dans un très-
grand nombre d’animaux , le foetus fe forme fans qu’il exifte
d’animal mâle de la même efpccc ; que dans un nombre con-
fidérable d’autres, le foetus cxiflc clans l ’oe uf de la femelle,
avant que le mâle ait pu en approcher ; 8c que dans toutes
les claires, il y a des exemples de parties animales formées
dans la femelle fans le concours du mâle. Suppl. III. 64. a.
De la néccfTité du concours du mâle pour le développement
du foetus. Expériences 8c obfervations faites dans le règne
végétal, Ibid. 6k. a. 8c dans le règne animal, qui démontrent
que le foetus vient de la mcrc ; mais que la liqueur fécondante
du mâle a le pouvoir d’en altérer 8c d’en modifier la
ftniéltirc. De la reffcmblance des enfans aux pères. Ibid. b.
V ie de l’embryon avant la fécondation. Foiblc accroiffemcnt
que cette vie peut lui donner. Comment la chaleur contribue
â l’accroiflcmcnt du foetus dans l’oe uf fécondé. C e que
la chaleur fait dans un oeuf déjà vivifié, la liqueur fécondante
paroît le faire fur l’embryon affoupi , dont le coeur 8ç les
organes encore fluides , n’agiffent pas encore. Effets du ftimu-
lus de cette liqueur. Ibid. 66. a.
Formation du fa tu s . Obfervations exaéles 8c très-détaillées
de la progrefiiou fucccffivc par laquelle le foetus cjti poulet
tend it fa perfeélion. Ibid. 66. b. Obfervations fur les progrès
de quelques-unes des parties principales du foetus. Àccroif-
femens du coeur. Ibid. 67. a. Formation des poumons. Ibid. b.
Difficulté de faire des expériences fur la formation du foetus
dans les quadrupèdes. Relation de ce qui a été obfcrvé fur
l'origine 8c la formation du foetus de la brebis, depuis fa fécondation
jufqu’au cinquante-cinquième jour. Ibid. 68. a.
Obfervations faites fur d’autres cfpcces de quadrupèdes. Difficulté
d’en faire de bonnes dans la femme. Des premiers
accroiffemens de l'oeuf humain. Ibid. b. Defeription des différentes
parties du foetus de l'homme, de leur ftruéturc, de
leur grandeur relative, b c . Ibid. 69. a. Sa longueur 8c l'on
poids quand il cil parvenu k fa maturité. Sa fituation dans fes
enveloppes. Difpofltion qu’il prend lorfqu’il cil arrivé à terme.
fbid, b.
Nutrition b conformation du fatu s . Etat de mucofité où il
fe trouve au commencement. Tout nous perfuade que dans
cet état il cft déjà pourvu de tous fes organes. La différence
)a plus cffcntiellc de cet embryon au foetus plus parfait, vient
de la trop grande abondance des parties aqueufes. Nombreux
animaux , qui. quoique dans un état à-peu-près fcmblablc ,
v iv en t, croiffcnt, agiffent 8c fe multiplient. Ibid. 70. a. Premières
nourritures dit foetus. Nature du blanc 8c du jaune
4c l’oeuf. Liqueur de l’amnios. L’eau, la liqueur gélatineufe
8c coagtilable, l'huile 8c. quelques felsdiffousjAi^ beaucoup
d’eau , font l’élément dont.le foetus doit prendre fon accroiu
fement, 8c la plus grande partie de lui-méme. S’il y a ClUr*
la mcrc 8c le foetus un commerce réciproque de véritable
fang. Ibid. b. Etat des autres humeurs du foetus. Comment
les parties qui doivent devenir folides perdent leur fluidité
Formation des fibres, des membranes, du tiïfij cellulaire 8c
de la peau. Ibid. n i . a. Comment fe forment les vaiffeaux
particulièrement les fanguins. Forces mouvantes du foetus •
l’air qui fe dilate par la chaleur 8c qui comprime le foetus
la chaleur cllc-mômc qui en raréfie les humeurs,ibid. b. l'attraction
qui agit fur les folides 8c fur les fluides, 8c fur-tout le
coeur. La caufc de l’accroiffemcnt rapide du foetus confiflc
principalement dans la force 8c l’irritanilité du coeur, qui
avec d’autant plus d’efficacité que le foetus cft plus tendre.
Defeription du méchanifmc de cet accroiffemcnt. Ibid. 72 ,4.
Ses progrès fe font dans la proportion de la fiipériorité du
coeur fur la fournie des réfiftanccs du refte du corps du
foetus. Et c’cft pour cela que les accroiffemens des derniers
jours de l’incubation font très-inférieurs h ceux des premiers.
Comment les parties partent de la tranfparcr.ee à l'opacité.
Comment naiflcnt les différentes couleurs, odeurs 8c faveurs
qu’on remarque dans le foetus. Des eau fes de la conformation
du foetus : ces caufcs font l ’cxpanfion, Tattraélion, la
prcffion. Ibid. 73. a. La dérivation 8c la révulfion, 8c peut-
être enfin l’humeur nutritive des animaux. Ibid. b.
F a tu s , du fa tu s 6* de fe s parties. Defeription du foetus', tel
qu’il cft au bout de cinq ou fix fe main es d’accroiffement. VI.
444. a. Le fexe des foetus femelles reffemble k celui des
mâles, jufqu’à l'âge de quatre mois. 46p. a. Différences obfcr-
vécs dans les enfans , relativement k la durée des groffeffes.
V IL pfo. b. Conduit artériel dans le foetus. I. 720. b. Etat
des alvéoles dans le foetus. I. 30t. b. IV. 824. a. Conduit
membraneux nommé ouraque. XI. 7 1 1 . a. I)u trou ovale.
X V I , 709. b. 11 y a plus de vaiffeaux dans le foetus que dans
l'adulte. 802. b. Etat du tiffu cellulaire dans le foetus. 11. 8.0.7; b.
Enveloppe du fa tu s . Membranes qui forment cette enveloppe.
I. 3 65 . a. XIV . 86 r . a. Diverfes obfervations fur l'état du fatus.
Comment la circulation fe fait en lui. III. 469. a , b. Obfervations
qui prouvent qu’il reçoit quelques portions d’air par
les vaiffeaux ombilicaux. 470". a. Le foetus cft le fcul animal
exempt de la néccflité de recevoir 8c de chaffcr alternativement
quelque fluide. <5:96. b. Les foetus vivans ont rarement
de la voix avant le nxicmc mois. V I. 451. b. Pouvoir de
l’imagination des femmes enceintes fur le foetus. VIII. 563.
a y b. Ufage du cordon ombilical dans le foetus. XI. a 10. a.
La fccrétion a lieu dans le foetus comme dans l’adulte. XIV.
872. a. Senfibilité du foetus. X V . 41. b. Caufe de fon repos
dans le foin de fa mcrc. 33a. a. Il n’a point l’cxcrcicc de la
fenfation du taél. 822. a. Differtation de Nymannus fur la
vie du foetus. X VII. 628. b. D e l'accroiffemcnt du fatus. Matière
dont les premiers rudimens des animaux font formés. XI.
288. b. D e l’accroiffemcnt de l’embryon jufqu’au tems ou il
prend le nom de foetus. V . ,6 t . Î .V l .d 6 8 , a. Etat d e s «
dans les premiers rems du foetus. XI. 687. b. Son « e n t a ment
dam chaque mois de la groffeffe. 1. 67. a. Caufes de Ion
accroilTcment rapide. Ibid. b. Accrraffcmcnt de la pour.«
dans le foetus. X ll. 895. a. D e la n a ïp n c e du fistus. Les foetus
des animaux n'ont qu'tin terme pour naître. VII. 960. a. La
foetus humain fait plus d’effort que ceux des «M W C |M r
fortir de fa prifon. 961. e. Acculons du foetus
l’avortement. VI. 450. b. Accouchement du foetus mort. •
83. b. Conduits extraordinaires par où cft font un fo «■ 04-
4 b. Jeux i . la àarure. Comment la vie cft entre|«nue d u
les foetus qui naiflcnt fan. tête. V I. ,70 . K g
cerveau, fans cervelet, ni moelle de 1 ¿pute. X. • 9 ^
J eu x de l a n a tu r e . Articles ttrh dufuppUÙfflWH , ,
de Cet parties. Proportion de fes principales partie • PP ' j
116. ¿. Du conduit artériel, 603. t . Struflure du g « «
II. 506 ,b . Etat des tcfticulcs. 793. a. Suppl. 1V. W+ • f.
de (a graiffe. Suppl. UI. 14 ? •? | H i B S |
trique. 483- *■ Organes qui le fac ‘'¿¿fcrvalioi,s
& qui en lortent avec I âge. Suppl. IV. 30a. a.
iimmppoorrttaanntteess ftuurr l1e0 ppooiuimu.ovn.. dii foeuis. i S l„n„¡lmn)aMuxx..
Membrane allanto.de qui enveloppe le f a « « “ , )e
Suppl. 1. apd e. Diverfes M e rw m tu far W W & S L f g &
l'urine du foetus humain, bu p p l.}. ^ ■ ‘ i f f r â lp0n M
des ufages de l’eau dans laquelle il nage. 367. • au
où l’ame s’unit;!, lui. 1» « . a b. Commun,canon
foetus; Sappl. IV. 588. « , b. Circulation du fang dan ^ ^
Suppl. II. 4 1 a . 11. h y e i T r o u o v a l e . C w b J w * * , s l
au foetus. Suppl. H. 43». b. Utilité du foie dan |i(„ ieur de
III. 81. a. D e fa prétendue «fixa tion dans ^
l’amnios, 393. b. ou immédiatement avant!., ^ t i g.
D e l'aeen/iftiimbdu m u b .S u m i l . W W t f i ‘. ’ go u . b. Sa
Ses premiers accroiffemens. Suppl. II. j ans le foeWS'
nourriture. Suppl. I. 368. a. Formation Commcn( „ „ recoa-
% ip / .w . 74. a. D e la rialpiice du/«''"• sivnos de l’avorte-
noù qu’il cft né ù terme. Suppl. I. 7* S’ ’
F O I
ihcrtt. 716- a » k ^eux eic nature‘ Accroiffeméns qui fe font
quelquefois dans le foetus contre l’ordre de la nature. Supol. I.
¡■¡7. b. Différentes caufcs qui peuvent k fon parfait développement,
en faire varier les formes & Je vicier^ 715. b.
716. a. Des foetus monftrucux. Suppl. III. 935. a> b. Foetus
fans coeur. Suppl. J. 134. a. § < Ê § Jü-VX DU Là n a tu re .
F oe tu s , delà mort d u , ( Médec. légale) Signes de fa mort
dans le cours de la eroflefle. Suppl. 1. 719. a. Diverfes obfervations
fur les caufes accidentelles de la mort des foetus, «1
l’occafton de l’importante queftion de l’infanticide. Suppl.
111. 594. a t b. b c . Quoique l’enfant ne préfente aucune
preuve qu’il ait rcfpiré, il ne fuit pas toutours dc-là qu’il
étoit mort avant l’accouchement. 594. b. D e la mort du foetus
cnuféè par l'entortillement du cordon ombilical autour de fon
c o l , 595. /a. 308. b. par l’oblitération précoce du trou botal,
<97. a , par 1 hémorragie du cordon ombilical. Ibid. a , b.
’Queftion médico-légale : un foetus de fept mois, tiré du fein
de fa merc par l’opération céfaricn n e , doit-il être cen’fé
viab le, ou avoir acquis le terme néceffairc pour jouir des
privilèges de la fociété ? Suppl. IV . 163. b.
F O G A R A S , ( Géogr. ) ville de Tranfylvanic. Suppl. III.
73. b. Sièges qu’elle a fou tenus dans le ficelé dernier.
Ibid. 74. a.
F O H I ,■ fondateur de l'empire de la Chine. III. 342. a , b.
Sa mémoire honorée par les Japonois. VIII. 456. a. Voye^
F e & F o £
F O I , ( Théolog. ) On ne peut rechercher la véritable acception
de ce mot qu’en recourant aux langues dans Icfqucllcs
les écritures nous ont été tranfmifcs. L’étymologié de credere, |
8c celle de fid e s , ne peuvent pas nous éclairer fur celle du
mot fo i. Ces deux mots conltdérés comme termes théolo- j
giques, n’ont pas emprunté leur fens du latin, mais des mots
grecs TTÎohvu oc irielu employés dans les écritures. Le premier
cft fynonyme de perfuafion. Cette perfuafion peut avoir
différons objets. V II. 7. a. i°. Le pouvoir de D ie u , fa bonté,
fa véracité dans fes promeffes, 8c alors f o i cft fynonyme de
confiance. 2U. Ces mots font employés relativement à Jefus-
Chrift : mais dans cet ufage leur lignification varie en plu-
ficurs manières. 11 fignific quelquefois, la difpofition d’eforit
des malades qui venoient à Jefus pour obtenir leur guérifon,
ou de ceux qui fe convertiffoient après une courte prédication
: celle des apôtres 8c des premiers chrétiens plus inftruits :
celle des apôtros 8c des chrétiens inftruits à fond, ou éclairés du
S. Efprit. Néccflité de diftinguer ces trois différentes époques.
Ibid. b. Obfervations fur l’idée que M. Locke a donnée du mot
de foi dans fon chrifiianifme raifonnable. Des trois fignifica-
tions des mots f o i & croire ; la dernierc cft celle fur laquelle
nous devons nous arrêter davantage. Le mot f o i fignific affez
fouvent la doélrine même de Jefus-Chrift. Mais nous prendrons
généralement le mot de fo i dans cet article, pour la
difpofition d’eforit de ceux qui reconnoiffent la divinité de \
la million de Jefus-Chrift, 8c la vérité de toute fa doélrine.
La foi confidéréc.dans cet article fous trois points de vue
différens, comme une perfuafion, comme une grâce, comme
une vertu. Ibid. 8. d.
I. Différentes fortes de Vérités qui font l’objet de la foi
confidéréc comme perfuafion. Les théologiens qui n’ont pas
diftingué avec affez de loin ces différens objets , ont défini
la foi, l’adhéfion de l’efprit aux vérités révélées, 8c propo-
fées par l’églifc comme telles. Examen de cette définition.
Des motifs de perfuafion que renferme la fo i. Le chrétien
reçoit pluficurs fortes de vérités : x. les principes de. la religion
naturelle : 2. ceux que l’autorité de la révélation, fup-
iofc d’une manière encore plus prochaine : 3. le dogme de
’autorité infaillible de l’églifc : 4. toutes les vérités que l’églife
propofe k croire. Les théologiens ont dit que les vérités qui
appartiennent à la fo i, font crues par le motif de la révélation j
8c encore, que ces vérités doivent être propofées par l’autorité
de l’églife. Ibid! b. Reftriélion qu’on doit apporter à
cette affertion pour la rendre cxaâc. La perfuafion des vérités
des deux premières clartés a pour fondement les motifs de
crédibilité que la feule raifon nous préfente. Accord de quelques
théologiens fur ce principe. Ibid. 9. a. Ces vérités des
deux premières clnffcs ne font point l’objet des décifions.dc
l’églife. La perfuafion du dogme de l’infaillibilité de l’églife a
pour motif la révélation même : mais cette doélrine ifcft
point propoféc aux fidèles par l’autorité infaillible de l’églife.
Quant aux vérités du quatrième ordre , nous ne pouvons
nous affurcr qu'elles font contenues dans la révélation, qu’en
recevant de 1 églife le fens des endroits de l’écriture qui les
-contiennent. Ibid. b.
D e fanalyfe de la fo i. On entond par-là l'cxpofition des
motifs raifoimés de la perfuafion de toutes les vérités que
renferme la foi chrétienne, 8c de l’ordre félon lequel ils
doivent; être rangés pour la produire dans l’efprit du fidèle.
O r comme celui qui reçoit les vérités du quatrième ordre
cft nufli convaincu de toutes les autres, on aura fait l’analyfe
de la foi de toutes les vérités chrétiennes, en aflignant les
motifs raifonnés qui produifent la perfuafion d’une vérité du
F O I 751
quatriemé ordre, d’un myfterc par exemple. Difficulté qu’on
éprouve ici à placer dans un ordre naturel 8c raifonnable
deux motifs q u i , félon la doélrine de la foi catholique,
doivent entrer dans lanalyfe de la foi; favoir l’autorité de
1écriture 8c celle de 1 églife. De-lit pluficurs méthodes différentes
danalyfer la. foi. Ibid. 10. a. Expofition de celle
que 1 auteur adopte: elle confiflcxn une chaîne de vérités
qui fe déduifent cxaélcmcntlcs unes des autres 8c trouvent
ainfi leur preuve 8c leur fondement dans cette vérité générale
qui les embraffe toutes ; la religion chrétienne eft ¿manie de
Dieu. Autre méthode employée par quelques théologiens
dans leurs difputcs avec les proteftans ,- pour élever à un
plus haut degré, s’il étoit pofliblc, l’autorité de l’églifc:in-
convcnicns dans îcfqucls ils font tombés. Ibid. b. Preuve*
en faveur de la métno'dc adoptée par l’auteur. \°. Elle cft
adoptée par de très-habiles théologiens. Ce que dit là-deffus
le P. Jucoiii. Principes d’Holden conformes k ceux de l’auteur.
Ceux de Grégoire de Valence. 2°. Preuve tirée du raifon-
nement. Ibid. 1 1 . a. Réponfes à quelques difficultés qu'oit
peut propofer contre cette méthode danalyfer la foi. Ob'-
jcâion contre ce principe de l’auteur, que ce n’eft pas par
l’autorité de l’églife que nous fommes sûrs de cette propos
fition : les écritures Jont vraies b font la parole de Dieu.
Réponfe à cette objection. Ibid. b. Comment l’auteur expliqué
ce partage de S. Auguftin : evangelio non crederem, niji mi
eccufiee catholicct commoveret auéloritas. Objeélion tirée d’un
partage de M. Boffuct, dans lequel il foutient que le fidelé
baptifé 8c adulte ne reçoit l’écriture que des mains de l’églife-.
Réponfe à cette objeélion. Ibid. 12. a. Autre objcâion. Scloit
l’analyfc de l’auteur, un adulte ne peut pas croire la divinité
des écritures fans les avoir lues. Il ne peut recevoir l’infaii*
libilité de l’églife, fans avoir lu les partages qui rétabliffenfc
Et comme la plupart des chrétiens ne lifent point l’écriture*
ils ne croiront ni k la divinité des livres faims, ni k l’infaillibilité
de l’églifc. Réponfe. Ibid. b. Avantage que la méthode
de l’auteur donne aux catholiques dans leurs difputcs aveé
les proteftans. Analyfes de la foi que proposent les proteftans,
comparées k celle que l’auteur vient d’établir. Le plus grand
nombre des doélcurs proteftans ont dit que l’écriture avoit
des caraéleres qui prouvent fa divinité k celui qui la lit, par
la voie du jugement particulier. Ce qu’on doit entendre par
ce jugement particulier, & jufqu’où s’en étend l’ufagc. Ibid,\
13 .a . 11 faut le diftinguer de Tcnthoufiafmc 8c de l’inipiratiotl
immédiate. Ce jugement particulier n’eft pas admis uniquement
par tous les théologiens proteftans pour juger de la
divinité des écritures. Quant au fens des écritures, tous les
proteftans ont dit que l’efprit prive en étoit juge. Analyfo
de la foi établie par la Placette. Défauts de cette aiialvfe
Ibid.- b. i
De l'objet de la fo i. C ’cft particulièrement à la perfuafiort
des vérités du quatrième ordre ( voyez ci-dcffus pag. 8. b. )
3uc les théologiens donnent le nom de fo i. C ’cft pourquoi
ans la fuite de cet article, nous prendrons ordinairement
le mot fo i pour la perfuafion des vérités de cet Ordre. Deux
queflions fur ces vérités. De quelle maniéré un dogme doit-
il être contenu dans la révélation pour être aéluellemcnc
l’objet de notre foi i D e quelle maniéré un dogme doit-il être
contenu dans la révélation pour devenir l’objet d’une perfuafion
que Dieu exige de nous par iinc nouvelle définition
de l’églile ? Réponfe à la première queftion. Un dogme,
pour être l’objet de la fo i, doit être contenu dans la révé-*
lation avec une certitude qui exclue toute cfpcce de doutèi
Diverfes fortes de propofitions contenues dans la révélation!
Ibid. 14. a. Un dogme qui y cft contenu d’une manière
expreffe, cft un objet de fo i, indépendamment d’une nouvelle
définition. Cela cft auffi vrai de ceux qui y font contenus
comme conféquencc de deux propofitions révélées.
Les propofitions contenues dans l’écriture , comme déduites
de deux propofitions, dont l’une eft révélée, Se l’autre
connue par la lumicre naturelle, font encore de fo i, indépendamment
d’une nouvelle définition de l’églifc: raifons qài
engagent l’auteur de s’écarter en cela de l’opinion commune.
Ibid. b. II eft impofiiblc de citer une feule conféquence de
cette cfpcce, qui ne foit vraiment de foi, 8c qu’on ne regarde
dansl’églife comme telle. Réponfe à la fécondé queftion propoféc
dans la page précédente ( Colonn. a. ). Les propofitions
contenues dans la révélation, comme conféquenccs des deux
prémiffes, dont l’une cft révélée, 8c l’autre conflue par la
raifon, mais dépourvue d’évidence, 8c fufceptiblc de qucl-
qu’cfpccc de doute 8c d’incertitude, ne font point de foi
indépendamment d’une nouvelle décifton de l’e g liic, 8c cllos
le deviennent dès que cette décifton a lieu. Ces propofitions
font aufli l’objet propre 8c particulier de la théologie. Obicr-
vations fur ce qu’on appelle une conclufion rhéôlogique.
Ibid. xç. a. Examen de cette queftion de S. Thomas: le
nombre des articles de foi s’cft-il augmenté par la fucccftion
des tems? Autre queftion examinée. Quand eft-ce qu’une
propofition cft déclarée fuffifaminent par l’églifc contenue
dans la révélation, de forte-que par cette .déclaration -cllv