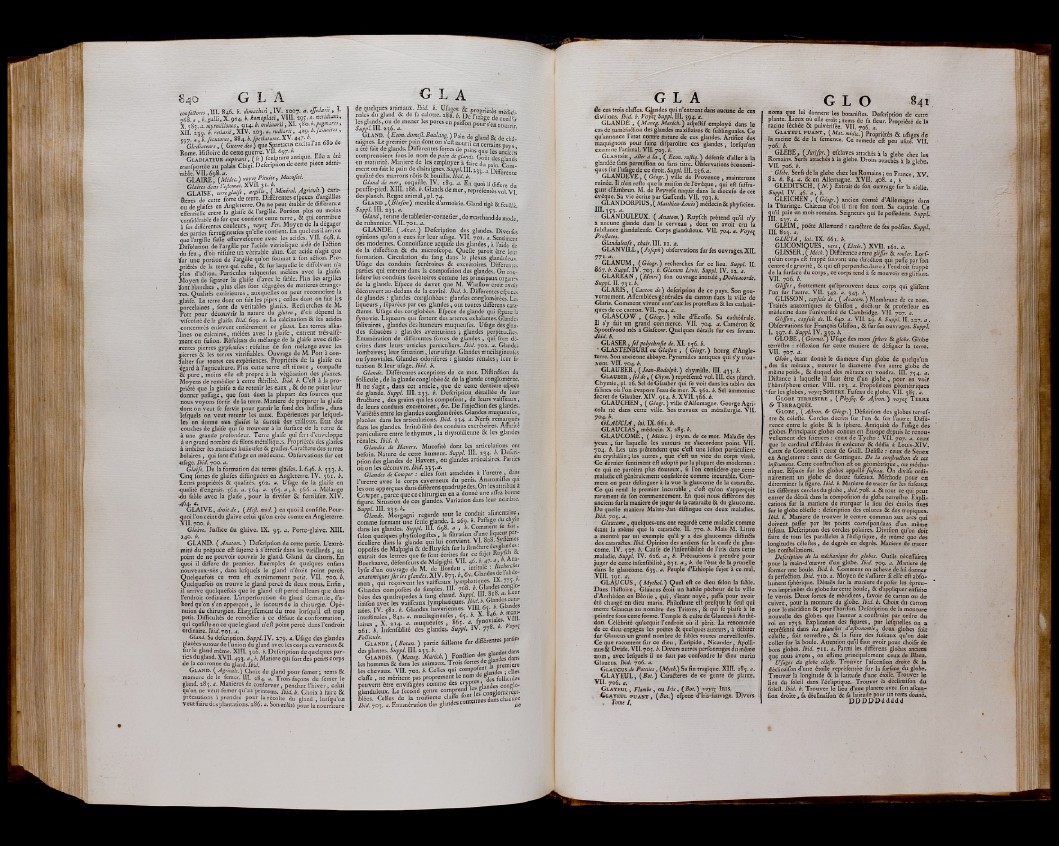
G L A G L A
conf'ltorts ,111. «4«. i- dm a ch c i , \ V . 1007. <r. s ß J a r ü , *•
768. 4 , A..g4//z, X .914-f- homoflaci, VIII. 295. a. menduni,
X. 182.4. myrmiüoncs, 914. A. ordinarii, X I. 580. b.pegmaresy
XII. 230. A. relia nt, X IV . 203. <t. radiari/', 429. b. Ja,imites ,
«97. a , A. fccutorts, 884. b.fpetlatures.X V . 447. A.
Gladiateurs, ( Guerre d es) que Spartacus excita I an 680 de
Rome. Hiftoire de cette guerre. VII. 697. A.
G ladiateu r expirant, ( l e ) fculpture antique. Elle a été
tranfportée au p a lis Chigi. Defcription de cette p.ece admirable.
V IL 698. <z. . xê r r
G L A IR E , P S w f t ) voyez Pituitey Mucofue.
Glaires dans l'eßomac. XVII. 3 1. b .^
GLAISE terre g la ife , argille , ( Muterai Agridult. ) cara
ôeres de celle forte de terre. Différentes ejpeces J «*>»>“
ou de slalfo en Angleterre. On ne peut établir de différence
effentielle entre la glaife & l'arglUe. Portion plus ou moins
'confidérable de fer que contient cette terre, 8c qui contribue
à fes differentes couleurs , voyt{ Fer. Moyen de la dégager
des parties ferrugineufes qu’elle contient. En quel cas il arrive
que l’argille faife effervescence avec les acides. VII. 698. A»
DifTolution de l’argille par l’acide vitriolique aidé de 1 action
du f e u , d’où réfulte un véritable alun. Cet acide nagit que
fur une portion de l’argille qu’on fouiuet a fon aclion. Pro-,
priétés de la terre qui refte, 8c fur laquelle le diffolvant n a
dIus d’aâion. .Particules talqueufes mêlées avec la glaife.
Moyen de Sparer la glaife d’avec le fable. Plus les argilles
Yont blanches , plus elles font dégagées de matières étrangères.
Qualités extérieures , auxquelles on peut reconnoitre la
glaife. La terre dont on fait les pipes ; celles dont on fait les
porcelaines , font de véritables glaifes. Recherches de M.
Pott .pour découvrir la nature du g luten, d’ou dépend la
"vifeonté de la glaife. Ibid. 699* a' calcination & les acides
concentrés enlèvent entièrement ce gluten. Les terres alka-
Ünes ou calcaires, mêlées avec la glaife, entrent très-aifë-
ment «n fufion. Réfultats du mélange de la glaife avec différentes
pierres gypfeufes : réfultat de fon mélange avec les
pierres & les terres vitrifiables. Ouvrage de M. Pott à con-
Yulter fur toutes ces expériences. Propriétés de la glaife eu
égard à l’agriculture. Plus cette terre eft ténace , compaâe
& pure, moins elle eft propre à la végétation des plantes.
Moyens de remédier à cette ftérilité. Ibid. A. C ’eft à la propriété
que la glaife a de retenir les eau x, & de ne point leur
donner paffage, que font dues la plupart des fources que
nous voyons fortir de la terre. Maniéré de préparer la glaife
dont on veut fe fervir pour garnir le fond des baflins, dans
lefquels on veut retenir les eaux. Expériences par lefquel-
les on donne aux glaifes la dureté des cailloux. Etat des
couches de glaife qui fe trouvent à la furface de la terre 8c
-à une grande profondeur. Terre glaife qui fert d’envcloppe
à un grand nombre de filons métalliques. Propriétés des glaifes
à imbiber les matières huiieufes 8c graftes. Caraâere des terres
bolaires , qui font d’ufage en médecine. Obfervations fur cet
ufage. Ibid. 700. a.
Glaife. D e la formation des terres glaifes. L 646. A. 533. A.
Cinq fortes de glaifes diftinguées en Angleterre. IV . 561. A.
'Leurs propriétés 8c qualités. 562. a. Uiage de la glaife en
cualité d’engrais. 562. a. 564. a. 565. a , A. 566. a. Mélange
-du fable avec la glaife, pour la divifer 8c fertilifer. XIV.
-464. a.
G L A IV E , droit d e , ( H iß . mod. ) en quoi il confifte. Pourquoi
l’on ceint du glaive celui qu’on c ré e comte en Angleterre.
¡VII. 700. A.
Glaive. Jnftice du glaive. IX. 95. a. Porte-glaive. XIII.
140. A.
G LAN D . ( Anatom. ) Defcription de cette partie. L’extrémité
du prépuce eft fujette à s’étrécir dans les vieillards , au
point de ne pouvoir couvrir le gland. Gland du clitoris. En
quoi il différé du premier. Exemples de quelques enfans
nouvfeaux-nés , dans lefquels le gland n'étoit point percé.
Quelquefois ce trou eft extrêmement petit. VII. 700. A.
Quelquefois on trouve le .gland percé de deux trous. Enfin ;
il arrive quelquefois que le gland eft percé ailleurs que dans
l’endroit ordinaire. L’imperforation du gland demande, d’abord
qu’on s’en apperçoit, le fecours de la chirurgie. Opération
du chirurgien. Elargiffement du trou lorfqu’u eft trop
petit. Difficultés de remédier à ce défaut de conformation,
qui cçtififtc en ce que le gland n’eft point percé dans l’endroit
ordinaire. Ibid. 701. a.
Gland. Sa defcription. Suppl. IV . 279. a. Ufage des glandes
placées autour de l’union du gland avec les corps caverneux 8c
furie gland même. XIII. 300. A. Defcription de quelques parties
du gland. XVII. 493. 4 , A. Maticre qui fort des petits corps
de la couronne du gland. Ibid.
G l a n d . ( Agricult.) Choix du gland pour ferner ; tems &
maniéré de le ferner. III. gg£g g Trois façons de ferner le
gland. 285. a. Manières de confcrver, pendant l ’h ive r , celui
qu’on ne veut ferner qu’au printems. Ibid. A. Choix à faire 8c
précautions à prendre pour la récolte du gland , lorfqu’on
veut faire des plantations. 286; a. Son utilité pour la nourriture
de quelques animaux. Ibid. A. Ufagcs & nronriéfJc W ik *
„ a l i d S gland & dé fa calotte. t8 g. b. D e f f i t d e c a t Î '
9 porcs en pai(ron p°urs’™ w m
G land . (£ « » . JomJUBoutang.) Pain de gland & . , .
taignes. L e premier pam dont on s eft nourri en certains pays
a été fait de glands. D ifférentes fortes de pains que les ancie-rc
comprennent fous le nom d e pain de glands. Goût desulands
en maturité. Maniéré de les employer à faire du pain Con -
ment on fait le pain de châtaignes. Suppl. III. 233.4. Diffé
qualité des marrons rôtis 8c bouillis. Ibid. A. te
¡ | g g d e msr « qu ille. IV . .89. a. En quoi il diffère du
poufTe-pied. XIII. 186. A. Glands de m er, repréfentés vol. VI
desplanch. Regne animal, pl. 74.
G land , ( lila fo n ) meuble d’armoirie. Gland tigé 8c feuille
Suppl. III. 233. a.
Glan d, terme de tabletier-cornetier, de marchand de mode
de rubannicr. V II. 701. a.
G LAN D E . ( A n a t. ) Defcription des glandes. Diverfes
opinions qu’on a eues fur leur ufage. VII. 701. a. Sentiment
des modernes. ConnoifTance acquiîc des glandes, à l’aide de
de la diffeélion 8c du microfcope. Quelle paroît être leur
formation. Circulation du fang dans le plexus glanduleux.
Ufage des conduits fecrétoires 8c excrétoires. Différentes
parties qui entrent dans la composition des glandes. On cou-
fidere’ les conduits fecrétoires comme les principaux organes
de la glande. Efpece de duvet que M. Winfiow croit avoir
découvert au-dedans de la cavité. Ibid. A..Différentes efpcccs
de glandes : glandes conglobées : glandes conglomérées. Les
liqueurs, féparées par ces glandes, ont toutes différens cara-
âeres. Ufage des conglobées. Efpece de glande qui féparc la
Synovie. Liqueurs qui fortent des artères exhalantes. Glandes
falivaires , glandes des humeurs muqueufes. Ufage des glandes
fébacées : glandes avénturines ; glandes perpétuelles.
Enumération de différentes fortes de glandes, qui font décrites
dans leurs -articles particuliers. Ibid. 702. a. Glandes
lombaires; leur fituation, leur ufage. Glandes mucilagineufes
ou fynoviales. Glandes odoriferes : glandes rénales ; leur fi-
tuation 8c leur ufage. Ibid. b.
Glande. Différentes acceptions de ce mot. Diftinâion du
follicule, de la glande conglôbée 8c de la glande conglomérée.
11 ne s’ag it, dans cet article, que de cette derniere efpece
de glande. Suppl. III. 233. A. Defcription détaillée de leur
ftruâure , des grains qui les compofent, de leurs vaiffeaux,
de leurs conduits excrétoires, &c. D e l’injeâion des glandes.
Variétés entre les glandes conglomérées. Glandes muqueufes,
placées dans les articulations. Ibid. 234. a. Nerfs remarqués
dans les glandes. Irritabilité des conduits excrétoires. Affinité
particulière entre le thymus, la thyroïdienne 8c les glandes
rénales. Ibid. A. ' .
Glandes de Havers. Mucofitè dont les articulations ont
befoin. Nature de cette humeur. Suppl. III. 234. A. Defcription
des glandes de Ha vers, ou glandes articulaires. Parties
où on les découvre. Ibid. 23 ç.n.
Glandes de Cowper : elles font attachées à 1 uretre, dans
l’uretre avec le corps caverneux du pénis. Anatomiftes qui
les ont apperçues d a n s différens quadrupèdes. On les attribue à
Cotvpe r, parce que ce chirurgien en a donné une affez bonne
figure. Situation de ces glandes. Variation dans leur nombre.
Suppl. III. 23 <. A. , .. •-
Glande. Morgagni regarde tout le conduit alimentaire,
comme formant une feule glande. I. 269. A. Paffage du chy e
dans les glandes. Suppl. III. 698. a , A. Comment fe ai *
félon quelques phyfiologiftes, la filtration d une
ticuliere dans la glande qui lui convient. VI. 808. y
oppofés de Malpighi 8c de Ruyfch fur la ftrufture des glandes,
extrait des lettres que fe font écrites fur ce fujet uy
Boerhaave, défenfeurs de Malpighi. V II. 46. A. 47- > •: .
ly fe d’un ouvrage de M. de Bordeu » inti , . : .-i> u,in.
anatomiques fu r Us glandes. X IV . 873. b . M Glandes ÿ labde-
men , qui reçoivent les vaiffeaux lymphatiques. 1A- 77v.
Glandes c o n f i é e s de funples III 768. i Glan es conglo;
bces des quadrupèdes à fang chaud. Suppl. III. 811 ■, ■
liaifon avec les vaiffeaux lymphauques. Ibut. b- Gb^ n i i a
nées. IV . 581. b. Glandes havanennes. VIII. 6e. b. Glan
inteftinales, 84a. a. mucilagineufes , 65. b. X. « « g v n I
laires , X . a . 4. a. muqueufes , S 6 5 u fynov.ales.Vni
2 6 1 . A. Infenfiblité des glandes. Suppl. IV . 770- b. y l
^ G lande , {Botan. ) partie faiUan.e fur différentes parti«
des plantes. Suppl. III. 233. A. dans
G landes. (Maneg . Maréch.)JF on a ion des g des dans
les hommes 8c dans les animaux. Trois fortes^ o e g em-iere
les chevaux. V II. 702. A. Celles qui compofe . e^eS
claffe , ne méritent pas proprement le nom ®jes ^Jicuh»
peuvent être envifagées comme des CI7 P“ _’jan(ies Conglo-
glanduleux. Le fécond genre comprend . ^ conel0mcirées.
liées. Celles de la .«Sfieme ■ W . ^ T c h a c / n e
Ibid. 703. a. Enumération des glandes co
G L A
«le ces trois claffes. fo n d e s qui n’entrent dans aucune de ces
«livifions. Ibid. A. Voyeç Suppl. III. 394. a.
GLANDÉ , ( Maneg. Maréch. ) adjeftif employé dans le
cas de tuméiàâion des glandes maxillaires 8c fublinguales. C e
qu’annonce l’état contre nature de ces glandes. Artifice des
maquignons pour faire difparoître ces glandes, lorfqu’on
examine l’animal. VII. 703. A.
. G landes , aller à l a , ( Econ. rufliq. ) défenfe d’aller à la
glandée fans permiffion ou fans titre. Obfervadons économiques
fur l’ufage de ce droit. Suppl. III. 236. a.
GLANDE V E , ( Géogr. ) ville de Provence , maintenant
rumée. Il n’en refte aue la maifon de l’évèque, qui eft iuffra-
gant d’Embrun. M. de Peyrefc naquit dans le diocefe de cet
évêque. Sa vie écrite par Gaffendi. VU. 703. A.
GLANDORPIUS, ( Matthieu-Louis ) médecin 8c phyfteien.
XII.3Ç3. a.
GLANDULEUX. ( Anatom. ) . Ruyfch prétend qu’il n’y
a aucune glande dans le cerveau , dont on avoit cru la
fubftance glanduleufe. Corps glanduleux. V IL 704. a. Voyez
Proftates.
Glanduleufe , chair. III. 1 1. a.
GLANVfiLL, ( Jofeph) obfervations fur fes ouvrages. XU.
7 7 1 . a.
G LAN UM , {Géogr .) recherches fut ce lieu. Suppl. U.
8 6 7 . b. Suppl. IV .'703. A. Glanum Liv ii. Suppl. IV. 12. a.
G LA R E A N , {Henri) fon ouvrage intitulé, Dodtcacorde.
Suppl. II. 731. A.
G LARIS, ( Canton de ) defcription de ce pays. Son gouvernement.
Affemblées générales du canton dans la ville de
Glaris. Comment vivent entr’eux les proteftans 8c les catholiques
de ce, canton. VII. 704. a.
G LA SCOW , ( Géogr. ) ville d’Ecoffe. Sa cathédrale.
U s’y fait un grand commerce. VII. 704. a. Caméron 8c
Spootfvood nés à Glaicow. Quelques détails fur ces favans.
Jbid. A.
GLASER , f e l pofyehrefte de. XI. 156. A.
* GLASTENBURI ou Glafton , ( Géogr. ) bourg d’Angleterre.
Son ancienne abbaye. Pyramides antiques qui s’y trouvent.
VII. 704. A.
GLAUBER j ( Jean-Rodolph. ) chymifte. III. 433. A.
. G l a u b e r , f e l d e 9 { Chym. ) repréfenté vol. III. des planch.
Chymie, pl. 16. Sel de Glauber qui fe voit dans les tables des
falines où l’on évapore l’eau de mer. X. 362. A. Sel ammoniac
fecret de Glauber. XIV. 914. A. XVII. 366. A.
G LAU CHEN , ( Géogr. ) ville d’Allemagne. George Agricola
né dans cette ville. Ses travaux en métallurgie. VII.
704. A.
G L A U C I A , loi. IX. 661. A.
G LAU C IA S , médecin. X. 285. A.
G L A U C OM E , ( Médec. ) érym. de ce mot. Maladie des
ÿ e u x , fur laquelle les auteurs ne s’accordent point. VII.
704. A. Les uns prétendent que c’eft une léfion particulière
«lu cryftaUin ; les autres, que c’eft un vice du corps vitré.
C e dernier fentiment eft adopté par la plupart des modernes :
ce qui ne paroitra plus douteux, fi l’on confidere que cette
maladie eft généralement confidérée comme incurable. Comment
on peut diftinguer à la vue la glauconie de la cataraâe.
C e qui rend le premier incurable , c’eft qu’on s’apperçoit
rarement de fon commencement. En quoi nous différons des
anciens furia maniere de juger de la cataraâe 8t du glaucome.
D e quelle maniere Maitre-Jart diftingue ces deux maladies.
Ibid. 705. a.
Glaucome, quelques-uns ont regardé cette maladie comme
étant la même que la cataraâe. I I . 770. A. Mais M. Littre
a montré par un exemple qu’il y a des glaucomes diftinâs
des catareaes. Ibid. Opinion des anciens fur la caufe du glaucome.
IV. 527. A. Caufe de l’infenfibilité de l’iris dans cette
maladie. Suppl. IV . 626. <*, A. Précautions à prendre pour
juger de cette infenfibilité, 631. a , A. de l’état de la prunelle
dans le glaucome. 633. a. Peuple d’Ethiopie fujet à ce mal.
iVIII. 391. a. v.
GLA.U CUS, (M y th o l.) Quel eft ce dieu félon la fable.
Dans l’hiftoire, Glaucus etoit un habile pêcheur de la ville
d ’Anthédon en Béotie , qui, s’étant n o y é , paffa pour avoir
été changé en dieu marin. Philoftrate eft prefque le feul qui
mette Glaucus au nombre des Tritons, & qui fe plaife à le
- peindre fous cette forme. Temple & culte de Glaucus à Anthé-
don. Célébrité qu?acquit l’endroit où il périt. La renommée
de ce dieu engagea les poètes 8t quelques auteurs, à débiter
fur Glaucus un grand nombre de fables toutes mcrveilleufes.
C e que racontent fur ce dieu, Euripide, Nicander, Apolli-
nus oc Ovide. VII. 70^. A. D ivers autres perfonnages du même
nom , avec lefquels il ne faut pas confondre le dieu marin
Glaucus. Ibid. 706. a.
G la u c u s de Potnies, {Myth.) Sa fin tragique. XIII. 185. a.
G L A Y E U L , ( So t. ) Caraâeres de ce genre de plante.
VII. 706.4.
G l a y e u l , Flambe , ou I r is , {B o t .) voye[ Iris. .
G l a y e u l p u a n t , ( B o l ) efpece a’Iris-fauvage. Divers
I Tome /,
G L O 841
noms que lui donnent les botaniftes. Defcription de cette
plante. Lieux ou elle croît ; tems de fa fleur. Propriété de la
racine féchée 8c pulvérifée. VII. 706. a.
G l a y e u l p u a n t , {Mat.médic.) Propriétés 8c ufàges d e
la racine 6c de la femence. Ce remede eft peu ufité! V IL
706. A.
GLEBE , (Jurifpr. ) efclaves attachés à la glebe chez les
Romains. Serfs attachés à la glebe. Droits attachés à la alebe.
VII. 706. A.
.Glebe. Serfs de la glebe chez les Romains ; en France X V
82. A. 84. a. 8c en Allemagne. X VII. 408. a , b. *
GLEDITSCH, ( N . ) Extrait de fon ouvrage fur la nielle.
Suppl. TV. 46. 4 , A.
G LEICHEN, ( Géogr. ) ancien comté d’Allemagne dans
la Thuringe. Château a’où il tire fon nom. Sa capitale. Ce
qu’il paie en mois romains. Seigneurs qui le poffedent. Suppl.
l ll . 237. 4.
GLÊIM, poète Allemand : caraâere de fes poéfiès. Suppl.
III. 823. 4.
G L I C I A , loi. IX. 661. A.
GLICON IQUE S, vers , { Littér. ) XVII. 161. a.
GLISSER, {M é ch .) Différence entre glijfer 8c rouler. Lorsqu’un
corps eft frappé fulvant une direction qui paffe par fon
centre de gravité, & qui eft perpendiculaire à l’endroit frappé
de la furface du corps, ce corps tend à fe mouvoir en elilïant.
VII. 706. A.
G lijfe r , frottement qu’éprouvent deux corps qui gliffent
l’un fur l’autre. VII. 342. a. 343. A.
G LISSON, capfule d e, ( Anatom. ) Membrane de ce nom.
Traités anatomiques de Gliffon , doâcur 8c profeffeur ea
médecine dans l’univerfité de Cambridge. VII. 707. 4.
G h jfon, capfule de. II. 640- a. VII. 29. A. Suppl. II. 227. 4 .
Obfervations lur François G liffon, 8c fur fes ouvrages. Suppl.
I. 397. A. Suppl. IV . 250. A.
G LO B E , ( GéométT) Ufage des mots fpkere 8c globe. Globe
terréftre : réflexion fur cette maniéré de défigner la terre.
VII. 707. a.
Globe, étant donné le diametre d’un globe de quelqu'un
, des fix métaux, trouver le diametre d'un autre globe de
même poids, 8c duquel des métaux on voudra. III. 774. 4.
Diftance à laquelle il faut être d’un globe , pour en voir
rhémifphere entier. VIII. 113. 4. Proportions géométriques
■fur les globes, voyeç Sph e r e . Fufeau de globe, v i l . 385. a.
G l o b e t e r r e s t r e , {Phyfiq. 6* AJlron.) voyt[ T e r r e
& T e r r a q u é e .
G l o b e , {AJlron. 6* Géogr.) Définition des globes terref-
tre 8c célefte. Cercles décrits fur l’un 8c fur raiitre. Différence
entre le globe 8c la fphere. Antiquité de l’ufage des
globes. Principaux globes connus en Europe depuis ie renouvellement
des fciences : ceux de Tycho : VII. 707. a. ceux
que le cardinal d’Eftrées fit exécuter 8c dédia à Louis-XIV.
Ceux de Coronelli : ceux de Guill. Delifle : ceux de Senex
en Angleterre : ceux de Gotdneue. D e la conflruSlion de ces
inftrumens. Cette conftruâion eft ou géométrique, pu mécha-
nique. Efpace fur les globes appelle fufeau. O n divife ordinairement
un globe ae douze fufeaux. Méthode pour en
déterminer la figure. Ibid. A. Maniéré de tracer fur les fufeaux
les différens cercles du g lobe, ibid. 708. a. 8c tout ce qui peut
entrer de détail dans la compofition du globe terreftre. Explications
fur la maniéré de marquer le lieu des étoiles fues
fur le globe célefte : defcription des colures 8c des tropiques.
Ibid. A. Maniéré de trouver le centre commun aux arcs qui
doivent paffer par les points correfpondans d’un même
fufeau. Defcription des cercles polaires. Divifipn qu’on doit
faire de tous les parallèles à l’êcliptique, de même que des
longitudes céleftes, de degrés en degrés. Maniéré de tracer
les conftellations.
Defcription de la méchanique des globes. Outils néceffaires
pour la main-d’oeuvre d’un globe. Ibid. 709. 4. Maniéré de
former une boule. Ibid. A. Commenr on achevé de lui donner
fa perfeâion. Ibid. 7 10 . a. Moyen de s’affurer fi elle eft abfo-
lument fphérique. Détails fur la maniéré de pofer les épreuves
imprimées du globe fur cette boule, 8c d’appliquer enfuite
le vernis. Deux fortes de méridiens, favoir de carton ou de
cuivre, pour la monture du globe. Ibid. A. Choix du carton
pour le méridien 8c pour l’horifon. Defcription de la monture
nouvelle des globes que l’auteur a conftruits par ordre du
roi en 1752. Explication des figures, par lesquelles on a
repréfenté dans les planches d'ajlronomie, deux globes foie
célefte, foit terreftre, 8c la iuite des fufeaux qu’on doit
coller fur là boule. Attention qu’il faut avoir pour choifir de
bons globes. Ibid. 7 1 1 . 4. Parmi les différens globes anciens
que nous avons, on eftime principalement ceux de B laeu.
Ufdges du globe célejli. Trouver l’afcenfion droite 8c la
dédinaifon d’une étoile repréfentée fur la furface du globe.
Trouver la longitude 8c la latitude d’une éroile. Trouver le
lieu du foleil dans l’écliptique. • Trouver Ja dédinaifon du
foleil. Ibid. A. Trouver le lieu d’une planete avec fon afeeq-
fion droite, fa dédinaifon & fi» latitude pour un tertts donné*
D D D D D d d d d d