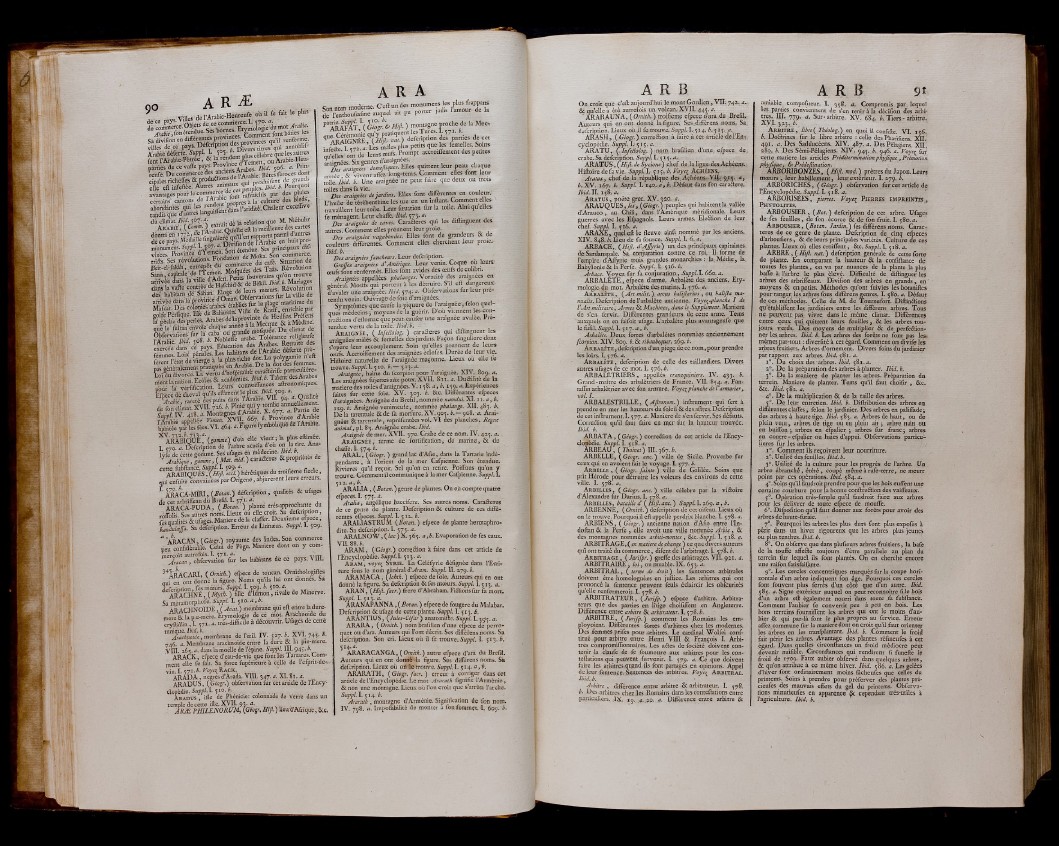
go A R ^
v ile s de l'Arabie-Heùreüfe où M f f M le î t e
Arabie déférte. Suppl 1* 1 5 . s céiebre que les autres
fent l’Arabie-Pétrée, & la reP , ,FV men ou Arabie-Heuï
ï m reufe. D wu cÊomÆmerBce ÊdeSs aSnagedBsi Amra fia^ Ê a ftroc«es »*►
dpalés.richeffes 8t p r o d u a .o iB ^ lA ^ Ai.fcnt d
elle eft infeftêe: Autres animai» q u 'P m J b Pourquo.
du climat. liil-J)°?‘ ?• là rèlàtion que M. Niébubr
. A r'a b ie , i-rtiielle eftla mèaleure dés cartes
dénna 'en I77? E'.éarmd'il'eri rapporta parmi d*autres
dé ce f f î ù : Î>$5ïon dè l'Arabie .en huît 'promonumeps.
W W v i j j étendue. Ses principaux dif-
vîn'ces. Province d Y « w » | o deMoka. Son commette.
trifts. Ses .révolutions. Fonoatmn Situation de
Béit-eWakih , eUtrépSt du c o m m e . p g | Révolution'
Sânà, capitale de 1 Yemen- MoW f0uvéralns qu’on trouve
atjivéë dims.la vilTe, i é Békil. Ibid-b. Mariages
dàioela v^ e .c o n nQ d éH f fc lu Ateuts. Révolution
dés ^ ô i s u ' Obfervations fu i la ville de
w Ê Ê Ë B sM Ë r v W fu È Ê fur lit plage maritime du
Mafcat. Des cotoriies arabes KUtif, éUricliié Par
¿ m Ê m Ê M 11I M S » de HëdftàS. Prélenè
exercée du», ¡ ¡ H i t f . f ¿ S m s dé l’Arabie dêferte pré-
férentTétatde v ierge'à la
trahie rareté des puits dans 1 Aranie. ya k y**- «• 'c.
Ifp’èèë.de c fcv a l p a | ^ P ^ H P Q r f t è
de fon cfinfot. T ^ T P a t t i e d é
f M k 'i iM ^ Prépu ce d’Arabie
À s fâ& 8 i& " ,'iè om m i) d’où eile ¡ 1 | W plus effimée.
I <70. u. Defcripüùn dé l’arbré acacia d ou on la tire. Ana-
lirfe de cette gommé. Ses.ufages en médecine. lbid. b.
.(&■ M ) * * * * * & Pr°fnW*de
' 'S t A B Ï d ü É s ”^ ; / . H ) hérétiques du troifiéme fiecle,
mieiiftiftè cénvàlUèus par Origene, abjurèrent leurs erreurs.
’ ARACA-MIRI, (Botan.) defcription, (Jualltés & ufages
de cet arbrifleâù dii Ôrëfil. 1. 57*’ , x , . «
A R A C A -PU D A , (Bbtàh. ) plante tres-apptochante du
roflolis Ses autres noms!Deux où elle croît. SU defcription,
fes qualités & ufages. Maniéré de la claffer. Deüxieinecipece
Jcandu/atffd. Sa defcription. Erreur delinnam». Suppl. L <09.
a V r A C Â N CGéogr.) royaume des Indes. Son commerce
peu confidérablè. Celui de Pégu. Manière dont on y cotai
rh’efcoit autrefois. I. 371. a.
Aracan, observation fur les hàbitarts de ce pays. VIII,
34aR A C A R I ( Omtih.) efpece de toucan. Ornithdlogiftes
n u ie n o n t donné là figure. Noms qu’ils lùi ont donnés. Sa
defcription, fés moeurs. Suppl. I. toc,. H n a.
A R A CH N É , (Myth. ) fille d’Idtaon, rivale de Minerve
Samétamotphofe.&>>/. 1 s t o .n . i .
AR A CH N OÏD E , ( Anat.) membrane qui eft entre la dure
mere 8c la pie-mere. Etymologie de ce mot. Arachnoïde du
cryftàllin, l. <71. a. très-diffiede a découvnr. Uiages de cettè
tunique.lbid.b,: w •• . v x r t fesi i
Arachnoïde, membrane de 1 oeil. IV . 327. b. XV I. 743. b.
^46. a. Membrane arachnoïde èntré la dure & la pie-mere.
V l l i . 265. <2. dans la moelle de l’épine. Suppl. III. 943. b.
ARACK-» efpece d’eau-de-viê que font les Tartârés. Comment
elle fe fait. §a force Supérieure à celle de refprit-de-,.
v in .I. Voye^RxCK. ’
A R A D A , negres d’Aradà- VIÏI. 347. a. XI. 81. a.
A R A D U S , {Géogr.) obfervahbn fur cet article de l’Ency^
clopèdie. SupplA- l 10- ^ . .. H . . . . . .
A r a d u s , ifle de Phémcie: colonnade de verre dans un
temple de cette ifle. XVII. 93. a-
ARÆ PHILENORUMy {Géogr,H ift.)heu'd Afrique, '&C.
A R A
Son nom moderne. C ’eft ondes monumens les pDs^fm^ans
de l’enthoufiafme auquel ait pu porter ,auo
defcription des parties de cet
X , ! a. Les miles plus P«>« q“ ;les femelles. Soins
urfelkf ont de lenrsoeufi. V n .p t accrodfemcnt des pentes
quittent leur peau d.aqne
année & vivent affeadong-tems. Comment eües font leur
toile, lbid. ¿. Une araignée ne peut faire que deux ou trois
toiles dans fa vie. 1 -
Des araignées de jardins. Elles font différentes en couleur.
L’huile /de térébenthine les rue en- un inftant. Comment elles
travaillent leur toile. Leur Situation fur la toile. Abri qu elles
fe ménagent. Leur chaiïé. lbid. 373.. as , .
Des araignées de caves. Carafteres qui les difhnguent des
autres; Comment elles prértnent leur proie.
Des araignées vagabondes. Elles’ font de grandeurs & de
couleurs différentes. Comment elles cherchent leur proie.
lbid. b. . .
Des araignées faucheurs. Leur defcription. ^ .
GroJJ’es araignées d’Amérique. Leur venin. Coque ou leurs’
oeufs font renfermés. Elles font avides des oeufs de colibri.
Araignées àppellées phalanges. V oracité des araignées en
général. Motifs qui portent à les détruire. S’il eft dangereux-
d'avaler une araignée, lbid. 374: a. Obfervations fur,leur prétendu
venin: OiiVrage de foie d’araignées. •
Symptômes quecaufe la piquiire de l’araignée , félon quel-
ques médecins; moyens de la guérir. D’où viennent les-con-
: traitions d’eflomac que peut.caufer une araignée avalée. Prétendue.
vertu de la toile. lbid:b. -
A r a ig n é e , ( Infedolog. ) carafteres qui diftinguent les
araignées? mâles & femelles des jardins. Façon finguliere dont
s’opère leur accouplement. Soin qu’elles prennent de leurs-
oeufs. Aceroiffement des araignées éclofes. Durée de leur vie.
Hiftoire naturelle de l’araignée, maçonne. Lieux où elle fe
trouve. Supp/.î. 310. ¿ ;— '3.1-3. a*.
Ara ignéehédne du feorpion pour 1 araignee. XIV. 000. a.
Lesarmgnèesfujettesaüxpoux.XVll. 811 .a. Duâilité cle la
matière des toiles d’araienèes. V. 138. a1, b. 139. a. Expériences
faites fur cette foie. XV. 303. ¿. &c. Différentes efpeces
d?araignèes. Araignée du Brefil, nommée namdui. XI. 11. a , b.
n o . b: Araignée veniiiieule, nommée phalange. XII. 483. b.
De la tarentule &de fa morfure. XV. 90*. ¿. — 908. *. Araignées
& tarentule, repréfentées vói. V I des planches, Regie
animal, pL 83. Araignée crabe, lbid. '
Araignée de mer. XVH. 370. Crabe de ce nom. IV. 423. a.
A ra ig n é e , terme de fortification, de marine, & de
chaffe. I. 374^. , ‘
ARAL, {Géogr. ) grand laé d’Afie, dans la Tartane indépendante,
à l’orient de la mer Cafpienne. Son étendue.
Rivières qu’il reçoit. Sel qu’ofi en retire. PoHfons qu’on y
trouve. Comment il communique à la mer Cafpienne. Suppl. L
312. a, b. p .
ARALIA, {Botan.) genre de plantes. On eh compte quatre
efpeces. I. 373. a.
Aralia, angélique baccifere. Ses autres noms. Caraâeres
de ce genre de plante. Defcription & culture de ces différ
rentes efpeces. Suppl. I. 312. b.
ARALLASTRUM {Botan.) efpece de plante hermaphroddiittee*..
SSaa ddeeffccrriippttiioonn.. II.. 337733.. aa..
ARALNO w , ( lac) X. 363. a,b. Evaporation de fes eaux.
VU. 88 .b.
ARAM, {Géogr.) corrç&ion à faire dans cet article de
l’Encyciopédie. Suppl.I. 313. a.
A ram , voye{ Syr ie . La Céléfyrie défignée dans l’Eeri-
ttire fous le nom général à!Aram. Suppl. II. 279. b.
ARAMACA, (ichth. ) efpece de foie, Auteurs qui en ont
donné la figure. Sa defcription & fes moeurs. Suppl. 1.313 .a.
ARAN, {Hift.facr.) frere d’Abraham. Fiétionsfur fa mort.
Suppl. I. 313. a.
ARANAPANNA, {Botan.) efpece de fougere du Malabar.
Defcription & ufage de cette plante. Suppl. I. 313. b.
ARANTIUS, {Jules-Céfar ) anatomifte. Suppl. 1. 3^3. a.
ARARA, ( Ornith. ) nom brafilien d’une cfoece de perroquet
ou d’ara. Auteurs qui l’ont décrit. Ses difïerens noms. Sa
defcription. Son cri. Lieux où il fe trouve. Suppl. I. 313. ¿.
314-a.
ARARACANGA, {Ornith.) autre efpece d’arâ du Brefil.
Auteurs qui en ont donrié'-la figure. Ses différens noms. Sa
defcription. Lieux où orille trouve. Suppl. I. 314* & j‘b.
ARARATH, ( Géogr. facr, ) erreur à corriger dans cet
article de l’Encyclopédie. Lé mot Ararath fignifie l’Arménie,
&non une montagne. Lieux où-l’on croit que s’arrêta l’arohe.
Suppl. 1. 5x4. b.
Araràth, montagne d’Arménie. Signification de fon nom.
IV. 7ç$. a. Impofubilité de monter à fon foramçt, 1, 609: b.
A R B A R B 9 t
On croit que c’eft aujourd’hui le mont Gordien, VII. 744. <*.-
& qu’elle, a été autrefois un volc^ny XVII. 44«. a.
' ARARAUNA, ( Qmith. ) tçoifiejne efpeçe d’ara ,du Brefil.,
Auteurs qui- en ont. donné, la figurei SesidifFérens, noms. Sa.
defcription. Lieux o.ù âl {exronvc. Suppl. I. 314, b. f i $.a._
ARASH, {.Géogr.) correction à,faire;à cet article del’EpT.
cyclopédie. Suppl. b 313. a.
ARATU, {, InfeClolog. ) , npnx brafilien. d’une, efpeçe dçj
crabe. Sa defcription. SuppL I. 315. a,-.
ARAïDUS-, (Hift. de Syçione.) ¡chef de.la ligue des Açhéens.
Hiftoire.de fa vie. Suppl. I< 5 1 5i b, Voyeç A çhéens.
Aratus, chef de la rép.ubliqne dçs. Açhéens^VH/ 913. a9
b. XV. 1674 b: Suppl. I. i^o. dy b. Défaut dans fon caraoçre.
lbid. II. 138. a.
A r a t u s , poëte grec. X y . 320. a.
ARAUQUES, les , ( Géogr. ) peuples qui habitent la vallée
d’Arauco, au Chili, dans l’Amérique méridionale. Leurs
guerres avec les Èipagnols. Leurs arme.s. Election, de leur
chef. Suppl. I. 316. a.
A R A xE , quel eft le fleuve ainfi nommé par les anciens.
XIV, 84$. ¿: Lieu de fa fource* Suppl, L 6. a,
ARBÂCE,. {Hift. d’-Afyrie) un des.prjncipaiix.capitaines,
de Sardanapale. Sa. conjuration contre. c§ rpi. Il- forme de
l’empire dlÀfiyrie trois, grandes monarçlties : la Médie, la,
Babylonie & la Perfe., Suppl., ï; 31^. bf
Arbaçe. Voyez fur fa, conjuration., Suppl. L 660. a.
ARBALÈTE, efpeçe, d’arme, Arhajête des anciens. Ety-
mologie ^u mot. Arbalète, des marinç..L 576. a.
A rbalè te ,. ( Art milit. ) ; arcus baliftarius, ou balifta ma-
nualis. Defcription de Tarbalète ancienne. Voye^planche 1 de
l ’Art militaire , jjrmes & Machines, dans le Supplément. Maniéré
de sîen- fervir. Différentes grandeurs, de cette arme. Tems
auxquels on en faifoit ufage. L’arbaléte plus avantageufe que
le fuul. Suppl. I. 517. a y b.
Arbalète. Deux fortes d’arbalètes nommées anciennement
feorpion. XIV. 809. b. & ribaubequer. 269. b.
A rbalète , defcription d’un, piegç d,e. ce nom, pour prendre
les loirs. I. 376, a.
A r b a l è t e , defcription de celle des taillandiers. Divers
autres ufages de ce mot. L 376. b.
ARBALÉTRIERS, appelles cranequiniers. IV. 433. b.
Grand-maître des arbalétriers de France. VII. 834. a. Fan-
taflin arbalétrier avec fon armure. Voye^ planche de l’armuriery
vol. /.
ARBALESTRILLE, ( Aftronom. ) infiniment • qui fort à
prendre en mer lçs hauteurs dû fqleilÔf dçs.aftres.. Defcription
de cet infiniment.!. 377. a. Maniéré de s’en fervir. Sçs défauts.
Correction qu’il faut faire en p\çr fur la hauteur trouvée.
lbid. b.
ARBATA, ( Géogr. ) correction de cet article de l’Ency-
dopédie. Suppl. I. 318. a.
ARBEAU, ( Thoinet ) III. 367. b.
ARBELLE, ( Géogr. anc. ) ville de Sicile. Proverbe fur
ceux qui en avoient fait le voyage. I. 377. b.
A rbelle , ( Géogr. fainte ) ville de Galilée. Soins que
prit Hérode pour détruire les voleurs des environs dé cette
ville. I. 378. a.
A rbelles , ( Géogr. anc. ) ville célébré par la viCloire
d’Alexandre fur Darius. I. 378. a.
A rbelles, bataille d’ ( Hift.anc. ) Suppl. I. 269. 'a, b.
ARBENNE, ( Ornith.) defcription de cet oifeau. Lieux où
on le trouve. Pourquoi il eft appeué perdrix blanche. I. 378. a.
ARBIENS, ( Géogr. ) ancienne nation d’Afie entre l’In-
doftan & la Perfe , elle avoit une yille nommée Àrbis, &
des montagnes nommées arbiti-montes, &c. Suppl. L $18. q.
ARBITRAGE,( tn matière dtchange) ce que qiyers auteurs
qui ont traité du commerce, difent de l’arbitrage. I. 378. b.
A r b itr a g e , {Jurifpr.) greffe des arbitrages. VU. 921. a.
ARBITRAIRE, loi, ou muable. IX. 633. a.
ARBITRAL, ( terme de droit ) les fentences arbitrales
doivent être homologuées en jultice. Les arbitre? .qui ont
prononcé la fentence peuvent feuls éclaircir les obfcurités
qu’elle renfermeroit. I; 378. b.
ARB1TRATEUR, ( Jurifp. ) efpeçe d’arbitre. Arbitra-
teurs. que des parties .en litige choifiiTent en Angleterre.
Différence entre arbitre & arbïtrateur. 1. 378. b.
ARBITRE, {Jurifp.) comment les Romains les em-
ployoient. Différentes fortes d’arbitres chez les modernes.
Des femmes.prifes pour arbitres. Le cardinal 'Wolfei çonf-
titué pour arbitre ençre Henri VÛI & François I. Arbitres
compromiflionnaires. Les aCfes de fociété doivent contenir
la claufe de fe foumett-re aux arbitres pour les con-
teftations qui peuvent furvenir. I. 579. a. Ce que doivent
faire les arbitres .quand Us font partagés en opinions. Appel
de leur fentence. ^»Qntènc^ des arbitres. Voyez A r b it r a l .
Ibfd.ib.
Arbitre , différence tentre arbitre & arbitrateur. I. 378.
b. Des arbitres chez les Romains dans les conteftations entre
particuliers. JX. 19. ,<j. a. Différence entre arbitre &
ainiable compofiteur. I. 338. a. Compromis. par. lequel
tes Parties conviennent de s’en tenir à la décifion des arbitres,
UI, 779. <z. Sur-arbitre. XV; 684/¿. Tiers - arbitre*
XVI. 3P3. b.
A r bitr e , tibre{ Théolog.) en quoi il confifte. VI. 136.
b. Doftrines fur le libre arbitre : celle des Pharifiens. XII.
491, a. Des Sadducéens. XIV. 487. a. Des Pélagiens. XU!
209, ¿. Des Sémi-Pélagiens. XIV- 94Ç. b. 946. a. Voye[ fur
cette matière les articles Prédétermination phyfique, Prémotion
phyfunuy & Prédejlination.
ARBOR1BONZES , { Hift. mod. ) prêtres du Japon. Leur?
moeurs , leur habillement, leur extérieur. I. 279. b.
ÂRBORICHÉS, {Géogr. ) obfervation fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. I. 318. a.
ARBORJSÉES, pierres. Voye1 Pierres empreintes j
Ph y to l ite s .
ARBOUSIER, {Bot. ) defcription de cet arbrei Ufages
de fes feuilles, de fon - ecorce oc de fon fruit. 1 . 580. a.
A rbousier , {Botan. Jardin. ) fes différens noms. Caracf
teres dç ce genre de plante. Defcription de cinq efpeces
d’arboufiers, &. de leurs principales variétés. Culture de ces
plantes, Lieux où elles croiflent, &c. Suppl, I. 518. a.
ARBRE, {Hift. nat.) defcription generaie de cette forte
de plante. En comparant la hauteur & la confiftance de
toutes les plantes., on va par nuances de la plante la plu?
baffe à; l’arbre le plus, élevé. Difficulté de diftinguer le?
arbres des arbriffeaux. Divifion des arbres en grands, en '
moyens & en petits. Méthodes qu’ont fuivies les botaitiftes
pour ranger, les arbres fous différens genres. L 380. a. Défaut
de çes méthodes. Celle de M, de Tournefort. Diftinétions
qu’ét^hhffent les. jardiniers entre les différens arbres. Tous
ne peu,ven| p^s, viyre dans le même climat; Différences
entre ceux qui, quittent leurs feuilles, & les arbres toujours,
yeydsp Des moyens de multiplier & de perfectionner
les arbres, lbid. b. Les arbres des forêts ne font pas les»
mêmespaMout : diyerfité à cet égard. Comment on divifè les
arbres, fruitiers. Arbres d’ornement. Divers foins du jardinier
par rapport aux arbres. Îbid, 381. a.
i°. Du choix des/arbres, lbid. 381. a.
2°. De la préparation des arbres à planter, lbid. b.
3°. De la maniéré de planter les arbres. Préparation du
terrein. Maniéré dç planter. Tems qu’il faut cnoifir , &c.
&c. Ibid. 382. a:
4°. De la miütiplication & de la taille des arbres.
3°. De leiir entretien. îbid. b. Diftribution des arbres en
différentes claffes, félon le jardinier. Des arbres en paliffade;
des arbre? à haute tige. lbid. 383.4. Arbres de haut, ou de
plein vept, arbres de tige ou en plein air; arbre nain ou
çn buiffon ; arbres en efpalier ; arbres fur franc; arbres
en contre - efpalier ou haies d’appui. Obfervations particulières
fur le? arbres.
i° . Comment il? reçoivent leur nourriture.
2®. Utilité de? feuilles.' lbid. b.
3°. Utilité de la culture pour les progrès de l’arbre. Un
arbre ébranché, étêté, coupé même h raie-terre f ne meurt
point par ce? opérations, lbid. 384. a.
4°. Soins qu’il faudrait prendre pour que les bois euflent une
certaine courbure pour la bonne conftruétion des vaiffeaux.
3°. Opération très-fimple qu’il faudrait faire aux arbres
pour les délivrer de toute efpece de moufle.
6°. Difoofition qu’il fout donner aux forêts pour avoir des
arbres de haute-futaie.
7°. Pourquoi le? arbres les plus durs font plus expofés à
périr dans un hiver rigoureux que les arbres plus jeunes
ou plu? tendres. Ibid. b.
8°. On obferye que dans plufieurs arbres fruitiers, la bafe
de la touffe affefte toujours d’être parallèle au plan du
terrein fur lequel ils font plantés. On en cherche encore
une raifçn fatisfaifante. .
90. Les cercles concentriques marqués fur la coupe horizontale
d’un arbre indiquent fon âge. Pourquoi ces cercles
font fouvent plus ferrés d’trn côte que d’un autre. Ibid.
383. a. Signe .extérieur auquel on peut reconnoître file bois
d’un arbre eft également nourri dans toute fa fubftance.
Comment l’aubier fe convertit peu à peu en bois. Les
bons terrains fourniffent les arbres qui ont le moins d’aubier
& qui par-là font le plus propres au fervice. Erreur
affez commune fur la maniera dont on croit qu’il faut oriente/
les arbres en les tranfplantant. Ibid. b. .Comment le froid
foit périr les arbres. Avantage des plantes rêfineufes à cet
égard. Dans quelles circonftances un froid médiocre péfit
.devenir nuifible. Circonftances qui rendirent fi fùnefte le
froid de .1709. Faux aubier ohfervé dans quelques arbres ,
& qu’on attribue à ce même hiver. Ibid. 386. a. Les gelées
d’hiver font ordinairement moins ficheules que celles du
printems. Soins à prendre pour préferver des plantes pré-
cieufes des mauvais effets du gel du printems. Ôbferva-
tions minutieufes en apparence 8c cependant très-utiles à
l’agriculture. Ibid. b.