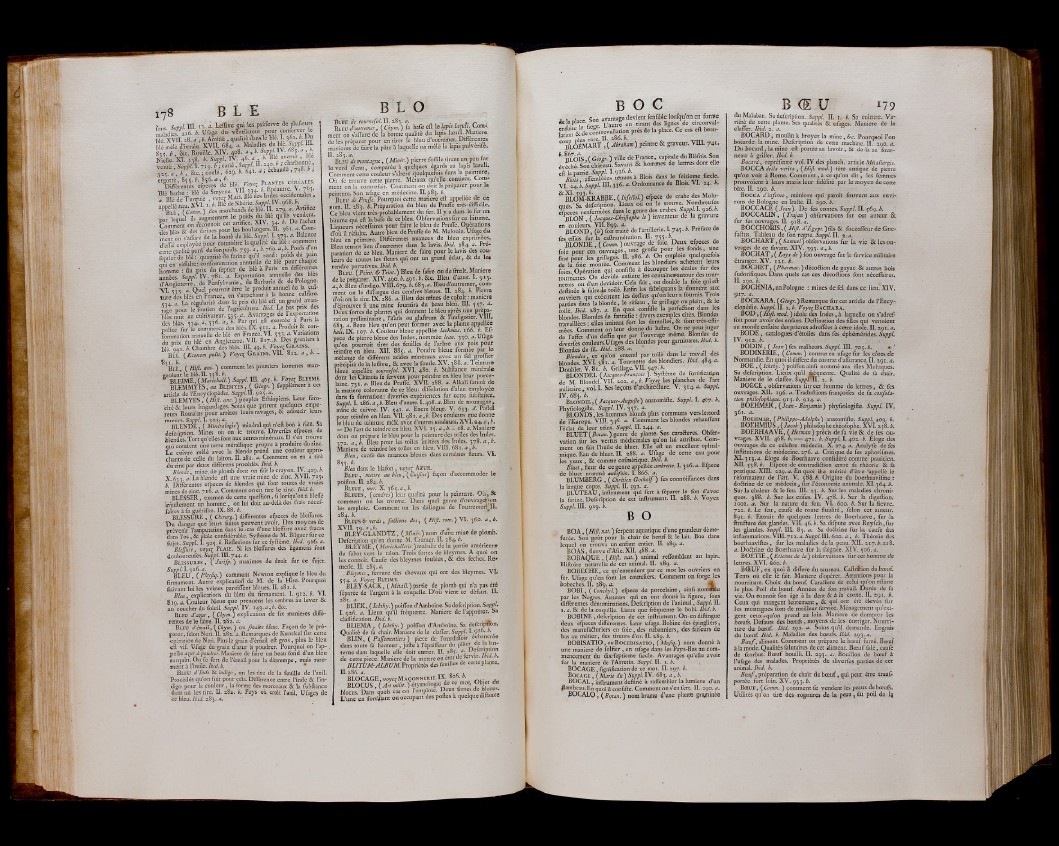
1 7 8 B L E B L O
fo„s Suppl. III. il 1 Lêffive qm les prêferfe i e plqfieurs |
S d i e s eië. i. Ufage d u - yfmilatem p o u r conferver le
blé XVn 28. a b. Amitié, qualité dans le ble. 1. 362. b. Du J
blé'mêlé d’ivraie. XVIL 684. a Maladies du ble. W . | |
8, 5. b , 'Sic. Rouille. XIV. 408. a , ï. S fffl. I V g g g u | |
Nielle XI 118. b.'Suppl. IV: 46. 4 , i. Blé a™ * ! , blé
I f l p S p ? t . 7.9. ê , carié;& .« * Û. » I ¿ g j j g j -
3“ “ ê , 8cc. ; coulé, 619-é- 041. e ; échaudé , 748. i , isllliifel «M fejfw U p M b1é f ^ M Ä d e s Iules occidcnJes3,
1 , Æ S % - S W ' - 1 V . 9Î8.*. g
apIn.^ ( ¿om,„. ) ¡¡es marchands de blé. IL 2-79. u. Artifice 1
par lequel Us augmentent le poids du b l e | | | * J | | g | g I
Comment on ieconnoit cet artifice. XIV. 34- ®g L,e M B 1
d e sÄ s & des farines pour les boulangers,II. 36t. a. Com-
menton s’affiire de la bonté du blé. Suppl. I. 379. 1 Balance I
d’eflii employée pour cônnoitre la qualité du ble : comment
cette qualité perd defonpoids. 739.4;i. 760.4,é. Poids dun
feotier de blé : quantité de farine qu il rend : poids du pain 1
qui en rèfulte: corifomniation annuelle de blé pour chaque I
homme : du prix du feptier de blé a Pans en differente I
années. Suppl. IV. 781. 4. Exportation annuelle des bies I
d’Angleterre, de Penfylvanie, de Barbarie & de Pologne. I
V I r i t j . Q u e l p o u r r a it ê tre lé prodmt annuel de la cultu
r e des blés en France, en s’attachant à la bonne culture,
eta 4 . La régularité dans lç prix du blé e f t un grand avantage
oout le foutien de l’agriculture, lbii. Le bas p r ix des
blés nuit. au cultivateur. 333. 4. Avantages de 1 expopagon
dU blés eau. 4. « « . U, t. Par qui eft exercée a Pans la
police fiir ?e commerce des blés. IX. 3 1 1. 4. Produit & con-
fommarion annuelle de blé en France. VI. 333.4. Variations ]
du prix du blé . en Angleterre. VII. 817..Î. Des greniers à
blé. 941. b. Chambré des blés. I1L 49. b. Çrains.
] j (Econom polir.) Voye[ GrainS.VÏI. 81a. 4, b. -
( Hifi. une. ) comment les premiers hommes maneeoient
le blé- H- 3 î®* b• _
BLEIME, ( Murée h a II. ) Suppl. HL 4° 5-1 Ble*me-
BLEMMYES, ou B lemyes , ( Géogr. ). fupplément à cet
article de l'Encyclopédie. Suppl.11. 92.5.a.
BLEMYES, {Hiß. anc.) peuples Ethiopiens. Leur férocité
& leurs brigandages. Soins que prirent quelques empereurs
Romains pour arrêter leurs ravages, & adoucir leurs
moeurs. Suppl. I. 925. a.
BLENDE, ( Mineralogie) minéral qui n eft bon a rien, ba
defeription. Mines où on le trouve. Diverfes efpeces de
blendes. Tort qu’elles font aux autres minéraux. Il s en trouve
qui contient une terre métallique propre à produire du zinc.
Le cuivre mêlé avec la blende prend une couleur approchante
de celle du laiton. II. 281. a. Comment on en a tiré
I
du zinc par deux différens procédés. Ibid. b.
Blende, mine, de plomb dont on fait le crayon. IV. 429. b.
X 633. a. La blende eft une vraie mine de zinc. XVII. 715«
b. ’ Différentes efpeces de blendes qui font toutes de vraies
mines de zinc. 716. a. Comment on en tire le zinc. Ibid. b.
BLESSER, examen de cette queition, filorfqu’on a bleffé
injuftement un homme, on lui doit au-delà des frais nécef-
faires à fa guérifon. IX. 88. é. .
BLESSURE , ( Chirurg.) différentes efpeces de bleflures.
"Du danger que leurs fuites peuvent avoir. E)es moyens de
prévenir l’amputation dans le • cas d’une bleffure avec fracas
dans l’os, & plaie confidéràble. Syftême de M. Bilguer fur ce
fujet. Suppl. 1. 925. b. Réflexions fur ce fyftême. Ibid. 926. a.
Bleffure, voye{ Plaie. Si les bleifures des ligamens font
douloureufes. Suppl. III. 744. a. . g . .
B lessures , ( Jürifp. ) maximes de droit fur ce fujet.
( Phyfiq. ) comment Newton explique le bleu du
firmament. Autre explication de M. de la Hire. Pourquoi
fuivant lui les veines paroiffent bleues. II. 281. A
Bleu, explications du bleu du firmament. I. 912. b. VI.
819. a. Couleur bleue que prennent les ombres au lever &
au coucher du foleil. Suppl. IV. 143. a,b. &c. ^
Bleu d’azur, (Chym.) explication de fix maniérés differentes
de le taire. IL 282. a.
Bleu d'émail,(Chym.) ou . fmake bleue. Faconde le préparer,
B lEÜ de toumefol. II. 283. à. . .. -, j
Bleu d'outremer, ( Chym.) fa bafe eft le lapis larult. Corn,
ment ori s’affure de la bonne qualité du lapis. lazuh. Manière
de les préparer pour en tirer le bleu d’outremer, pmérentes
maniérés de faire la pâte à laquelle on mêlé le lapis, pulyerifé*
u. 283.0. W êê
B leu de montagne, (Aimer.) pierre foffile tirant un, peu lur
leverd d’eau, comparée à,quelques égards au lapis lazuli.
Comment cette couleur ë’altere' quelquefois dans la peinture.
Où fc trouve cette pierre. Métaux qu’elle contient, comment
félon Neri. II. 282. a. Remarques de Kunckel fur cette
‘ opération de Neri. Plus le grain d’émail eft gros, plus le bleu
eft vif. Ufage du grain d’azur à poudrer. Pourquoi on l’appelle
a^ur à poudrer. Maniéré de faire un beau fond d’un bleu
turquin. On fe fert de l’émail pour la détrempe, mais rare-
- ment à l’huile. Ibid. b.
Bleu d’Dide 8c indigo, on les tire de la feuille de l’anil.
Procédés qu’on fuit pour cela. Différence entre l’inde & l’indigo
pour la couleur, la forme des morceaux & la fubftancc
dont on les tire. II. 282. b. Pays où croît l’anil. Ufages de
ce bleu. Ibid. 283. a.
on la contrefait. Comment on doit la préparer pour la
peinture. Son ufage en médecine. II. 783. b.
B leu de Pruffe. Pourqiioi cette, matière eft appellee de ce
nom. II. 283. b. Préparation du blèu de Pruffe très-difficile.
Ce bleu vient très-probablement du fer. Il y a dans lé fer un
bitume qui eft labàfe de ce bleu. Obfervations fur ce bitume,
liqueurs riéceffaires pour faire le bleu de Pruffe. Opérations
d’em il réfulte. Autre bleu de Pruffe de M. Maloùin.Ufagedu
bleu en peinture. Différentes nuances de bleu exprimées.
Bleu tenant lieu d’outremer dans le lavis. Ibid. 284. a. Préparation
de ce bleu. Maniéré de faire pour le lavis des couleurs
de toutes les fleurs qui ont un grand éclat, 8c de les
rendre portatives. Ibid. b. ’ .
Bleu. (Peint. & Temt.) Bleu de faire ou de fmalt. Manière
de le préparer. XIV. 490. é. 491. b. &c. Bleu d’âzurl I. 913.
a, b. Bleu d’indigo. VIII. 679. ¿. 683. a. Bleu d’outremer, com-
I ment on le diftingue des cendres bleues. II. 284. b. Pierre
d’où on le tire. IX. 286. a. Bleu des mines de cobalt : mamere
d’éprouver fi une mine fournira du beau bleu. 1U. 557* a‘
Deux fortes de plantes qui donnent le bleu après une préparation
préliminaire, l’ifatis oujjlaftrum & 1 indigotier. VIII»
683. a. Beau bleu qu’on peut former avec la plante appellee I kali. IX. 107. b. Couleur bleue appellée laekmus. 166. b. Ef- I pece dé pierre bleue des Indes, nommée leao. 330. ¿.Ufagê I qu’on pourroit tirer des feuilles de l’arbre aux {ibis pour
1 teindre én bleu. XII. 88<r. a. Poudré bleue formée par le I mélange de différens acides minéraux avec un fel groffier
précipité de laleffive, & avec la I foude. XV. 388. a. Teinture bleue appellée toumefol. XVI. 480. b. Sübftance minerale I dont les Chinois fe fervent pour peindre en bleu leur porce- I laine. 73 t . a- Bleu de Pruffe. XVII. 288. a. Alkali faturé de
la matière colorante dé ce bleu: diffolution d’alun employée I dans fa formation: diverfes expériences fur cette fubftance. I Suppl. I. 286. a , b. Bleu d’anate. 1. 408. <z. Bleu de montagne, I mine de cuivre. IV. 341. a. Encre bleqe. V. 633. d. Paftel I pour teindre en bleu. VII. 981. a, b. Des couleurs que donne I le bleu de teinture mêlé avec d’autres couleurs. XVl. 24. a,b.
— Dé l’art de teindre en bleu. XVI. 13. a , b. - 18. a. Maniéré I dont on prépare le bleu pour la peinture des toiles des Indes. I 372. a, b. Bleu pour les toiles imitées des Indes. 378. a , b. I Maniéré de teindre les toiles en bleu. VUï. 681. a , b.
I Bleu, caufe des nuances bleues dans certaines fleurs. VL I 855- b.
j Bleu dans le blafon, voyez Azvk.
Bleu, mettre au bleu, ( Cuifuie) façon d’accommoder le
I poiffon. II. 284. b.
II Bleue, mer. X. 363.a, b. Bleues , ( cendres) leur qualité pour la peinture. Où^ 8§
comment on les trouve. Dans quel genre d’ouvragépon
les emploie. Comment on les difungue de l’outremen^II.
284. b.
Bleu s & verds, faélions des, ( Hiß. rom.) VI. 360. a,b.
XVII. 59. a,b. . ■ « . , , • .
BLEY-GLANDTZ, {Miner.) nom d’une mine de plomb.’
Defeription qu’en donne M. Cramer. II. 284. b.
BLEYME, {Marcchallerie ) maladie de la partie antérieure
du fabot vers le talon. Trois fortes de bleymes. A quoi on
les connoît. Caufe des bleymes foulées, & des feches. Rer
mede. II. 283. a. __
Bleymes, ferrure des chevaux qui ont des bleymes. VL'
534. a. Voyez BlEIME.
BLEY-SACK, {Métall.)partie de plomb qui n’a pas été
féparée de l’argent à la coupelle. D’où Vient ce défaut. H.
283. a. . ’
BLIEK, {.Ichthy. ) poiffon d’Amboine. Sa defeription. Suppl» I I. 926. a. Lieux qu’il fréquente. Maniéré de l’apprêter. Sa
I claffification. Ibid. b. " .
i BLIEMA , I Ichthy. ) poiffon d’Amboine. Sa defcripnbn.
J Qualité de fa chair. Maniéré de le claffer. Suppl. I-926- b.
j BLIN, I Paffementiers) piece de l’ourdiffoir échancrée II tdearnnse toduantes lfaaq huaelulete uelrl,e judfotiet àe nl’térpeari.f fIeIu. r2 d8u5 .p ial'.i eD*Le ”:fc n*.ap u.onn"
I de cette piece. Maniéré de la m e t tr e e n état de iervir. / . .
j . BLITUM-ALBUM. Propriétés des feuilles de cette plante.
I ü. 286. a. „ s ,
| BLOCAGE, voyez Maçonnerie. IX. 806. b. - ■
BLOCUS, ( Art milit. ) étymologie de ce mot, Objet du
blocus. Dans quels cas on l'emploie. Deux fortes de blocus.
L’une en forfifeint ou occupant des poftes à quelque ddtance
B O C B (S U I79
.. t 1 . . Cnn avantaee devient fenfible lorfqu'otl en forme
Âe)aplt fieuê S ’ I en tirant des lignes"de cirçonval-
Uûon & Je contrevallation près de la place. Ce cas eft beau-
“ bÎÆéMART1,1^ Jlrahum ) peintre & graveur. VIII. 741.
S RLOß ( Gioèr. ) ville de France, capitale du Blêfois. Son
é v ê c h é . S^h château. Savans & hommes de lettres dont eUe
e* iL P?faffeS é e s '?m u e sà Blois dans le feizieme fiede.
VI. a4.LÿBpp/.IH,33fi.‘'-0 ,'fiennancede Blots,VI. a4. A
& B L 'Æ kR A B B E , éW Ê Ë . elpece de crabe des Moto-
ques. Sa defeription. Lieux oir on le trouve. Nombreuies
efpeces renfermées dans le genre des crabes. Suppl. L 926. g
BLON , ( Jacquts-Chrifiophe U ) inventeur de la gravure
'"bLOND j « 5 fonvraitè de l’artillerie. L 745-h- Préface de
fes eflais fur la caftramétation. IL 7(5. ».
¡BLONDE, ( Comm. ) ouvrage de foie. Deux efpeces de
foie pour ces ouvrages, une greffe pour les fonds, une
fine pour les grillages, n . 286. b. On emploie quelquefois
de la foie montée. Comment les blondiere achètent leurs
foies. Opération qui confifte à découper les écales fur des
tournettes. On devide enfiüte les centamesrautour des tour-
nettes ou d’un dévidoir. Cela fait, on double la foie qui eft
deftinée à faire 4e toilé. Enfin les fàbriqnans la- donnent aux
ouvriers qui exécutent les deffms qu’on leur a fournis. Trois
parties dans la blonde, le réfeau , fe grillage ou plein, & le
toilé Ibid. 287. a. En quoi confifte la perfeéhon dans les
blondes. Blondes de fentaifie : divers exemples cités. Blondes
travaillées : elles imitent fort les dentelles, & font tres-efti-
mées. Comment on leur donne du luftre. On ne peut juger
de l’effet d’un deffin que par l’ouvrage même. Blondes de
diverfes couleurs.Ufages des blondes pour garmtures. Ibid. b.
Blondes de fil.. Ibid. 288. a. ^
Blondes , ce qu’on entend par toilé dans le travail des
blondes. XVI. 381. a. Tournette des blondiers. Ibid. 484. a.
Doublet.V.81. b. Grillage.VII.947. b. f .
BLONDEL Uacques-François).'Syftême de fqrtihcatipn
de M Blondel. VII. 202. a, b. Voye[ les planches de l’art
militaire, vol.I. Ses leçons'd’architeôure. V. 314.a.-Suppl.
IV. 683. b. t
B londel,{ Jacques-Augufie) anatomifte. Suppl. I. 407. b.
Phyfiologifte. Suppl. IV. 337, a.
BLONDS, les hommes blonds plus communs verslenord
de l’Europè. VIII. 346. a. Comment les blondes rehauffent
l’éclat ,de leur teint. Suppl. II. 244. a.
BLUET {Botan. ) genre de plante. Ses caractères. Obfer-
vation fur les vertus médicinales qu’on lui attribue. Comment
on fait l’huile de bluet. Elle eft un excellent ophtalmique.
Eau de bluet. II. 288. *. Ufage de cette eau pour
les yeux, & comme cofmétique. Ibid. b.
Bluet, fleur de ce genre appellée ambrette. I. 326. a. Eipec«
de bluet nommé aubifoin. I. 8.66. a.
BLUMBERG, ( Chrétien Gotholf) fes connoiffances dans
la langue copte. Suppl. II. 392. a.
BLUTEAU, infiniment qui fert à féparer le fon d avec
la farine. Defeription de cet infiniment. II. 288. b. Voyez
Suppl. n i . 919. b.
B O
BO A , {Hiß.nat.) ferpent aquatique d’une grandeur déme-
furée. Son goût pour la chair de boeuf & le lait. Boa dans
lequel on trouva un enfant entier. II. 289. a.
BOAS, fleuve d’Afie. XII. 488. a.
BOBAQUE, {Hiß. nat.) animal reffemblant au lapin.
Hiftoire naturelle de cet animal. II. 289. a.
BOBECHE, ce qu’entendent parce mot les ouvriers en
fer. Ufage qu’en font les couteliers. Comment on forgeles
bobeches. II. 289. a. f l f
BOBI, {Cohchyl.) efpece de porcelaine, ainfi nommée
par les Negres. Auteurs qui en ont donné la figure, fous
différentes dénominations. Defeription de l’animal, Suppl. H.
i.a.Sc de la .coquille. Lieux que fréquente le bobi. Ibid.b.
BOBINE, defeription de cet inftrument. On- en diftingue
deux efpeces différentes. Leur ufage. Bobine des épingliers,
des manufacturiers en foie, des rubanniers, des faifeurs de
bas au métier, des tireurs d’or. II. 289. b.
BOBISATIO, ou Bocedisatio , ( Mufiq. ) nom donné à
une maniéré de folfier, en ufage dans les Pays-Bas au commencement
du dix-feptieme fiecle. Avantages qu’elle avoit
fur la maniéré de l’Arretin. Suppl. II. 1. b.
BOCAGE, lignification de ce mot. II. 297. b.
Boca ge, {Marie du) Suppl. IV. 683. a , b.
BOCAL, inftrument deftiné à raffembler la lumière d’un
flambeau. En quoi il confifte. Comment on s’en fert. II. 290. a.
BOCALQ a {Bojan. ) nom brame d’une plante gr«ypinée
du Malabar. Sa defeription. Suppl. IL I. b. Sa culture. Vâ-
riété de cette plante. Ses qualités & ufages. Maniéré de la
claffer. Ibid. 2. a. 6
BOCARD, moulin a broyer la mine, &c. Pourquoi l’on
bocarde. la mine. Defeription de cette machine. II. 200. a.
Du bocard, la mine eft portée au lavoir, & de-làau fourneau
à griller. Ibid. b.
Bocard, repréfenté vol. IV desplanch. article Métallurgie.
BOCCÀ délia verita , {Hiß. mod.) tète antique de pierre
qu’on voit à Rome. Comment , à ce qu’on dit, les femmes
prouvoient à leurs maris leur, fidélité par le moyen de cette
tête. II. 290. b.
Bo c c a d'infemo, météore qui paroît fouvent aux envi-,
rons de Bologne en Italie. II. 290. b.
BOCCACË {Jean). De fes contes.Suppl. II. 369.b.
BOCCALIN, ( Trajan ) obfervations fur cet auteur &
fur fes ouvrages. II. 918. a.
BOCCHOSlS, ( Hiß. d'Égypt. ) fils 8c fucceffeur de Gne-
faélus. Tableau de fon regne. Suppl. II. 2. a.
BOCHART, ( Samuel) obfervations fur la vie & les ouvrages
de ce favant. X IV. 393. a , b.
BOCHAT, ( Loys de ) fon ouvrage fur Je fervice militaire
étranger. XV. 121. b.
BOCHET, ( Pharmac. ) décoCtion de gayac & autres bois
fudorifiques. Dans quels cas ces décodions font néceffaires,
II. 290. b.
BOCHNIA, en Pologne : mines de fel. dans, ce lieu! XIV.
917. a.
BOCKARA. (Géogr. ) Remarque fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 2. b. Voyc^ BACHARA.
BOD ,{Hiß. mod. ) idole des Indes, à. laquelle on s’adref
ioit pour avoir des enfàns. Deftination des filles qui venoient
au monde enfuite des prières adreffées à cette idole. II. 291 .a.
BODE , catalogues d’étoiles dans fes éphémérides. Suppl.
IV. 912. b.
BODIN, ( Jean ) fes. malheurs. Suppl. III. 703. b. *
BODINÊRIE, ( Comm. ) contrat en ufage fur les côtes de
Normandie. En quoi il différé du contrat d’affurance,. II. 291. a.
BOE , {Ichthy. ) poiffon ainfi nommé aux ifles MoluqueS.
Sa defeription. Lieux qu’il fréquente. Qualité de fa enair.
Maniéré de le claffer. SupptrU. 2. b.
BOÉCE, obfervations fiir cet homme de lettres, & fes
ouvrages. XII. 196. a. Traduilions françoifes de fa confola-
tion philofophique. 913. b. 914. a.
BOEHMER, {Jean - Benjamin ) phyfiologifte. Suppl. IV.
.36.1. a.
B oehmer, {Philippe-Adolphe) anatomifte. Suppl. 409. b.
BOEHMIUS, {Jacob ) philofophe théofophe. XVI. 238. b.
BOERHAAVE, {Herman) précis de fa vie & de fes ouvrages.
XVII. 468. b.— -471. b. Suppl. I. 402.-b. Éloge des
ouvrages, de ce célébré médecin. X. 274. a. Analyfe de fes
inftitutions de médecine. 276. a. Critique de fes aphorifmes.
XI..313. a. Éloge de Boerhaave confiaéré comme praticien.
XIL 338. b. Elpece :de contradifrion entre fa théorie & fa
pratique. XIII. 229. a. En quoi il a mérité d’être fappcllé le
réformateur de l’art. V. <88. b. Origine du boerhaavifine :
doârine de ce médecin, lur l’économie animale. XI. 364.b.
Sur la chaleur & le feu. III. 23. b. Sur les maladies chroniques.
388. b. Sur les crifes. IV. 478. b. Sur la digeftion:
1001. a. Sur la nature du feu. VI. 600. b. Sur la fievre.
722. b. Le feu, caufe de toute fluidité, félon cet auteur.
891. b. Extrait de quelques lettres de Boerhaave, fur-la
ftruélure des glandes. Vil. 46. b. Sa difpute avec Ruyfch, fur
les glandes. Suppl. III. 83. a. Sa doârine fur la caufe des
inflammations. VllI. 712. a. Suppl. III. 600. a , b. Théorie des
boerhaaviftes, fur les maladies de là peau. XII. 217. b. 218.
a. Doôrine de Boerhaave fur la faignee. XIV. 306. a.
BOÉT1E , {Étienne de la) obfervations fur cet liomme de
lettres. XVI. 660. b.
BOEUF, en quoi il différé du taureau. Caftrltion du boeuf.
Tems où elle fe fait. Maniéré d’opérer. Attentions pour la
nourriture. Choix du boeuf. Caraélere de celui qu’on eftime
le plus. Poil du boeuf. Années de fon travail. Durée de fa
vie. On eonnoît fon âge à la dent 8c à la' corne. IL 2^1. b.
Ceux qui mangent lentement, & qui ont été éleves^ fur
les montagnes font de meilleur fervice. Ménagement qu’exigent
ceux «qu’on prend au loin. Maniéré de dompter les
boeufs. Défauts des boeufs, moyens de les corriger. Nourriture
du boeuf. Ibid. 292. a. Soins qu’il demande. Engrais
du boeuf. Ibid. b. Maladies des boeufs. /éid. 293. a.
Boeuf, aliment. Comment on prépare le boeuf fumé. Boeuf,
à la mode. Qualités falutaires de cet aliment. Boeuf falé, caufe
de feorbut. Boeuf bouilli. II. 293. a: Bouillon de boeuf à
l’ufage des malades. Propriétés de diverfes parties de cet
animal. Ibid. b.
Boeuf, préparation de chair de boeuf, qui peut être tranfi
portée fort loin. XV. 933. é.
Boeuf, {Comm. ) comment fe vendent les peaux de boeufs.
Utilités qu’on tire dçs rognures de la peau, du poil de I3