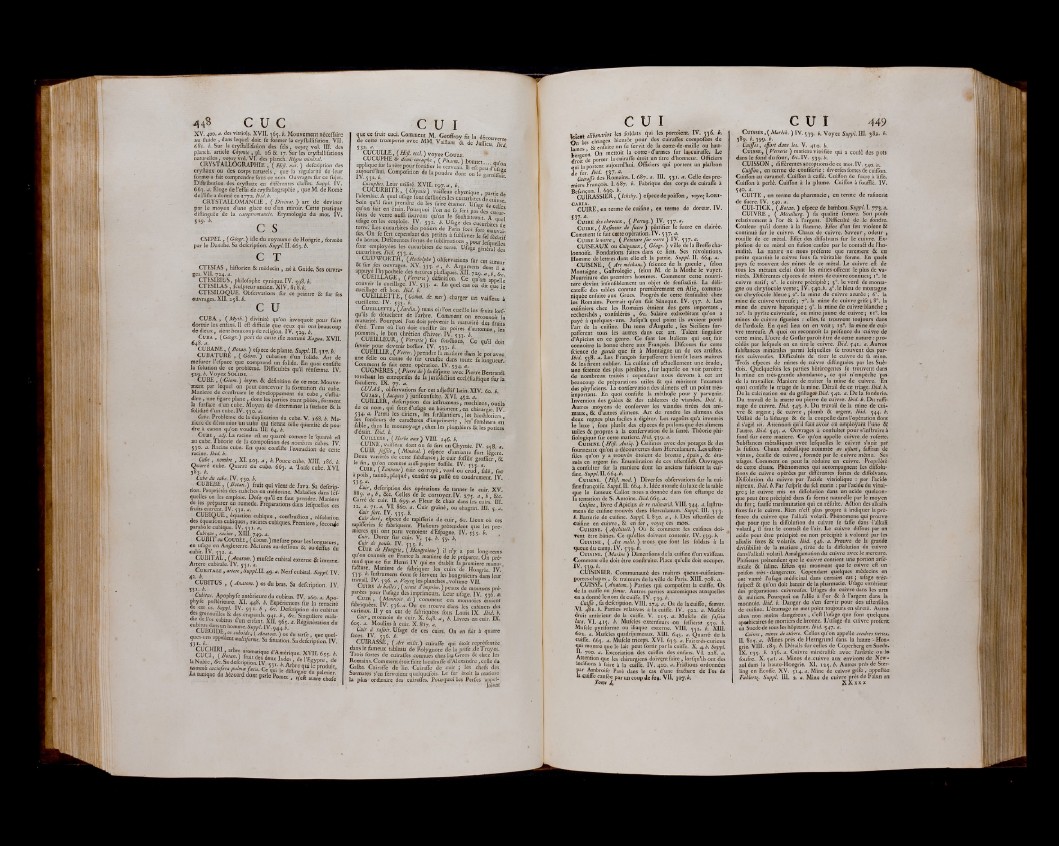
■4 4 ^ eue XV. 4oo. a. des vitriols. XVII. 365. b. Mouvement néceffaire
au fluide , dans lequel doit fe former la cryffcillifarion. VII.
681. b. Sur la cryftallifation des fcls, voyc^ vol. III. des
planch. article Chymie , pl. 16 & 17. Sur les cryflallifations
naturelles, voyez vol. VI. des planch. Régne minéral. '
CRYSTALlOGRAPHIE , ( Hijl. riai: ) defeription des
cryftaux ou des corps naturels , que la régularité de leur
forme-a fait comprendre fous ce nom. Ouvrages fur ce fujer.
Diflribution des cryflaux en différentes claues. Suppl. IV.
663. a. Éloge de l’effai de cryflallographie , que M. de Romé
dci’Ifle a donné en 1772. Ibid. b. ,
CRYSTALLOMANCIE , ( Divinat. ) art de deviner
par le moyen d'une glace ou d’un miroir. Cette pratique
diflinguée de la catoptromancie. Étymologie du mot. IV.
529. b.
C S
CSEPEL, ( Géogr. ) ifle du royaume de Hongrie, formée
par le Danube. Sa delcription. Suppl. II. 663. b.
C T
CTESIAS , hiitorien 8c médecin , né à Guide. Ses ouvrages.
VII. 724. a.
CTESIBIUS,philofophe cynique. IV. <98. b.
CTESILAS , lculpteur ancien. XIV. 8io.b.
CTESILOQUE. Obfcrvations fur ce peintre & fur fes
ouvrages. XII. 2 5 8. b.
C U
CUBA , ( Myih. ) divinité qu’on invoquoit pour faire
dormir les entans. Il cil difficile que ceux qui ont beaucoup
de dieux, aient beaucoup de religion. IV. 329. b.
^ C u b a , (Géogr.) port de cette ifle nomméXagua. XVII.
CUBANE, (Botan.) cfpece de plante. Suppl. II. 317. b.
ÇUBATURÈ g ( f j É É cubation d’unTolide Art de
mefurer l’efpace que comprend un folide. En quoi conûile
la folution de ce problème. Difficultés qu’il renferme. IV.
529. b. Voyez S o u d e . ..
CUBE, ( Géom. ) étym. & définition de ce mot. Mouvement
par lequel on peut concevoir la formation du cube.
Maniéré de conftruirc le développement du cube , c’cft-à-
dire , une figure plane, dont les parties étant pliées, forment
la furface d’un cube. Moyen de déterminer la furface & la
folidité d’un cube. IV. 330. a,
Cube. Problème de la duplication du cube. V. 168. b. Maniéré
de détermicr tin cube qui tienne telle quantité de poudre
k canon qu’on voudra. 111: 64. b.
G u b e f** racine cil au quarré comme le Quarré efl
au cube. Théorie de la compofition des nombres cubes. IV
530. a. Racine cube. En quoi confifle l’extraélion de cette
racine. Ibid. b.
Cube , nombre , XI. 103. ee, b. Pouce cube. XIII. 186. b
Qiarrt cube. Quarré liu cube. 663. „. Toife cube XVL
383. b.
Cube du cube. IV. 530. b.
CUBEBE, (Botan.) fruit qui vient de Java. Sa defeription.
Propriétés des cubebes en médecine. Maladies dans lef-
quelles on les emploie. Dofe qu’il en faut prendre. Manière
de les préparer en remede. Préparations dans lcfqucllcs ces
fruits, entrent. IV. 331. a.
CUBIQUE, équation cubique , conitruiiion , réfolurlon
les ¿quations cubiques. ciihim»»c P r 1.
—----> — »> «.unurucuon , retojution
des équations cubiques, racines cubiques. Première, fécondé
parabole cubique. IV. 321. a.
Cubique, racine, XIII. 749. a.
CUBIT 0« Coudée, (Comm.) mefure pour les longueurs,
ufage en Angleterre. Mcfures au-deffous Ji ufat. ___ & audeffus dii
cubit. IV. 331. a.
CUBITAL, (Anatom.) mufcle cubital externe & interne
Artère cubitale. IV. 531.11.
C u b i t a l e , artere, Suppl. II. 49. a. Nerf cubital. Suppl. IV
'42. b. rr
CUBITUS , (Anatom. ) os du bras. Sa defeription. IV.
53 ï- %
\fubitus. Apophyfc antérieure du cubitus. IV. 260. a. Apo-
phyfe poftérieure. XI. 448. b. Expériences fur la ténacité
t c« os- ÊÊHÊ Jv - 931- é , &c. Defeription du cubitus
¿ g & df,s crapauds. 941. b, &c. Singulière mala-
cubitus ?a„C "U* m C,nfant- M 365. & Régénération du
r n i inm ï1 homme-SuPPl- IV. 944.b.
u u u u iu t os cuboïdc, ( Anatom. ) os du tarfe, que quelques
uns appellent multiforme. Sa fituaüon. Sa defcr’i p S lV.
f i r ï iq“,c d'A“>*riqu=- x v ii . 63.. t.
la Nubie ,’Cç.Sa d e l c r i p t i o n . de >. de
nommé cuciofera palmee fade. Ce qui" le* ilirtin* lüm
la tunique du béaoard dont parle Pontet, "|è'ft ait « 5 e
C U I
332. a. ■ ÂO,a.
rCnUrCrUiPcHu Ee ’&/ WJcrn-Mcucu)p h,v,o,y c(2 P Cho„UmL.E )- bonnet... S § |
applique fur la têtepour forttfier lu cerveau. Il cil peu ! S §
atÿourd hui. Compofition de la poudre dont on le garni®'
Cucuphes. Leur utilité. XVII. 197. a b.
f u r V? BITf § 1 ChymieS vaiffcau chymique, partie de
l alembic. A quel ufage font deBinées les cucurbires de cuivre
Soin qu'il faut prendre de les faire étamer. Ufaeo de
qu on fait en étain. Pourquoi l'on ne fefert pa/dca cucur
bites de verre «ufo fouvent qu’on le foubaiferoit A omd
ufage on les emploie. IV. 331. b. Ufagé des cucurbitcs de
terre. Les cucurbires des potiers de Paris font fort mauvab
les. On fe fert cependant des petites à fublimer le fel féd .rif
du borax. Différentes fortes de fublimations, pour lefquellc*«
font employées les cucurbites de terre. Ufage général
cucurbitcs. Ibid. 533. a. B es
CUDWORTH, (Rodolphe) obfcrvations fur cet auteur
8e fur fos ouvrages. XV. 333. a b. Argumcns dont il a
1W i t i S& r iîm ,d5 K S E g i l i a a f l l AU- 7Â9. u, i , Ce.
CUEILLAGE, (Verrerie) définition. Ce qu'on appelle
couvnr le cueillage. IV. 333. a. En quel cas on dit qîe lc
cueillage efl bon. Ibid. b.
CUEILLETTE, (Cornai, de mer) charger un vaiffeau k
cueillette. IV. 533. b.
Cueillette , (Jardin.) tems où l’on cueille les fruits lorf-
quils fe détachent de 1 arbre. Comment on reconnoît la
maturité. Pourquoi l’on doit prévenir la maturité des fruits
dété. Tems ou l’on doit cueillir les poires d’automne les
pommes, le bon chrétien d’hiver. IV. 53V. b.
CUEILLEUR, f Verrerie) fes fondions, Ce qu’il doit
favoir pour devenir bofficr. IV. 533. b.
CUEILLIR, ( Verrer.) prendre la matière dans le pot avec
une felle ou canne de fer creufcc dans toute fa longueur.
Comment fe fait cette, opération. IV. 534. a.
CUGNERES, ( Pierre de) iadifiiute avec Pierre Bertrand»
touchant les entreprifes de la jurifdidion eccléfiailique fur la
féculiere. IX. 77. d.
CUJAS, observations fur cet adjedif latin. XIV. 60. b.
Cujas, (Jacques) jurifconfultc. XVI. 452. a.
CUILLER, defeription des inflrumens, machines, outils
de ce nom, qui font d'ufage en bâtiment, en chirurgie. IV
<34. a. Parmi les ciricrs, les ferblantiers, les bimblotSers’
rLi s de cara^cres dlmprimcrie , les*fondeurs en
fable , dans le monnoyage, chez les plombiers & les potiers
d étain. Ibid. b. ■
Cuillers , (Herbe aux) VIII. 146. b.
« v a i f e u dont on fe fert en Chymie. IV. 258. a.
CUIR fojfile, ( Minéral.) efpecc d’amiante fort légère.
Deux variétés de cette fubftancc; le cuir foifile groflicr, &
le fin, qu’on nomme aufli papier foifile. IV. 535. a.
CUIR, ( Tanneur) cuir co r ro y é , verd ou c ru d, fa lé , fec
a poils, tanné,plaqué, cendréou paffé en coudreraent IV
335-a: '
Cuir, defeription des opérations de tanner le cuir. XV.
889. ay é, 8cc. Celles de le corroyer.IV. 275. a, b , 8cc.
Carré de cuir. II. 699. a. Fleur 8c chair dans les cuirs. III.
Iz- a: ?}• *. V t 860. a. Cuir grainé, ou chagrin. III. c. a.
Cuir fort. IV. 533. b.
Cuir doré, efpcce de tapifferie de cuir, &c. Lieux où ces
tapifferies fe fabriquent. Pluficurs prétendent que les pre-,
miercs qui ont paru venoient d’Elpagnc. IV. 535. b.
Cuir. Dorer fur cuir. V, <4. b. <q. b.
Cuir de voule. IV. «35. b.
CÎiir de Hongrie, ( Hongroieur) il n’y a pas long-tems
qu on connoit en France la manière de le préparer. On prétend
que ce fut Henri IV qui en établit la première manu-,
facture. Maniéré de fabriquer les cuirs de Hongrie. IV.
535. b. Inflrumens dont fe fervent les hongroicurs dans leur
travail. IV. 526. a. Voye^ les planches,volume VII.
Cuirs de balles, (terme d’imprim.)pciux de moutons préparées
pour l’ufage des imprimeurs. Leur ufage. IV. 536. *
C u ir , (Monnoiâ de) comment ces monnoies étoient
fabriquées. IV. 536. a. On en trouve dans les cabinets des
curteux. Il y en eut de fabriquées fous Louis IX. Ibid. b.
Cuir, monnoie de cuir. X. 648. a, ¿.Livres en cuir. IX.
003. a. Moulins k cuir. X. 817. a.
Cuir à rafoir. Ufage de ces cuirs. On en fait k quatre
faces. IV. 336. b.
CUIRASSÉ, (Art milit.) cuiraffe qui étoit repréfentée
dans le fameux tableau de Polygnote de la prife AeTraycs.
Trois fortes de cuiraffes connues chez les Grecs 8c chez les
Romains. Comment étoit faite la cuiraffe d’Alexandre, celle de
Galba. Cuiraffe de lin. Cuiraffe de cuir ; les chefs des
Sarmatcs s’en fervoienr quelquefois. Le fer .étoit la matière
la plus ordinaire des cuiraffes. Pourquoi les Perfcs appel“
loiciit
C U I G U I 449
elibunanos les foldats qui les fon d en t IV. 511. i .
5 . clrtngca bientôt pour des cuiraffes compofées de
l n ^ ènluite on fe fervit de la cotte-de-maille ou hau-
kereeon. On mettoit la cotte - d’armes fur la»cuiraffe. Le
droit de porter la cuiraffe étoit un titre d’honneur. Officiers
qui la portent aujourd’hui. Officiers qui portent un plaflron
de fer. Ibid. 337. a.
Cuiraffe des Romains. 1. 687. a. III. 531. a. Celle des premiers
François. I. 687. b. Fabrique des corps de cuiraffe à
Befançon. 1. 699. b. .„
CUIRASSIER, (Ichthy.) cfpece de potffon, voye^ L o r i -
C AM A . . t ,
CUIRE, en terme de cuifine, en terme de doreur. IV.
* C u i r e des cheveux, ( Perruq.) IV. 537. a.
C u i r e , ( Rafineur de fucre ) pétrifier le fucrc en clairée.
Comment fe fait cqtte opération. IV. 537. a.
CUIRE le verre , ( Peinture fur verre) IV. 537. a.
CUISEAUX ou Cuircaux, ( Géogr.) ville de la Brcffecha-
lonnoifc. Fondations faites dans ce lieu. Scs révolutions.
Homme de lettres dont elle efl la patrie. Suppl. II. 664. a.
CUISINE, ( Art médian, ) fcience de la gueule , félon
Montaigne , Gaflrologic , félon M. de la Mothe lc vayer.
Nourriture des premiers hommes. Comment cette nourriture
devint infenfiblemcnt un objet de fenfualité. La déli-
cateffc des tables connue premièrement en Afie, communiquée
enfuite aux Grecs. Progrès de cette fenfualité chez
les Romains. Portrait qu'en fait Séneque. IV. 537. b. Les
cuifiniers chez les Romains étoient des gens importans ,
recherchés , confldérés , &c. Salaire exhorbitant qu’on a
Payé ä quelques-uns. Jufqu’à quel point ils avoient porté
art de la cuifine. Du tems aAugufte , les Siciliens fur-
pafferent tous les autres dans cet art. Talent fmgulier
d’Apicius en ce genre. Ce font les Italiens qui ont. fait
connoître la bonne chere aux François. Difcours fur cette
fciencé de gueule que fit k Montaigne un de ces artifles.
Ibid. 538. .a. Les François furpafferent bientôt leurs maîtres
6 les nrent oublier. La cuifine efl aâucllement une étude,
une fcience des plus pénibles, fur laquelle on voit paroître
de nombreux traités : cependant nous devons à cet art
beaucoup de préparations utiles & qui méritent l’examen
des phyuciens. La confervation dcs-alimens efl un point très-
important. En quoi confifle la méthode pour y parvenir.
Invention des gelées & des tablettes de viandes. Ibid. b.
Autres moyens de conforvcr les viandes tirées des animaux,
& aautres ali mens. Art de rendre les alimens des
deux règnes plus faciles à digérer. Les ragoûts qu’a inventés
le luxe , font plutôt des efpeccs de poifons que des alimens
utiles & .propres à la confervation de la fante. Théorie philologique
fur cette matière. Ibid. 339. a.
CuisiftE. ( Hifl. Antiq. ) Cuifincs avec des potages & des
fourneaux qu’on a-découvertes dans Hcrculanum. Les uften-
ffles qu’on y a trouvés étoient de bronze, épais, 8c ¿famés
en argent fin. Énumération de ces uflcnfile!. Ouvrages
à consulter fur la manière dont les anciens faifoient la cui-
finc. Suppl. II. 664. b.
C u i s in e . ( Hiß. mod. ) Divcrfes obfcrvations fur la cuit
fuie françoife. Suppl. II. 604. b. Idée morale du luxe de la table
que le fameux Callot nous a donnée dans fort cflainpc de
la tentation de S. Antoine. Ibid. 665. a.
Cuifine, livre d’Apicins de re culinarid. VIII. 344. a. Inftru-
raens de cuifine trouvés dans Herculanum. Suppl. III. 352.
b. Batterie de cuifine. Suppl. 1. 830. a , b. Des uftcnfilcs de
cuifine en cuivre, & en Fer, voyt{ ces mots.
C u i s in e . (Architefl.) Où & comment les cuifincs doi-
yent être bâties. Ce qu elles doivent contenir. IV. 339. b.
C u i s in e , ( Art milit. ) trous que font les foldats à la
queue du camp. IV. 339. b.
C u i s in e . (Marine) Dimcnfions de la cuifine d’un vaiffeau.
Comment clic doit être conflruitc. Place qu’elle doit occuper.
CUISINIER. Communauté des maîtres qucux-cuifiniers-
pQrtcs-chapes, & traiteurs de la ville de Paris. XIII. 708. a.
CUISSÊ. ( Anatom. ) Parties qui compofent la cuiffc. Os
de la cuiffc ou fémur. Autres parties anatomiques auxquelles
on a donné le nom de cuiffe. IV. 3 39. b.
Cuiffc , fa defeription. VIII, 274. a. Os de la cuiffc, fémur.
V I 481. b. Parties relatives k la cuiffe. IV. 322. a. Mufcle
droit antérieur de la cuiffe. V. »13. a. Mufcle dit fafeia
lata. VI. 413. b. Mufclcs extenfeurs ou fefliersr 559. b.
Mufcle pyritorme ou iliaque externe. VIII. 332. b. XIII.
<5oa. a. Mufclcs quadrijumeaux. XIII. 643. a. Quarré de la
cuiffe. 663. a. Mufcle triceps. XVI. 633. a. Fait très-curieux
Îui montre que le lait peut fortirpar la cuiffc. X. 4. b. Suppl.
I. 700. a. Excoriation des cuifles des enfans. VI. 228. a*
Attention que les chirurgiens doivqnt faire , lorfqu’ils ont des
incifions à faire à la cuiffc. IV. '420. a. Friélions ordonnées
par Ambroifc Paré dans le cas d’une frailurc de l’os de
« cuiffc caufée par un coup de VII, 307. b.
Tome /,
Cuisses,( Martch. ) IV. 539. i. Voyez Suppl XII. 38». 4.
389. b. 399. b.
. Cuiffe s y effort dans les. V. 410. b.
CUISSE , ( Verrerie ) matière vitrifiée qui a coulé des pots
dans le fond du four, &c. IV. 339.'é.
CUISSON, différentes acceptions de ce mot.lV. 340. ’a.
Cuiffon, en terme de confifcric : divcrfes fortes de cuiffom
Cuiffon au caramel. Cuiffon à caffé. Cuiffon de fucre ¿1 liffét
Cuiffon à perlé. Cuiffon k la plume. Cuiffon à foufllé. !Vk
540. a.
CUITE , en terme de pharmacie » en terme de rafincrie
de fucre. IV. 340. a.
CUI-TICK» (Botan* ) efpece de bambou. Suppl. I. 773. a.
CUIVRE , ( Métallurg. ) fa qualité ionorc. Son poids
relativement k l’or & k l’argent. Difficulté de le fondre,
Couleur qu’il donne à la flamme. Effet d’un feu violent &
continué lur le cuivre. Chaux de cuivre. Saveur, odeur »
rouille de ce métal. Effet des diffolvans fur le cuivre. Ex-
plofion de ce métal en fufion caufée par le contaél de l’humidité.
La nature ne nous préfente que rarement & en
peüte quantité le cuivre fous fa véritable forme. En quels
pays fe trouvent des mines de ce métal. Le cuivfe eu. de
tous les métaux celui dont les mines offrent le plus de variétés.
Différentes efpeccs de mines de cuivre connues j i°. le
cuivre natif; 20. le cuivre précipité; 30. leverd de montagne
ou chryfocole verte ; IV. 540. b. 40. le bleu de montagne
ou chiyfocole bleue ; 20. la mine de cuivre azurée ; 6°. la
mine de cuivre vitreufe ; 70. la mine de cuivre grife ; 8°. la
mine de cuivre hépatique ; 90. la mine de cuivre blanche ;
io°. la pyrite cuivreufe, ou mine Jaune de cuivre; 11°. les
mines de cuivre figurées : elles, fe trouvent toujours dans
de l’ardoife. En quel lieu on en voit ; 120. la mine de cuivre
terreufe. A quoi ou reconnoît la préfence du cuivre de
cette mine. L’ocre de Goflar paroît être de cette narure : procédés
par lefqucls on en tire lc cuivre. Ibid.. 341. a. Autres
fubflances minérales parmi lefquclles fe trouvent des. parties
cuivreufcs. Difficultés de tirer le cuivre de fa mine*
Trois efpeccs de mines dç cuivre diflinguées par les Sué^
dois. Quelquefois les parties hétérogènes fe trouvent dans
la mine en très-grande abondance, ce qui n’empêche mis
de la travailler. Maniéré de traiter la mine de cuivre. En
Ïuoi confifle le triage de la mine. Détail de ce triage; Ibid. A
>c la calcination ou du grillage! Ibid. 342. a. De la fonderie»
Du travail de la matte ou pierre de cuivre. Ibid. b. Du raffinage
de cuivre. Ibid. 343. ¿. Du travail delà mine de Cui*
vrc & argent; & cuivre , plomb & argent. Ibid. 544. b.
Utilité de la litharge & de la coupelle dans l’opération dont
il s’agit ici. Attention qu’il faut avoir en employant l’une &
l’autre. Ibid. 343. a. Ouvrages h coniulter pour s'inflruirc à
fond fur cette matière. Ce qu’on appelle cuivre de rofette.
Subflances métalliques avec lefquclles le cuivre s’unit pat
la fufion. Chaux métallique nommée as ujlum, faffran de
vénus, écaille de cuivre, formée par lc cuivre même. Ses
ufages. Comment on peut la réduire en cuivre. Propriété
de cette chaux. Phénomènes qui accompagnent les diffolu-
tions.de cuivre opérées par différentes fortes de diflolvans.
Di ffolution du cuivre par l’acide vitriolique : par l’acidé
nitreux. Ibid. b. Par l’cfprit du fel marin : par l’acide du vinaigre
; le cuivre mis en diffolution dans un acide quolcon- 3üe peut être précipité dans fa forme naturelle par le moyen
u fer ; fatiffe tranfmutation qui en réfulte. Aélion des alkalis
fixes'fur le cuivre. Rien n’eft plus propre à indiquer la pré-
fencc du cuivre que l’alkali volatil. Pnénomcne qui prouve
cjue pour que la oiffolution du cuivre fe faffe dans l’alkali
volatil, il faut le contaél de l ’air. Lc cuivre diffous par un
acide peut être précipité ou non précipité à volonté par les
alkalis fixes & volatils. Ibid. 546. a. Preuve^ de la grande
divifibilité de la matiete, tirée de la diffolution du •cuivra
dansl’alkali volatil. Amalgamation du cuivre avec Je mercure.
Pluficurs prétendent que lc cuivre contient une portion arfe-
nicalc & falinc. Effets qui montrent que le cuivre efl un
poifon très-dangereux. Cependant quelques médecins en
ont vanté l’ufage médicinal dans certains cas ; ufage très*-
fufpeél 8c qu’on doit bannir de la pharmacie. Ufage extérieur
des préparations cuivreufcs. Ufages du cuivre dans les arts
8c métiers. Pourquoi on l’allie à l ’or 8c à l’argent dans la
monnoie. Ibid. b. Danger de s’en fcryir pour des uftenfilcs
de cuifine. L’étamagc ne met point toujours en sûreté. Autre
abus non moins daugereux, c’eft l’ufage que font quelques
apothicaires de mortiers de bronze. L’ufage du cuivre prolcrit
en Suède de tous les hôpitaux. Ibid. 347. a.
Cuivre, mines de cuivre. Celles qu’on appelle cendres Certes.
II. 813. a. Mines prés de Herngrund dans la haute - Hongrie.
VIII. 183. b. Détails fur celles de Côpcrbcrg en Suede.
IX. 133. b. 136. a. Cuivre minéralifé avec l’arfctiic ou le
foufre. X. 341. a. Mines de-cuivre aux environs de Ncw-
zoldans la hautc-Hongrie. XI. 123..b. Autres prés de Sterling
en Ecoffe. XV. 514. a. Mine de cuivre grife, appellée
Fahltrt^. Suppl, III. 2. a. Mine de cuivre près de Falun en