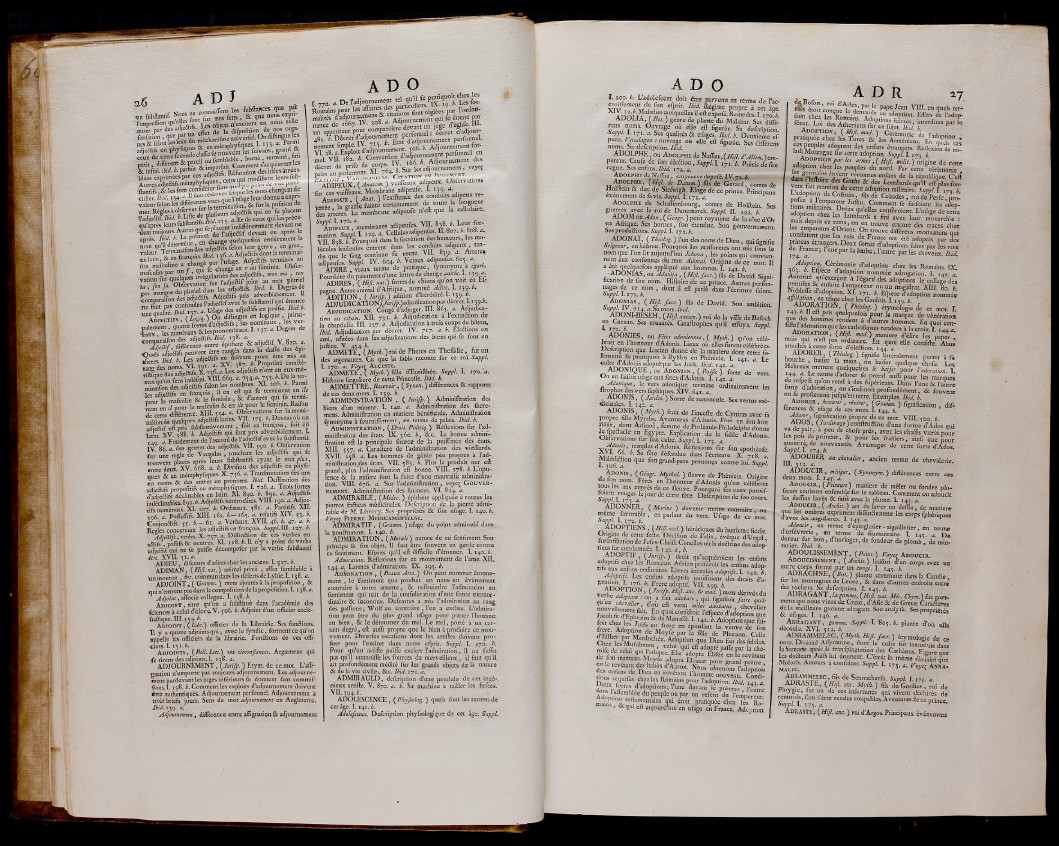
a.5 A D J
WBÈmÊ ÈKSBÊ ÊMËW!Ê ^B^ ÊM8mb fenfariSn , f e E i ' S "¿ctonifme univerfcl. On tliffingue ïes
„ cs 6c felon W » ^ ^ “ ¿“ hyr.ques. I. i 33- - I’3,™1
adjeffifs en phyfiques 8c en P ^ les faivans,.grand _&
ceux àe cettefacondedaffc y borné, terminé,fini
petit, différent & pareil ot i e n * B s’acquicrent les
& infini. ibid.'“ -/• b. S É® & ,d ' Jflifs.S r Réfutation R¿Sntíón des des idées idées innées,
innées.
idees idées exprimées par par
c
Autres Autresadieaifemènphy^adjeâifs métap
ues,“ « ^ , 1[tlc YMfUn-
’ftantifs ,& les que les mots changent de
culier./étï. 134-»-H Kfagéïenr donneàexprtvaleur
félon les* ffér í®la terminaifon, & fur la pofitton de
m e r . Régies a obfOTer f c uk adjeâifc qui ne fe placent
Tadjeâit Ibid- ^-^1 . rv a.Et de ceux quilesprécequ’après
leurs <“ b^ ’ U j J L ¡„différemment devant ou
- d e n t toujours. Autres qui i 1 ,, ¿ieflif devant ou après le
après, ^ P .0 S caíStie^ quelquefois entièrement la
nom qffil W%£Ëà3S3 adie£B6 <èl°n leur genre , en grec ,
valeur. Ternunadisu les J ¿ Adjeâifs dont la terminaren
latin, & en françois. I ■ 3 • ^djeâifs terminés au
9 E M H I WKÊM
«omparafon d e n i r e ' é p i t L e & adjeftif. V. 820. f .
'Ouels<íadíeáifs peuvent être rangés dans la claffe des épi-
arhe tes. Irbkid-j. Ab . U1 *çs aadiqieeâaiifBe nne | |d oivent^ pporrnotp rêièttrée cmarias ftaèu-
rang des noms.. 19 7<6 a Les adieffife n’ont en eux-mê-
” * r t e Æ w 7# 6 6 a i . 7 54-4.7 5 5 .é .D elater-
TtarifoTd» adjeSifs felón les nombres. 206. b. Parmi
fcsad Slifs en françois, il.en eft qm fe terminent en
1 ma{ciilin & le femimn, & d autres qui le termi-
Tient en il pour le mafeulin & en de pour le féminin Raifon
H »1»Aré>nce XIII. «<4. a. Obfervanons fur la.termi-
tiaifon de quelques adjefti^ latins. VII. 175. b. Des cas ou un
adieâif eft pris fubftandvement, foit en > folt e"
Î X y v ‘ 88 t Adieftifs qui font pns adverbialement. L
m 4 ï o K n e n , d e W c o % ’4 e â i f avec le fubftanrif.
IV? 86. 4. des genres des adjeâifs. VII. 590. b. Obfervauon
f... une regle Je Vaugelas , touchant les adjeâifs qui fe
.trouvent pheés aprèsleurs fubftantifs ayant le mot plus
entre deux. XV. 668. a. b. Divdion des adjeftifs en phyfi-
„„es & en métapbyfiques. X. 736.4. Tranfmutation des uns
en noms & des autres en pronoms. Ibid. Deltination des
adjeâifs propofitifs ou métaphyfiques. I. 726 a. Trms fortes
d’adjeâifs déclinables en latin. XI. 890. é. 801. 4. Adjeâifs
indéclinables. 89;. b. Adjefftfc hetérodites VIII. 190.4 Adjectifs
numéraux. XI. 207. *. Ordinaux. 581. *. Partitifs. XIL
106. 4. Poffeffifs. XIII. 162. b . - 165. 4. relatifs XIV. 53. b
Conjonaifs. 33. b . - 6 i . a Verbaux. XVII. 46. b, 47. 4. b
Reales concernant les adjeâifcen françois. Suppl. Ul. 127. b.
5 </ieSifr ,v e r i« .X 7S7-4. Diftinaion de ces verbes en
-aff.6 , paffds& neutres. XI. 118 i . l l n y a point de verbe
adjeâif gui ne fe puiffe dècompofer par le verbe fubftanuf
Are. XVII. 31. »■ I i , ,
ADIEU, difeours d adieu chezles anciens. 1. 527. b.
ADIMAN, {Hift.nat.) animé privé , aflez femblable à
un mouton , &c. commun dans les défera de Lybie.1. 138. a.
ADJOINT, ( Gramm. ) mots ajoutés à lapropofition , &
qui n’entrent pas dans la compofition de là propofidon. 1 . 138. a.
‘ Adjoint ,afcoc\ë collegue. 1.138. b.
A d j o in t , titre qu’on a fubftitué dans l’académie des
fciences à celui d’élève. V. 306. b. Adjoint d’un officier ecclé-
fia(tique.3II.554.A ' _ . .
A d jo in t ,{Libr.) officier de la Librairie. Ses fonctions.
11 y a quatre adjoints qui, avec le fyndic, forment ce qii’on
appelle les officiers tle la librairie. Fonctions de ces officiers.
1 . 131. A. . . .
A d j o in t s , {BelLLett.) -ou circón fiances. Argumens qui
4è tirent des adjoints.!. 138. a.
ÂDJOURNEMENT, {Jurifp.) Etym. de ce mot. L’affi-
gnation n’emporte pas toujours ajournement. Les adjourne-
jnens pardevant les juges inférieurs fe donnent fans commif-
fions. 1.138. b. Comment les exploits d’adjournement doivent
être authentiqués. Adjournement perfonnel. Adjournement à
trois briefs jours. Sens du mot adjournement en Angleterre.
Ibid. 139I a.
Adjournement, différence entre affignatioa & adjournement
A D O
1 _-0, a. De ïadjournement tel çp D fc 'for-
Romains pour les affairesdespa t ^ l’ordonmàbtés
ffad]ournemens 8cjiit^ o^rnementqui £ do„ „e g r
nance de 1667. IV. 3 . devant un juge déglife- lu .
un appariteur pour compwo'tr ( dicret d’ad)Our-
485- è. Décret ^ praf d’at^ournement perfonneL
nement fimple. IV. 713. • , b Adiournement for-
VI.28.4.Ewloit dad)Oiirnement. 2 . perfonnel en
mel. VII. 182. i. Convcrfion d^ournemçn p ^m=nt dcs
décret de pnfe de ^ " P ; j ’ s ur lesadjournemens, voyq;
pairs au parlement. U R B » g W S S Ê M
j vaiffeaux_adipeux. Obfcrvauons •furA^feu“ "^ Wmm k- iettée la eraiffe fuinte certainement de toute la longueur
des ar’teres La membrane adipeufe neft que la cellulaire.
S“fm p à j x , ‘’membranes adipeufes. VR. 838. é. Leur for-
ç„ ’ / T IM. ». CeUules adipeufes. II. 807. é. 808.4.
VR 838. b!Pourquoi dans lafecrérion deshumeurs, les mo-
lécules huileufes entrent dans les oonfits adipeux, tandis
que le fane continue fa route. VU. 839. 4. Ancres
adipeufes. Suppl. IV. 604. b. Veines adipeufes. 603. a. |
Id IR É , vieux terme de pratique, fynonyme à cgarc.
Pourfuite du paiement d'une lettre tfe change ndtrfr. L i^ . u.
ounuite au paiciucut u — - - o , - -
ADIRES,. */( Hifl.rrd 441.)_ \ fA.fortes Me/de 1» rliipnt chiens flll qu On on VOlt voit en en
£.1'
pagne. Autre animal d’Afrique, nommé Adiré. 1. 139. .
ADITION, (Jurifp.) adition d hérédité. I. 139. ».
ADJUDICATION,(/»riyp.)adjudicationpar décret. 1.139.«.
A d j u d i c a t io n . Congé d’adjuger. III. 863.. 4. Adjudication
au rabais. XII. 731. b. Adjudication à lextina.on de
la chandeUe. UL 127. a. Adjudication à trois coups de baron.
Ibid. Adjudication par décret. IV. 717. à. b. Elections en
ami, ufitées dans les adjudications des biens qui fe font en
'UlA DM ¿T ¿ ! ( Myth. ) roi de Pheres en Theffalie, fut un
des argonautes. Ce que la fable raconte fur ce roi. Suppl.
ï . 170. a. Voyez A lceste. t
ADMETE, { Myth.) fille- d’Eurifthèe. Suppl. I. 170. a.
Hiftoire finguliere de cette Princeffe. Ibid. b.
ADME1 TR E , Recevoir, {Synon.) différences & rapports
de ces deux mots. I. 130. b. #
ADMINISTRATION , ( Jurifp. ) Admmiftration des
biens d’un mineur. I. 140. a. Adminiftration des facre-
mens. Adminiftration en matière bénéficiale. Adminiftration
fynonyme à fourniffement, en terme de palais. Ibid. b. ^ ,
A dm in is tr a t io n , (Droit.Politiq.) Réflexions fur l’ad-
miniftration des états. IX. 360. b, &c. La bonne admini-
flration eft la principale fource de la puiffance des états.
XIII. 337. a. Caraétere de l’adminiftration des vieillards.
XVII. 238. a. Les hommes de génie peu propres à lad-
miniftration des états. VII. 383. b. Plus le produit net eft,
grand, plus l’adminiftrationi eft bonne. VIIL 278. b. L’opulence
& la mifere font la fuite d’une mauvaife adminiftration.
VIII. 676. a. Sur l’adminiftration, voyc^ G o u v e r nement.
Admmiftration des finances. VI. 814. a.
ADMIRABLE, {Médec. ) épithete appliquée à toutes les
1 pierres Taélices médicinales. Defeription de la pierre admirable
de M. Lémeiy. Ses propriétés & fon ufage. I. 140. b.
Voyer Pierre Médicamenteuse.
AUMIRATIF, {Gramm.) ufage du point admiratif dans:,
la ponÊhiation. I. 140. b.
ADMIRATION, {Morale) nature de ce fentiment.Son
principe ■& fon objet. Il faut être fouvent en garde contre
ce fentiment. Efprits qu’il eft difficile d’étonner. 1. 140. b.
Admiration. Réflexions fur ce mouvement de l’ame. XII.
144. a. Larmes d’admiration. IX. 293. b.
A d ju r a t io n , {Beaux Arts.) On peut nommer étonne-,
ment, le fentiment que produit en nous un événement
contraire à notre attente, & reftreindre l’admiration aul
fentiment qui naît de la conftdêration d’une force extraordinaire
& inconnue. Defcartes a mis l’admiration au rang
des pallions; Wo lf au contraire , l’en a exclue. L’admiration
peut être du plus grand ufage pour porter l’honime
au bien, 8c le détourner du mal. Le mal, porté à un certain
degré, eft auffi propre que le Bien à produire ce mouvement.
Diverfes occafions dont les artiftes doivent profiter
pour l’exciter dans notre efprit. Suppl. I. 170. b.
Pour qu’u n 'artille puiffe exciter l’admiration, il ne fuffit
pas qu’il connôiffe les fources du merveilleux, il faut qu’il
ait profondément médité fur les grands objets de la nature
8c ae la vie civile, 8cc. Ibid. i j i . a.
ADMIRAULD, defeription d’une pendule de cet ingé-,
nieux artille. V. 870. a. b. Sa machine à tailler les fufées.
VII. 394. b.
ADOLESCENCE, {Phyfiolog. ) quels font les termes de
cet âge. I. 141. b.
Âdolcfccnct. Defeription phyfiologique de cet âge. SuppL
ADO Í £ 2°/r‘ ^ a^°‘^ cent- ^tre parvenu au terme de l’ac-
Croiffement de fon efprit. Ibid. Régime propre à cet âge.
A D O m ? *6SI Ä I U f expofé.Remedes.I. i 7o b.
pnAç UnUnLmIcA ,f ( Bot. ) genre _di ie _ pl.a nn te/. du .M alna bar. S.es diffé-
ADR 17,
^ A J o uu maiaoar. 5es dittê
“nTP vr 9“ 1' 1 q rSa gqeu al,tése & e uffa8 efsi-s iIlbriéde-- PS a tiefeription Deuxième efnnoms.
5oa delcmription. °Ibid. “ *Ue eft fiSurée’ Sestfifférenx
ADOLPHE, ou A d o l ph e de Naffau, (Hifi. d'Allem. ) empereur.
Caufe de fon éleâion, Suppl. L i 7 i. b. Précis de for
regne. Ses enfms.lbid. i 7u .a.
A d o l p h e de Naflau, empereur dépofé. IV. 72 b
„ Adolp„h e ,’ Dunem.) fils de Gérard .' comte de
Holftem & duc de Slefwigh. Eloge de ce prince. Principaux
événemens de fa vie. Suppl 1. 172. a.
A d o l ph e de Schaffembourg, comte de Holflein Ses
guerres avec le roi de Danemarck. Suppl. II. 222. b.'
ADOM 01î Adon, ( Géogr. ) petit royaume de la côté d’Or
en Afrique. Ses bornes, fon étendue. Son gouvernement
Ses produâions. Suppl. I. 172. b.
AD ONAÏ, ( Théolog.') l’un des noms de Dieu, qui lignifie
Seigneur, enhébreu. Pourquoi les mafforetes ont mis fous le
nom que l’on lit aujourd’hui fchova , les poinrs qui conviennent
aux confonnes du mot Aionaï. Origine de ce mot II
3 fiuelguefois appliqué aux hommes. I. i 4r. b
■ ADONLAS, ou Adonija , {Hifi. fie r .) füs de David. Signification
de fon nom. Hiftoire de ce prince. Autres perfon-
nages de ce nom , dont U eft parlé dans l'écriture fainre
Suppl. I. 172. b. S »«me.
ÀDONIAS, ( Hifi. fier. ) fils de David. Son ambition.
ouppl. IV. 714. a. Sa mort. Ibid.
ApONI-BESEH, {Hifi. ancien.) roi de la ville deBefech
£ni ^ naan. Ses cruautés. Cataftrophes qu’il effuya. Suppl.
ADONIES, ou Fêtes adomennes, ( Myth. ) qu’on célé-
hroit en 1 honneur d’Adonis. Lieux où elles furent célébrées.
Lieicriptton que Lucien donne de la maniéré dont cette fo-
lemmté fe pratiquoit à Byblos en Phénicie. I. I4i. a. Le
culte d Adonis adopté par les Juifs. Ibid. 142. a
ADONIQUE , ou A d o n ie n ( Poifie ) forae de vers.
On en faifoit ufage aux fetes d’Adonis. I. 142. a.
Adonique, le vers adomoue termine ordinairement les
firophesdesversfaphiques.XIV.641. 4.
ADONIS, {Jardin.) Sorte de renonciüe. Ses vertus mé-
«ucmales. I. 142. a.
frait tIe fifMfie de Cyniras avec fa
propre fille Myrrha. Aventures d’Adonis. Fête en fon hon-
£ f r é f r ÎT i ° e ’ T ' , Ptolémée-Philadelphe donna
le fpeâacle en Egypte. Expbcation de la Éible d’Adonis.
Obfervanons fur Ton culte. Suppl. I. 173 „
AJom\s temples d'Adonis. Réflexions fué fon apothéofe.
Sa H fiefendue dans l’écriture. X. 718. 4
I 306 4 ^ £raild-Per« prononça contre lui. Suppl.
y ° ONIS" Ï ÏÈ Ê L m WÏÏl ) fleuve de Phénicie. Origine
S r i ! s lhoi,neur d’Adonis qu’on célébrait
T - “ de, ce flei,ve’ Pour3“ oi & eaux paraif-
sù pfi S M i ü ,OUr de cetre R k - Defeription de fon cours.
ADONNER, {Marine ) devenir moins contraire, ou
Su î l i 2 f i ’ 6,1 Parla” ‘ d“ Ve“ ' Ufage de ce mot’
/dOPTIENS , {Hifi. eccl.) bérériques du huitième fiecle.
Ongme de cette feâe. Décifion de Félix, évêque d’Urgel
fur fa filiation de Jefus-Chrift. Conciles où la doârine des adop-
tiens fut condamnée. I . i 42.<z,é.
AD O P T IF , {Jurifp. ) droit qu’acquéraient les enfims
adoptifs chez les Romains. Adrien préférait les enfans adop-
tifs aux enfans ordinaires. Livres intitulés adoptifs. 1. i
„ „ ï f - L“ adoptifr jouiffoient des droits d’agnation.
f 1^6. b. Frere adoptif. VII. 209. b.
v e A ? ° r rION > ( W È M S f * oiod. ) mots dérivés du
O5 cChfe/va Tlier •,' 1do u?- meft vaedn0hua r‘m ’il e8s“ a dobatus facihreev aqluieelrî
a r a b f i t 'S — ' ^ nÆ iC0m5ft,0it 1,cfPece d’adoption que
itooic tcncezh lets l Jfuf,fes u&nd cfrMeraen eanlK I¿Lpo *u4c2 . b. jA dovpetuivoen qduee ffrrmi-
d’Efthe^parCriardC Pai- £ 1 d= i | 2 ! î c ï ï
Chez lesPMufr?m. e’ ^pptiop que Dieu fait desfideles.
t-nez les Mufulmans , celui qm eft adopté paffe par la che-
ntifede celui qu,¿adopte. Elie* adopta Éifée en fe revêam
de f„p mameau. Moyfe adopta Eléazar pour g r a i d - ^ .
dès enf ! ISd A,ar° n- Nous obtenons l’a L r io n
î'“ enfans/ile Dieu en revêtant l’homme nouveau Candi-
S x r f2Ut “ j ' f R° T " S P?ur Adoption. Ibid. 143. u.
¡ï™ es dadoPtl°ns; lune devant le prêteur l ’a u t r e
AdVtione mfié ed “ P-eUple °UAPa- refcrit dc SÎpéÆiifc
mainV ï , • ^ enmre ®u I !® prauquée chez les Ro-
> Stqui eft aujourdbui en ufage en France. Adoption
étoft’cofçu'e^la demar Pape h 33 V1IL C" ï ueIs ter'
«on chez les Romains. Adoptions
fénac Loi des Athéniens T P" °
pratiqS^chez |
iàe<fiMoPleS ad? >rcnt des «nfans étrangers. Réflexwndé S
ladi Momague fur cette adoption. Suppl. 1. r7 , b
A d o p tio n par Us armes, {Hifl. milic. ) origine de cette
les S Î l£S pe,!pIe5 dn nord’ Par « tte cérémonie ,
¿ ¿ s S S reLco2nus enfc,s de la république. Cefi
dans I hiftou-e des Go,hs & des Lombards qu’il eft plus fou-
vent faii menrion de cette adoprion militaire. Suppt. I i 7 , b
n o fe Pf T . de 0fs» & de Cebades , roi de ^erfe J p i Î
j M H É B B a i Comment fe fùifoient les a L -
T t ?,ts cIu eIles conféroient. L’ufaee de cette
c o n S ç e; r: dqs
d’adoption chez les Romains. IX
303. b. Lfpece d adoption - nommee adrogation. I. 147 a
™ n?Ueî “ S0it à ré8ard des adoptions le collège des
E l Î f f e d’ 4" “ cJHPereur «u un magifirat.' XUI. lo . b.
a“ÿd£iatfioin enuTfàg°e chlez l,e Ws G.a uhl'o Eisf. pIe. c:e 3 9Î.a éd.option nommée
l i f ( Tlil t?S- ) étymologie de ce mot. I.
n i l ' i ï u pns (î0e7 uefols pour « marque de vénération
^ e des hommes renient à /autres homTes. Eu nuoi cop-
fifte 1 adoration que les catholiques rendent à la croix I 144 a
A d o r a t io n , {Hifl. mod!) maniéré fféËre frs pâpÎ
mao qm n eft pas ordinaire. En quoi elie confilte Abus
attachés à cette forte d’élêôion. x44 u comme. Abus
h AP , FRI ( TMolog. ) fignifie littéralement porter à fa
bouche , batfer fa main, ou baifer quelque chofe Lm
ai^ttent finciquefois le iu i / c r j o i l'a do r îiio fit
detcfncA te,rme dadorer fe prend aufltpour les marques
à,.des fupérieurs. Dans l’une & l’aùtre
on fr d adoranon, on s indinoit profondément, & fouvent
on fe profiemoir jufqn’en terre. Exemples. Ibid b
tférrAen„Dce°sR &LR u’ f/ag°e" dTe ’c ersM mro"ts’ . I(.G 1™44». "b-..) lignification , dif-
■ K E S fiftn.ifiçation propre de ce moL V in . 300. b.
AU Ub , { Jardinage ) conftruâion d’une forme d’Ados oui
va de pair, a peu de chofe près, avec les chaffis vitrés pour
les pois de primeur, & pour les fraif.ers, ainf. que four
quantité, de nouveautés. Avantages de cette forte d’Ados.
ouppl. 1. 174. b.
ADOUBER un chevalier, ancien terme de chevalerie1
111. 312. a.
ADOUCIR, mitiger, { Synonym. ) différences entre ces
deux mots. L 143. a.
A d o u c i r , {Peinture) maniéré de mêler ou fondre plusieurs
couleurs enfemble fur le tableau. Comment on adoucit
les delfins lavés 8c faits avec la plume. L 143. a.
A d o u c i r , {Archit.) art de laver un deflin, de maniéré
que les ombres expriment diftinâement les corps fphériaues
a avec les angulaires. L 143. a. r ~
Adoucir, en terme d’épingletier - aiguiUetier, en terme
dorfevrene , en terme de diamantaire. I. 143. a. De
doreur ¡ur bois, d’horloger, de fondeur de plomb , de teinturier.
Ibid. b.
ADOUCISSEMENT, ( Peint. ) Voyez A d o u c ir .
Adoucissement, {Archit.) liaifon d’un corps avec un
autre corps formé par un congé. I. 143. b.
ADRACHNE, (Bot. ) plante commune dans la Candie ,
lur les montagnes de Leuce, & dans d’autres endroits entre
des rochers. Sa defeription. I. 143. b.
AD R AG AN T , la gomme, {Hifl. nat. Méc. Chym. ) fuc gommeux
qui nous vieut de Crete, tf’Afic & de Grece. Caraâeres
de la meilleure gomme adragant. Son analyTe. Ses propriétés
& ufages. I. 146. n. •
A d r a g a n t , gomme. Suppl. I. 803. b. plante d’où aile
découlé. XVI. < 12. b.
ADRAMMEÉEC, (Myth^ Hift. facr. ) étymologie àe ce
nom. Dtvtmté AfTynenne dont le culte fat introduit dans
aSamane après la tranfplaqtarion des Cathéens. Figure nue
Ü “ d?n,nent- la même divmité que
a le c * CUrS a conPulter- Sup p i I. X75. a. Voyez A n n a -
de Sennacll=ril>- Suppl. I. , 7j. u.
ADRASTE, {Hifi. me. Myth.) fils deGordius, roi de
Flirygie, fut un de ces mfortunés qui vivent déchirés de*
remords, fans s être rendus coupables. Aventures de ce prince
ouppl. 1. 173. a. r
A d r a s t e , {Hift. anc. ) roi d’Argos. Principaux événemens