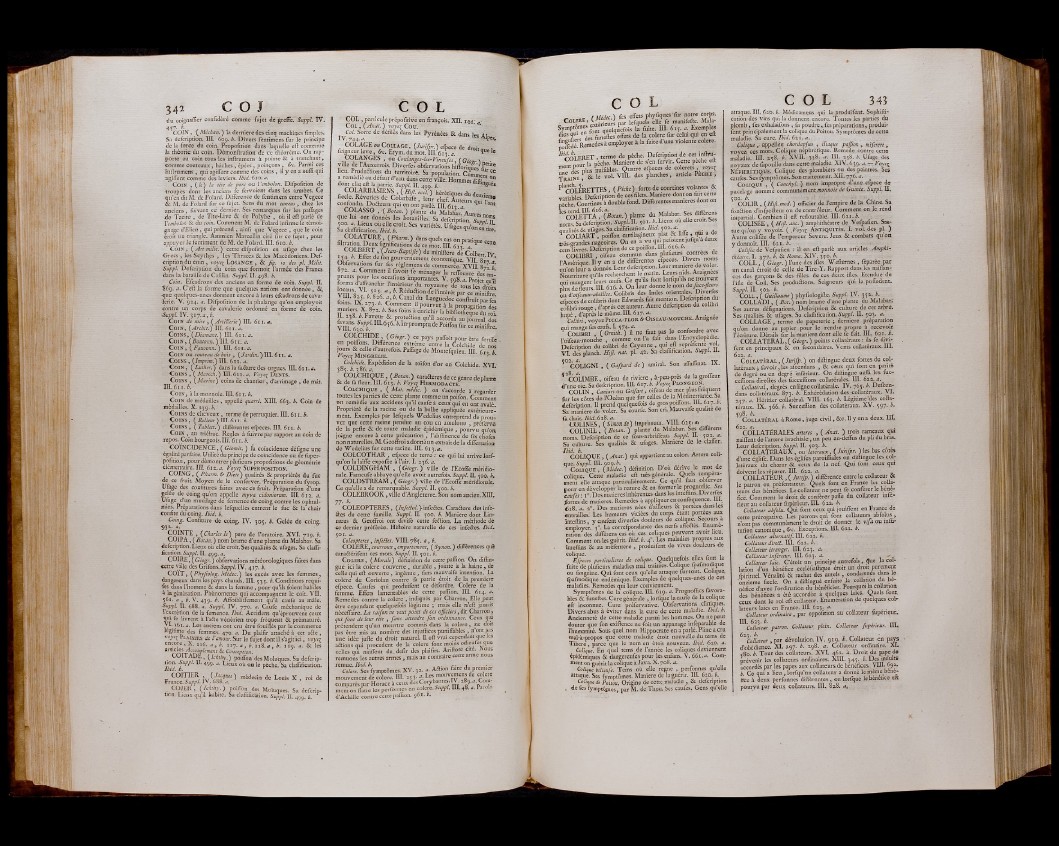
342 C O J
du coignaifier confidéré comme fujet de greffe. Suppl. TV.
457. b. S . ; . I
. COIN, '( Méchan. ) la derniere des-cinq machines fimplcs.
Sa defcription. ÏII. 6oç). b. -Divers fenrimens fur le principe
de la force du coin. Proportion dans laquelle eft contenue
la théorie du coin. Démonftration de ce théorème. On rapporte
au coin tous ’les inftrumens à pointe & à tranchant,
«comme couteaux , haches, épées, poinçons, &c. Parmi ces
inffrumens , qui agiffent comme des coins , il y en a auffi qui
«igifi'ent comme des leviers. Ibid.610. a.
COIN -,(/«) la tête de porc ou Yembolon. Difpoiition de
troupes dont les anciens le fervoient dans les armées. Ce
Ifuffïf ditM. de Folard. Différence de fenrimens entre Vegece
8c M. de Folard fur ce fujet. "Sens du mot cuneus, chez les
anciens, fuivant ce dernier. Ses remarques fur les paffages
Je Tacite , de Tite-Live & de Polybe , où il eft parlé de
Yembolon 8c du coin. Comment M. de Folard infirme le témoignage
d’Elien, qui prétend, ainfi que Vegece , que le coin
etoit un triangle. Ammien Marcellin cité iur ce fujet, pour
appuyer le fentiment de M. de Folard. III. 610. b.
Coin , ( Art milit. ) cette difpofition en ufage chez les
•Grecs, les Scythes , les Thraces & les Macédoniens. Def-
■cription.du coin, voye[ Losange , & fig. 10 des pl. Milit.
Suppl. Defcription du coin que formoit l’armée des Francs
dans la bataille de Cafxlin. Suppl. II. 498. b.
Coin. Efcadrons des anciens en forme de coin. Suppl. II.
869. a. C’eft la forme que quelques nations ont donnée, &,
•que quelques-unes donnent encore a leurs efcadrons de cavalerie.
V. 924. a. Difpofition de la phalange qu’on employoit
contre un corps de cavalerie ordonné en forme de coin.
Suppl. IV. 317.ii, b.
COIN de mire , | Artillerie ) XII, 6m . a.
Coin, (Archit.) III. 611. a.
COINS, (Diamant.) III. 611. a.
Coin , |Boutonn» ) III. 611. a.
C oiN, | Fauconn. ) III. 611. tu
COIN ou couteau de bois , {Jardin.') III. 6ï ï. a.
Coins , | Imprimé) III. 6 n . a.
Coin , {Luther.) dans la faéture des orgues.III.611.tf.
- C o in s , (Maréch.) III.6 1 1 .a. Foye^Dents.
Coins , {Marine) coins de chanrier, d’arrimage 1 de mât.
DI. 611. b. 5
Coin, S la monnoie. III. 6l 1. b.
Coin de médailles > appelle quarre. XIÎI. 663. bi Coin de
médailles. X. 239. b.
Coins de cheveux » terme de perruquier. Iü. 611. b.
COINS, ( Relieur) Iü. 611. b,
- Coins , ( Tablett. ) différentes efpeces. III. 611. b.
Coin , au triéfrac. Réglés à fuivre par rapport au coin de
repos. Coin bourgeois. III. 611. b.
COÏNCIDENCE, (Géomét. ) la coïncidence défigne une |
égalité parfaite. Utilité du principe de coïncidence ou de fuper- I
pofition, pour démontrer plufieurs propoiitions de géométrie j
élémentaire. III. 612. a. Foyer Superposition.
COING, ( Pharm. è Diete) qualités & propriétés du fuc
TT>Ce ^rU*C‘ °yen de le conferver. ‘Préparation du fyrop.
Ufage des confitures faites avec ce fruit. Préparation d’une
gelée de coing qu’on appelle myva cidoniorum. III. 612. a.
-Ufage d’un mucilage de femence de coing contre les ophtalmies.
Préparations dans lefquclles entrent le fuc & la chair
confite du coing. Ibid. b.
Coing. Confiture de coing. IV. 303. b. Gelée de coing.
932. a.
COINTE , ( Charles le ) pere de l’oratoire. XVI. 719. b.
COIPA, {Botàn.) nom brame d’une plante du Malabar. Sa
defcription. Lieux où elle croît. Ses qualités & ufages. Sa clafli- ,
¿cation* Suppl. II. 499. a.
COIRE, ( Géogr. ) obfervations météorologiques faites dans
cette ville des Grifons. Suppl. IV. 417. b.
COÏT, (Phyjiolog. Médec.) les excès avec les femmes,
dangereux dans les pays chauds. III. 533. b. Conditions requi-
fes dans l’homme & dans la femme, pour qu’ils foient habiles
à la génération. Phénomènes qui accompagnent le coït. VII.
561. a , b. V. 439. b. Affoibliffement qu’il caufe au mâle.
Suppl. IL 688. a. Suppl. IV. 770. a. Caufe méchanique de
1 excrétion de la femence. Ibid. Accidens qu’éprouvent ceux
?§ livrent à l’aéle vénérien trop fréquent 8c prématuré,
u • «S? a' anciens ont cru être fouillés par le commerce
legitinw des femmes. 470. a. Du plaifir attaché à cet aéle ,
voyt{ Plaisirs de l’amour. Sur le fujet dont il s’agit ici, voyez
m m r n m I m É î i i i s . - , g i ? 9 . i & 1«
r ^ v r i r ^ lement ^ C°nception.
c 1 il ’ I hhfby. ) poiffon des Moluques. Sa defcription.
Suppl. II. 499. a. Lieux où on le pêche. Sa claflification.
ibid. b.
COITIER » médecin de Louis X , roi de
France. Suppl. IV. 688. a.
COJER , { Ichthy. ) poiffon des Moluques. Sa deferip-
ticn. Lieux quii habite. Sa clafuhcàtion. Suppl. II. 499. b.
COL COL »particuleprépofitivê en françois. XII. lo t ;a'
C o l , {Anat. ) voye^ Cou. ;
i y Co/' S°anC dC d6filés dans k s Pyrénées & dans les Ajpe i
COLAGE ou C o l la g e , {Jurifpr.) efoecc de d™:»
feigneur leve, &c. Etym. du mot. flL É iÇ .T t0i,tl“e l=
’ 0,lC>:uIanga-ùs-y-meujis, IGtoert
ville de LAuxerrois. Diverfes obfervations hiftoriqïafi, Me
du territoire.Hénl Sa population.ctfTittt^ Commet 1
i!ecfeOLRé“ é d eNC Ô & confondu. Doftcurs qui en Ses ont “parlé III d efcriptiojnf.g , . a ^ ont
COLASSO , ■(Balan.') plante du MlbVrf-Autresno»
que lu. ont donnés les botaniftes. Sa ai wgf jëL
. . ^ Uff T i ’ du ntiniftere de Colbert IV
J Î A *• t r s< 8= fou gouvernement économique. V I I . 8 „ /
Obfervations fur fes réglemens de commerce. X V I I s J i i
Bru. a. C om m en til fa vo it fe ménager la reffource des em
prunts pour les occaf.ons importantes. V . 508. a. Projet qu’il
forma d affranchir 1 intérieur du royaume rfe tous les droits
V m 8 » V i V ’ l ^ ' du.a ionId« ‘ ’intérêt par ce miniflre.
f c ns IX5' , l r C an :lld u L *” guedoc conflruitparfes
ioins. IX . 273. ¿. Comment i l pourvut à la propagation des
m u ie r s . X .8 7 a . 4. Ses foins i. enrichir la bibliothèque du roi
I I . 238. ¿ .F a v e u r & proteftion qu’il accorda au journal des
V I lT 6 o T 5 i -*n-Pr01"P>u <ic Poiffon fur ce miniflre.
c.e W paifoit pour être fertile'.
en poiffons Différence extreme entre la Colchide de nos
jours & celle d autrefois. Paffage de Montefquieu I I I 61, t
Foyer MlNGRELIE. 3'
Colchide. Expédition de la toifon d’or en Colchide. XVI’
385.^.386;».
_ COLCmQUE, (Fuma.) carafleres de ce genre déplanté
oc de fa fleur. III. 613. b. Foyeç Hermodactê.
C o lch iq u e , ( Mat. médic. ) on s’accorde à regarder
toutes les parties de cette plante comme un poifon. Comment-
en remédie aux accidens qu’il caufe à ceux qui en ont avalé.
Propriété de la racine ou de la bulbe appliquée extérieurement.
Exemples par lefquels Wedelius entreprend de prouver
que cette racine pendue au cou en amulette , préferve
de la pefte & de toute maladie épidémique , poûrvu qu’on
joigne encore à cette précaution , l’abftinence de fix chofes
non naturelles. M.Geoffroi a donné un extrait de la differtation
de Wedelius fur cette racine. Iü. 613. a.
COLCOTHAR , eipece de terre : ce qui lui arrive lorf-
qu’on la laifte expofée à l’air. I. 236. a.
COLDINGHAM , ( Géogr. ) ville de l’EcofTe méridionale.
Fameufe abbaye qu’ell.e avoit autrefois. Suppl. II. èoo. b.
COLDSTREAM, ( Géogr. ) ville de l’Ecofte méridionale.
Ce qu’elle a de remarquable. Suppl. II. çoo. b.
COLEBROOK, ville d’Angleterre. Son nom ancien. XIII.
7 7 . b.
COLEOPTERES, {In/eflol.yinfe&es. Caraâere desinfe-
ftqs de cette famille. Suppl. II. 500. b. Maniéré dont Lin-
næus & Geoffroi ont divifé cette feétion. La méthode de
ce dernier préférée. Hiftoire naturelle de ces infeâes. Ibid<
301. a.
Coleopteres, infcèles. V I I I . 785. a , b.
COLERE, courroux, emportement, ( Synon. ) différences qii#
caraftérifent ces mots. Suppf. II. 501. b.
COLERE, {Morale) définition de cette pàffion. On diftin-
gue ici la colere couverte , durable , jointe à la haine, de
celle qui eft ouverte , ingénue , fans inaüvaife intention. La
colère de Coriolan contre fa patrie étoit de la première
efpece. Caufes qui produifent ce défordre. Colere de la
femme. Effets lamentables de cette paflion. III. 614. a.
Remèdes contre la colere , indiqués par Charron. Elle ^peut
être cependant quelquefois légitime ; mais elle n’eft jamais
néceffaire. La raifon ne veut point de ces officiers, dit Charron,
qui font de leur tête , fans attendre fon ordonnance. Ceux qui
prétendent qu’un meurtre commis dans la colere, ne doit
pas être mis au nombre des injufticcs puniffables , n’ont pas
une idée jufte du droit naturel. Il eft vrai cependant que les
avions qui procèdent de la colere font moinsodieulesque
celles qui naiffent du.defir des plaifirs. Ariftote cité. Nous
remuons les autres armes , mais au contraire cette arme nous
™Tol«cbSesfymptômes.XV. 32. a. Aérion faite du premier
mouvement Co^ybmnesJV.^^.l Comcomparés
par Horace a ceux acs J
n t on flanc les perfonnes c colcrc. Suffi. III. 48. c. Parole
d’Achille contre cette paflion. 961. b.
COL
Symptômes U fuite. III 6rç. a. Exemples
dies qui en q . ejj-ets ¿e la colere fur celui qui en eft
p"§-édê.rRemedes à employer à la fuite d'une violente colere.
Jir n l FRET , terme de pêche. Defcription de cet inftru-
nourla pêche. Maniéré de s’en fervir. Cette pêche eft
olus nnifibles. Quatre efpeces de colerets , voyet
^ , « r & " vol. VIII. des planches, article PêcheÇ
r n i ÎrETTES , ( Picht) forte de courtines volantes &
variables Defcription de ces filets. Maniéré dont on fait cette
L a . Courtines à double fond. Différentes maniérés dont on
'c .O L F 'r rA , (Boun.) plante du Malabar. Ses différens
noSadefcription. Suppl.l\. 5ot. ¿.Lioint oueUecroit.Ses
. «miirés & ufages.Saclaffificauon.Ibid. 502.0. .
COLIART , poiffon cartilagineux plat 8c liffc , qui a de
très-grandes nageoires. On en a vu quipefoient jufqn à deux
cens livres. Defcription de ce poiffon. III. 616. b. , . ,
COLIBRI , oifeau cbmmun dans plufieurs contrées de
l’Amérique. 11 y en a de différentes efpeces. Divers noms
qu’on leur a donnés. Leur deferipuon. Leur maniéré de voler
Nourriture qu’ils recherchent le matin. Leurs nids. Araignées
qui .Z>en? leurs oeufs. Ce qu’ils font lorfqu’ds ne trouvent
plus de leurs. 111. 616. t. On leur donne le nom^e
lu d•oif'aux-ab'Uks. Colibris des Indes orientales. Diverfes
efpeces de colibris dont Edwards fait mention. Defcnption du
colibri rouge, d’après cet auteur. Autre defcription du colibri
hupé, d’après le même. III. 617. a. .
Colibri »voyez P ic c a - flo r & Oiseau-mouche. Araignée
qui mange fes oeufs. I. 574*a- , f
C o lib r i , ( Ormth. ) ü ne faut pas le confondre avec
l’oifeau-mouche , comme on l’a fait dans 1 Encyclofédie.
Defcription du colibri de Cayenne , qui eft repréfente vol.
VL des planch. Hiß. nat. pl. 42- Sa daftification. Suppl. U.
5°COU GNI , ( Gafpard de ) amiral. Son affaflinat IX.
5 Ci)LIMBE, oifeau de riviere , à-peu-près de la groffeur
d’une oie. Sa defcription. III. (Si7.b. Voyez Plongeon.
COLIN , Caniart ou Grifart, oifeau de mer plus fréquent
’ fur les côtes de l’Océan que fur celles de la Méditerranée. Sa
defcription. Il prend quelquefois de gros poiffons. IIL 617. 4.
Sa maniéré de voler. Sa courfe. Son cri. Mauvaife qualité de
fa chair. Ibid. 618. a. _ ,
COLINES, {Simonde) inq>nmeur. VlII. 625.¿x.
COLINIL , ( Botan. ) planté du Malabar. Ses diftérens
noms. Defcription de ce fous-arbriffeau. Suppl. IL joa. a.
Sa Cliltùre. Ses qualités & ufages. Manière de le daffer.
* COLIQUE, ( Anat. ) qui appartient au colon. Artere coli-
que. Suppl. 1U. 909. b. m
Colique , (Médec.) définition. D’ou dérive le mot de
colique. Cette maladie eft tuès-générale. Quels tempérament
elle attaque particulièrement. Ce qu’il faut obferver
pour en développer la nature & en former le prognoluc. Ses
caufes : i°. Des matières inhérentes dans les inteftins. Diveries
fortes de matières. Remedes à appliquer en conléquence. 11L
618 a. 20. Des matières nées d’ailleurs & portées dans les
entrailles.' Les humeurs viciées du corps étant portées aux
inteftins, y caufent diverfes douleurs de colique. Secours a
employer. 30. La correfpondance des nerfs affeétes. Enumération
des différens cas où ces coliques peuvent avoir lieu.
Comment on-les guérit. Ibid. b. 4°- Les maladies propres aux
inteftins & au mèfentere , produifent de vives douleurs de
Efpeces particulières de colique. Quelquefois elles font la
fuite de plufieurs maladies mal traitées. Colique fpâfinodique
ou fanguine. Qui fout ceux qu’elle attaque iur-tout. Colique,
ipafmodique endémique. Exemples de quelques-unes de ces
maladies. Remedes qui leur conviennent.
Symptômes de la colique. III. 619* <z. Prognoftics favorables
8c funeftes. Cure générale , lorfque la caufe de la colique
eft inconnue. Cure préfervative. Obfervations cliniques.
Divers abus à éviter dans la cure de cette maladie. Ibid. b.
Ancienneté de cette maladie parmi les hommes. On ne peut
douter que fon exiftence ne foit un appanage inféparable de
l’humanité. Sous quel , nom Hippocrate en a parlé. Pline a cru
mal-à-propos que cette maladie étoit nouvelle du tems de
Tibère, parce que le nom en étoit nouveau. Ibid. 620. a.
Colique. Eri quel tems. de l’année les coliques deviennent
épidémiques & dangereufes pour les enfans. V. 661. a. Comment
on guérit la colique à Java. X. 708. a.
Colique bilieufe. Tems où elle regne , perfonnes qu’elle
attaque. Ses fymptômes. Maniéré de la guérir. III. 620. b.
Colique de Poitou. Origine de cette maladie , 8c defcription
, de fes fymptôjnes par M. de Thou. Ses caufes. Gens qu’elle
C O L 343
attaque. III. 620. b. Médicamens qui la produifent. Sophifti-
cation des vins qui la donnent encore. Toutes les parties du
plomb, fes.exhalaifons, fa poudre, fes préparations, produifent
principalement la colique du Poitou. Symptômes de cette
maladie. Sa cure. Ibid. 621, <j.;- : -
Colique y appellée chordapjus , iliaque paffion , miferere ,
voyez ces mots,‘Colique néphrétique. Remede. contre cette
maladie. III. %$. b. XVII. 338. a. IIl. 258. 6; Ufage des
noyaux de fàpotille dans cette maladie. XIV, 639,4.— Foye[
Néphrétique; Colique des plombiers ou des peintres. Ses
caufes. Ses fymptômes. Son traitement. XIL 776.0.
Colique , ( Conchyl.) nom impropre d une efpece de
pucelage nommé communément/n^0^ dc Guinée. Suppl. IL
?°COLIR , {Hift.mod. ) officier de l’empire de la Chine. Sa
jfonérion d’infpeaeur ou de contrôleur. Comment on. le rend
impartial. Combien il eft‘ redoutable*. III. 621 . b. - - _
COLISÉE , ( Hiß. anc.), amphithéâtre de Vefpafien. Statue
qu’on y voyoit. ( .Foyeç Antiquités. I: vol; des pl. )
Autre colifée de l’empereur Severe. Jeux 8c combats qu’on
y donnoit. III. 621. b. • ..,.,1 • ..
Colifée de Vefpafien : il en eft parlé aux articles Amphithéâtre.
I. 377. b. 8c Rome. XIV. 350. b. .
COL L, ( Géogr. ) l’une des ifles Wefternes , feparée par
un canal étroit de celle de Tire-Y. Rapport dans les nailïan-
ces des garçons 8c des filles de ces deux ifles. Etendue de
M e de Coll. Ses produirions. Seigneurs qui la poffedent.
Suppl. II. 302. b.
Coll , ( Guillaume ) phyliologifte. Suppl. IV. 35 a. b.
COLLADI, ( Bot. ) nom brame d’une plante du Malabar:
Ses autres défignations. Defcription 8c culture de cet arbre.
Ses qualités 8c ufages. Sa claflification. Suppl. II. 503. a.
COLLAGE, terme de papeterie ; derniere préparation
qu’on donne au papier pour le rendre propre à recevoir
l’écriture. Détails fur la maniéré dont elle le fait. III. 621. b.
COLLATÉRAL, | Géogr. ) points collatéraux : ils fe divi-
fent en principaux 8c en fecondaircs. V ents collatéraux. IIL
622. a.
, C o l la t é r a l ,{Jurifp. ) on diftingue deux fortes de collatéraux
; favoir, les afeenaans , 8c ceux qui font en parité
de degré ou en degré inférieur. On diftingue auffi les fuo-
ceffions dire&es des fucceffions collatérales. III. 622. <2.
Collatéral, degrés en ligne collatérale. IV. 765. b. Delcen-
dans collatéraux. 873. ¿. Exhérédation des.collatéraux, VI.
237. a. Héritier collatéral. VIII. 163. b. Légitime’des collatéraux.
IX. 366. b. Succeffion des collatéraux. XV. 597. ^.
^ C o l l a t é r a l à Rome, juge civil, 8cc. Il y en a deux. III,
622. a..
CÔLLATÉRALES arteres , ( Anat. ) trois rameaux qui
naiffent de l’artère brachiale, un peu au-aeflus du pli du bras.
Leur defcription. Suppl. II. 503. b. .
COLLATÉRAUX, ou latéraux, ( Jurifpr. ) les bas côtés
d’une églife. Dans les églifes paroiffiales on diftingue les collatéraux
du choeur 8c ceux de la nef. Qui font ceux qui
doivent les réparer. III. 622. a. . .. o
COLLATÉUR, ( Jurifp. ) différence entre le collateur ÖC
le patron ou préfentateur. Quels font en France les colla-
teurs des bénéfices. Le collateur ne peut fe conférer le bénéfice.
Comment le droit de conférer paffe. du collateur inférieur
au collateur fupérieur. III. $22. b. ;
Collateur abfolu. Qui font ceux qui jouiffent en France de
cette prérogative. Les patrons qui font collateurs abfolus ,
n’ont pas communément le droit de donner le vifa ou îniu-
tution canonique, &c. Exceptions. M. 622. b.
Collateur alternatif. III. 622. b.
Collateur direél. IÜ. 622. b.
Collateur étranger. III. 623. a.
Collateur inférieur. III. 623. a. _ . s
Collateur laïc. Cétoit un principe autrefois, <fue la collation
d’un bénéfice eccléfiaifique étoit un droit purement
fpirituel. Vénalité 8c rachat des autels , condamnés dans le
'onzième fiede. On a diftingué enfuite_la collation du bénéfice
d’avec l’ordination du bénéficier. Pourquoi la collation
des bénéfices a été accordée à quelques laïcs. Quels lont
ceux dont le roi eft collateur. Enumération de quelques col»
lateurs laïcs en France. III. 623. a. , .
Collateur ordinaire, par oppofition au collateur iupèneur.
111CoU^teur patron. Collateur plein. Collateur fupérieur. Iü;
Collateur , par dévolution. IV. 91^. b. Collateur en pays
d’obédience. XI. 297. b. 298. a. Collateur ordinäre. XL
380. 1 Tour des collateurs. XVI. 462. a. Droit du pape de
prévenir les collateurs ordinaires. XIII. 243. b. Des induits
accordés par les papes aux collateurs de bénéfices* VIII. 692.
b. Ce qui a lieu , lorfqu’un collateur a donné le même béné-
fiée à deux perfonnes différentes, ou lorique le bénéfice eft
pouryu par deux collateurs.. III. 828. a,