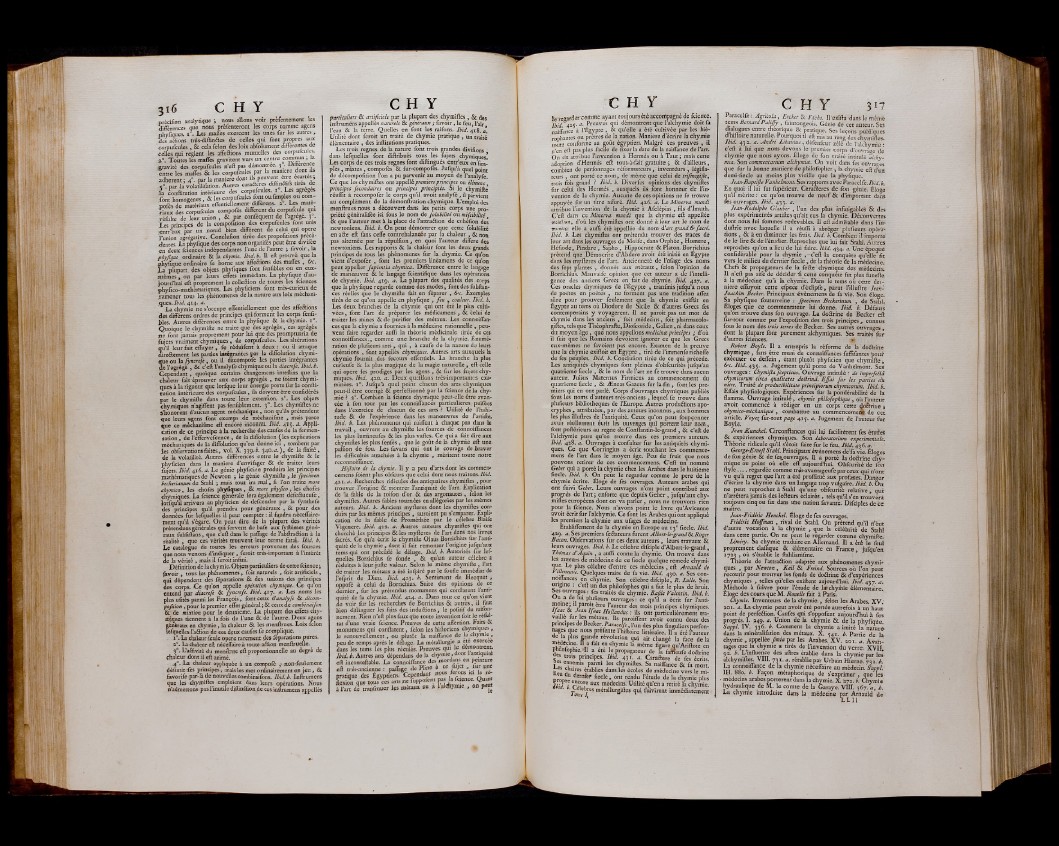
3 1 6 C H Y
prccifion analytique ; nous allons voir prefentement les
•différences que nous préfenteront les corps comme agens
phyfiques. i°. Les maffes exercent les unes fur les autres,
des actions très-diftinftes de celles qui font propres aux
corpufcules , & cela félon des loix abfolument différentes de
celles cnn règlent les affections mutuelles des corpufcules.
2°. Toutes les maffes gravitent vers un centre commun ; la
«ravité des corpufcules n’eft pas démontrée. 3 _• 1 rence
entre les maffes & les corpufcules par la manière dont ils
adhèrent ; 40. par la maniéré dont ils peuvent être écartés,
a : par la volaSiûtion. Autres caraflcr» g f eW * nrés du
ïa conflituttou intérieure des corpufcules. l . Les agrégés
font homogènes , Se les corpufcules font ou finales ou com-
pofés de matériau* effenrie&emen^différens. a . Les maté-
xiaux des corpufcules compofés différent du corpufcule qiu
.réfulte de lèûr union , & par conféquent de l’agrégé. 3°.
Les principes de la compofition des corpufcules font unis
•entreux par un noeud bien différent de celui qui opere
l’union agrégative. Conclufion tirée des propofitions précédentes.
La phyfique des corps non organifés peut être divifée
en deux feiences indépendantes l’une de l’autre ; favoir, la
phyfique ordinaire & la chymie. Ibid. h. U eft prouvé que la
Îhyfique ordinaire fe borne aux affeétions des maffes , bc.
a plupart des objets phyfiques font fenfibles ou en eux-
¡mêmes, ou par leurs effets immédiats. La phyfique d’aujourd’hui
1
eft proprement la colleâion de toutes les feiences
ohyfico-mathématiques. Les phyficiens font très-curieux de
.ramener tous les phénomènes de la nature aux loix méchani-
ques. Ibid. 414. a.
La chymie ne s’occupe effentiellement que des affections
des différens ordres de principes qui forment les corps fenfibles.
Autres différences entre la phyfique 8c la chymie. i°.
Quoique le cbymifte ne traite que des agrégés, ces agrégés
fie font jamais proprement pour lui que des promptuaria de
fujets vraiment chymiques , de corpufcules. Les altérations
qu’il leur fait effuyer, fp rédyifent à deux : ou il attaque
[ire&ement les parties intégrantes par la diffolurion chymi-
ue ou la fyncreje, ou il decômpofe les parties intégrantes
Je l’agrégé , & c’eft l’analy fê chy mique ou la diacrefe. lbid.b.
Cependant, quoique certains changemens inteftins que la
chaleur fait éprouver aux corps agrégés , ne foient chymiques
à la rigueur que lorfque leur énergie porte fur la confti-
tution intérieure des corpufcules, ils doivent être confédérés
par le chymifte dans toute leur extenfion. 20. Les objets
chymiques n’agiffent pas fenfiblemcnt. 30. Les chymiftes ne
s’honorent d’aucun agent méchanique, non qu’ils prétendent
que leurs agens font exemps de méchanifme , mais parce
que ce méchanifme eft encore inconnu. Ibid. 413. a. Application
de ce principe à la recherche des caufes de la fermentation
, de l’effervefcence , de la diffolution Çles explications
méchaniques de la diffolution qu’on donne ici , tombent par
les observations faites, vol. X. 339. b. 340. a.)t de la fixité,
de la volatilité. Autres différences entre le chymifte & le
phyficien dans la manière d’envifager 8c de traiter leurs
fujets. Ibid. 416. a. Le génie phyficien produira les principes
mathématiques de Newton ; le génie chymifte, le fpecimen
becherianum de Stahl ; mais tout ira mal, fi l’on traite more
chymico, les chofes phyfiques, & more phyfico, les chofes
chymiques. La fcience générale fera également défeftueufe,
lorfqu’il arrivera au phyficien de defeendre par la fynthefe
des principes qu’il prendra pour généraux , & pour des
données fur lefquelles il peut compter : il faudra néceffaire-
pient qu’il s’égare. On peut dire de la plupart des vérités
prétendues générales qui fervent de bafe aux fyftèmes généraux
fubftftans, que c’eft dans le paffage de l’abftraétion à la
réalité , que ces vérités trouvent leur terme fatal. Ibid. b.
Le catalogue de toutes les erreurs provenant des fources
que nous venons d’indiquer, feroit très-important à l’intérêt
de la vérité , mais il feroit infini.
Définition de la chymie. Objets particuliers de cette fcience ;
favoir, tous les phénomènes, foit naturels , foit artificiels,
qui dépendent des féparations 8c des unions des principes
ces corps. -Ce qu’on appelle opération chymique. Ce qu on
entend par diacre fie 8c jyncrefe. Ibid. 4*7- a' noms les
plus ufites parmi les François , font ceux d'analyfit & décom-
pofition, pour le premier effet général; 8c ceux de combinaifon
8c de mixtion pour le deuxième. La plupart des .effets chy-
miques tiennent à la fois de l’une & de l’autre. Deux agens
généraux en chymie, la chaleur 8c les menftrues. Loix félon
lefquelles l’aâion de «et deux caufes fe complique-
. i°. La chaleur feule opere rarement des féparations pures.
2.0. La chaleur eft néceffaireà toute aCtion menftruelle.
3°. L’aftivitê du menftrue eft proportionnelle au degré de
chaleur -dont il eft animé.
-4°- -La chaleur appliquée à un compofé non-feulement
défumt fes principe, mais les met ordinairement en jeu, &
favorife par-là de nouvelles combinaifons. lbid. b. Inftrumens
que les chymiftes emploient dans leurs opérations. Nous
n’admettons pas l ’inutile diftinâion de ces inftrumens apjpcllés
CHY particuliers 6c artificiels par la plupart des chymiftes, 8c des
inftrumens appellés naturels & généraux ; favoir, le feu, l’air,
l’eau 8c la terre. Quelles en font les raifons. Ibid. 418./.
Utilité dont feroit un traité de chymie pratique , un traité
élémentaire , des inftitutions pratiques.
Les trois régnés de la nature font trois grandes divifions *
dans lefquelles font diftribués tous les lujcts chymiques!
Les corps de ces trois régnés font diftingués entr’eux en Amples
, mixtes, compofés & fur-compofés. Jufqu’à quel point
de décompofition l’on a pu parvenir au moyen de l’analyfe.
Ce que les chymiftes ont appellé premiers principes ou êlémens
principes fecondaires ou principes principiés. Si le chymifte
réufiit à rccompofer le corps qu’il avoit analyfé, il parvient
au complément de la démonftration chymique. L’emploi des
menftrues nous a découvert dans les petits corps une propriété
généralifée ici fous le nom de Jolubilité ou mifcib'uiti.
& que l’auteur met à la place de l’attraélion de cohéfion des
newtoniens. Ibid. b. On peut démontrer que cette folubilité
en afte eft fans ceffe contrebalancée par la chaleur , & non
pas alternée par la répulfion, en quoi l’auteur différé des
newtoniens. Les rapports & la chaleur font les deux grands
principes de tous les phénomènes fur la chymie. Ce qu’on
vient d’expofer , font les premiers linéamens de ce qu’on
peut appeller fapientia chymica. Différence entre le langage
de manoeuvre oc le langage feientifique dans les opérations
de chymie. Ibid. 419. a. La plupart des qualités des corps
que la phyfique regarde comme des modes, font des fubftan-
ces réelles que le chymifte fait en féparer , &c. Exemples
tirés de ce qu’on appelle en phyfique , feu <j couleur. Ibid. b.
Les deux branches de la chymie qui ont été le plus cultivées,
font l’art de préparer les médicamens, oc celui de
traiter les mines &de purifier des métaux. Les connoiffan-
ces que la chymie a fournies à la médecine rationnelle , peuvent
faire regarder aufii la théorie médicinale tirée de ces
connoiffances., comme une branche de la chymie. Énumération
de plufieurs arts , qui , à caufe de la nature de leurs
opérations , font appellés chymiques. Autres arts auxquels la
chymie fournit .des fecours eflentiels. La branche la plus
curieufe 8c la plus magique de la magie naturelle, eft celle
qui opere ies prodiges par les agens, 8c fur les fujets chymiques.
Ibid. 420. a. Deux queltions très-importantes examinées.
i°. Jufqu’à quel point chacun des arts chymiques
peut-il être corrigé 8c perfectionné par la fcience de la chymie
? 20. Combien la fcience chymique peut-elle être avancée
à fon tour par les connoiffances particulières puifées
dans l’exercice de chacun de ces arts ? Utilité de l’habitude
8c de l’expérience dans les manoeuvres de l’artifte.
Ibid. b. Les phénomènes qui naiffent à chaque pas dans le
travail , ouvrent au chymifte les fources de connoiffances
les plus lumineufes 8c les plus vaftes. Ce qui a fait dire aux
chymiftes les plus fenfés, que le goût de la chymie eft une
paftion de. fou. Les favans qui ont le courage de braver
les difficultés attachées à la chymie , méritent toute notre
reconnoiffance.
Hifioire de Ip chymie. Il y a peu d’arts dont les commen-
cemens foient plus obfcurs que celui dont nous traitons. Ibid.
42 x. a. Recherches ridicules des antiquaires chymiftes, pour
trouver l’origine 8c montrer l’antiquité de l’art. Explication
de 'la fable de la toifbn d’or 8c des argonautes , félon les
chymiftes. Autres fables tournées en allégories par les mêmes
auteurs. Ibid. b. Anciens myfteres dont les chymiftes conduits
par les mêmes principes , auroient pu s’emparer. Explication
de la fable de rromérhée par le célébré Blaife
Vigenere. Ibid. 422. a. Autres auteurs chymiftes qui ont
cherché les principes 8c les myfteres de l’art dans nos livres
facrés. Ce qu’a écrit le chymifte Olaüs Borrichius fur l’antiquité
de la chymie, dont il fait remonter l’origine jufqu’aux
tems qui ont précédé le déluge. Ibid. b. Autorités fur lefquelles
Borrichius fe fonde , 8c qu’un auteur célébré a
réduites à leur jufte valeur. Selon le même chymifte, l’art
de traiter les métaux a été infpiré par le foufle immédiat de
l’efprit de Dieu. Ibid. 423. b. Sentiment de Hecquet ,
oppofé à celui de Borrichius. Suite des opinions de ce
•dernier, fur les prétendus monumens qui conftatent l’antiquité
Je la chymie. Ibid. 424. a. Dans tout ce qu’on vient
de voir fur les recherches de Borrichius 8c autres, il faut
bien diftinguer les faits des induCtions, le pofitif du raifon-
nemenr. Rien n’eft plus faux que toute invention foit le réful-
tat d’une vraie fcience. Preuves de cette affertion. Faits 8c
monumens qui conftatent, félon les hiftoriens chymiques,
le renouvellement, ou plutôt 1% naiffance de la chymie ,
peu de temps après le déluge. La métallurgie » été exercée
dans les tems les plus réculés. Preuves qui le démontrent.
Ibid. b. Autres arts dépendans de la chymie , dont 1 antiquité
£¡1 jncontelfebïe. La connoiffan« ste wordans en pointu»
eft tris-ancienne : paffage de PJine à « / “)« >. fur une
pratique des Égyptiens. Cependant nous/erons ici la r4r
& n que » » c e s arm ne ïuppofent pas la faence. Quant
à l’art de tranfmuer lçs métaux ou à lal^ymte , on peut
CHY le regarder comme ayant toujours été accompagné de fcience.
Ibid 423- a‘ Preuves ÿ u démontrent que 1 alchymie doit fa
naiffance à l’Égypte, 8c qu’elle a été cultivée par les hiérophantes
1G<
ou prêtres de la nation. Maniéré d’écrire la chymie
toute conforme au goût égyptien. Malgré ces preuves , il
n’en eft pas plus facile de nxer la date de la naiffance de l’art.
On en attribue l’invention à Hermès ou à Taut ; mais cette
adoption d’Hermès eft touc-à-fait gratuite ; 8c d’ailleurs,
combien de perfonnages réformateurs , inventeurs , légifla-
teurs, ont porté ce nom, de même que celui de trifmegifie,
trois fois grand ? Ibid. b. Diverfcs opinions des chymiftes
fur celui des Hermès , auxquels ils font honneur de l’invention
de la chymie. Aucune de ces opinions ne fe trouve
appuyée fur un titre affuré. Ibid. 426. a. Le Minerva mundi
attribue l ’invention de la chymie à Afclèpias , fils d’Imuth.
C’eft dans ce Minerva mundi que la chymie eft appellée
•¡roinliHVy d'où les chymiftes ont donné à leur art le nom de
îrsintic elle a auffi été 'appellée du nom d'art grand & fiacré.
Ibid. b. Les chymiftes ont prétendu trouver des traces de
leur art dans les ouvrages de Moïfc, dans Orphée, Homere,
Héfiode, Pindare | Sapho, Hippocrate 8c Platon. Borrichius
prétend que Démocrite d’Abdere avoit été initié en Égypte
dans les myfteres de l’art. Ancienneté de l’afage des noms
des fept plantes -, donnés aux métaux, félon l’opinion de
Borrichius. Mauvaifc opinion que cet auteur a de l’intelli-
■jencc des anciens Grecs en tait de chymie. Ibid. 427. a.
|es oracles chymiques de l’Égypte , tranfmis jufqu’à nous
de poètes en poètes , ne forment pas une tradition aftez
sûre pour prouver feulement que la chymie exiftât en
Égypte au tems où Diodore de Sicile & d autres Grecs fes
contemporains y voyagèrent. Il ne paroît pas un mot de
chymie dans les anciens foit médecins, foit pharmacolo-
giftes, tels que Théophrafte, Diofcoride, Galien, ni dans ceux
du moyen âge , que nous appelions medicinct principes ,* d’où
il fuit que les Romains devoient ignorer ce que les Grecs
eux-mêmes ne favoient pas encore. Examen de la preuve
que la chymie exiftoit en Egypte , tiré de l’immenfe richeffe
de fes peuples. Ibid. b. Conclufion tirée de ce qui précédé*
Les antiquités chymiques font pleines d’obfcurités jufqu’au
quatrième fiecle, 8c le nom de l’art ne fe trouve dans aucun
auteur. Julius Matcrnus Firmicus au commencement du
quatrième fiecle, 8c Æneas Gazeus fur la-fin , font les premiers
qui en ont parlé. Corps d’ouvrages chymiques publiés
fous les noms d’auteurs très-anciens , lequel fe trouve dans
plufieurs bibliothèques de l’Europe. Autres produirions apocryphes,
attribuées, par des auteurs inconnus, aux hommes
les plus illuftres de l’antiquité. Ceux qu’on peut foupçcnner
avoir réellement écrit les ouvrages qui portent leur*nom,
font poftérieurs au regne de Conitantin-le-grand , 8c c’eft de
l’alchymie pure qu’on trouve dans ces premiers auteurs.
Ibid. 428. a. Ouvrages à confulter fur les antiquités chymiques.
Ce que Corringius a écrit touchant les commence-
mens de l’art dans le moyen âge. Peu de fruit que nous
pouvons retirer de ces commencemens. C’eft ûn nommé
Geber qui a porté la chymie chez les Arabes dans le huitième
fiecle. Ibid. b. On peut le regarder comme le pere de la
chymie écrite. Éloge de fes ouvrages. Auteurs arabes qui
ont fuivi Geber. Leurs ouvrages n’ont point contribué aux
progrès de l’art; enforte que depuis Geber, jufqu’aux chymiftes
européens dont on va parler, nous ne trouvons rien
pour la fcience. Nous n’avons point le livre qu’Àvicenne
avoit écrit fur l’alchymie. Ce font les Arabes qui ont appliqué
les premiers la chymie aux ufages de médecine.
Etabliffement de la chymie en Europe au 13e fiecle. Ibid.
419. a. Ses premiers feftateurs furent Albert-le-grand & Roger
Bacon. Obfervations fur ces deux auteurs , leurs travaux 8c
leurs ouvrages. Ibid. b. Le célébré difciple d’Albert-le-grand,
Thtfmas d’Aauin , a auffi connu la chymie. On trouve dans
les auteurs de médecine de ce fiecle quelque remede chymi*
JÊSSï Le plus célébré d’entre ces médecins, eft Arnauld de
Villentuve. Quelques traits de fa vie. Ibid. 430. a. Ses connoiffances
en chymie. Son célébré difciple, R. Lulle. Son
origine : c’eft un des philofophes qui a fait le plus de bruit.
Ses ouvrages : fes traités de chymie. Bafile Valentin. Ibid. b.
, a de lw plufieurs ouvrages: ce qu’il a écrit fur l’antimoine;
il paroit être l’auteur des trois principes chymiques.
•ua r \an f a? c H°llandus : ils ont particulièrement travaillé
fur les métaux. Ils paroiffent avoir connu deux des
principes de Becker. Paroeeffe, l’un des plus finguliers perfonnages
que nous préfente l’hiftoire littéraire. Il a été fauteur
de la plus grande révolution qui ait changé la face de la
médecme. H a fait en chymie la même figuie au’Ariftote en
Pni.ofophie. 'Il a été le propagateur de fa faMeufe doârine
«es trois principes. Ibid. 431. a. Caraftere de fes écrits.
Le«eun*miS parmi leS ch>rmiftes- Sa naiffance 8c fa mort,
lien r T s t tablies dans les écoles de médecine vers le mi-
crnnv n’er fiecle » ônt rendu l’étude de la chymie plus
Ibid b C\u°if auX médecinS- Utilité qü’en a retiré la chymie.
Torne l m^tallurSl^cs Wk fuivirent immédiatement
C H Y 31-
Paracèlfc: ^b-So/î, Ercker & Fachs. Il'exMa dans le mêlllê
tems BernardPalrffy , faintongeois. Génie de cet auteur. Sei
dialogues entre dte^que 8c pratique. Ses leçons publiques
d Moire naturelle. Pourquoi il eft mis au rang des chymiftes.
Ibid. 432. a. André Libavius, défenfeur zélé de l’alchymie *
c’eft à lui que nous devons le premier corps d’ouvraec dé
cliymie que nous ayons. Éloge de fon traité intitulé «/diy-
mia. Son commentarium alchymitz. On voit dans fes ouvrages
que fur la bonne maniere de philofopher -,‘ià chymie eft d’un
demi-fiecle au moins plus vieille que la phyfique.
Jean-Baptïfle Vanhelrnont. Ses rapports avec Paracelfe. Ibid. b.
En quoi il lui fut fupérieur. Caracteres de fon génie. Éloge
qu’il mérite : ce qu’on trouve de neuf & d’important dani
fes ouvrages. Ibid. 433. a.
Jean-Rodolphe Glauber , l’un des plus infatigables 8c des
plus expérimehtés ^rtiftes qu’ait eus la chymie. Découvertes
dont nous lui fommes redevables. Il eft admil-able dans I’in-
duftrie avec laquelle il a réufli à abréger plufieurs opérations
, 8c à en diminuer les frais. Ibid. b. Combien il importe
de le lire 8c de l’étudier. Reproches que lui fait Stahl. Autres
reproches qu’on a lieu de lui faire. Ibid. 434. a. Une ¿poqu¿
confidérable pour la chymie ,- c ’eft la conquête qu’elle fiç
vers le milieu du dernier fiecle, de la théorie de la médecine.
Chefs 8c propagateurs de la fefte chymique des médecins^
Il n’eft pas aifé de décider fi cette conquête fin plus funefte.
à la médecine qu’à la chymië. Dans le tems où cette dei-
niere eflùyoit cette efpece d’édipfe, parut l’illuftre Jean-
Joachim Becker. Principaux évènemens de fa Vie. Son éloge.
Sa phyfique fbuterreine : fpecimen Beckerinum , de Stahl.
Éloges que ce commentateur lui donne. Ibid. b. Défauts
qu’on trouve dans fon ouvrage. La doftrine de Becker eft
fur-tout connue par l’expofition des trois principes , connus
fous le nom des trois terres de Becker. Ses autres ouvrages,
dont la plupart font purement alchymiques. Ses traités fur
d’autres feiences.
Robert Boyle. Il a entrepris la réforme de la doélrine
chymique, fans être muni de connoiffances fuffifantes pour’
exécuter ce deffein , étant plutôt phyficien que chymifte *
&c. Ibid. 433. a. Jugement qu’il porte de Vanhelrnont. Ses
ouvrages : Chy mi fiaJcepticus. Ouvrage intitulé : de imperfeflâ
chymicorum circa qualitates doÜrinâ. Effai fur les parties dit
nitre. Traité de producibilitàte principiorum chymicorum. Ibid. b.
Effais phyfiologiques. Expériences fur la pondérabilité de la
flamme* Ouvrage intitulé, chymie philofophique, où l’auteur
avoit commencé à rédiger en un corps cette doftrine »
chymico-méchanique , combattue au commencemerfe de cet
article. Voye[ fur-tout page 413* a. Jugement de l’auteur fur
Boyle.
Jean Kunckel. Circonftances qui lui facilitèrent fes étude*
8c expériences chymiques. Son laboratorium expérimentale.
Théorie ridicule qu’il s’étoit faite fur le feu., Ibid. 436. a.
George-Ernefi Stahl. Principaux événemens de'fa vie. Éloges
de fon génie 8c de fe$_ouvrages. Il a porté la doftrine chy-
mique au point où elle eft aujourd’hui. Obfcurité de fon
flyle . . .. regardée comme rrès-avanrageufe par ceux qui n’ont
vu qu’à regret que l’art a été proítítué aux profanes. Danger
d’écrire la chymie dans un langage trop vulgaire. Ibid. b. On
ne peut reprocher à Stahl qurune obfcurité relative, qui
n’arrêtera jamais des lefteurs éclairés , tels qu’il s’en trouverà
toujours cinq ou fix dans uhe nation favante. Difciples de ce
maître*
Jean-Fridéric Henckel. Éloge de fes ouvrages.
Fridéric Hoffman , rival de Stahl. On prétend qu’il rt’éut
d’autre vocation à la chymie , que la célébrité de Stahl
dans cette partie. On ne peut le regarder comme chymifte.
Léméry. Sa chymie traduite en Allemand. Il a été le feul
proprement claffique 8c élémentaire en France, jurqu’en
1723 , où s’établit le ftahlianifme.
Théorie de l’attraâion adaptée aux phénomènes chymi- .
ques , par Newton, Keil 8c Freind. Sources où l’on peut
recourir pour trouver les fçnds de doârine 8c d’expériences
chymiques , telles qu’elles exiftent aujourd’hui. Ibid. 437. a.
Méthode à fuivre pour l’étude de 1» chyôiie élémentaire.
Éloge des cours que M. Rouelle fait à Paris*
. Chymie. Inventeurs de la chymie., félon les Arabes. XV.'
201. a. La chymie peut avoir été portée autrefois à un haut
dans la minéralifation des métaux. X. 341. b. Partie de la
chymie , appellée fimia par les Arabes. XV. 201. a. Arah-
rages que la chymie a tirés de l’invention du verre. XVII,
92. b. L influence des aftres établie dans la chymie par les
alchymiftes. VIII. 731. a. rétablie par Urbain Hierne. 732. b.
La connoiffançe de la chymie néceffaire au médefcin. Suppl.
IH. 880. b. Façon métaphorique de s’exprimer , gue les
• médecins arabes portèrent dans la chymie. X. riz. b. Chymie
hydraulique de M. le comte de la Garayc. VIII. 367. a, b.
La chymie introduite dans lu médecine par Arnauld de
X L l l