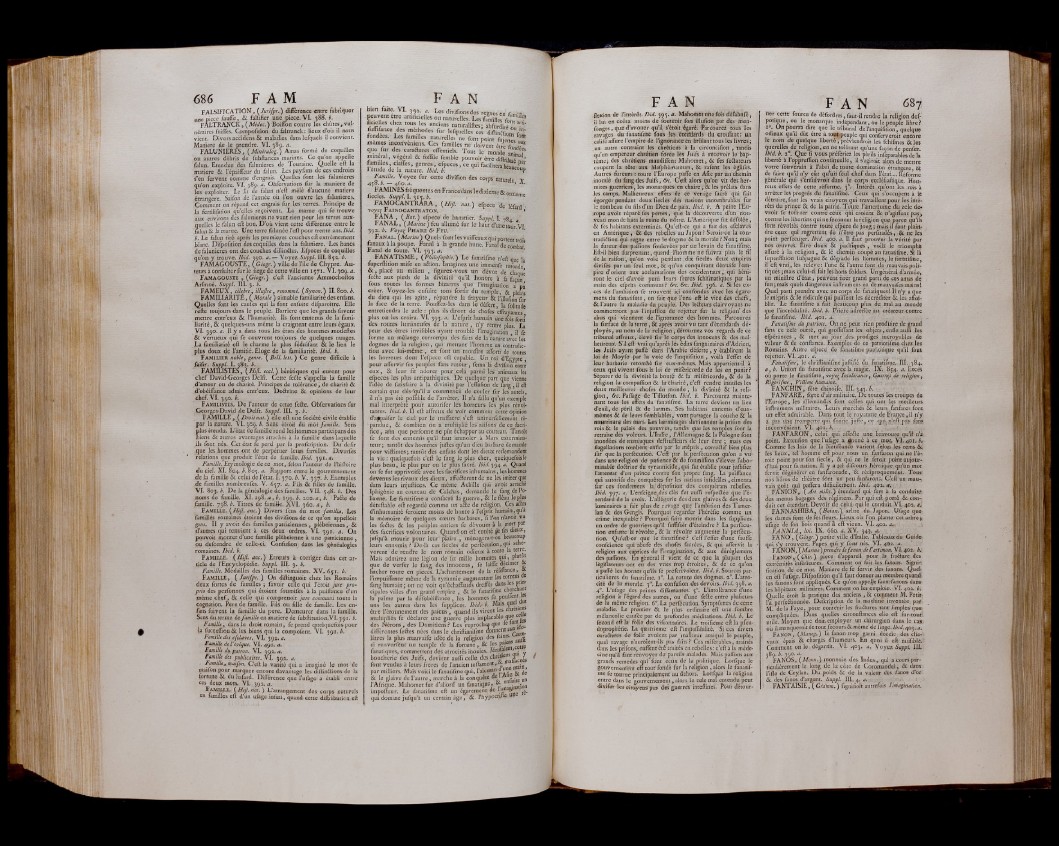
686 F A M f a n
FALSIFICATION, ( Jurifpr.) différence entre fabriquer
nue pjcce fauffc, & faliifier une pièce. VI. 388. b.
FALTRANCK, (Médec. ) Boiflon contre les chûtes, vulnéraires
fuiffes. Compofition du faltranck: lieux d’où il nous
vient. Divers accidens & maladies dans le/quels il convient.
Maniéré de le prendre. VI. 380. a.
FALUNIERES, ( Minéralog.) Amas formé de coquilles
ou autres débris de fubflanccs marines. Ce qu’on appelle
falun. Etendue des fainniercs de Touraine. Quelle eft la
maticre & l’épaiflcur du fàlun. Les payians de ces endroits
s’en fervent comme d’engrais. Quelles font les falunicres
qu’on exploite. VI. 380. a. Obfervations fur la manière de
les exploiter. Le Jit de falun n’eft mêlé d’aucune maticre
étrangère. Saifon de l’année où l’on ouvre les falunicres.
Comment on répand cet engrais fur les terres. Principe de
la fertiliifation qu’elles reçoivent. La marne qui fc trouve
aux environs des falunicres ne vaut rien pour les terres auxquelles
le falun eft bon. D’où vient cette différence entre le
falun & la marne. Une terre falunéc l’cft pour trente ans.Ibid.
b. Le falun tiré après les premières coucncs eft extrêmement
blanc. Difpofnion des coquilles dans la faluniere. Les bancs
de falunicres ont des couches diflinâcs. Efpcces de coquilles
qu’on y trouve. Ibid. 390. a. — Voyez Svppl. III. 852. b.
FAMAGOUSTE, ( Géogr. ) ville de l’île de Chypre. A
teursàconfultcrfurlc ficgcde cette ville en 1571. VI. 309. a.
F a m a g o u s t e , (Géogr.) c’eft l’ancienne Ammochoftos
Arfmoé. Suppl. 111. 3. b.
FAMEUX, célébré. illuflre, renommé. ( Synon.) II.800.b.
FAMILIARITÉ, ( Morale ) aimable familiarité des enfans.
Quelles font les caulcs qui la font enfuite difparoitre. Elle
refte toujours dans le peuple. Barrière que les grands favent
mettre entr’eux & l’humanité. Us font ennemis de la familiarité
, & quelques-uns même la craignent entre leurs égaux.
VI. 390. a. Il y a dans tous les états des hommes modeftes
& vertueux qui fe couvrent toujours de quelques nuages.
La familiarité eft le charme le plus féduifant & le lien le
plus doux de l’amitié. Éloge de la familiarité. Ibid. b.
F a m i l i e r noble, genre. ( Bell. lett. ) Ce genre difficile à
iâifir. Suppl. I. 283. b.
FAMILISTEb, ( Hifl. eccl.) hérétiques qui eurent pour
chef David-Georges Dclfr. Cette feéle s’appella la famille
.d’amour ou de charité. Principes de tolérance, de charité &
d’obéiffancc admis entr’eux. Doélrine & opinions de leur
chef. VI. 390. b.
F a m i l i s t e s . De l’auteur de cette feâe. Obfervations fur
Gcorgcs-David 4c Dclfr. Suppl. 1IL 3. b.
FAMILLE, ( Droitnat.) elle eft une fociété civile établie
par la nature. VI, 309. b. Sens étroit du mot famille. Sens
plus étendu. L’état de famille rend les hommes participans des
biens & autres avantages attachés à la famille dans laquelle
ils font nés. Cet état fe perd par la profeription. Du defir
que les hommes ont de perpétuer leurs familles. Divcrfes
relations que produit l’état de famille. Ibid. 391 .a.
Famille. Etymologie de ce mot, félon l’auteur de l’hiftoirc
du ciel. XI. 804. b. 805. a. Rapport entre le gouvernement
de la famille & celui de l’état. I. 370. b. V. ,337. b. Exemples
de familles nombreufes. V. 637. a. Fils & filles de famille.
VI. 80\.b. De la généalogie des familles. VII. 548. b. Des
.noms de famille. Xi. 198. <*, b. 19p. b. 200.a, b. Paéle de
famille. 738. b. Titres de famille. XVI. 360. a , b.
F a m i l l e , (Hifl. anc.) Divers fens du mot familia. Les
famillés romaines étoient des divifions de ce qu’on appelloit
gens. Il y avoit des familles patriciennes , plébéiennes, &
d’autres qui tenoient à ces deux ordres. VI. 391. a. On
pouvoir monter d’une famille plébéienne à une patricienne,
ou defeendre de celle-ci Confufton dans les généalogies
romaines. Ibid. b.
F a m i l l e . ( Hijl. anc.) Erreurs à corriger dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. III. 3. b.
Famille. Médailles des familles romaines. XV. 651. b.
F a m i l l e , ( Jurifpr. ) On diftinguoit chez les Romains
deux fortes de familles ; favoir celle qui l’étoit jure pro-
prio des perfonnes qui étoient foumifes à la puiffance d’un
même chef, & celle qui comprenoit jure commuai toute la
cogoation. Pere de famille. Fils ou fille de famille. Les en-
fans fuivent Ja famille du pere. Demeurer dans la famille.
Sens du terme de famille en maticre de fubftitution.VI. 391. b.
famille, dans le droit romain, fe prend quelquefois pour
la fucçeffioudc les biens qui la coropofcnt. VI. 391. b.
Famille des efclaves. VI, 39a. a.
Famille de l'évêque. VI. 49a. a.
Famille du patron. VL 392. a.
Famille des publicaires. Vl. 302. a.
' famille,, maifon. C’eft la vanité qui a imaginé le mot de
piaifon pour marquer encore davantage les uiftinélions de la
fortune & du hafard. Différence que l’ufagc a établi entre
ces deux mots. VI. 392. a.
E a m r l EA Hifl. nat.) L’arrangement des corps naturels
en familles eft dun ufage infini, quand cette diftributioneft
bien faite. VI. , ? i . *. Les divifions des règnes en f& ÿ l
peuvent etre art,hc elles on naturelles. Les « 1 1 1 1 1 I
t e l le s chez tous les anciens naturalifles ; abfurdi.é ô ,
fuffifancc des méthodes fur lefquellcs ces diftinà on! V ^
fondées. Les familles naturelles ne f„„, poim f i f â - K #
mêmes mcohvémens. Ces familles ne doivent être te l"
que fur des carafteres effentidsi Tout le monde S ?
minéral, végétal & folTile femblc pouvoir être diltribu*^ ’
familles, daffes, genres, cfpeccs, ce qui faciliterai*,. ^
l’étude de la nature. Ibid. b 1 IacU,tCn,béaucoup
Famille. Voyez fur cette divifion des corps'naturel« v
438. b. — 460. a.
FAMINES fréquentes en Francodans ledixieme & Ê É
ficelés. Suppl. I .2 13. é. ■ . T onïieme
FAMOCANTRARA, ( Hifl. nat. ) cfpcce de léfar<i -
voyer F a i n o c a n t r a t o n . »
FANA , ( Bot. ) efpece de bananier. Suppl\ I. 784 .
FANAL, {Marine)feu allumé fur le haut d’u n e toiir VI
392. b. Voyc{ P h a r e 6 * F e u . *
F a n a l . (Marine) Quels font les vaiffeaux qui portent trou
fanaux à la poupe. Fanal à la grande hune. Fanal de Combat
Fanal de foute. VI. 3 9 3 . a.
FANATISME, (Philofophie.) Le fanatifinc n’eft qlIC u
fupcrftition mife en aélion. Imaginez une immenfe rotonde
8c, placé au milieu , figurez-vous un dévot de chaque
feéle aux pieds de la divinité qu’il honore à fa façon
fous toutes les formes bizarres que l’imagination a pu
créer. Voyez-les enfuite tous fortir du temple, & pleins
du dieu qui les agite, répandre la frayeur & lijhifion fur
la face de la terre. Pouffcz-les dans le défert, la folitude
entretiendra le zele : plus ils diront de chofes effrayantes
plus on les croira. VI. 30 3 . a. L’efprit humain une fois fortî
des routes lumincufes de la nature, n’y rentre plus. La
peur des êtres invifiblcs ayant troublé nmagina'tion il fc
forme un mélange corrompu des faits de la nature avec les
dogmes de la religion, qui mettant l’homme en contradiction
avec lui-méme , en font un monftre ailortr' de toutes
les horreurs dont l’éfpecc eft capable. Un roi’ d’Egypte ,
pour affervir fes peuples fans retour, fema la divifion entre
eux, & leur fit adorer pour xelà parmi les animaux les
efpcces les plus antipathiques. De quelque part que vienne
l’idée de fatisfairc à la divinité par l’efuifion de lang, il eft
certain que dès/qu’il a commencé de couler fur les autels,
il n’a pas été poffible de l’arrêter. Il n’a fallu qu’un cxcrçiple
mal interprété pour autorifer les horreurs les plus révoltantes.
Ibid. b. Il eft affreux de voir comment cette opinion
d’appaifer le ciel par le maffacrc/ s’eft univcrfcllcmcnt répandue,
& combien on a multiplié les raifons de ce Sacrifice
9 afin que perfonne ne put échapper au couteau. Tantôt
fe font des ennemis qu’il faut immoler , à Mars exterminateur
; tantôt des hommes jtiftes qu’un dieu barbare demande
pour viâimes ; tantôt des enfans dont les dieux redemandent
la vie: quelquefois c’eft le fane le plus cher, quclquefoisle
plus beau, le plus pur ou le plus iacré. Ibid.3 9 4 .a. Quand
on fc fut app ri voile avec les facrificcs inhumains, les hommes
devenus les rivaux des dieux, affrétèrent de ne les imiter que
dans leurs injufticcs. Ce même Achille qui avoit arraché
Iphigénie au couteau de Calchas, demande le fang de Po*
lixene. Le fànatifme a confacré la guerre, & le fléau le plus
détcftablc eft regardé comme un acte de religion. Ces ailes
d’inhumanité feroient moins de honte à l’efprit humain, qui
ta mémoire de quelques coeurs barbares, fi l’on n’avoir vu
les feétes & les peuples entiers fe dévouer à la mort par
des facrificcs volontaires. Quand on eft entêté fc fes dieux,
jufqu’à mourir pour leur' plaire , ménagcra-t-on beaucoup
leurs ennemis ? Dc-là ces fiecles de pcrfécution, qui ache'
verent de- rendre le nom romain odieux h toute la terre.
Mais admirez une légion de fix mille hommes qui » P*utj*
que de verfer le fang des innocens, fc laiffe décimer »
hacher toute en pièces. L’acharnement de la réfinance,
l’impuiffance même de l'a tyrannie augmentent les torrens û
fang humain; on ne voit qu’échaffauds dreffés dans les pn
cipalcs villes d'un grand empire , de le fanatifinc chercioa
la palme par la défobéiffance, les hommes fc poullcnt ^
uns les autres dans les fuppliccs. Ibid/ b. Mais quel1
l’éronnemenr des païens, quand ils virent les cniço
ultinliés fc déciarcr une guerre plus implacable que c
_;s Nérons, des Domiticns ? Les reproches que *e
différentes feétes nces dans le chriftianifmc uonnent aux ^
lètrcs la plus mauvaife idée de la religion des wints.
ci renvcrfint mi tc-mple <tc | fortune, & j.“ in c e t t e
fanatiques, commettent des atrocités inouïes, jeruw *
boucherie des Juifs, devient auffi celle des elireFLa^acr^
font vendus h leurs freres de l’ancien teftament, ot
par milliers. Mais voici le fanatifinc qui , l’alcoran 0. ^ ^
& le glaive de l’autre, marche à la conquête d'u * <• -a un
l’Afrique. Mahomet fut d’abord un fanatique, & c . .-n
impofteur. Le fanatifinc eft un égarement de l nn3& ^
qui domine jufqu’à un certain âge, & PliypocçM»f
F A N
flexion de l’intérêt. Ibid. 393. a. Mahothétiihe fois défabnfé,
il lui en coûta moins de foutenir fon illufiOn. par des ihen-
fonges, que d’avouer qu’il s’étoit égaré. Parcoure^ tous les
ravages du fanatifine fous les éteifdàrds du croiffatit: un
calife affurc l’empire de l’ignorance én btûlànt tous les livres ;
un autre contraint les chrétiens à la circoncifion , tandis
qu’un empereur chrétien force lés Juifs à recevoir le baptême;
des chrétiens maudiffent Mahomet, & fes fcélateurs
coupent :1a tête aux blajphématêurs, & raient les églifes.
Autres fureurs t toute l’Europe paffe en Afie par un chemin
inondé du fang des Juifs, 6>c. C eft alors qu’on vit des hcr-
mites guerriers, les monarques en chaire; & les prélats dans
les camps. Malheureux effets de ce vertige facré qui fait
égorger pendant deux fiecles dés nations innombrables fur
le tombeau du fils d’un Dieu de paix. Ibid. b. A peine l’Eu-
ropc avoit réparé fes pertes, que là découverte d’un ilou-
.veau monde hâta la ruine du nôtre. L’Amérique fut déiolée,
& fes habitans exterminés. Qu’cft-ce qui a fait des cfclavcS
en Amérique, & des rebelles au Japon? Scroit-ce là côn-
tradiélion qui règne entre le dogme 8c la nlorale ? Non ; niais
la fureur (les pafiions foulevées par un levain de fanatifitie.
Eft-il bien furprenant, quand l’homme ne fuivra plus le fit
de la raifon, qu’on voie pendant. dix fieclés deux ciiiuirês
divifés par un feul mot, & qu’un conquérant détrüife l’cm-
pirc d’orient aux acclamations des occidentaux, qui béniront
le ciel d’avoir puni leurs frères fchifmatiqttcs par la
main des cfprits communs? &c. &c. Ibid. 396. a. Si les excès
de l’ambition fc trouvent ici confondus avec les égare*
mens du fanatifinc, on fait que l’une eft le vice des chefs,
& l’autre la maladie du peuple. Des leélcurs clairvoyans ne
commettront pas l’iniiifticc de rejetter fur la religion' des
abus qui viennent cíe l’ignorance des htimmes. Parcourez
la furtace de la terre, & après avoir vu tant d’étendards dé'
ployés, au nom de la religion, détournez vos regards de ce
tribunal affreux, élevé fur le corps des innoccfis oc des malheureux.
S’il eft vrai qu’après les ¿dits fanguinaircs d’Adrien,
les Juifs ayant pafic dans l’Arabie déferte, y établirent la
loi de Moyfe par la voie de rinquifition , voilà l’effet de
leur barbarie retombé fur eux-mêmes. Mais appartient-il à
ceux qui virent fous la loi de miféricorde de fes en punir ?
Séparer de la divinité la bonté & la miféricorde, & de la
religion la compaffion & la-charité,c’cft rendre inutiles les
deux meilleures chofes du monde, la divinité & la religion
, 6>c. Paffage de Tillotfon. Ibid. b. Parcourez maintenant
tous les éffêts du fanatifinc. La terre devient un lieu
d’exil, de péril & de larmes. Scs habitans ennemis d'eux-
mêmes & de leurs femblablés, vont partager la couche & la
nourriture des ours. Les hermitages deviennent la prifon des
rois & le palais des pauvres, tandis que les temples font la
retraite des voletirs. L’Italie, l’Allemagne & la Pologne font
inondées de maniaques deftrufteufs de leur être ; mais ces
flagellations tombent enfin par le mépris, corrcélif bien plus
iùr que la pcrfécution. C’eft; par la. perfécution qu’on a vu*
dans une religion de patience & de fouiniffion s’élever l’abo->
minable doârinC du tyrannicide, qui fut établie pour juftifier
l’attentat d’un prince contre fon propre fang. La puiffance
qui autorifa des conquêtes fur les nations inhdcllcs, cimenta
lur ces fondemens la/ déposition des conquérans rebelles.
Ibid. 307. a. L’enfeignesdes clés fut auffi refpeêtcc que l’étendard
de la croix. L’allégorie des deux glaives & des deux
luminaires a fait plus de ravage que l’ambition des Tamer-
lan & des Gcngis. Pourquoi regarder l’hcréfic comme un
crime, inexpiable ? Pourquoi faire mourir dans les fuppliccs
un ordre de guerriers qiril fuffifoit d’éteindre ? La pcrfécution
enfante là révolte, & la révolte augmente la pcrfécution.
Qu’cft-ce que le fanatifinc? c’cft l’effet d’une fauffe
confidence qui abufe des chofes facrécs, & qui affervit la
religion aux caprices de Fimaginatiôn, & aux dérégtemens
des pafiions. En général il vient de ce que la plupart des
législateurs ont en des vues trop étroites, & de ce qu’on
a paffé les bornes qu’ils fc prcfcriVOiCnt. Ibid. b. Sources particulières
du fanatifinc. t°. La nature des dogmes. 20. L’atrocité
de ht morale. 30. La confùfion des devoirs. Ibid. 398. a.
4°. L’ufagc des peines diffamantes. 3®. L’intolérance d'une
religion à l’égard des autres, ou d’une fefte entre pluficurs
de Ta même religion. 6°. La pcrfécution. Symptômes de cette
maladie. Le premier & le plus ordinaire eft une fombre
mélancolie cauféc par de profondes méditations. Ibid. b. Le
fécond eft ht folie des vifionnaircs. Le rroifieme eft la pfcii-
doprophérie. La quatrième eft l’impaifibilité. Si ces divers
cwra&eres de folie avoient par malheur attaqué le peuple,
quel ravage n’auroient-ils pas faits? Ces miférablcs, tramés
dans les priions, enflent été traités en rebelles : c’cft à la médecine
qu’il fàur renvoyer de pareils malades. Mais paflons aux
grands remedes qui font ceux de la politique. Lorfque le
gouvcrneiifefnt eft tout fondé fur la religion, alors le fanatifine
fe tourne principalemçnt au dehors. Loffouc la religion
entre dans le gouvernement, alors le zele mal entendu peut
divifor les citoyens pa» des guerres inteftines. Pour détour-
F A N 687
iier cette fourcc de défordres, faut-il rendre la religion despotique
, ou le monarque indépendant, ou le peuple libre ?
i°. Un pourra dire que le tribunal de l’inquifition, quelque
odieux qu il dut etre a tout-peuple qui confcrveroit encore
le nom de quelque liberté ; préviendroit Ici fchifmcs &les
querelles de religion, en ne tolérant qu’une façon de penfer.
Ibid. b. 20. Que fi vous préfériez les périls inféparablcs de la
liberté à l’oppreffion continuelle, il s agiroit alors de mettre
votre fouverâin à l’abri de toute domination étrangère 61
de faire qu’il n’y eût qii’ùif feul chef dans l’étaf.... Réforme
générale qui S’Cnfuivroit dans le corps eçcléfiaftique. Heureux
effets de cette, réforme^ 3 . Intérêt qu’ont les rois à
arrêter lCS progrès du fanatifinc. Ceux, qui s’occupent à le
détruire, font les vrais citoyens qui travaillent pour les irité-
rêts du prince & de la patrie. Toute l’âmcrtumc dii zele de-
vroit fc tourner contré ceux qtii croient & n’agiffent paÿ>
contre les libertins qui nefecoucnt la religion que parce qu’ils
font révoltés contre foufê clpéce dé joug ; mais il faut plaindre
ceux qui regrettent de iTêtre pas perfuadés, fk ne les
point pcrfécuter. Ibid. 400. à. îl faut prouver la vérité par
nos oeuvres. Être doux & pàclfiqués , voilà le triomphe
aflùré à la religion, & le enemin coupé au fanatifine. Si la
fupcrftition fübjugue & dégràdc les hommes, lu fanatifine,
il eft vrai, les rdeve: l’une & l’autre font de mauvais politiques
; mais celui-ci fait les bons foidats. Un général d’armée,
un miniftre d’état, peuvent tirer grand parti de ces amas de
feu;mais quels dangereux ihftrumens en demaûvaifcsmainsî
Quel parti prendre avec un corps de fanatiques 1 11 n’y a que
le mépris & le ridicule qui puiffent les décréditer & les affoi-
blir. Le fanatifine a fait beaucoup plus de mal au monde
que l’incrédulité. Ibid. b. Prieto âdreffée au créateur contre
le fanafîfiiié. Ibid. 401. à.
Fanatifme du patriote. On né peut rien produire de grand
fanS Ce zélé outré, qui grofiiflant les objets, enfle a uni les
efpérânccs , & met au jour des prodiges incroyables de
valeur &de confiance. Exemples de ce patriotifinc. chez les
Romains. Autre cfpcce. de fanatifinc paulotiqdp qu’il faut
rejetter."VI. 401. a.
Fàhdtifme\ le chriftianifmc juftifié (Tu fanatifine. IlI. 384.
a , b. Union du fanatifine avec la magic. IX. 834. a. Excès
où porte le fanatifine, voyez Intolérance, Guerrpp de religion,
Rigorifnie, Viêlime humaine. ,
FANCHÍN, fête cbíriójfe.' III. 343. b.
FANFARE, fiy'tc d’air militaire. De toutes, les troupes de
l’Europe, les allemandes font celles qui ont les meilleurs
inftrumens militaires. Leurs marchés oc leurs, fanfares font
un effet admirable. Dans tout, lé royaume ,de Françe, il n’y
à pas une frômpcrtc qui fonne. juuc, ce .quln’eApas fans
inconvénient. Vl. 401. b.,
FANFARON, celui qui affeéle une bravoure qu’il n’à
point. Extcnfion que l’ufagc a xjpnné à ce mot. VI. 401. %
Comme les loix de la bicnféancc varient, félon les* tems Ôc,
(es fieux, 'tel homme eft pour nous un fanfaron qui ne l’étoit
point pour fon fiecle, & qui ne le feroit point aujourd’hui
pour fa nation. Il y a tel difeours héroïque qu’un mot
feroit dégénérer en fanfaronade, & réciproquement. Tous1
nos liéros ’dc tfiéârrc font un peu fanfarons C’eft un mau-,
vais, gotit qui pafiera difficilement. Ibid. 402. a. \
FANION, (Art rhilit.) étendard qui feit à la conduite
des menus bagages des regimens. Par qui cft: porté 60 conduit
cet étendart. Devoir de celui qui le conduit. VI. 402. «.
FANNASIUBA, (Botanff arbre^ du, lapon. Ufage quo,
les dames font de fes fleurs. Lieux où l’on plante cet arbre *
ufage de fon Éois quanail eft vieux. VI. 402. a,.
F.ANNIA,, loi. IX. 660. a. XV. 343. a.
FANO , (GéogrA petite ville d’Italie. Tableaux du Guide
qui sV trouvent. Papes qui y font nés. VI. 402. a.
F ANON, ( Marine ) prendre le fanon del artimon. VI. 402. b.
F a n o n „ (Chir.) pièce d'appareil pour lit fraâure des
extrémités inférieures. Comment on fait les fanons. Signi-;
ficatÎOn de ce mot. Maniere de fe fervir des fanons. Quel
c.ii eft l'ulâgc. Dïfpofitfon qu’il faut donner au membre quand'
les fanons font appliqués. Ce qu’on appeljc faiixrfanons dan»
les hôpitaux militaires; Comment on les emploie. VI. 402. b.
Quelle étoit fa pratique des anciens, & comment M. Petit-
l’a, pcrfeRionnée. Dcfcription de la machine inventée- pat*
MÍ de la Fayc, pour contenir les fraélurcs tant Amples que
compliquées. Dans quelles circonftanccs elle eft fur-tout-l
utile. Moyen que doit employer un chirurgien dans le ca»,
où ilmanqucroitdetout/ecoursflcmême'dc linge, /¿¿d.403. a.
F a n o n , (Maneg.) le fanon trop garni dc.celc des cHe?
vaux épais 8c chargés d’humeurs. En quoi il eft nuifiblé. -
Comment on le. dégarnit. VI. 403. a. Voyez Suppl. III.
389. b. 390. a.
FA NOS, ( Monn.) monnoie des Indes ,> qui a cours particulièrement
le long de la côte de Coromandoi, & dans
lifte de Çcylan. Du poids 6c de la valeur des fanos d’or
Si des- fanos d’argent. Suppl. III. 4.a . .
FANTAISIE, ( Gfdnxnï. ) fignifioft autrefois Fimaginatiôn.