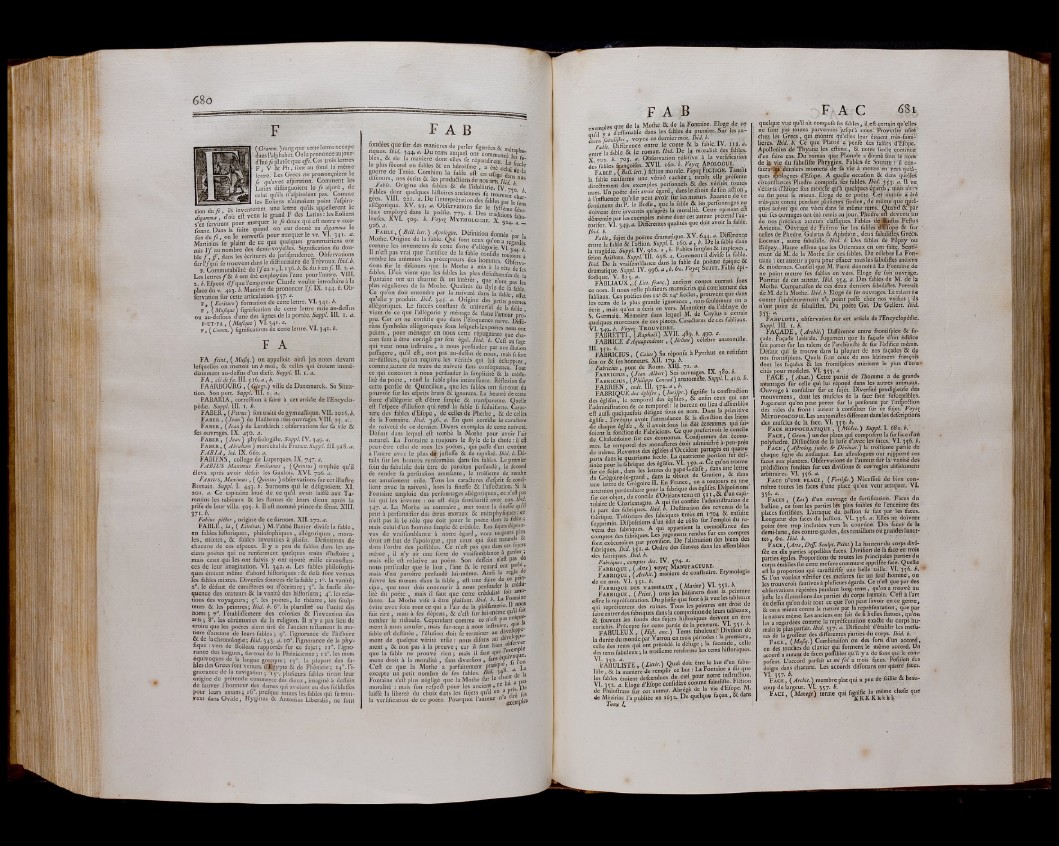
68o
Gramm. ) rang que cette lettre occupe
dans l’alphabet. On la prononce aujourd’hui
fe plutôt que effe. Ces trois lettres
F , V & Ph, font au fond la même
lettre. Les Grecs ne prononçoient le
fe qu’avec afpiration. Comment les
Latins diftinguoient le fe afpiré, de
celui qu’ils n’afpiroient pas. Comme
les Eoliens n*aimoient point l’afpira-
«ion du f i , ils inventèrent une lettre qu’ils appellerent le
digomma, d’où eft venu le grand F des Latins : les Eoliens
s’en fervirent pour marquer le f i doux qui eft notre v couronne
Dans la finie quand on eut donné au dieammu le
fiin du f i , on le renverfa pour marquer le ne. VI. 341. a.
Martinius fe plaint de ce que quelques grammairiens ont
mis 1’/ au nombre des demi-voyelles. Signification du double
/ / dans les écritures de jurifprudence. Obfervations
fur F/qui retrouvent dans le diftionnaire de Trévoux, ftid. 4.
F . Coiiiinutabilité de l’/en v ,I . n é . i .& d u ie n / I I . 2. u.
Les lettres/ & h ont été employées l’une pourlautre. V lll.
a. é. Efpece d’/que l’empereur Claude voulut introduire a la
piace du v. 4*3. b. Maniéré de prononcer Vf. IX. 144. b. Ob-
rervationfurcettearticulation.337.it.
F , (Ecriture) formation de cette lettre. V I. 341. b.
F | (Mufuptc) fignification . iujique 1 n g n in cu iiu n udve cette »le»tt.rve mif-e au-—defliis
ou au-deflous d’une des lignes de la portée. Suppt. III. i
F -U T -F A , (Mufique ) VI. 34i.fi. • _
F , ( Comm.) fignifications de cette lettre. V I . 341. b.
F A
FA feint t ( Mufiq.) on appelloit aiiifi jes notes devant
lefquelles on mettoit un b mol, & celles qui étoient immédiatement
au-deflfus d’un diefe. Suppl. II. i. a.
F A , clé de fa. III. 516. a , b.
FAARBOÚRG, (G¿oer.) ville de Danemarck. Sa Situation.
Son port. Suppl. n i. i. a*
FABARIA, correélion à faire' à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 1. b.
FABER, (Petrus) fon traité de gymnaftique. VII. 1016. b.
F a b e r , (Jean ) de Hailbron : fes ouvt'ages. VIII. 25. a..
F a b e r , (Jean) de Lentkirch : obfervations fur fa vie &
fes ouvrages. IX. 450. a.
F a b e r , (Jean') phyfiologifte. Suppl. IV. 349. a.
F a b e r , ( Abraham ) maréchal de France. Suppl. III. 918. a.
F A B IA , loi. IX. 600. a.
FABIENS, collège de Luperqucs. IX. 747. a.
FABIUS Maxïmus Emilianas , (Quintus) trophée qu’il
éleva après avoir défait les Gaulois. XVI. 706. a.
Fabius, Maximus , ( Quintus ) obfervations fur cet illuftre
Romain. Suppl. I. 443. b. Surnoms qui le défignoient. XI.
201. a. Ce capitaine loué de ce qu’il avoit laiíTé aux Ta-
rentins les tabicaux & les ftatucs de leurs dieux après la
prife de leur ville. 503. b. Il eft nommé prince du fénat. XIII.
Í Ü b\ . Fabius piflor, origine de ce furnom. XII. 272. a.
FABLE, la, ( Littirat. ) M. l’abbé Banicr divife la fable,
en fables hiftoriques, philofophiques , allégoriques, morales,
mixtes, 8c fables inventées à plaifir. Définitions de
chacune de ces efpeces. Il y a peu de fables dans les anciens
poètes qui ne renferment quelques traits d’hiftoire ;
mais ceux qui les ont fuivis y ont ajouté mille circonftan-
ces de leur imagination. VI. 342. a. Les fables philofophiques
étoient même d’abord hiftoriques : & delà font venues
les fables mixtes. Diverfes fources de la fable ; i°. la vanité;
2°. le défaut de caracteres ou d’écriture ; 30. la faufte éloquence
des orateurs & la vanité des hiftonens ; 40. les relations
des voyageurs ; 30. les poètes, le théâtre, les fculp-
teurs 8c les peintres ; Ibid. b. 6°. la pluralité ou l’unité des
noms ; 70. l’établiffement des colonies 8c l’invention des
arts ; 8°. les cérémonies de la religion. Il n’y a pas lieu de
croire que les poètes aient tiré de l’ancien teftament la matière
d’aucune de leurs fables ; 90. l’ignorance de l’hiftoire
& de la chronologie; Ibid. 343. a. io°. l’ignorance de la phy-
ftque : vers de Boilcau rapportés fur ce fujet ; 1 1°. l’ignorance
des langues, fur-tout de la Phénicienne; 120.les mots
équivoques de la langue gre.çque ; 130. la plupart des fables
des Grecs font venues d’Egypte 8c de Phénicie ; 140. l’ignorance
de la navigation ; 15«. plufieurs fables tirent leur
origine du prétendu commerce des dieux, imaginé à deflein
de fauver 1 honneur des dames qui «voient eu des foiblcilcs
pour leurs amans; 16 .prefque toutes les fables qui fetrou-
rent dans Ovide, Hyginus & Antonius Libcralis, ne font
F A B
fondées que fur des manières de parler fùmrécs & .
EïïVf ?44' ' r S ■¡P"1 •« »mm™stp,r bles, & de la maniéré dont elles fe répandirent r ?
le plus fécond en fables & en héroïfme , a été t S 5“ e
guerre de Troie. Combien la fable eft en ufaæ à la
difeours, nos écrits & les produfllons de nos art? m m i ™5
Fabl, Origine des fables & de l’idolâtrie [ T i I
Fables; dont quelques lilftoites anciennes fe trouvent ,*
gées. V lll. aai. u. De l’interprétation des fables par „ 5” '
allégorique. XV. ai. a. Obfervations fur le fylême * k "
léux employé dans la poéfic. 779. b. Des trailmn.« f 7
| Ü ¡ ¡ ¡ j 309- g f f | Mytholoo’e x “ § -
926. A
, , FÎ bl?.’ ü ) ¿polcguc. Définition donnée Mr 1
Mothe. Origine de la fable. Qui font ceux qu’on a reLdi?
comme les inventeurs de cette forte d’allégorie. VI WÂl
Il n’eft pas vrai que l’artifice de la fable confifté toùiours i
rendre les animaux les précepteurs des hommes. Obfe
tions fur le difeours que la Mothe a mis à la tête deTes
fables. D’où vient que les fables les plus défeftueufes de la
Fontaine ont un charme 8c un intérêt q..u..e.. .n ’o*nt pas les
plus régulières de la Mothe. Qualités du ftyle de la fable
Ce qu’on doit entendre par la naïveté dans la fable effet
qu’elle y produit. Ibid. 345. a. Origine des petits poèmes
allégoriques. Le fucces confiant & univerfel de la fable
vient de ce que l’allégorie y ménage & flatte l’amour propre.
Cet art ne confifte que dans l’éloquence naïve. Différons
fymboles allégoriques fous lefquels les poètes nous ont
peints , pour ménager en nous cette répugnance que chacun
fent à être corrigé par fon égal. Ibid. b. C’eft au faee
qui veut nous inftruirc , à nous perfuader par une illufion
paffagere, qu’il eft, non pas au-deflùs de nous, mais fi fort
àu-deffous, qu’on reçoive les vérités qui lui échappent,
comme.autant de traits de naïveté fans conséquence. Tout
ce qui concourt à nous perfuader la fimplicité 8c la crédulité
du poète, rend la fable plus intéreflante. Réflexion fur
cette penfée de Quintilien, que les fables ont fur-tout du
pouvoir fur les efprjts bruts & ignorans. La beauté de cette
forte d’allégorie eft d’être limpie & tranfparentc. Quelle
eft l’efpece d’illufton qui rend la fable fi féduifante. Caractère
des fables d’Efope , de celles de Phcdre, 8c de celles
de la Fontaine. Ibid. 346. a. En quoi confifte le caraâere
de naïveté de ce dernier. Divers exemples de cette naïveté.
Défaut dans lequel eft tombé la Mothe pour avoir l’air
naturel. La Fontaine a toujours le ftyle de la chofe:il eft
peut-être celui de tous les poètes, qui paffe d’un extrême
à l’autre avec le plus dj| jufteffe 8c de rapidité. Ibid. b. Détails
fur les beautés renfermées <jans fes fables. Le premier
foin du fabulifte doit être de paroître perfuadé, le fécond
de rendre fa perfuafion amulante, le troifieme de rendre
cet amufement utile. Tous les caraâcres d’efprit fe concilient
avec la naïveté, hors la flnefTe 8c l’affcâation. Si la
Fontaine emploie des perfonnages allégoriques, ce n’eft pas
lui qui les invente : on eft déjà familiarité avec eux. Ibid.
347- La Mothe au contraire, met toute la fineffe qu’il
peut à perfonnifler des êtres moraux 8c métaphyfiques .* ce
n’eft pas là le rôle que doit jouer le poète dans la fable î
mais celui d’un homme Ample 8c crédule. Les fujets dépourvus
de vraifcmblance à notre égard, vont toujours plus
droit ai» but de l’apologue, que ceux qui font naturels oc
dans l’ordre des poffiblcs. Ce n’eft pas que dans ces fujets
même , il n’y ait une forte de vraifcmblance à garder ;
mais elle eft relative au poète. Son deflein n’eft pas do
nous perfuader que le lion , l’âne 8c le renard ont1 pari||
mais d’en ' paroitre perfuadé lui-même. Ainfi la regle |
fuivre les moeurs dans la fable , eft une fuite de ce pnu*
cipe, que tout doit concourir à nous perfuader la cre ■
lité du poète , mais il faut que cette crédulité foit am -
fante. La Mothe vife à être plaifant. Ibid. b. La Font3*
évite avec foin tout ce qui a 1 air de la plaifanterie. Il no
fait rire , mais à fes dépens, 8c c'eft fur lui-même qu t_
tomber le ridicule. Cependant comme ce n’eft pas umq ^
ment à nous amufer, mais fur-tout à nous inftruire, q
fable eft deftinée, l’illuflon doit fe terminer au déve PP
ment de quelque vérité utile : nous difons au <‘ ^-e‘^er
ment, 8c non pas à la preuve ; car il faut bien 0 je
que la fable ne prouve rien ; mais il faut que .
mene droit à la moralité , fans diverfion , fan5 * |.Qrl
C’eft ce que la Mothe a. ppaarrffaaiitteemmeenntt pratiq11»o- » Û .La
excepte un petit nombre de fes fables. Ibid’ 34 ’ j ja
Fontaine s’eft plus négligé que la Mothe fur le c a aS
moralité ; mais fon rcfpeél pour les anciens, r.e
laiffé la liberté du choix dans les fujets qu’il en a F • ^
la verfifteation de ce poète. Pourquoi l’auteur n jgj
F A B F A C 681
„ , mDle, que fie la Mothe & de la Fontaiue. Eloge de ce
ou il V a d'çftimabie dans les fables du prenuer. Sur les an-
cietts fibujifies, voyez ce dernier mot. ibid. b. . ,
Fuite Différence entre le conte & la fable. IV. l u . a.
ih fable & le roman. Ibid. De lq moraliid des fables.
; b 70I. a. Obfervation relative à la verfification
des fabies ftançplfes. XVII. tfio. b. Ecye£ APOLOGUE.
F a b l e , ( Bell. 1er.. ) fiftion morale. FùyejFlCTlQN. Tantôt
la fable renferme une vérité cachée.; tantôt elle prefeptè
dircélement des exemples perfonnels 8c des verués toutes
nues. Un poète doit avoir égard, dans le choix de fon action,
à l’influence qu’elle peut avoir for les moeurs. Exanjen .de ce
.fentintent du P. le Boflù, que la fable & les perfonnages ne
doivent être ipventés qu'après la moralité. Cette opinion eft
démentie par les exemples même dont cet auteur prétend1 lau-
torifer. VI. 349. a. Différentes qualités que doit avoir la fable.
lbFable, fuiet du poërae dramatique. XV. Î44. a. Wdrencp
entre la fable 8c l’aflion. Suppl. I. 160. a , b. De la fable dans
' tragédie. Suppt. IV. 061. a , b. Fables impies 8çiniplexes,
la tragédie,ouppt.i v .902.a o.x au.v» .....j..«* t ,félon Ariftote. Suppl.c....«/ m Tïi . 638.8 a.n. Comment Comment il il divife divife h la table.
fable.
Ibid. De la vraifemblance dans la fable du noeme épique oc
dramatique. Suppl. IV. e,g6.a.b.&e. F e / r f S u j e t . Fable épi-
fodique. V. 815. a. >
FABLIAUX, (Litt.franç.) anciens coqtes cpimus fous
ce nom. Il nous refte plufieurs manuferits qui contiennent des
fabliaux. Ces poéfics des 12' 8c 14e Accles, prouvem.que dans
les tems de la plus grande ignorance, non-fculcinent on a
écrit mais qu’on a écrit en vers. Manufcnt de. 1 abbaye de
S. Germain. Mémoire dans lequel M. de Caylus a extrait
quelques morceaux de ces pièces. Caractères de ces rabliaux.
VI. 3 4 0 . b. Voyez T r o u v e r R E .
FABRF.TTI, ( Raphaël) XVII. 489. b. 490. |
FABRICE ifAquapenierue , (Jérôme) célébré anatomdte.
III. 352. b.
FaLrICIUS , ( Caïus) Sa réponfe à Pyrrhus en refufant
on or 8c fes honneurs. XII.
Fïaabbnricciiuuss,, ppoonntt duee Rxvodmiuei... X4 U^ L. 71. —
F a b r i c i u s , ( Jean Albert) Ses ouvrages. IX. 380. b.
F a b r i c i u s , (Philippe Conrad) anatomute. Suppt. 1. 410. b.
FABRIEN, code. III. 37a. a , b.
FABRIQUE des édifie , (Jurifpr.) figmfie la conftru£hon
les églifesT le temporel des égltfes, & enfin ceux qu. ont
’adminlfirationde ce temporel: le bureau oulieudaffemblée
lit auffi quelquefois défigué fous ce nom. Dans la prunmve
■elife, l’evêque avpit l’intendance 8c la direction des biens
i l chaque égîife , & ¡1 avoit fous lui des économes qu. fat-
bien. la fonction de Fabriciens. Ce que préfet.vo.t le concile
le Chalcédolnc fur ces économes. Coadjuteurs des éçono-
nos Le temporel des monafteres étolt admmiftré à-peu-prés
le même. Revenus des égllfes d’Oecldent partagés en quatre
larts dans le quatrième fiecle. La quatrième portion fut def-
ruéepour la fabrique des égllfes. Vl. p o .a .
ut ce fujet, dans les lettres du pape Gelafe, dans une lettre
Je Gréeoire-lc-grand, dans le décret de Gratien, 8c dans
une lettre de ¿Trégoire II. En France 1 on a toujours eu une
attchtion particulière pour la fabrique des égltfes. Difoofitions
fur cet objet, du concile d'Orléans tenu en ( i l , & dun capt-
tulaite de Charlemagne. A qui fut confiée 1 adminlfiration de
la part des fahtlquel lb i d l Deftinaùou des «venus de la
fabrique. Tréforlers des fabriques créés en 1794 ®c .e" ‘ulIC
fiipprimés. Difoofitions d’unédit de 1680 fur 1 emploi du revenu
des fabriques. A qui appartient la connoiflance des
comptes des fabriques. Les iugemens « " du?/“ r..c“ J°™P!“
font exécutoires par provifion. De labénauon des hetis des
fabriques. Ibid. 3 31. u. Ordre des féances dans les aflemblées
des fabriques..ibid. b.
Fabriques, comptes des. IV. <74. n.
F a b r i q u e , (Arts) voyeç M a n u f a c t u r e . .•
Fabrique, ( Archit.) manière de conftruire. Etymologie
de ce mot. VI. 331. b. . . VT ,
F a b r i q u e d e s v a i s s e a u x , (Marine) V L 331. t>.
F a b r i q u e , (Peint.) tous les bâtimens dont la peinture
offre la repréfentation. Du plaifir que font à la vue les tableaux
qui représentent des ruines. Tous les peintres ont droit de
faire entrer des fabriques dans la compofition de leurs tableaux,
8c fouvent les fonds des fujets hiftoriques doivent en être
enrichis. Précepte fur cette partie de la peinture. VI. 331. b.
FABULEUX, (Hiflo anc.) Tems fabuleux*Divifion de
la durée du monde par Varron en trois périodes : la première,
celle des tems qui ont précédé le déluge ; la fécondé, celle
des tems fabuleux ; la troifieme renferme les tems hiftoriques.
V FjÿlULISTE, (Littir.) Quel doit être le but d’un fabulifte
, & la manière de remplir ce but : La Fontaine a dit que
les fables étoient defcenducs du ciel pour ¿.n1. ‘
VI. 332. «x. Eloge d’Efope confidéré comme fa!)ul ?pe- ^ aif.n
Pliiloftrate for cet auteur. Abrégé de la vie dEfope. Mquelque
vue qu’il ait compofè les fables, il.eft certain qu’elles
ne font pas toutes parvenues jufau’à nous.' Proyèvbe ufité
chez lés Qrecs, qui ÿiontre qu’elles leur ¿toiént.très-^mi-
liercs. Ibid.' b. Cô que Plàton a penft dès''fables d’Efôpc.
Apollonius de Thyane les eftima, 8c notre ficcle continué
d’en faire cas. Dti'roman que Planude a donné fous léffpnr
de I41 vie du fobulifte Phçygien. Fables dé Socratè : il cdn-
facra'les derniers momens de fà vie à înettrè en'yCri 'qiicl-
ques apologues d’Efope. A quelle o.ccafiqn. 8c dans quelles
circonitànces'Phcdrc compoia fes fables. Ibid.'.333: a. Il ne
s’écarta'd’Efope fon modèle qti’à ! quelques égaï-qs , ipÿis aj'o^S-
ce. fut pour le mieux. Eloge de ce poète. ;CeÎ ?autenr a été
très-peu conniï pendant plufieurs fiecles de mémc que quel-
qnes àutrés'qm ont vécu’dans le même rems1. Quâhd 8c par
qui fes ouvrages ont été remis au jour. Phedreèft devenu Ain
de nos précieux auteurs' cÎàfoq'ues. Fables tlejRuftis Fèftus
Avierius. 'Olivfàg;é dé'Faërnd for les fables doefopç 8c for *
celles de Phedre. Gabrias 8c Aphthon, deux fabuliués Grées.
Locman, autre fabulifte. Ibid. b: "Des fables dé Pilpây ou
Bidpay., Haute eftime que les.Orientaux en ont faite. Septi-
mcnt ’dé M. 'de. la Mothe.iur ces. fables. Du célébré La Fontaine
: cet auteur à paru pour effacer tous les fabuliftes anciens
8c modernes. Confeilque M. Pàtrù donnoità La Fontaine de
ne point mettre fes fablès en vers. Eloge de fon ouvrage.
Portrait de cet auteur. Ibid. 334. a. Des fables de M. de la
Mothe. Comparaifon de ces deux derniers fàbuliftes. Portrait
de M. dé la Mothe. Ibid. b. 'jElpgé de fes ouvrages. Lé talent dè
conter 'fiipérieiirement n’a noînt paffé chez nos voifins ; ils
n’ont point de fabuliftes. Du poète Gai. De Gçllert. Ibid.
335. '
F a b u l i s t e , obfervation for cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 1. b. . .
FAÇADE, (Archit.) Différence entre frontifpice 8c façade.
Façade latérale. Jugenièrit que la façade dun édifice
fait porter for les talens de rarchiteftc 8c for l’édifice même.
Défaut qui fe trouve dans la plupart de nos façades 8c dp
nos frontifpiccs. Quels font ceux de nos bâtiïnens françois
dont les foçadcs 8c les frontîfpices méritent le plus d’être*
cités pour modèles. VI. 333. a. ■ j
FACE , (Anat.) Cette partie de l’homme a de grands
avantages fur celle qui ïui répond dans les autres animaux.
•■Ouvrage à confolter for ce lujÜt. Diverfité prodigieufe des
mouvemens, dont lés müfcles de la face fonr foîceptibles.
Jugement qu’on peut porter for la perfonne par l’inipeftion
des rides au front : auteur à confolter for ce fujet. V°yeK.
M é t o p o s c o p i e . Les anatomiftes différent dans les deferiptions
des mufcles de la face. VI. 333. b.
F a c e h i p p o c r a t i q u e , (Midec.) Suppl. I. 68t . b.
F a c e , ( Geom.) un des plans qui compofom la forfàce d’ud
polyhedre. Diftiiiétion de la bafe d’avec les faces. VI. 336. b.
F a c e , (Aflrolog. judic. & Divïnat.) la troifieme partie de
chaque figne du zodiaque. Les aftrologues ont rapporté ces
faces aux planetes. Obfervations de l’auteur for la1 vanité des
prédirions fondées fur ces divifions 8c ces règles abfplumertt
arbitraires. VI. 336. a.
F a c e d ’u n e p l a c e , ( Fortifie. ) Néceflité .de bien c o i î -
noître toutes les faces d’une place qu’on veut attaquer. VI.
336. a. v’
F a c e s , (Les) d’un ouvrage de fortification. Faces du
baftion, ce font les parties les plus foibles de l’enceinte des
£ laces fortifiées. L’attaque du baftion fe fait par les' faces.
,ongueur des faces du baftion. VI. 336. a. ISlles né doivent
point être trop inclinées vers la couftinè! î>cs faces de la
demi-lune, des contre-gardes, des tenaillons ôu grandes lunettes
, bc. Ibid. b. . ‘ .
F a c e , (ArtSyDeJf. Sculpt. PeintYLi hauteur du corps dtvi-
fée en dix parties appellées faces. Divifion de Îa race en troi*
parties égaies. Proportions de toutes les principales parties du
corps établies fur cette mefure commune appeliée face. Quelle
eft la proportion qui caraftérife une belle-taille. VI. 336. b. •
Si l’on vouloit vérifier ces mefures for un foui homme, on
les trouveroit fautives à plufieurs égards. Ce n’eft que par des
obfervations répétées pendant long-tems, qudna trouvé du
iufte les dimcnfions des parties du corps humain. C eft à 1 art
du deflin qu’on doit tout ce que l’on peut favoir en ce genre,
8c on a mieux connu la nature par la repréfentation, que par
la nature même. Les anciens, ont foit de fi belles ftatucs, qu On
les a regardées comme la repréfentation exafte du corpS humain
te plus parfait. Ibid. j 3 7. ¿. Difficulté d’établir les mefures
de la grofTeur des différentes parties du corps. Ibid. b.
Fa ce , (Mufiq.) Combinaifon ou des fons d’Un accord,
ou des touches au clavier qui forment le même accord. Un
accord a autant de faces pofTtbles qu’il y a de fons qui je com-
pofent. L’accord parfait ut mi fol a trois faces. Pofition des
doigts dans chacune. Les accords difïonans ont quatre races.
VI. 3 37. b. « C L
Face , ( Archit.\ membre plat qui a peu de faillie 8c beaucoup
de largeur. VI. 337. b. \ : l >
F a c e , (Manège) terme qui ft&KniK£cKJ ^lvIkTk^keK1, ^ue