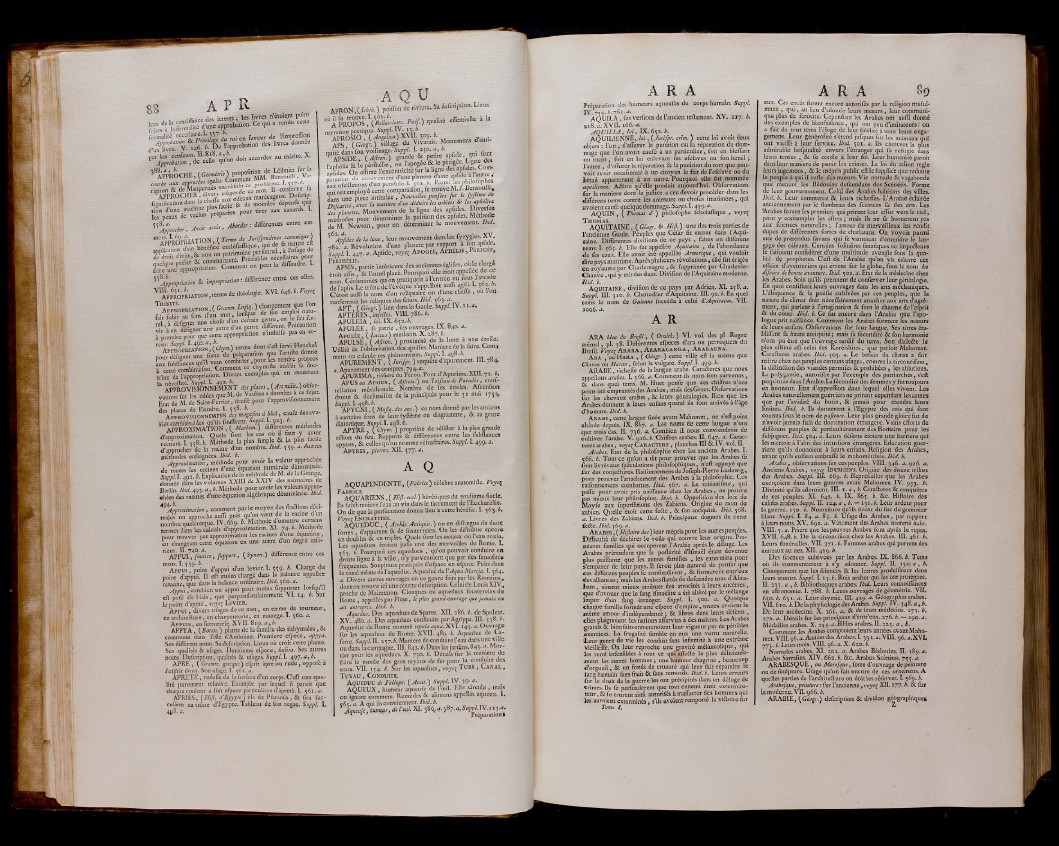
83 A P R
■ir 4« lettres, les livres nètoient point 1
} % îdfh fo rm S t è d'uneapprobarion.Cequta rendu cette
formalité roi en faveur de l’impreffion
M È Ê Ê txm ff lpFdes üTres *lonn
S ] qu’on doit accorder au mérite. X.
eourbe aux approches ce ’ ])roilémc. I. 5 S7-*•
rienon & de Maupertius ontrilo i u conferve fa
APPROCHER , Avers ' ^ ¿ Cmarécage„x. Defcrtp- ]
figmficanon dans la chaffe moindre dêpenfe que
i l H i canar<k-
Approcher, Avoir occis, Aborder : différences entre ces
mots. I-^-nVAT-TrkN / Terme de Jurifprudence canonique )
de droit divin, & non un p p ,J bles „¿ceffaires pour
( "■ L
” Appropriation & impropriation : différence entre ces a3 es.
^ ¿ p lo p U iO t t , t e rm e de théologie. XVI. 646. *. I;?»SèS'îïstsS ä
renr. Suppl. 1-4 9 b/a ym) tormo dont s’eftfervl Henckel
lâÊ ^ tÊ ftÊ /Ê B B i
i ■— 1
u  p p r o v k K n p Æ n t dPpUci I
vaüons fur les tables que M. de Vauban a données a ce lu,et
Ermde M. de Saint-Ferrier, dreffè pour l’approvdionnement
^AppROVKIONNEMESS des magafins i bled, caufe desava- I
“ a î PROÄ Ä l f S l J f Æ t e ' s méthodes
S3SSS-& d’approcher de la racine d’un nombre, lbtd. 559. a. Autres
miAppnxmMml, méthode pour avoir la valeur approchée
donnée* dans les volumes XXIU & XXIV des mémoires de
Berlin. Ibid. 40V a> É Méthode pour a v o i r les valeurs approchées
des racines d’une équation algébrique déterminée. lbid.
49Approximation, comment parle moyen des fraôionsdécimales
on approche auffi près qu’on veut de la racine dun
nombre queïconque. IV. 66> b. Méthode d omettre certains
termes dans les calculs d’approximation. XL 74. ¿. Méthode
pour trouver par approximation les racines dune équation ,
eu changeant cette équation en une autre dun degré infè-
11 APPUI^fouiien, fupport, {Synon.} différence entre ces
A ppui ^point d’appui d’un levier. I. <; 39. ¿. Charge du
point d’appui. Il eft moins chargé dans la balance appellee
romainey que dans la balance ordinaire, lbid. 560. a.
Appui y combien un appui peut moins fupporter lorfquil
eft pofé de biais, que perpendiculairement. VI. 14. b. bur
le point d’appui, voyeç L evier. |
A p pui , envers ufoges de ce mot, en terme de tourneur,
enarchitefture, en charpenterie, en manege. I. 560. a.
A ppuis , en ferrurerie. XVII. 819. a,b.
APPYA, {Botan.} plante de la famille des tithymales, &
commune dans l’ifle d’Amboine. Premiere efpece, appya.
Ses différens noms. Sadefcripdon. Lieux où croît cette plante.
Ses qualités & uiages. Deuxième efpece, hulira. Ses autres
noms. Defcription, qualités 8c ufages. Suppl. I. 497.at b.
APRE, ( Gramm, grecque | efprit âpre ou rude, oppofé à
1’efp‘rit doux. Son ufage. I. 561. a.
APRETÉ, rudeffe de lafurface d’un corps. C’eft une qualité
purement relative. Exemple par lequel il paraît que
chaque couleur a fon efpece particulière d’âpretè. 1. <6i. a.
APR1ÈS, {Hiß. d’Egypte} fils de Pfammis, & ion fuc-
ceffeur au trône d’Egypte. Tableau de fon regue. Suppl. L
4ßS. a.
A Q U
A P R O N ,^ " * - ) poiffon de riviere. Sa defcription. Lieu*
°Ùlm O P O s ! ( t 'là s - le t t r . Poéf.) qualité effentieUe à la
"“ APRONO T ^ t ^ X V l i * 309- i- ,, .
APS (Grè^O village du Vivarais. Monumeus danti.
parai ion du mouveiriént d’une planete dune apfide i l autre ,
aux ofcillations d’un pendule. I. ç6i. b. Parmi les philofophes
nul ont employé cette comparaifon, fe trouve M. 1. Bemoulli,
dans une piece intitulée, Nouvelles penfees [ur le Mime do
§ É iW fdïec la maniere d'en déduire les orbites f
dJpianotes. Mouvement de la ligne des apfides. Diverfes
méthodes pour déterminer la poîition des apfides.
de M. Newton, pour en déterminer le mouvement, lbid.
\ f 4 s «les de la lune , leur mouvement dans les fyaygies. XV.
78a. n. Révolution d’une planete par rapport à f»n ;1P“ “ ’
Suppl. 1 4 4 7 - a. Apfide, f e Apogee, Aphelie , P erigee,
PEAPSIS, partie intérieure des ancienneséglifes, ouïe clergé
étoit affis , & l’autel placé. Pourquoi elle étoit aPPel'e® “
nom. Cérémonies q/on pratiquoit à entré,= ou fous i t e | g
de l’apfis. Le trône de l’éveque s appello« auffi g g M g f c g I C’étoit auffi le nom d’un reliquaire ou d une chafle , ou lo o
I renfermoitles reliques des(ùnxs.lbid. 563.a.
! A P T , ( Géogr. ) lieu dans la Gaule. Suppl. 1V. 11. a.
| APTERES , infedes. VIII. 786. b.
j APULEIA, loi. IX. 65a. b.
APULÉE, fa patrie , fes ouvrages. IX. 040. a.
I Apulée , ( Lucius ) médecin. X. 287. ¿. l 8
1 APULSE, ( Aftron. ) proximité de la lune a une étoile. I Utilité de l’obiervation des apulfes. Maniere de la faire. Comi
I ment on calcule ces phénomènes. Suppl. 1. 49®*b% .
* APUREMENT, ( Jurifpr. } requete d apurement. III. 784.
a. Apurement des comptes. 794- a.
APURIMA, riviere du Pérou. Pont d Apurima. Am.72. «.
APUS ou APOUS, ( Aftron.} OU Yoifeau de Paradis , conf-
tellation méridionale. Nombre de fes étoiles. Afcenfion
droite & déclinaifon de la principale pour le 31 mai 1752*
5UΣpYC§I, ( Muftq. des anc.) ce nom donné par les anciens
à certains fons de leur iyftême ou diagramme, & au genre
diatonique. Suppl.l. 498. b.
I APYRE , ( Chym. ) propriété de réfifter à la plus grande
aftion du feu. Rapports 8c différences entre les fubftances
apyres, 8c celles qu’on nomme réfra&aires. Suppl. 1. 499, a.
APYRES, pierres. XII. 577. a.
A Q
I AQUAPENDENTE, (Fabrice) cèlebre anatomifle. Voye^
I Fabrice. . ,
AQUARIENS, ( Hift. eccl. ) hérétiques du troifieme fiecle.
I Ils fubftituoienr l’eau au vin dans le facrement de l’Euchariftié.
I On dit que la perfécution donna lieu à cette héréfie. L 563. ¿.
I Voyer E n c ratite s. 9 1 , , I AQUEDUC, ( Archit. Antiquit. ) on en diftmgue de deux
I fortes d’apparens 8c de fouterreins. On les diftribue encore
I en doubles 8c en triples. Quels font les canaux ou l’eau roula.
1 Les aqueducs étoient jadis une des merveilles de Rome. L
I «63. b. Pourquoi ces aqueducs , qu’on pouvoit conduire en
I droite ligne à la ville, n’y parvenoient que par des fmuofités
I fréquentes. Soupiraux pratiqués d’efpace en efpace. Puits dans
I le canal même de l’aqueduc. Aqueduc de YAqua Marcia. 1. 564.
I <2. Divers autres ouvrages en ce genre faits par les Romains ,
1 dont on trouve ici ime courte defcription. Celui de Louis XIV,
I proche de Maintenon. Cloaques ou aqueducs fouterreins de
I Rome , appellés par Pline, le plus grand ouvrage que jamais on
I ait entrepris. lbid. b.
I Aqueduc. Des aqueducs de Sparte. XII. 286. b. de Spolete.'
I XV. 480. a. Des aqueducs conftruits par Agrippa. III. 538. ¿.
I Aqueduc de Rome nommé tepula aqua. XVI. 145. a. Ouvrage
I fur les aqueducs de Rome. aVII. 489. b. Aqueduc de Ca-
ferte. Suppl. II. 257^. Maniere de conduire l’eau dans une ville
ou dans la campagne. III. 842. b. Dans les jardins. 843. a- Mortier
pour les aqueducs. X. 730. b. Détails fur la maniere dte
faire le moule des gros tuyaux de fer pour la conduite des
eaux. VII. 154. b. Sur les aqueducs, voyc^T u b e , C a n a l ,
Tuyau , Conduite.
Aqueduc de Fallope. (Anat.) Suppl.lV-39\a’
AQUEUX, humeur aqueufe de l’oeil. Elle circule , mais
on ignore comment. Remedes & alimens appelles aqueux. 1.
e6q.a. A qui ils conviennent. Uid.b.
}qu<ufe,/iumtpr9 de Pmi. XI. ¡ ¡ ¡ j a, 387. a, Supgl.IV.113.*-
A R A A R A
Préparation des humeurs aqueufes du corps hiimaîn. Suppl.-
IV. 7<!9>b. 761. a, , i i
ÂQUILA, fes verfions de 1 ancien teftament. XV. 217. b, j
fti8. a. XVII. 166. a.
AQUIL1A , loi y IX. 6^.2. bu
AQUILIENNE, loi, ( Jurifpr. crim. ) cette loi avôit deux
objets : l’un , d’aflurer la punition ou la réparation du dommage
que l’on avoit caufé à un particulier, foit en bleflant
0.11 tuant, foit en lui enlevant les efclaves ou fon bétail ;
l’autre, d’affurer la réparation 8c la punition du tort que pouvoit
avoir occafionnè à un citoyen le fait de l’efclave ou du
bétail appartenant à un autre. Pourquoi elle fut nommée
aquiliènne. Aftion qu’elle produit aujourd’hui. ObferVations
fur la maniéré dont la juftice a cru devoir procéder dans les
différens tems contre les animaux ou chofes inanimées, qui
avoient caufé quelque dommage. Suppl. 1. 499' m
AQUIN , ( Thomas d’ ) philofophe fcholaftique , voyei
.Thom a s . | . . . .
AQUITAINE, ( Géogr. & Hift. ) une des trois parties de
l ’ancienne Gaule. Peuples que Céfar fit entrer dans l’Aquitaine.
Différentes divifions de ce pays , faites en différens
tems.I. 565. b. Elle fut appellée Aquitaine , de l’abondance
de fes eaux. Elle avoit été appellée Armorique, qui youloit
dire pays maritime. Après pluüeurs révolutions, elle fut érigée
en royaume par Charlemagne , 8c fupprimée par Charles-le-.
Chauve, qui y mit des ducs. Divifion de l’Aquitaine moderne.
lbid. b. ! „
A q u it ain e , divifion de ce pays par Adrien. XI. 258. a.
Suppl. III. 310. b. Chancelier d Aquitaine. III. 90. b. En quel
tems le nom de Guienne fuccéda à celui d’Aquitaine^ VII.
1006. a.
A R
ARA bleu du Srefil , ( Ornith. ) VI. vol. des pl Régné
animal, pl. 38. Différentes efpeces d’ara ou perroquets du
Brefil. Foyer A r a r a , A r a r a c a n g a , A r a r a u n a .
A r a , ou H a r a , ( Géogr.) cette ville eft la même que
Charan ou Haran, félon la vulgate. Suppl. I. 499. b.
ARABE, richeffe de la langue arabe. Caraéleres que nôus
appelions arabes. I. 366. a. Comment ils nous font parvenus,
& dans quel tems. M. Huet penfe que ces chiffres n’ont
point été empruntés des Arabes, mais desGrecs. Obfervations
fur les chevaux arabes , 8c leurs généalogies. Bien que les
Arabes donnent à leurs enfirns quand ils font arrivés à l'âge
d’homme. lbid. b. t
A r a be , cette langue fixée avant Mahomet, ne s eft point
altérée depuis. IX. 867. a. Les noms de cette langue n’ont
.que trois cas. II. 736. a. Combien il nous conviendroit de
cultiver l’arabe. V. 916. b. Chiffres arabes. H. 647. a. Caractères
arabes, voye^ C a r ac tè r e , planches III 8c IV. vol. II.
Arabes. Etat de la philofophie chez les anciens Arabes. I.
<66. b. Tout ce qu’on a dit pour prouver que les Arabes fe
font livrés aux fpèculations philofophiques, n’eft appuyé que
fur des conje&ures. Raifonnemens de J ifeph-Pierre Ludewig-,
pour prouver l’attachement des Arabes à la philofophie. Ces
raifonnemens combattus. lbid. 567. a. Le zabianifme, qui
paffe pour avoir pris naiffance chez les Arabes, ne prouve
pas mieux leur philofophie. lbid. b. Oppofition des loix de
Moyfe aux fuperftitions des Zabiens. Origine du nom de
zabien. Quelle étoit cette fe&e , 8c fon antiquité, lbid. 5 68.
a. Livres des Zabiens. lbid. b. Principaux dogmes de cette
fefte. lbid. 569. a.
A rabes , (Hiftoire des} leur mépris pour les autres peuples.
Difficulté de déchirer le voile qui couvre leur origine. Prej
mieres familles qui occupèrent,!’Arabie après le déluge. Les
Arabes prétendent que la poftérité d’Ifmaël étant devenue
plus puiffante que les autres familles , les extermina pour
s’emparer de leur pays. I l feroit plus naturel de penfer que
ces différens peuples fe confondirent, 8c formèrent entr eux
des alliances ; mais les Arabes flattés de defeendre tous d Abraham
, aiment mieux atribuer des atrocités à leurs ancêtres,
que d’avouer que le fang ifmaélite a été altéré par le mélangé
impur d’un fang étranger. Suppl. I. 500. a. Quoique
chaque famille formât une efpece d’empire, toutes avoient le
même amour d’indépendance ; 8c libres dans leurs déferts,
elles plaignoient les nations affervies à des maîtres. Les Arabes
grands 8c bien faits entretenoient leur vigueur par de pénibles
exercices. La frugalité femble en eux une vertu naturelle.
Leur genre de vie les conduit fans infirmité à une extrême
vieilleffe. On leur reproche une gravité mélancolique , qui-
les rend infenfibles à tout ce qui .affe&e le plus delicieufe-
anent les autres hommes ; une humeur chagrine , beaucoup
d’orgueil, 8c un fonds de cruauté qui leur fait répandre le
iang humain fans fruit 8c fans remords. lbid. b. Leurs erreurs
fur le droit de la guerre les ont précipités dans un déluge de
’Crimes. Ils fe perfuaderent que tout ennemi étoit exterminateur
, 8c fe crurent ainfi autorifés à maffacrer des hommes qui
les auroient exterminés, s’ils avoient remporté la vittoire fur
Tome I,
eux. Ces excès furent eriéôré áiitórifés par la religión muful-*
mane , qui, au lieu d’adoucir leurs moeurs , leiir comfniini-
qua plus de férocité. Cependant les Arabes ont auffi donné
des exemples de bienfaifance, qui ont peu d^imitatéufs i 011
a fait de tout tems l’éloee de leur fidélité à tenir leurs eriga-
gemens. Leur générofité s’étend jufques fur les animaux qui
ont vieilli à leur fervice. lbid. 301. a. Ils exercent la plus
admirable hoíjútalité envers 1 étranger qui fe refugie dans
leurs tentes , & fe confie a leur foi. Leur humanité paraît
dans leur maniere dé punir les crimes. La loi du talion régie
leurs jugemens, 8c le mépris public eft le fupplice qué redoute
le peuple à qui il relie des moeurs. Vie nômadé 8c vagabonde
que mènent les Bédouins defcehdaüs des Scériétis. Forme
de leur gouvernement. Celiû des' Arabes habitons dés villes,
lbid. b. Leur commerce 8c letirë richeiTes. L’Arabie éclairée
anciennement par le flambeau des fciences 8c des arts. Les
Arabes furent les premiers qui prirent leur eflor vers le ciel,
pour y contempler les aftres ; mais ils ne fe bornèrent pas
aux fciences naturelles ; f amour du niexYeilleux les rendit
dupes de différentes fortes de charlatans. On Voyôit parmi
eux de prétendus favans qui fe vantôiertt d’entendre le langage
des oifeaux. Certains folitaires fanatiques ôù impofteurs
le faifoient confidérer d’une multitude aveugle foùs'la qualité
dç prophètes. C’eft de l’Arabie qu’on vit éclorre cet
eiTaim d’aventuriers qui errent fur le globe, fous le nom dé
difeurs de bonne aventure. lbid. 302. a. Etat de ià médecine chez
les Arabes. Sóin qu’ils prennent de conferver leur généalogie.
En quoi confiftent leurs ouvrages dans les arts mechaniques.
L’éloquence 8c la poéfie cultivées par ces peuples, que la
nature du climat doit tiécefiairemeñt attacher aux arts d’agrément,
qui parlent à l’imagination 8c font lé charme de l’eiprif
8c du coeur. lbid..b. C e fut encore dans l’Arabie que l’apologue
prit naiflaricé. Comment les Arabés forment les moeurs
de leurs enfans. Obfervations fur leur langue. Ses titres éta-
bliffent fa haute antiquité ; mais fa fécondité & fon harmonie
n’ont pu êtré que l’ouvrage tardif du tems. Son dialeâe lé
plus eftimé eft celui des Roréishites, que parloit Mahomet.
Carafteres arabes, lbid. 303. a. Le béloin du climât a foit
naître chez ces peuples certains ufages, comme la circoncifion,
la diftinâioti des viandes permifes 8c prohibées, les ablutions.
La polygamie, autorifée par l’exemple des patriarches, s’eft
perpétuée dans l’Arabie.La fécondité des femmes y fut toujours
en honneur. Etat d’oppreflion dans lequél elles vivent. Les
Arabes naturellement guerriérs ne prirent cependant les armes
que par l’avidité du butin, 8c jamais pour étendre leurs
limites. lbid. b. Ils donnèrent à l’Egypte des rois qui font
connus fous le nom de pafteurs. Leur plus grande gloire fut de
n’avoir jamais fubi de domination étrangère. Vains efforts de
différens peuples 8c particulièrement des Roihains pour les»
fubjuguer. lbid. 304. a. Leurs déferts étoient une barriere qui
les mettoit à l’abri des incurfións étrangères. Education guer-'
riere qu’ils donnoient à leurs enfans. Religion des Arabes,
avant qu’ils euflent embraffé lé mahométifme. lbid. ¿.
Arabes y obfervations fur ces peuples. VIII. 346. a. 926. a:
Anciens Arabes, voyez ïduméens. Origine des douze tribus
des Arabes. Suppl. III. 669. b. Reprélailies que les Arabes
exerçoient dans leurs guerres avant Mahomet. IV. 933. b.
Divinité qu’ils adoraient. III. 1. d * ¿. CaraftereS 8c conquêtes
de ces peuples. XI. 642. b. IX. 863. b. 8cc. Hiftoire des
califes arabes. Suppl. II. 124. a , b. — 131. ¿; Leur ardeur pour
là guerre. 130. b. Nourriture qu’ils tirent du fuc dugommief
blanc. Suppl. I. 84. a. 85. b. Ufage des Arabes, par rapport
a leurs noms. XV. 692. a. Vêtement des Arabes nommé habe.
VIII. 3. a. Priere que les pauvres Arabes font après le repas.
XVII. 648. b. De la circoncifion chez les Arabes. III. 461. ¿.
Leurs funérailles. VII. 371. b. Femmes arabes qui portent des
anneaux au nez. XII. 429. b.
Des fciences cultivées par les Arabes. IX. 866. b. Tems
où ils commencèrent à s’y adonner. Suppl. II. 130:a , b.
Changement que les fciences 8c les lettres produifirent dans
leurs moeurs. Suppl. 1. 13. ¿. Rois arabes qui les ont protégées.
II. 233. a , ¿.Bibliothèques arabes. lbid. Leurs Connoiflances
en aftronomie. I. 788. b. Leurs ouvrages de géométrie. VIL
630. b. 631. a. Leur chymie. III. 420. a. Géographes arabes*
V il. 610. b. De la phyfiologie des Arabes. Suppl. IV. 348. a , ¿*
De leur médecine. X. 26i . a. 8c de leurs médecins. 271. ¿.
‘272. a. Détails fur les principaux d’entr’eux. 276. b. — 290. a.
Médailles arabes. X. 233. Bibles arabes.II. 223. a , ¿.
Comment les Arabes comptoient leurs années avant Mahomet.
VIII. 96. a. Années des Árabes. 1. 301. a. VIII. 96. a. XVL
773. ¿.Leursmois. VIII. 96. a. X. 620. b.
Nomades arabes. XI. 202. a. Arabes Bédouins. IL 189. a.
Arabes Sarraíhis. X IV. 662. b. 8cc. Arabes Scénites. 73 3. a.
ARABESQUE, ou Morefque, forte d’ouvrage de peinture
ou de fculpture. Ufage qu’on foit encore de ces ornemens. A
quelles parties de l’architeôure oh doit les rèferver. I. 369. b.
Arabefque, peinture : fur l’ancienne, voye{ XII. 277« b. 8c fur
ia moderne. VII. 966. b.
ARABIE, {Géogr.} defcription & divifion géographique*