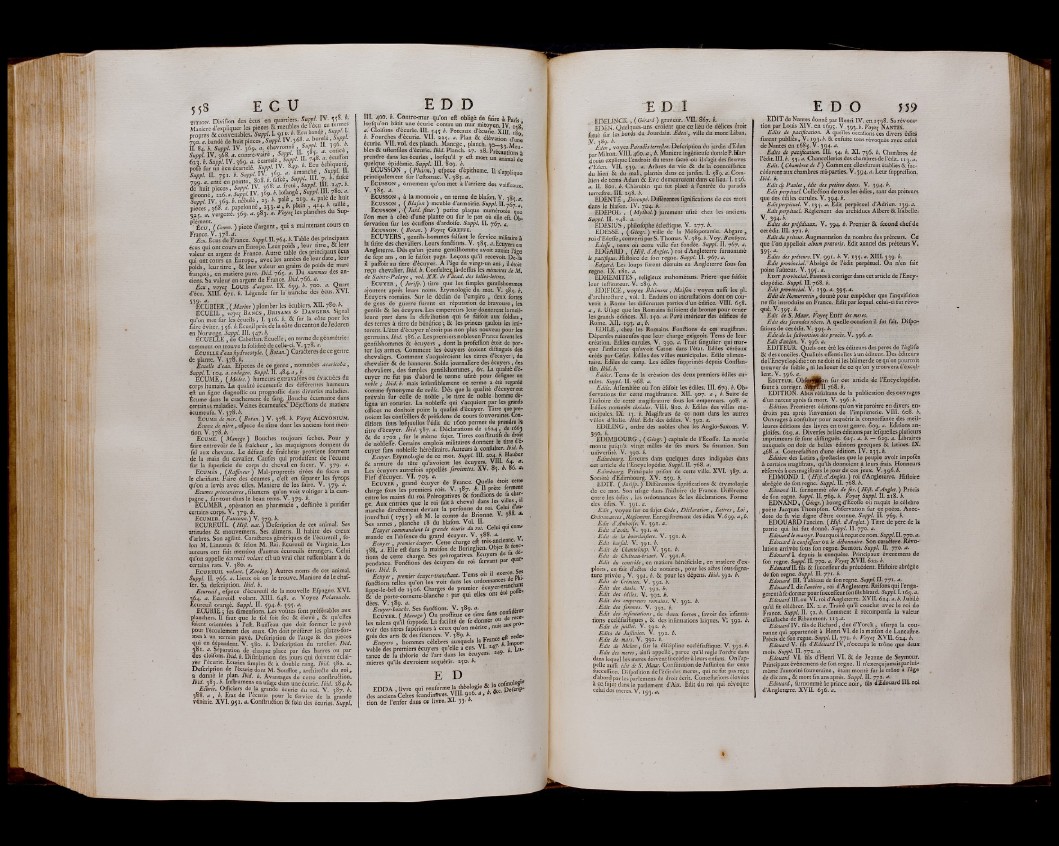
55B E C U
TITION. Dmfion des iras en quartiers. Suppl. IV. 558 ».
Manière d’expliquer les pieces & meubles de 1 icu e (
propres & convenables. Suppl. 1. 91:u ». Ecu band*, PP
" L . bandé de huit pieces, Suppl. IV. 368. a . burelé , Suppl.
0 . l w W r n i \ r.n „ pV< p v rnn I«. l i b. Suppl. IV. 369. i chevronnnéé . buppl- ¿4* 39®*,
S«p/>/. IV. 3M. <*. contre-vairé , H- 585. . »
pofé fur un écii écartelé. s^PPhM4 ç„„B/ II
V II. 7 5 , ï : z*7 m
79g. a. enté en pointe, 800. n. nupe, ,
le huit places, W - d H ù A Ht 780 a
gi tonné, ai6. a. Suppl. IV. 369- «• lof f 6 é > Ô g P f t L
Suppl. IV. 369. »• nébulé, a3. ». palé , 119. a. palé de huit
pièces, 368. a. papelonné, 133. a , ». plein , 414. »■ tadlé,
j 2 i. a. vcrgeité. 369. a. 983. a. Vuyc[ les planches du Sup-
^ Écu, ( Comm. ) piece d’argent, qui a maintenant cours en
France. V. 378. a. '
Ait. Écus de France. Swpp/.II.764.¿.Table des principaux
¿eus qui ont cours en Europe. Leur poids, leur titre, 8c leur
valeur en argent de France. Autre table des principaux écus
qui ont cours en Europe, avec les années de leur date, leur
poids, leur titre , & leur valeur en grains de poids de marc
françois, en matière pure. lbid. 765- a- Du nummus des anciens.
Sa valeur en argent de France. Ibid. 766. a.
Écu , voyer LOUIS <£argent. IX. 699. b. 700. a. Quart
d’écu. XIIÏ. 671. b. Légende fur la tranche des écus. XVI.
531 c ü b i e r , ( Marine ) plomber les écubiers. XII. 780. b.
ÉCÜEIL , voyez Banc s , B r i s a n s 1 D a n g e r s . Signal
qu’on met fur les écueils, I. 316. b, 8c fur la côte pour les
faire éviter. 3 36. b. Écucjl près de la «ôte du canton de Jedcren
en Norvège. Suppl. III. <47. b. .
ÉCHELLE 1 de Cabeftan. Écuelle \ en terme de géométrie:
comment on trouve la folidité, deçell#-çl V . 378. a.
ÉCUELLE Seau hydrocotyle. ( Botan.) Caractères de ce genre
de plante. V. 378. b.
Ecuelle d'eau. Efpeces de ce genre, nommées acartcoba,
Suppl. I. 104. à. codagen. Suppl. II. 484. a, b.
ECUME , ( Médec. ) humeurs extravafées ou évacuées du
corps humain. La qualité écümeufe des différentes humeurs
eft un ligne diagnoftic ou prognoilic dans diverfes maladies.
Écume <jans le crachement de lâng. Bouche écumante dans
certaines maladies. Veines écumeulesrDéjeftions de matière
écumeufe. V. 378. b.
ÉCUME de mer. ( Botan. | V. 378. b. Voyez AlCYONIUM.
Écume de nitre, efpece de nitre dont les anciens font mention.
V . 378. A *
E cum e. ( Manège ) Bouches toujours feches. Pour y
faire entrevoir de la fraîcheur, les maquignons donnent au
fel aux chevaux. Le défaut de fraîcheur provient fouvent
de la main du cavalier. Caufes qui produifent de l’écume
fur la fuperfîcie du corps du cheval en fueur. V. 379. a.
E cum es ,(Raffineur) Mal-propretés tirées du fucre en
le clarifiant. Faire des écumes, c eft en féparer les fyrops
qu’on a levés avec elles. Maniéré de les faire. V. 379. a.
Ecumes printanières, filamens qu’on voit voltiger à la campagne
, fur-tout dans le beau tems. V . 379. b.
ECUMER, opération en pharmacie , deftinée à purifier
certains corps. V . 379. b.
ECUMER. (Fauconn.) V. 370. b.
ECUREUIL. (FUJI. nat-J Defcription de cet animal. Ses
attitudes & mouvemens. Ses alimens. 11 habite des creux
d’arbres. Son agilité. Carafteres génériques de l’écureuil, félon
M. Linnæus & félon M. Rai. Ecureuil de Virginie. Les
auteurs ont fait mention d’autres écureuils étrangers. Celui
qu’on appelle écureuil volant eft un vrai chat reffemblant à de
certains rats. V. 380. a.
E c u r e u i l volant. ( Zoolog. ) Autres noms de cet animal.
Suppl. II. y66. a. Lieux où on le trouve. Maniéré de le chaf-
ier. Sa defcription. Ibid. b.
Ecureuil, efpece d’écureuil de la nouvelle Efpagne. XVI.
364. a. Ecureuil volant. XIII. 648. a. Voyez Polatouche.
Ecureuil orangé. Suppl. II. 594. b. 595. a.
ECURIE ; les dimenfions. Les voûtes font préférables aux
planchers. Il faut que le fol foit fec & élevé, & qu’elles
ibient orientées à l’eft. Ruiffeau que doit former le pavé
pour l’écoulement des eaux. On doit préférer les plates-formes
à un terrein pavé. Defcription de l’auge 8c des pièces
qui en dépendent. V. 380. b. Defcription au râtelier. Ibid.
581. a. Séparation de chaque place par des barres ou par
ces cloifons. Ibid.b. Diftribution des jours qui doivent éclairer
1 écurie. Ecuries fimplcs 8c à double rang. Ibid. 382. a.
Defcription de l’écurie dont M. Soufflot, architecte du roi,
a donné le Mam Ibid. b. Avantages de cette conftruilion.
Ibid. 383. b. Inftrumens en ufage dans une écurie. Ibid. 284. A
Ecurie. Officiers de la grande écurie du roi. V. 387. b.
388. a t b. Etat de 1 écurie pour le fervicc de la grande
vénérie. XVI. 951. a. Conftruétion 8c foin des écuries. Suppl.
E D D
III. 400. b. Contre-mur qu’on eft obligé de faire 4 Paris
lorfqu’on bâtit une écurie contre un mur mitoyen. IV mr!
¿. Cloifons d’écurie. III. <45 b. Poteaux d’écurie. XIU ig ?
b. Fourches d’écurie. VU. 22c. a. Plan 8c élévation d’une
écurie. VII. vol. des planch. -Manege, planch. 30—33, Meubles
8c uftenfiles d’écurie. Ibid. Planch. 27. 28. Précautions à
prendre dans les écuries , lorfqu’il y eft mort un anim^j d»
quelque épidémie. Suppl. III. 809. b.
ECUSSON , (Pharm. ) efpece d’épitheme. Il s'appliqua
principalement fur l’eftomac. V . 385. a.
E c u s s o n , ornement qu’on met à l’arriere des vaifleaux.
E c u s s o n , à la monnoie, en terme de blafon. V. 385.
E c u s s o n , ( Blafon ) meuble d’armoirie. Suppl. II. 767.*«]
ECUSSON , <( Jard. fleur. ) petite plaque numérotée que
l’on met à côté d’une plante ou fur le pot où elle eft. Ob-
fervarion fur les écuffons d’ardoife. Suppl. II. 767. a.
E c u s s o n . ( Botan. ) Voyez G r e f f e .
ECUYERS , gentils-hommes faifant le fervice militaire à
la fuite des chevaliers. Leurs fonctions. V . 385. a.Ecuyers en
Angleterre. Dés qu’un jeune gentilhomme avoit atteint l’âge
de fept ans, on le faifoit page. Leçons qu’il recevoit. De-là
fi paffoit au titre d’écuyer. A l’âge de vingt-un ans, il ¿toit
reçu chevalier. Ibid. b. Confultezlà-deffus les mémoires de Ai.
de Saihte-Palaye , vol. XX. de l acad. des belles-lettres.
E c u y e r , (jurifp.)- titre que les fimples gentilshommes
ajoutent après leurs noms. Etymologie du mot. V. 385. b.
Ecuyers romains. Sur le déclin de l’empire , deux fortes
de gens de guerre furent en réputation de bravoure, les
gentils 8c les écuyers. Les empereurs leur donnèrent la meilleure
part dans la diftribution qui fe faifoit aux foldats,
des terres à titre de bénéfice ; 8c les princes gaulois les imitèrent.
L’état d’écuyer a’étoit pas non plus nouveau pour les
germains. Ibid. 386. a. Les premiers nobles en France furent les
gentilshommes 8c écuyers , dont la profefïion étoit de porter
les armes. Comment les écuyers étoient diftingués des
chevaliçrs. Comment s’acquéroient les titres d’écuyer -, de
chevalier 8c de banneret. Solde journalière des écuyers, des
chevaliers, des fimples gentilshommes, &c. La qualité d’écuyer
ne fut pas d’abord le terme ufité pour défigner un
noble ; Ibid. b. mais infenfiblement ce terme a été regardé
comme lynonyme de noble. Dès que la qualité d’écuyer eut
prévalu fur celle de noble , le titre de noble homme dé-
figna un roturier. La nobleffe qui s’acquiert par les grands
omees ne donnoit point la qualité d’écuyer. Titre que pre-
noient les confeillers 8c préfidens de cours fouveraines. Conditions
fous lefquelles l’étüt de 1600 permet de prendre le
titre d’écuyer. Ibid. 387. a. Déclarations de 1624, de 1663
& de 1702 , fur le même fujet. Titres conftitutifs du droit
de nobleffe. Certains emplois militaires donnent le titre dé-
cuyer fans nobleffe héréditaire. Auteurs à confulter. Ibid. b.
Ecuyer. Etymologie de ce mot. Suppl. III. 204.^. Hauber
8c armure de tête qu’avoient les écuyers. VIII. 64. a.
Les écuyers autrefois appellés fervientes. XV. 05. b. 00. a*
Fief d’écuyer. VI. 703. a.
E c u y e r , grand écuyer de France. Quelle étoit cette
charge fous les premiers rois. V. 387. ê. Il prête Arment
entre les mains du roi. Prérogatives 8c fonâions de fa char
ge. Aux entrées que le roi fait à cheval dans les villes , 11
marche direftement devant la perfonne du roi. Celuiid aujourd’hui
(175 s ) eft M- le con}tc d® Drionne. V. A
Scs armes, planche 18 du blafon. Vol. II. .
Ecuyer commandant la grande écurie du rot. Le lui qui commande
en l’abfence du grand écuyer. V. 388. a.
Ecuyer, premier écuyer. Cette charge eft tres-ancienne. -
388. ¿. EUe eft dans la maifon de Beringhen. Objet 8c ton
tiom} de cette charge. Ses prérogatives. Ecuyers de fa
pcndancc. Fondions des écuyers du roi fervant p <1
Ecuyer, premier êcuyer-tranchant. Tems ou il exer<\e‘ pt:.
fondions telles qu’on les voit dans les ordonnances oe
lippe-le-bel de 1306. Charges de premier écuy e/',tt'f_ olRr
8c de porte-cornette-blancne : par qui elles ont P°
dées. v. 389. a.
Ecuyer~bouche. Ses fondions. V. 389. a. „Anùibtèt
E c u y e r . ( ManegeJ On proftitue ce titre fans ^
les talens qull fuppole. La facilité de fe donnfer o
voir des titres fupérieurs à ceux qu on mérite, nuit
grés des arts 8c des fciences. V. 389. b. » rcde-
Ecuyers , hommes célébrés auxquels la *'ran ^ Impor*
yable des premiers écuyers qu’elle a eus. VI. *47* * . ^u.
tance de m théorie de l’art dans les écuyers. - 49-
mieres qu’ils devroient acquérir. 250. b.
E D |
EDDA , livre qui renferme 1» thiologi- * lVc°OeC^f
des anciens Cehes^îcandinives. VIII. 9>6- - . »• « c’ u
tion de l’enfer dans ce livre. XI. 33- •
E D I E D O J 59
È0 ËL1NCIC , (Girard) graveur. VIL 867. ».
EDEN. Quelques-uns croient que ce lieu.de délices étoit
iitué fur les bords, du Jourdain. Éden, ville du mont Liban.
•V. 389. b. . . .
¿den, voyez Paradis terreftre. Defcription du jardin d’Eden
par Milton; VIII. 460. a , b. Maniere ingénieufe dont le P. Har-
douin explique l’endroit du texte facré où il-s’agit des fleuves
«l’Eden. VIL 539. a. Arbres de vie 8c de la connoiffaiice
du bien 8c du mal, plantés dans ce jardin. I. 389.¿.Combien
de tems Adam 8c Eve demeurèrent dans ce lieu. 1. 126.
a. II. 801.. b. Chérubin qui fut placé à l’entrée du paradis
terreftre. III. 298. b.
EDENTÉ, Découpé. Différentes lignifications de ces mots
dans le blafon. IV. 704. b.
EDEPOL , ( Myihol.) jurement ufité chez les anciens.
Suppl. II. 748. a.
EDESIUS, philofophe écleftique. V. 277. b.
. EDESSE , ( Géogr. ) ville de la Méfopotamie. Abgare,
jr-oi d’Edeffe, converti par S. Thomas. V. 389. A. Voy. Bambyce.
Edeffe, tems où cette ville fut fondée. Suppl. II. 767. a.
. EDGARD , (Hijl. iAnglet. ) roi d’Angleterre furnommé
le pacifique. Hiftoire de fon regne. Suppl. II. 767. a.
. Edgard. Les loups furent détruits en Angleterre fous fon
regne. IX. 181. a.
EDHEMITES , religieux mahométans. Priere que faifoit
leur inftituteur. V. 289. A»
EDIFICE, voyez Bâtiment, Maifon : voyez auifi les pl.
d’architefture , vol. I. Enduits ou incruftations dont on cou-
vroit à Rome les différentes parties d’un édifice. VIII. 658.
a , b. Ufage que les Romains falfoient du bronze pour orner
les grands édifices. XI. 150. a. Pavé intérieur des édifices de
Rome. XII. 193. a,b.
, EDILE, chez les Romains. Fondions de ces maeiftrats.
Dépenfes ruineufes que leur charge exigeoit. Tems de leur
création. Ediles curules. V. 390. a. Trait fingulier qui marque
l’influence qu’a voit Caton dans l’état. Ediles céréaux
créés par Céfur. Ediles des villes municipales. Edile alimentaire.
Ediles de camp. Les édiles fupprimés depuis Conftan-
tin. Ibid. b.
Ediles. Tems de la création des deux premiers édiles cundes.
Suppl. II. 768. a.
Edile. Affemblée où l’on élifoit les édiles. III. 679. b. Ob-
fervations fur cette magiftrature. XII. 907. a , b. Suite de
l’hiftoire de cette magiftrature fous les empereurs. 908. a.
Ediles nommés céréales. VIII. 810. b. Ediles des villes municipales.
IX. 13. b. Magiftrats de ce nom dans les autres
villes d’Italie. Ibid. Edit des édiles. V. 392. a.
EDILING, ordre des nobles chez les Anglo-Saxons. V.
390. b.
EDIMBOURG, ( Géogr. ) capitale de l’Ecoffe. La marée
•monte jufqu’à vingt milles de fes murs. Sa fituation. Son
univeruté. V. 390. b.
Edimbourg. Erreurs dans quelques dates indiquées dans
cet article de l’Encyclopédie. Suppl. II. 768. a.
Edimbourg. Principale prifon de cette ville. XVI. 387. a.
Société d’Edimbourg. XV. 259. b.
EDIT. ( Jurifp. ) Différentes lignifications 8c étymologie
de ce mot. Son ufage dans l’hiftoire de France. Différence
entre les édits , les ordonnances 8c les déclarations. Forme
des édits. V. 391. a.
. Edit, voyez fur ce fujet Code, Déclaration, Lettres, Loi,
Ordonnances, Règlement. Enregiftrcmcnt des édits. V. 699. afb.
. Edit d’Ambotfei V. 39t. a.
■ Edit d’auút. Y . 391. a.
. Edit de la bourdaifiere. V. 391. b.
. Edit burfal. V. 391. b.
. Edit de Chanteloup. V. 391. b.
■ Edit de Ch&teaurbriant. V. 391. b.
Edit du contrôle, en matière bénéficiale, en maticre d’exploits
, en fait d’aéics de notaires, pour les aftes fous-figna-
ture privée , V. 391. b. 8c pour les dépens. Ibid. 392. b.
: Edit de Çrémieu. V. 392. b.
■ Edit des duels. V. 392. b.
. Edit des édiles. V. 392. b.
Edit des empereurs romains. V. 392. b.
.Edit des femmes. V. 392. b.
Edit des infinuations, de deux fortes, favoir des infinua-
tions eccléfiaftiques , 8c des infinuations laïques. V*. 392. b.
. Edit de juillet. V. 392. b.
Edits de Juflinien. V. 392. b.
■ Edit de mars. V. 392. b.
Edit de Melun, fur la difeipline eedéfiaftique. V. 392. b.
Edit des meres , ainfi appelle , parce qu’il regle l’ordre dans
dans lequel les meres doivent fuccéder à leurs enfans. On l’appelle
aufli édit de S. Maur.- Conftitution.de Juftinien fur cette
fuccefîion. Difpofition de l’édit des meres, qui ne fut pas reçu
d’abord par les parlemens de droit écrit. Conteftations élevées
à ce fujet dans le parlement d’Aix. Edit du roi qui révoque
celui des meres. V. 193. ¿.
ËÏMT de Nantes donné par Henri IV. en 1598. Sa révocation
par Louis XIV. en 1695. V. 393. é. Voye^ N a n t e s .
Edits de pacification. A quelles occafions ces divers édits
furent publiés, V. ,193. b. 8c enfuite tous révoqués avec celui
de Nantes en 1685. V. 394. a.
Edits de pacification. III. 54. b. XI. 736. b. Chambres de
l’édit. III. b. 55 .a. Chancelleries des chambres de l’édit x 13. ¿.
Edit. ( Chambres de T j Comment elles furent établies 8c fuc-
cédcrcnt aux chambres mi-parties. V. 394. a. Leur fuppreflion.
Ibid. b.
Edit de Poulet, édit des petites dates. V. 394. b.
Edit perpétuel. Colleâion de tous les ¿dits, tant des préteurs
que des édiles curules. V. 394. b.
Edit perpétuel. V. 135. a. Edit perpétuel d’Adrien. 139. a.
Edit perpétuel. Règlement des archiducs Albert 8c Iiabelle.
v. 394-i.
Edits des prèfidiaux. V. 394. b. Premier 8c fécond chef de
cet édit. III. 271. b.
Edit du préteur. Augmentation du nombre des préteurs. Ce
que l'on appelloit album preetoris. Edit annuel des préteurs V .
Edits des préteurs. IV. 991. b. V. 133. a. XIII. 339. b.
Edit provincial.'Abrégé de l’édit perpétuel. On n’en fait
point l’aûteur. V. 393. a.
E d i t provincial. Fautes à corriger dans cet article de l’Ency-,
dopédie. Suppl. II. 768. b.
Edit provincial. V. 139. a. 39 <f.a.
Edit de Romorentin, donné pour empêcher que l’inquifition
ne fut introduite en France. Édit par lequel celui-ci fut révo*
qüé. V.- 393. b.
'Edit de S. Maur. Voye^ E d i t des met es.
Edit des fécondés nôces. A quelle occafion il fut fait. Diipo-
fitionsde cet édit. V. 393. b.
Edit de la fubvention des procès. V. 396. a.
Edit d!union. V. 3961 a.
EDITEUR. Quels ont été les éditeurs desperes de l’égliià
8c des conciles. Qualités effentielles à un éditeur« Des éditeurs
de l’Encyclopédie : on ne doit ni les blâmer de ce qu’on pQurroit
trouver de foible, ni les louer de ce qu’on y trouvera d’èxcel-
lent. V. 396. a.
E d i t e u r . ObfidHpn fur cet article de l’Encyclopédie«
faute à corriger. SMpfiFYl 768. b.
EDITION. Abus réfultans de la publication des ouvrages
d’un auteur après fa mort. V. 396. b.
Edition. Premières éditions qu’on vit paroître en divers endroits
peu après l’invention de l’imprimerie. VIll. 608. b.
Ouvrages à confulter pour acquérir la connoiffance des meilleures
éditions des livres en tout genre. 609. a. Editions an-
gloifes. 629. a. Diverfes belles éditions par lefquelles plufieurs
imprimeurs fe font diftingués. 625. a. b. — 620. a. Libraires
auxquels on doit de belles éditions grecques oc latines. IX.
468. a. Contrefaçon d’une édition. IV. 133.b.
Edition des Latins, fpeâacles que le peuple avoit impofés
à certains magiftrats, qu’ils donnoient à leurs frais. Honneurs
réfervés à ces magiftrats le jour de ces jeux. V. 396. b.
EDMOND I, (Hift. dAnglet. ) roi d’Angleterre. Hiftoire
abrégée de fon regne. Suppl. II. 768. b.
Edmond II. furnommé côte de fer. ( Hifi. dAnglet.) Précis
de fon regne. Suppl. II. 769. b. Voyez Suppl. IL 218. b.
EDNAND yÇGéogr.) bourg d’Ecofle ou naquit le célébré
poëte Jacques Thompfon. Obfervation fur ce poëte. Anecdote
de fa vie digne d’être connue. Suppl. II. 769. b.
EDOUARD l’ancien. (Hifi. dAnglet.) Titre de pere de là
patrie qui lui fut donné. Suppl. 11.770. a.
Edouard le martyr. Pourquoi il reçut ce nom. Suppl. II. 770. a.
Edouard le confejfeur ou le débonnaire. Son caraâere. Révolution
arrivée fous fon regne. Sa mort. Suppl. H. 770. a.
Edouard I. depuis la conquête. Principaux évenèmens de
fon regne. Suppl. IL 770. a. Voyez XVII. 622. b.
Edouard II. fils 8c iucccffeur du précédent. Hiftoire abrégée
de fon regne. Suppl. II. 771. b.
Edouard III. Tableau de fon regne. Suppl. II. 771. a.
Edouardl. ditrancien, roi d’Angleterre.Raifonsqui l’engagerentàfedonnerpourfucceffeurfonfilsbâtard.
Suppl. 1. 169^.
Edouard III. ou VI. roi d’Angleterre. XVII. 624. a. b. Jubilé
qu’il fit célébrer. IX. 2. a. Traité qu’il conclut avec le roi de
France. Suppl. II. 32. b. Comment il récompenfa la valeur
d’Euftache de Ribaumonr. 11 y a.
Edouard IV. fils de Richard, ducd’Yorck, ufurpa la couronne
qui appartenoit à Henri VI. de la maifon de Lancaftre.
Précis de fon regne. Suppl. H. 771. b. Voyez XVII. 624. b.
Edouard V. fit» d’Edouard IV, n’occupa le trône que deux
mois. Suppl. II. 772. a.
Edouard VI. fils d’Henri VI. 8c de Jeanne de Seymour.
Principaux événemens de fon regne. Il n’exerça jamais par lui-
même l’autorité fouveraine, étant monté fur le trône à l’âge
de dix ans, 8c mort fix ans après. Suppl. II. 772. a.
.Edouard, furnommé le prince noir, fils d’Edouard IIL roi
d’Angleterre. XVII. 636. a.
%