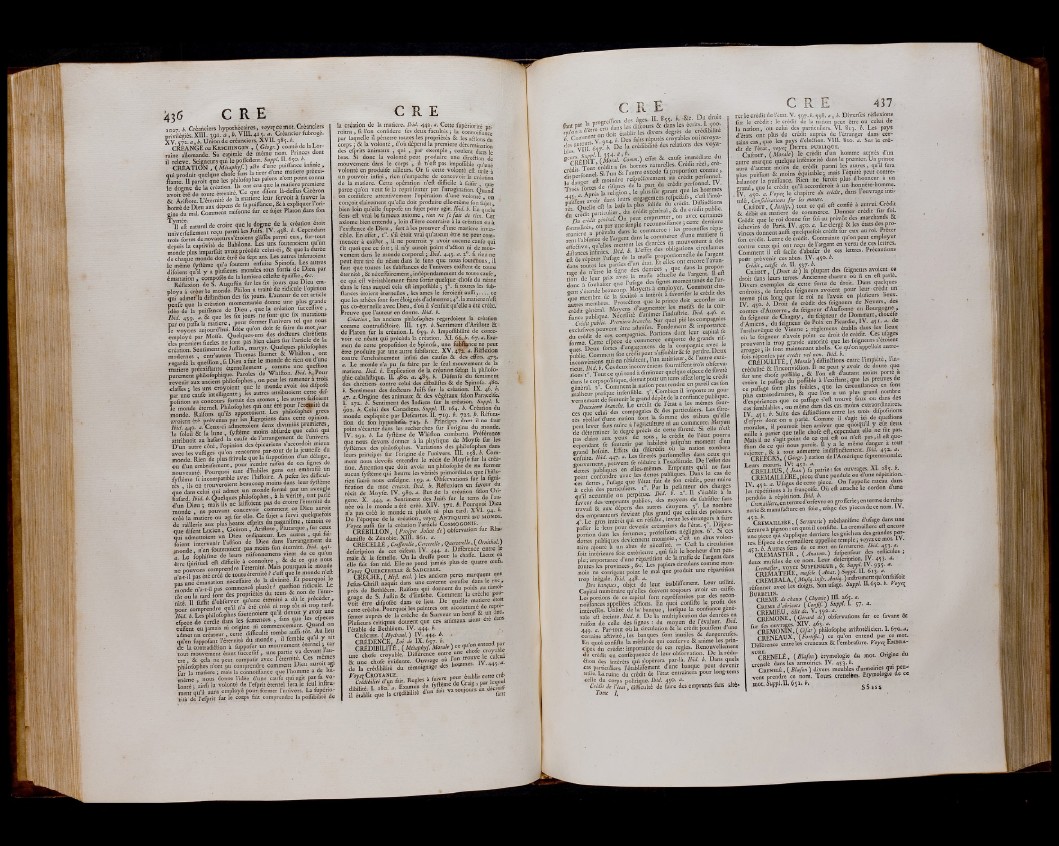
C R E
1017 b Créanciers hypothécaires, voyrç ce mot. Créanciers |
privilégiés. XIII. 3 91.0, é. VIII. 4M. «• Créancier fubrogé.
XV. 372. <* » Union de créanciers. XV IL 3»5. I
CREANGE ou K r i c h i n g e n , ( Géogr. ) comté de la Lor- I
raine allemande. Sa capitale de même nom. Pnnfes don£ I
il releve. Seigneurs qui le poffedent. Suppl. 11. 650. b. 1
CRÉATION , ( Métaphyf.) afte dune puiffance infinie , I
qui produit quelque chofe fans la tirer d une^ matière préexi- I
Sanie. Il paraît que les philofophes païens n ont pouit connu
iedoeme de la Création. Ils ont cru que lamaucre prenuere
a v o ® de tome éternité, t e que thfent là-deffus Cicéron
& Ariftote. L’éternité de la mauere leur fcrvoit à fauver la ■
bonVédeDieu auxdépensde rapmirance.&àexpUquetlonrine
du mal. Comment ralfoune fur ce £u)et Platon .dans fou
Æ naturel de croire que le dogme de la crtaion étoit
u n lv e r fc llem e n t reçu parmi les Juris.IV. 438- 4- Cependant I
trois fortes de novateurs féroient gliflés parmi eux , fur-tout I
depuis la captivité de Babilone. Les uns foutenoient quun
inonde plus imparfait avoir précédé celui-ci, & que la durée 1
de chaque monde doit être de fept ans. Les autres infiniment
le même fyftême qu’a foutenu enfmte Smnofa. Les autres
difoient f û t y a pUeurs mondes tous forns de Dieu par
émanation , compofésde lalunuere célefte épaiffie, f-c.
Réflexion de S. Auguftin fur les fix jours que Dieu employa
i créer le monde. Philon a traité de ridicule 1 opinion
qui admet’ la diftinftion des fut jours L’auteur de cet article
penfe que la création momentanée donne une plus grande
idée de la puiffance de Dieu , que la créanon fucceffive,
Ibid 440. a. & que les fix jours ne Ioni que fix mutations
par où paffa la madere, pour former 1 univers tel que nous
Fe voyons aujourd’hui. Idée qu’on doit fe &ro du motjour
employé par Moife. Quelques-uns des doâeurs chrénens
des premiers fiedes ne font pas bien clairs fur ‘ article de la
créarion. Sendment de Juftin, marrer. Quelques phdofophes
modernes , entr’autres Thomas Burnet & Whifton , ont
regardé la queffion, fi Dieu a fait le monde de rien ou d une
matière preexiftante éternellement . comme une queflion
puremeni phUofophique. Paroles de Whifton. Ibid. i.Pour
revenir aux anciens philofophes, on peut les ramener à trOK
claffes : les uns croyoient que le monde avoir été difpoft
par une caufe intelligente ; fes autres atmbuoient cette dtf-
pofition au concours fortuit des atomes ; les autres faifoient
le monde éterneL Philofophes qui ont été Éjgg t M f r »
monde. Raifons qu’ils apportoient. Les phdofophes grecs
avoient été prévenus par les Egyptiens dans cette opinion.
Ibid. 440. a. Ceux-ci admettolcnt deux divinités premières,
le foleil & la lune, fyftême moins abfurde que celui qui
attribudit au hafard la caufe de l’arrangement de 1 univers.
T)'un autre côté, l’opinion des épicuriens saccordoit mieux
avec les veftiges qu’on rencontre par-tout de la jeuueffe du
monde. Rien de plus fHvole que la fuppofmon d un déluge,
ou d’un embrafement, pour rendre raifon de ces fignes de
nouveauté. Pourquoi tant d’habiles gens ont enibraffi un
fyftême fi incompatible avec l’hifloire. A pefer.les dÆjul-
lès ils eu trouveroient beaucoup moins dans leur fyfteme
que’dans celui qui admet un monde formé par un aveugle
hafard Ibid. b. Quelques philofophes, à la vérité, ont parlé
d'un Dieu ; mais ils ne laiffoient pas de croire 1 éternité du
monde , ne pouvant concevoir comment ce Dieu aurait
créé la matière ou agi fur elle. Ce fujet a ferai^quehjuefois
«le raillerie aux plus beaux efpnts du pagamfme, témoin ce
que difent Lucien, Cicéron , Ariftote Plutarque, fur ceux
qui admettoient un Dieu ordinateur L e s “ ff“ ’ S“‘ ferment
intervenir l’aftion de Dieu dansla™gemen.du
monde, n’en foutenoient pas moinsfon éternité. " ‘¿ 44'.
Le fophifme de leurs raifonnemens vient de ce qu un
êlre foirituel eft difficile à connoitre , & de ce que nous
ne pouvons comprendre l’éternité. Mais pourquoi le monde
n’a S p i été créé de toute éternité > c’eft que j e monde n eft
S i u n e émanation néceffaire de la divimti Et pourquoi le
Lnnde n’a-t-il pas commencé plutôt ! queftion ridicule. Le
tôt ou le tard font des propriétés du tems & non de 1 éternité
Il fufüt d’obferver qu’une éternité a du le précéder ,
nite. il îumi ,* , - crèt ni trop tôt ni trop tard.
qu’en fuppofant l’éternité du monde , il
de la contradiélion à fuppofer un mouvement éternel .car
tout mouvement étant lucceflif, une partie va dev .
tre, & çela ne peut compatir avec l’éternité. Ces mernes
philofophes n’ont pii comprendre comment Dieu auroit agi
fur la matière ; mais la connoiffance que l’homme a de lui-
même -, nous donne Vidée d’une caufe qui agit par fa volonté
• ainfi la volonté de l’efprit éternel fera le feul inftru-
ment qu’il aura employé pour, former l’univers. La Supériorité
de l’efprit fur le coeps fait comprendre lapôflibifité de
C R E
la création de la matière. Ibid. 44a. a. Cette fupériorité
roîtra , fi l’on confidere fes deux facultés ; la connoiflance
par laquelle il pénètre toutes les propriétés & les aétions du
corps ; & la volonté , d’où dépend la première détermination
des efbrits animaux , qui , par exemple, coulent dans le
bras, ai donc la volonté peut produire une direction de
mouvement dans le corps , il n’eft pas impoilible qu’une
volonté en produife ailleurs. Or fi cette volonté eft unie à ■
un pouvoir infini, rien n’empêche de concevoir la création
de la matière. Cette opération n’eft difficile à faifir , que
parce qu’on veut fe la repréfenter par l’imagination. Quand
on confidere attentivement l’opération d’une volonté , on
conçoit clairement qu’elle doit ^produire e lle-même fon fujet, "
bien loin qu’elle fuppofe un fujet pour agir. Ibid. b. En quels
fens eft vrai le fameux axiome, rien ne fe fait de rien. Cet
axiome bien entendu, loin d’être contraire à la création ou à
l’exiftence de Dieu , fert a les prouver d’une manière invincible.
En effet, t°. s’il étoit vrai qu’aucun être ne peut commencer
à exifter , il ne pourroit y avoir aucune caufe qui
•fît quoi que ce foit | il n’y auroit point d’aâion ni de mouvement
dans le monde corporel ; Ibid. 443. a. a0, fi rien ne
peut être tiré du néant dans le fens que nous foutehons, il
faut que toutes les fubftances de l’univers exiftent de toute
éternité , & néceffairement »indépendamment de toute caufe,
ce qui eft véritablement faire fortir quelque chofe du néant
' dans le fens auquel cela eft impofiible ; 30. fi toutes les fubftances
étoient éternelles, lesames le feroient aufli,— ce
que les athées font fort éloignés d’admettre ; 40. la matière n’eft
pas co-éternelle avec Dieu, d’où il s’enfuit qu’elle a été créée.
Preuve que l’auteur en donne. Ibid. b.
Création, les anciens philofophes regardoient la création
| comme contradiâoire. lll. 157. b. Sentiment d’Ariftote &
dè Platon fur la création. I. 639. b. Impoflibilité de concevoir
ce néant qui précéda la création. XI. 6é,.b. 67. a. Examen
de cette propofition de Spinofa, une fubftgnce ne peut
être produite par une autre fubftance. XV. 47a.' a. Réflexion
contre l’enchaînement infini des caufes & des effets. 47^-
a. Le monde n’a pu fe foire par le feul mouvement de la I matière. Ibid. b. Explication de la création félon la philofo- I phie cabaliftique. II. 480. a. 483-I é. Défenfe du fentiment des chrétiens contre celui des cübaliftes & de Spinofo. 4 ^
II b. Sentimeut des dofteurs Juifs fur la création. IX. 46. b. 47. a. Origine des animaux & des végétaux félon Paracelfe. 1 1. V7%. b. Sentiment des Indiens fur la création. Suppl. L II 90a. b. Celui des Canadiens. Suppl. II. 164. b. Création du monde expliquée par Defcartes. IL 719. b. 72a. b. Réfuta- I tion de Ion hypothefe, 7^3’ Principes dont il ne fout I point s’écarter dans les recherches fur l’origine du monde,
r IV. 29a. b. Le fyftême de Whifton combattu. Préférence I que nous devons donner à la phyfique de Moyfe fur les I ïyftêmes des philofophes. Variations des philofophes dans II leurs principes fur l’origine de l’univers. III'. 158. b. Com- ment nous devofis entendre le récit de Moyfe fur la créa- II tion. Attention que doit avoir un philofophe de ne former aucun fyftême qui heurte les vérités primordiales que rhifto- I rien facré nous enfeigne. 139. u. Obfervations fur la figiu- I fication du mot creavit. Ibid. b. Réflexions en faveur du I récit de Moyfe. IV. 980. a. But de la création félon Uri- I eene. X. 444. a. Sentiment des Juifs fur le tems de lao- II née où le monde a été créé. XIV. 371. b. Pourquoi Dieu n’a pas créé le monde ni plutôt ni plus tard.( XVI. 94* • I De l’époque de la création, voye^ A n t i q u i t é d u m o n d e . I Voyez aufli fur la création l’article C o s m o g o n i e .
1 CRÉBILLON, ( Profper Joliot de) obfervation fur Kha-
damifte & Zénobie. XIIÏ. 861. a. . .
CRECELLÉ , Creffercllc I Cercerelle I Quercercllc. ( Ormthol.)
defeription de cet ojfeÆi, IV. 444- -■ D.ffilenccemic le
mâle & la femelle. On la drefle pour la chafle. Lieux ou
eUe foit fon nid. Elle ne pond jamais plus de quatre ceuis.
Voyez Q u e r c e r e l l e & S a r c e l l e .
CRÈCHE A Hi(l. ceci. ) les anciens peres marquent que
Jefus-Chrift naquit dans une caverne creufée dans le roc,
près de Bethléem: Raifons qui donnent du poids au témoignage
de S. Juftin & d’Euiebe. Comment la crèche pou-
voif ême difpofée dans ce lieu. De quelle mat,e« émit
cette crèche. Pourquoi les peintres ont accoutumé de repr
fenter auprès de la crèche du Sauveur un boeuf & un ane.
Plufieurs critiques doutent que ces animaux aient été
l’étable de Bethléem. IV. 444. b.
C r è c h e . (Hydraul. ) IV. 444. b. .
CRÉDENCE, Loi de IX. 637. b. .
CRÉDIBILITÉ, {Miuphyf.MoraU) ce.1“ onff
une chofe croyable. Différence en.rej u n e choff c r o y ^
& une chofe évidente. Ouvrage ou I on jro^v ^
de la crédibilité du témoignage des
rqyrç C r o y a n c e . établir cette cré-
CMibtluil un fiit. Réglas » de Craig, par lequel
dibilité. I. 180. a. Exam • ya t0uj0urs en décroifil
établit que la crédibilité d“ “ | ? fant
CRE CRE ■437
.ta. âaes. II. 833. b. 'Sic. Du droit
fant par | § ® ^ ¿ „ s les diêours & dans les écrits. I. 900.
quon a detr g divers degrés de crédibilité
t. C om m en t 0 es faiK réputés croyables ou incroyades
auteuni.^ • 9 ^4-^ ^ des relations des voya-
P 'n t r OE r C M o r l ’ t m ï y M & eaufe immédiate du ■
Tout’crédit a fes bornes naturelles. Crédit reel, cré-
crédit. lou t excede fa proportion connue ,
f * f „ t r " â r a ù S n d S refpeâivement a^ crédit perfonnd.
ra • Ihrtes de rifques de la part du crédit perfonnel. IV.
A é r é s la religion, le plus lùr garant que les hommes
443. a. Ap . engaeemens refpeéhfs » c eft l mté-
T Oue^e eft la bafe la plusgfolide du crédit. Diftinaïons
dj u ^ ift oarticulier, du crédit général,& du crédit public, c réd it particulier, emprunter, ou avec certaines
l Ü S S M reconnôlffance ; cette derniere
formalités, ou par un w e . ^es pr0meffes reparmeannt
ile’arab fean cper édvea llaur gent dans le ccoommmmeerr^c e d’une mani|èr e^ fi
effeftive,quelles mett obligations circulantes
diftaiiçes infimes /fai A L ^ de l'argent
eft de répété lufage de la malle ^ p ^ ^ ^ rava„.
dans toutes les parues dans la propor-
«?S? t g ec fa maffe éau’eÆ de l’argenF ifeft
J ^ rouhaker une l’ufage des fignes momentanés de lar-
& n u e “ S t é d’animer l’induftrie. IHi. 446. g
MlupuL.'PrmUrarancn,. Sur quel pié les compagnies
exclufives peuvent être adinifes. Fondement & importance-
dé créd“ & “ s compagnies. Pomons dont leur capital fe
forme Cette efpece de commerce emporte de grands nf-
«nés Deux fortes d’cngagcincns de la compagnie avec le
Dublic Comnu.nl fpncrèdkpeutg
P en rAfultent, l’un intérieur, & 1 autre extê
S Î m ï t êesdeuxinconvéhiens fourniffenttrois obferva-
W m Tout ce qui tend à diminuer quelque efpece de ffire é
dans le corps politique, détruitpour un tems affez long le crédit
général a". Comment la nation peut rendre en pared casfon
malheur prefqiie infenfible. 3?. Combien il importe au gouvernement
de foutenir le grand dépôt de la confiance publique.
S S e branche. Le crédit de l'érat a les mêmes fou^
ces que celui des compagnies & des particuliers. Les lùre-
tés réelles'd’une nation iont la fomme des tributs qu elle
peut lever fans nuire à l’agriculture ni
Se déterminer le degré précis de cette jureté. Si elle n elt
pas claire^aux yeux6 dé tous, le crédit de l’état pourra
cependant fe fôutenir par habileté jufqu’au moment dun
grand befoin. Effets d ï diferédi. où la nation tombera
c 'ta iiîiti aa’7 a Les iùretés perfonnelles dans ceux qui
» M t t Æ a l g|a®ûae. De l'effet Ses
lettes publiques en elles-mêmes. Emprunts qu il
point confondre avec .les dettes pubhques. Dans le cas de
ces dettes, l'ufage que l’état Sut de fon crédit, peut nuire
à celui des partêuliers. Par la pefanteur
qu’il accumule ou perpetue. lhi- !>■ a • “ s é'arbl " k.
faveur des emprunts publics, des moyens de fobfifter fans
travail & aux dépens des autres citoyens. 3 . Le nombre
d« Emprunteurs 5evie.it plus grand que ceta des prêteurs
4°. Le gros intérêt qui en réfulte.mviie les étrangers à fane
paffer fe leur pour devenir créanciers de l état V ^ r o -
portion dans les fortunes; profefliqns
Wpie; imSpofrtaknc eM d’unel Êréparmtition mde lam ®a fffefdÎeT 1 a rlgeennt dtaSns
toutes les provinces | bc. Les papiers circulans comme mon-
noie ne corrigent point le mal que produit une répartition
trop inégale. Ibid. 448. a. , , T ... .
Des banques, objet de leur établiiTement. Leur utilité.
Capital numéraire qu’elles doivent toujours avoir en caille.
Les portions de ce capital font représentées par des $2C0n-
noilfances appellées aétions. En quoi confifte le profit des
intéreffés. Utilité de la- banque, lorfque la confiance générale
eft éteinte. Ibid. b. De la multiplication des denrées en
raifon de celle des fignes : du moyen de l’évaluer. Ibid.
449. a. Par-tout où la circulation & le crédit jouiflent d’une
certaine aftivitê, les banques font inutiles & dangereufes.
En quoi confifte la méthode qui confervc & anime les principes
du crédit: importance de ces réglés. Renouvellement
du crédit en conféquence de leur obfervation. De la réduction
des intérêts qui s’opérera par-là. Ibid. b. Dans quels
cas particuliers l’établiflcment d’une banque peut devenu:
utile. La ruine du crédit de l’état entraînera pour long-tems
celle du corps politique. Ibid. 450. a.
Crédit de Vétat difficulté de faire des emprunts fans alté-
Tome /,
rer le crédit de l’état. V. 397. b. 398. a , b. Diverfes réflexjons
fur le crédit : le crédit de la nation peut être ou celui de
la nation, ou celui des particuliers. VI. 813. b. Les pays
d’états ont plus de crédit auprès de l’étranger dans certains
cas,que les pays d’eleélion. VIII. 810. a. Sur le crédit
de l’état , voyc{ D e t t e p u b l i q u e .
C r é d i t (Morale) le crédit dun homme auprès dun
autre marque quelque infériorité dans le premier, Un prince
aura d’auraiit moins de crédit parmi les autres, qu il fera
plus puiffant & moins équitable ; mais 1 équité peut contrebalancer
la puiffance. Rien ne ferait plus d honneur a un
grand, que le crédit qu’il accorderait à un honnete-homme.
. IV. 450. a. Voyt{ le chapitre du crédit, dans 1 ouvrage inti-
tulé, Confidératïojis iur les moeurs. ■ . _
C r é d i t , (Jurijp.) tout ce qui eft confié à autnii.Crédit
& débit en matière de commerce. Donner crédit fur loi.
Crédit que le roi donne fur foi au prévôt des marchands ot
échevins de Paris. IV. 450. u. L e c le r g é & les états des provinces
donnent aufli quelquefois crédit fur eux au roi. Prêter
fon crédit. Lettre de crédit. Contrainte qu on peut employer
contre ceux qui ont reçu de l’argent en verni de ces lettres.
Comment il eft faefle d’abufer de ces lettres. Précaunons
poflr prévenir ces abus. IV. 4; 0. i.
Crédit, cuitfc de. II. Ç37. b.
C r é d i t , (Droit de) la plupart des feigneurs avoient ce
droit dans leurs terres. Ancienne chartre ou d en elt parlé.
Divers exemples de cette forte de droit. Dans quelques
endroits, de impies feigneurs avoient pour leur-crédit un
terme plus long que le roi ne l’avoit en plufieurs lieux.
IV 430. b. Droit de crédit des feigneurs de Nevers, des
comtes d’Auxerre , du feigne.tr d’Auffonne en Bourgogne_,
du feigueur de Chagny, du feigneur de Dommart, dioceie
d’Amiens, du feigneur de Poix en Picardie, IV. 4!>-
l’archevêque de Vienne ; réglemens établis dans les lieux
où le feigneur n’avoit point ce droit de crédit. Ces ufages
prouvent la trop grande autorité que les feigneurs s étoient
arrogée; ils font maintenant abolis. Ce quonappelloit autre
fois réponlés par crédit vcl non. Ibid. b.
CRÉDULITÉ, ( Morale) diftinétions entre 1 impiété, 1 incrédulité
& l’inconviôion. 11 ne peut y avoir de doute que
fur une chofe poffible, & l’on elLd’autant moins porté à
croire le paffage du poffible à l’exiftant, que les preuves de
ce paffage font plus foibles, que les circonftances en font
plus extraordinaires, & que l’on a un plus grand nombre
inexpériences que ce paffage s’eft trouvé 6ux ou dans des
cas femblables, ou même dans des cas moins extraordinaires.
IV 4ti b. Suite des diftinaions entre les trois difpofmons
d’efprit dont on a parlé. Comme il s’agit ici de queftions
morales, il pourroit bien arriver que quoiquil y cul deux
mille à parier que telle chofe eft,cependant elle ne fut pas.
Mais il ne s’agit point de cp qui eft ou neft pas, il eft queftion
de ce qui nous parait. Il y a le même Ranger à tout
reietter & a tout admettre indiftinctemenr. roid. 452. a.
GREECKS, ( Géogr. ) nation de l’Amérique feptentrionale.
Leurs moeurs. IVt 432. a. 1
CRELLIUS, (jean) fa patrie : fes ouvrages. XL 283. b.
CREMAILLERE,piece d’une pendule ou d une répétition. •
IV aç2 a. Ufages de cette piece. On l’appelle rateau dans
les répétions a“ a françqife. Où eft attaché le cordon dune
oendule à répétition. Ibid. b. ' . , .
Cremaillere. en terme d’orfevre en groflerie ; en terme de ruba-
nerie & manufafture en foie, ufage des pièces de ce nom. IV.
4,c're'mmi.lere, (Serrurerie) méchanifme d'ufage dans une
ferrure à pignon : en quoi il confifte. La cremaillere e« encore
une piece qui s’applique derrière les guichets des grandes portes.
Ffpece de cremaillere appellee temple -, voyezue mot. IV.
ata i f Autres fens de cemot en ferrurene. Ibid. 453. a.
CREMASTER , (Anatom.) fufoenfeur des teflicules ,
deux mufdes de ce nom. Leur defcnpnon. IV. 453- “■
Cremalier, voyei SusPEttSEUR, 8t s “fP!-1V- 93Ï- *•
CREMATERE, mufcle (Anat.) Suppl. II. 613- f - .
CREMBALA, (Mufy. infr. ai««,. ) inllrumcm qu onfa.foit
réfonner avec les doigts. Son ufage. Suppl. ILÎ50. b. Voyeç
B u r b e l i n . ■ n ,
CREME de chaux ( Chymte') III. 263. a.
CREME d'abricots ( Confif ) Suppl. I . 3 7 .
: c r em ie u , édit de. v . 302. | ■resaMSia
CREMONE, ( Gérard de) obfervations fur ce lavant o£
CREMOnIn, ( Céfar) philofophe ariftotélicien. 1. 670. a.
CRENEAUX, (Fortifie.) ce qu’on entend par ce mot.
Différence entre les creneaux & rembrafure. Voye[ E m b r a -
SUCRENELÉ, (Blafon) étymologie du mot. Origine du
crenelé dans les armoiries. IV. 433. b. ■ .
C r e n e l é , ( Blafon) divers meubles d’armoines qui peuvent
prendre ce nom. Tours crenelées. Etymologie de ce
mot. Suppl.U, 651. b. S S s s &