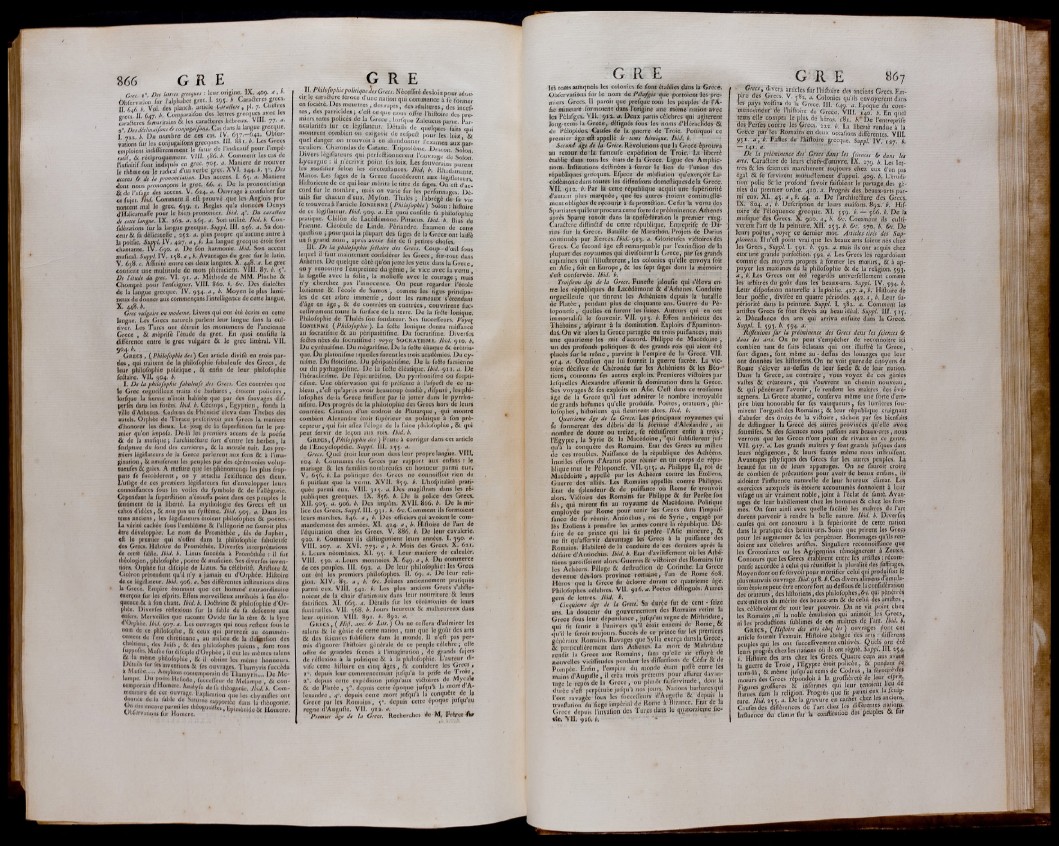
866 GRE Grtc D " lu t " ! g r " ‘l « " I leur origine^ IX . 405. « . <•
m ë M
II m î t A V(il. «Ici plaucli. ariitUi U ir itt lt r t, pl. 7. um tre s
eréci. II. 1)47. A Comporailoii <I«» lettre* g r c c q u f f f v c c le»
¡»railerra nmwiiain» & les taraélere» hébreux. VIII. 77. <r,
D t f iUcllilitifottf & conjurai [u n i. Cas dam la langue grecque.
I, 7»a. h. Du nombre de ce» en». IV. 0 4 *- Gmcr-
vadons furie» B 9 H
emploient indifféremment le fwur de J indicatif pour l impératif,
6c réciproquement. V1XI. g | b. Comment Jes ca» de
¡ ’infinitif font inoiqnée en grec, 703. a. Maniéré de trouver
le théine ou le radical d'un verbe grec, a VI, 144- M " - p «
A» de la prononciaiion. Pc» actcns. I. 63. 4. Manière
dont nous prononçai# le grec, 66, a. De la prononciation
de J’nfagc de» accen». V. 614- Ouvrage à confultcr fur
ce fujet. f i /4 Comment il eA prouvé que les Anglais prononcent
mal le grec, 639. e. Règle* ou’» donnée* Denys
d’Halicarnafle pour le bien prononcer, m i l . 4"- D u caraflere
dt cent langue. IX. *6 » ,", »6.5, a, Son milité, Ibid. b. C o u -
fidération* m H langue grecque. ¿'«/y»/, 111. 236. 4. Sa dou-
ccur 8c fa délicateffe , »5*. ", plus propre qu'aucune autre à
la poéfie. S u f f i . IV. 407, a , b. La langue grecque était fort
chantante. Iv . 690, ", De fon harmonie. U/id. Son accent
nuifical, Suppl. IV , 138. " , â, Avantages du grec fur le latin,
V. 638. r. Affinité entre ces deux langues. X, 448. a. Le grec
contient une multitude de mots phéniciens. V III. 87. b. Jm
D t Cétude du grtc. VI. 9t. a. Méthode de MM. Pluche 6c
Champ ré pour l'enfeigner. V III, 860. b, Grc, Des dialeétes
de la langue grecque, IV. 934. a , b, Moyen le plus lumineux
de donner aux commençons l'intelligence de cette langue.
X . 448, b.
Grtc vulgaire ou modtrnt. Livres qui ont été écrits en cette
langue. Les Giecs naturels parlent leur langue fans la cultiver.
Le» Turcs ont détruit les monumens de l’ancienne
Grece , 6c méprifé l'étude du grec. En quoi confiAe la
différence entre le grec vulgaire 8c le grec littéral. V IL
, i Philofophie de s) Cet article divifé en trois parties
, qui traitent de la philofophie fabuleufe des Grecs, de
leur philofophie politique , (k enfin de leur philofophie
feélaire, VIL 904. b.
I. D t la philofophie fabultufe dtf Grecs, Ces contrées que
le Grec orgueilleux traita de barbares, éroient policées «
lorfque la tienne n’était habitée que par des fauvages dii-
pertes dans les forêt*. Ibid, b. Cécrops, Egyptien , fonda la
ville d’Aibenes. Cadmus de Phénicie éleva dans Thcbe* des
autels. Orphée de Thrace preferivoir aux Grecs la. maniéré
d'honorer les dieux. Le joug de la fuperAition fut le premier
qu'on hnpofa. Pe-Jà les premiers accens de la poéfie
dt de la (indique; l'arcbiteAure fort d'entre les herbes, la
ieulpture du fond des carrières, 6c la morale noir. Les premiers
légülareurs de la Grece parlèrent aux fens 6c k l'imagination
. 6c amuferent les peuples par des cérémonies volup-
tueufes 6c gaies. A mefure que les phénomènes les plus frap-
Iians fe fuccéderent, on y attacha l'cxdlcnce des dieux.1
Adage de ces premiers légitlateur» fut d'envelopper leurs
connoiffimces fous les voiles du fymhole 6c de 1 allégorie.
Cependant la fuperAition n'étouffa point dans ces peuples le
(«miment de la liberté. La mythologie des Grecs eA un
cabas d'idées, 6c non pas un fy Aême. Ibid. qqk, a. Dans les
tous anciens, les légdlateurs étaient philotopnes 6c pactes. *
La vérité cachée fous l'emblême 6c l'allégorie ne fauroit plus
être développée. Le nom de Prométhée | 61s de Japliet,
«A le premier qui »'offre dans la philofophie fabuleufe
des Grecs, HiAOlre de Prométhée. Diverfes interprétations
de céttê fable, Ibid. b, Linus fuccéda à Prométhée : il fut
théologien, philofophe, poète 6c muficien. Ses diverfes inventions,
Orphée fui oifeipie de Linus. Sa célébrité, AriAote 6c
Cicéron prétendent qu il n'y a jamais eu d'Orphée, HiAoire
4e ce légdlateur. Ibid, 906, a, Ses différente» inAitutions dans
la Grece. Empire étonnant que cet homme* extraordinaire
exerçait fur les efprits. Effets merveilleux attribués & fon éloquence
6c à fon chant. Ibid. b. DoÂrine 6c philofophie d'Orphée.
Diverfes réflexions fur la fable de fa dc/cente aux
enfers. Merveilles que raconte Ovide fur la tête 6c la lyre
d'Orphée, Ibid, 907, a. Les ouvrages qui nous reAent fou» le
nom de ee philofophe, 6c ceux qui parurent au commencement
de 1 ere chrétienne, au milieu de la difignfion des
chrétiens, des Juifs. 84 des philofophes païens, fon t tous
tupnofès, Mufée fut difclple d’Orphée \ il eut les mêmes ralcns
et^la même philofophie, 6c il obtint les mémo honneurs,
E l <ur »«‘ inventions 6c fes ouvrages. Thamyris fuccéda
a Mutée,,,,,, Amphion contemporain de Thamyris,,,, De Me-
lle' f f i g l lS ® « É ffeeffisur de Melam,». & cou-
«mporiin/Homore, W y f e de fa théogonie, t f Corn-
S i ® J , | S EMUwIob aie le» el.ymifte. ont
o ï d f? 1 T " * ™j>Poms du» la théogonie.
G R E
i l PU h>fip hu M l i ,iVuHa G r ta . Nécertité d t r io » pour ado»,
ctr le caractère léroce d’une nation qui commence à fe former
en loctété, D e s meurtres, des rapts, des adultères, des incef-
t e s , des parricide» j c eA ce que nous offre ThiAoire des pre-
miers tems pohcés de b Grè ce r Iprfq,,« Zaleucu# parut. Particularités
iu r ce légiflatcur. Détails de quelques fait» oui
montrent combien on exigeait de rcfpeét pour les loix \
quel danger on trouvoit à en abandonner l'examen aux particuliers,
Charondas de Cataiie. Tripiolêmc, Dracoj) Solon
D iv er s légiflateurs qui perfcélionnerenr l'ouvraue dé Solon
Lycurgne ; il n’écrivit point fes loix. Les fouveraios purent
le» modifier félon les circonAances. Ibid, b. Rhadamantc.
Minos. Les fages de Ja G r e c e fuccéderent aux légWlateurs'
HiAoriette de ce qui leur mérita le titre de /hges. On eA d'ae-
cord fur le nombre, ipais 011 varie fur les perfonnages. Dé-
wil» fur cliacun d'eux. M yfon . T h ab s j l'abrégé de fa vie
fe trouvera h l'article lONJkWNE ( P h ilo fo p h it) Solon ; hiAoire
de ce légiflatcur. Ibid. 909. a. En quoi confiAe fit pliilofophic
pratique. Cbilon de Lacédcinonc. Pittacu*. Ibid. ù. IJia« de
Prienne. Cléobu lc de Linde, Périandre. Examen de cette
qucAion i pourquoi la plupart des fuges de la Gre ce ont laiffé
un A grand nom , après avoir fait de fi petites chqfes.
111. D t la p h ilojoph it fcH oirt d t f Grecf. Coup - d ’oeil fous
lequel il faut maintenant coiifidérer les G re c s , fur-tout dans
Athènes, D e quelque côté qu’on jette les y eu x dans la G re c e ,
on y rencontre l'empreinte du gén ie , le v ice avec la v e r tu ,
la lageflè avec la fo lie , la moîlefle avec le courage \ mais
n’y cherche/, nas l'innocence. O n peut regarder l’éicole
Ionienne 6c l’é cole de Sam os , comme les tiges principales
de cet arbre immenfe , dont les rameaux s'étendant
d’âge en â g e , 6c de contrées en con trée s, couvrirent fuc-
ceiuvemeni toute la furface de la terre. D e la fe i le Ionique.
Philofophie de Thalés fon fondateur. Ses fucceffcurs. P o y tr
lONttNNE ( Ph ilo fop h it La feéle Ionique donna naiflance
au focratifmc 6c au uénpatétifme. D u iocratifme. Diverfes
feéles nées du focratifmc ; voytr S o cu a t ism h , Ibid. 910. b.
Du cyrénaïfme. D u mégarifme. U e la feéle éliaque 6c érétria-
que. Du platonifmc : quelles furent le* trois académies. Du c y -
nifine. Ou Aoïcifine. Du péripatétifme. D e la feéle famienno
ou du p y thagorifme. D e la i'eéle éléatique. Ibid. 9 1 1 . a. \ ) e
l’héraclitifme. D e i'épicuréifinc. Du pyrrlionifme on feepii-
cifme. Une obfervation qui fe préfente k l'affieél de ce tableau
, c'cA qu’après avoir beaucoup é tu d ié , difputé, les philofophes
d c ’ia Gre ce fini fient par te jetter dans le pyrrho-
nifme. De» progrès de la philofophie des Grecs h or* de leurs
contrées. Citation d'un endroit de Plutarque , qui montre
combien Alexandre éroit fupérieur en politique â fon précepteur
,' qui fuit afi'ca l'éloge de la faine philofophie, 6c qui
peut fervir de leçon aux rois. Ibid. b,
G u k c s , ( P hilofoph it d t t ) l’V.ute à corriger dans cet article
de l'Encyclopédie. Suppl. ( il, 255. ",
G r tc f. Q u e l étoit leur nom dans leur propre langue. V I IL
104, b. Coutumes de» G re cs par rapport aux enfans : le
mariage 6c les familles nombreufes eu honneur parmi eux*
V . 656. b. La politique des Grecs ne connoifioit rien de
fi pu'ufant que la ven u , X VH. 839. b. L'hofpitnlité pratiquée
parmi eux, VIII. 3 1 s . " .D e s magifirats dans les république
» grecques. IX, 836, h, D e la police des Grecs.
X U . 003, " . 906. b, Des impôts. X V I I . 866. b. D e la milice
des Grecs, Suppl, 111. 931. b, Grc. Comment ils formaient!
leur» marches. 840. a t b, Des officier» qui avoient le commandement
des armées, XI, 424, a , b. HiAoire de l’art de
['équitation ciiex les Grecs. V. 880, b. D e leur cavalerie.
920. b. Comment ils dlAiuguoient leurs année». I. 390. " .
V III, 207. " , X V I . 773, " , b, Mois de» Grecs. X . 6 a i.
b. Leurs néoménies. X I, 93. b, Leur maniéré de calculé»*.
VU I . 330, " . Leurs monnoies. X. 649. a , b. D u commerce
de ces peuples. III. 692, a. D e leur philofophie s les Grec*
ont été les premiers philofqphes. II. 69. " , D e leur religion.
X IV . 83. " , b. C/c. Jeûnes anciennement pratiqué»
parmi eux, VIII, 342. b. Les plus anciens Grec» s'abAe-
noient.de la chair d’animaux dans leur nourriture, & leur»
faciifices. XI. 663, a. Détails fur les cérémonies de leur»
funérailles. V I I . 368. b, Jours heureux 6c malheureux dan»
leur opinion. VIII. 891. b. 892. ".
G u t e s . ( H iß . une. & D u t . ) On ne cefiera d’admirer les
talcns 6c le génie de c e t te nation, tant que le goût des arts
6c des fcienccs fuhfiAera dans le monde. Il n eA pas permis
d'ignorer ThiAoire générale de ce peuple célébré ; elle
offre de grandes feenes k l'imagination, de grands fujét»
de réflexion à la politique 6c k la philofophie, L'auteur di*
vif« cette hiAoire en cinq â g e s , oc confiderc les Grecs »
i g, depuis leur commencement jufqu'à la prrfe de y 0'®*
a", depuis cette expédition jufqu’aux viéloires de
6c de Platée , ||1 depuis cette époque jufqu'à la mort d A -
lexandre, 4", depuis cette mort jnfqu'à la conquête dc^ la
Gre cç par les Romains, 3“ . depuis cette époque jufquau
regne tl'AugnAe. V I I , o sa . ",
Premier Age dt la Grèce. Recherches de M, Pr é fe t w
GRE les rems auxqnds les colonies Ce fon t établies dans la Grccè.
Gbfervaiioits fur le nom de PHwfgdt que portôienc les pre-
miers Grecs. Il paroit que prefque tou» les peuplés de l'A-
fie mineure foruioient dan» l’origine une même nation avec
les Pélafgc». V II. 912. a. Deux partis célébrés qui agitèrent
long-teins la Grece, défignés fous les noms d'Héracudes &
de Pélopides, Gaules de la- guerre de Troie. Pourquoi ce
premier âge eA appel lé le • teins héroïque. Ibid, b.
Second Abc, de la Grèce. Révolutions que la Grece éprouva
nu retour ne la fameufe expédition de Troie. La liberté
établie dans tous les états de la'Grece. Ligue des Amphic-
tiens. InAitutions deAinées à ferrer le lien dé l’union des
républiques grecques. Efpcce de médiution qu’exerçoit La-
cédémone dans toutes les dtffenfions domeAiquesde la Grece.
V II. 912, b. Par là cette république acquit une fupériorité
d'autant plus marquée, que les autres etoient continuellement
obligées de rçcourjr à fa proteélion. Cefut la vertu des
Spartiates qui leur procura cette forte de prééminence. Athènes
après Spart* tenole dans la confédération lé premier rang.
Gurnétcre diAinélif de celte république. Entreprife de Darius
fur la Grece. Bataille de Marathon, Projets de Darius
continués par Xercés. Ibid. 913. a. Glorieufes viéloires dés
Grecs. Ce fécond âge eA remarquable par l'extinétion de la
plupart des royaumes qui dlvifoient la Grece, par fes grands
capitaines qui l’iliuArerent, les colonies qu’elle envoya foir
en Afie, foit en Europe, 6c les fept fages dont la mémoire
s’eA confcrvée. Ibid. b.
Troifiemc âge de la Grèce, FuneAe jaloufie qui s’éleva entre
les républiques de Lacédémone oc d'Athenes. Conduite
orgueilleufe que tinrent les Athéniens depuis la bataille
fie Platée, pendant plus de cinquante ans. Guerre du Pé-
loponefc, quelles en furent les fuites. Auteurs qui en ont
immortaiifé le fouvenir. V II. 913, b. Effets ambitieux des
Thébains, afpirant à la domination. Exploits d’Epaminon-
da». On vit alors la Grece partagée en trois puiffances \ mais
une quatrième les mit d'accord. Philippe de Macédoine,
un des orofonds politiques 6c des grands rois qui aient été
placés Iur le trône, parvint à l'empire de la Grece. VIL
t) j 4. ". Occafion que lui fournit la guerre facrée. La victoire
décifive de Qtéronée fur les Athéniens & les Béo-*
tiens, couronna fes autres exploits. Premières viéloires par
lcfquclles Alexandre affermit ta domination dans la Grece.
Ses voyages & fes exploits en Aflc. C’eff dans ce troifieme
âge de la Grece qu’il faut admirer le nombre incroyable
de grands hoThmcs qu’elle produifit. Poètes, orateurs-, phi-
iofôphe?, hifforiens qui fleurirent alors .Ib id , b.
Quatrième âge de la Grece, Les principaux royaumes qui
fe formèrent des débris de la fortune d’Alexandre, au
nombre de douze ou treize, fe réduifirent enfin à trois ;
l’Egypte, la Syrie 6c la Macédoine, 'qui fubfifterent ju f-
qu% la conquête des Romains. Etat des Grecs au milieu
«le ces troubles. Naiflance de la république des Achécns.
Inutiles efforts d'Aratns pour réunir en un corps de république
tout le Péloponefe. V II. 913. a. Philippe I I , roi de
Macédoine , appellé par les Achéons contre les Etoüens.
Guerre des alliés. Les Romains appcllés contre Philippe.
Etat de fplendeur 8c de puiffance oü Rome fe trouvoit
alors. Viéloire des Romains fur Philippe 8c fur Perfée fon
61s, qui mirent fin au royaume de Macédoine. Politique
employée par Rome pour tenir les Grecs dans l’impuif-
fance de fe réunir. Amiochus, roi de Syrie, engagé par
lès Etoliens k prendre les armes contre la république. Défaite
de ce prince qui lui fit perdre l’Afie mineure, 8c
ne fit qu’affervlr davantage les Grecs à la puiffance des
Romains. Habileté de la conduite «le ces derniers après la
défaite d’Antiochus. Ibid. b. Etat d'aviliffement oü les Athéniens
naroiffoient alors. Guerres 8c viftoires des Romains fur
les Achéens. Pillage 8c deAruélion de Çorinthe. La Grèce
devenue dès-lors province romaine, l’an de Rome 608.
Héros que la Grece fit éclorre durant ce quatrième âçe.
Philofophes célèbres. V II. 916. ". Poètes diftmgués. Autres
tiens de lettres. Ibid. b,
Cinquième Age de la Greee. Sa durée Ait de cent “ feize
ans. La douceur du gouvernement des Romains retint la
Grece fbus leur dépendance , jufqu’au règne de Mnhridatc,
qui fit fenrir à i'univers qu’il étoit ennemi de Rome, 6c
qu'il le feroit toujours. Succès de ce prince fur les premier»
généraux Romains. Havage» quebylla e x e rç a dans la Grèce,
oc particulièrement dans Àthenes. La mort de Mithridate
rendit la Grece aux Romains, fans qu'elle ait effuyé de
nouvelles viciffitudcs pendant les dlffenfiom de Céfar 8c de
Pompée. Enfin, l’empire d\\ monde étant pnffé entre les
mains d’Augufle , il créa trois préteurs pour nflurer davantage
le repos de lu Grece, ou plutôt flufervitude , dpm la
durée s’eit perpétuée jufqu'à nos jours, Nations barbares qui
l’ont ravagée fou» les fiicceffeurs d’Augufle 8c depuis a
tranflation du f.egc impérial de Rome à ïlirancc. Etat de la
Grèce depuis l'inyslfion des Turcs dans le quatorzième fie-
«4e. VU. 916* S. ■ ......................
G R E 8 6 7
, G t " 1 > divers articles fur l’hlftoirc des anciens Grec». Km-
pire des Grcci. V. ëSï, a. Colonie» qu'ils envoyèrent dan»
les pay» volfin, d, 1, Grece. III. (5%; ® Epnqtie du com-
Ditncerfidiir de lÿitotrc de Grèce. VIII. t V b. En quel
tems elle compta c plut dé Itiro». 18t. ».'De l'entreprife
des Pcrfc» contre les^rec». u t . b. La liberté rendue à la
'pér les Romains en deux occafions diferentes. V IIL
9J1. a , b. Falle« de lliiftoire grecque. Suppl. IV . 1 1 7 . b.
— 14t. a.
D e la prééminence des ' Grecs dans Us fciencts & dans 1er
arts. Cara&ercde leurs chefs-d’oeuvre. IX. 279. b. Les lettre
» 8c lés fcienccs marchèrent toujours chez eux d'un pas
égal Sc fe fcrvireiit mutuellement d'appui. 409, b. L’érudition
polie 8cie profond favoir faifoient le partage des génies
du premier ordre. 410. ". Progrès des bcaux-art* par-
rçii eux. XI. 43. " , b. 44, a. De lxrchireélurc des Grec».
IX. '804. " , b. DefcriptiOn de leurs maifons. 892/ I I . Hif-
toife de l’éloquence grecque. XI. <39. b. — 366. b. D e la
miifiquè' de» Grecs. X. 9,00. " , II. Grc. Comment ils culfi-
ver;ejît l’arr c^e la peinturé. XII, 233. b. Grc. 270. b. Grc. D e
leur» poères, 'voyeç c e dernier mot. A rt ic le f tirés des Supplément,
Il n eA point vrai que les beaux arts foicnr nés chez
les Grecs, Suppl. I. 391. b. 392. a. mais il* ont acquis chez
eux únte granulé perfection. 392.", Les Grecs les regardoient
comme dés moyens propres à former les moeurs, 8c à appuyer
les maximes de la philofophie 6c de la religion. 393.
a t b .L c s Grecs ont été regardés univerfcllcmcnt comme
les arbitres du goût dans les beaux-arts. Suppl. JV. 394. b.
Leur difoofition naturelle à la poéfie. 427. a , b. HiAoire de
leur poéfie, divifée en quatre périodes. 442. a , b. Leur fupériorité
dans la peinturé. Suppl. L 382. Comment le»
artifles Grecs fe font élevés au beau idéal. Suppl. l i t 313.
a. Décadence des arts qui arriva erifuite dans la G re c e .
Supol. I. 393. b. 394. a.
Réflexions fu r la prééminence des Grecs dans les fciences 6*
dans les ans. On ne peut s'empêcher de reconnoltre ici
combien tant de faits eclatan* qui ont illufirê la Grece,
font dignes, font même au-déffus des louanges que leur
ont données les hiAoriens. On ne yoit guerede citoyens de
Rome s'élever au-deffiis de leur fieclc 6c de Içur nation.
Dans la Grece, au contraire , vous voyez de ces génies
vafles 6c créateurs, qui »'ouvrent un chemin nouveau,
6c qui pénétrant l'avenir, fe rendent les maîtres, dç» évé-
nepiens. Là Grece abattue, conferva même une forte d’empire
bien honorable fur fes vainqueurs, fes lumières fournirent
l’orgueil des Romains : 8c leur république craignant
d’abufer des droits de la viétoire, tâchoit par fes bienfaits
de diAinguer la Grece de» autres provinces qu’elle avoit
foumifes. Si des fciences nous paflons aux beaux-arts, nous
verrons que les Grecs n’ont point de rivaux en ce genre,
V II. 917. ". Les grands maîtres y font grands jufques dans
leurs négligences, 8c leurs fautes même nous inffruifent.
Avantages phyfiquci des Grecs fur les autres peuples. Là
beauté tut un de leurs appanages. On ne fauroit croire
de combien de précautions pour avoir fie beaux enfans, ils
aidoient l'influence naturelle de leur heureux climat. Le»
exercices auxquels ils étoient accoutumés donnoient à lciir
vifage un air vraiment noble, joint à l’éclat de fanté. Avantages
de leur habillement chez les hommes 6c chex les femmes.
On fent ainfi avec quelle facilité les maîtres de l'ar»
durent parvenir à rendre la belle nature. Ibid. b. Diverfe^
caufes qui ont concouru à |a fupériorité de cette nation
dans la platique des beaux-arts. Soins que prirent lçs Grec»
pour les augmenter 8c les perpétuer. Hommages qu'ils ren-
doient aux célebres artifles. singulière rcconnoiflance que
les Crotoniates ou les Agrigcntins témoignèrent à Zeuxis.
Concours que les Grecs établirent entre lés artifles ; récom-
penfe accordée à celui qui réùniffoit la plurqlifé des fuffrages,
Moyen dont on fefervoit popr mortifier celui qui prodyifoit le
plus mauvais ouvrage. Ibid: 918. b. Ces divers afiqiens d émulation
étoient peut-être encore fort au-deffous de là cpnfidération
des orateurs, des hifforiens, des philofophes ,& e . ciuTpénétré»
eux-mêmes du mérite des beaux-arts 6c de celui des artifles,
les célébroicnrde tout leur pouvoir, pn ne vit jpqint chez
les Romains,ni la noble émulation qui ammpiç lcs Çrec»f
ni les productions fublimcs de ces maîtres ,de J’nrr. Ibid. b>
Grec», ÇHIJloirc des arts cht[ le s ) ouvrages jlqnt ce»
article fournit rextralr. Hiftoirc abrégée des art# : difieren»
peuples qui les ont fucccffivement coliivés. Çuels ont été
leurs progrès chez les nations oü ils ont régné. Suppl. JU. 234,
b HiAoire des arts chez les Grecs. Quatre f.eps ans avau»
la guerre de Troie, l’Egypte étoit policée, 8c pcpjlant pq
tems-là, 8c même jufquau tems de Cpdru#, la férocité’<rp»
moeurs des Grecs répondoit à la grofiiéreté de leur e/prih
Figures groffieies 8c informes qui leur jCRojent heu ne
Aatues dans la religion. Progrès que fit parmi eux /a |culp-
ture. Ibid. 2< 3. a. De la gravure en cacbet cJjçz les ancien»,
Caufes des différences de ¡'art chez ¡of différentes
Influence du Climat for la conAlfution des peuples oc fur