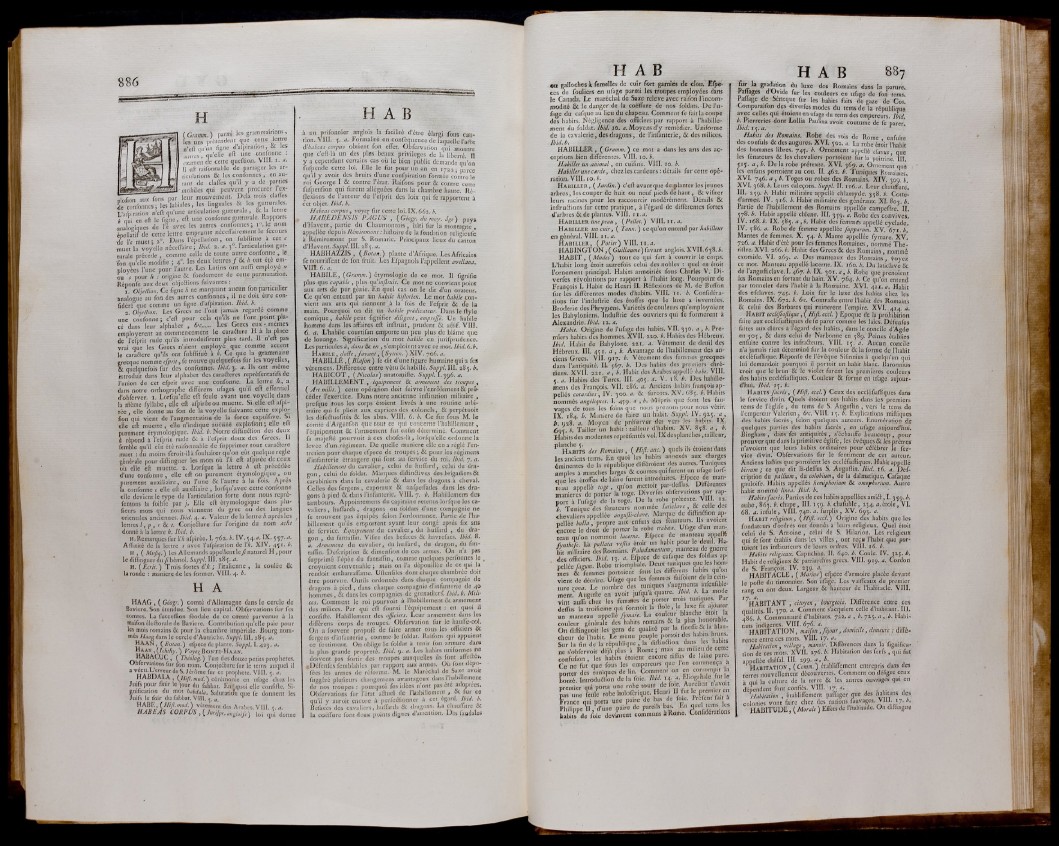
H
(C r am m .) pai™! 1« grammairiens,
tes uns prétendent que cette lettre
n’eft {tii'titi tigne d’n lpiraiion, Se les
'mires, qu’elle eA une confonnc :
¿xaincn J e c e t te quertion. VIII. i . a.
II eA rairpnnablc de partager les articulations
& les confonncs , en autant
de elafles qu’il y a de parties
*]' mobiles qui peuvent procurer l’ex-
Sfinii aux fons par leur mouvement. Delà trois claffes
3e confonncs ; les labiales, les linguales & les Rtimi ra es
L ’afp ration n’efi qu'une articulation gutturale, 8c U lettre
h oui cil eft le lig n e , eft une confonnc gutturale. Rapports
analogiques de Û avec les autres confonncs; i" . le nom
épcllatif de cette lettre emprunte néceffaircmcnt le fccours
de l’e muet ; a", »mis l’épcliatlon, on fubdittic à cet e
muet la voyelle néceffalrc; Ibid. a. a. 3».larticulation gutturale
précède , comme celle de toute autre conforme , le
fon quelle modifie ; q” . les deux le t t r e s /8 c h ont été ein-
ulovées l’une pour l’autre. Les Latins ont auffi employé v
ou , pour h : origine 8c fondement de cette permutation.
Rénonfc aux deux objeétions fulvantes :
I Obicilion. C e ligne h ne marquant aucun fon particulier
analogue au fon des autres confonncs, ¡1 ne dent être confiderò
que comme un ligne d’afpiration. Ibid. h.
a. o ije ition . Les Grecs ne l’ont jamais regardé comme
une confonnc ; c’c ll pour cela qu’ils ne l’ont point placé
dans leur alphabet , S K Les Grecs e u x - mêmes
employèrent au commencement le caraétere H a la place
de l’éfprlt rude qu’ils introdiiifircnt plus tard. Il n’eft pas
vrai que les Grecs n’aient employé que comme accent
le caraétere qu’ils ont fubftifué à h. C e <juc la grammaire
grecque nomme cfpr it, fe trouve quelquefois fur les vo y e lle s ,
oc quelquefois fur des confonnes. Ibid. 3. a . Ils ont même
Introduit dans leur alphabet des caraéteres repréfentatifs de
l’union de cet ciprie a v e c une confonne. La lettre A , a
dans notre orthographe différens ufages qu’il eft eflenticl
d’obfervcr. 1. Lorfqu’cllc eft feule avant une v o y e lle dans
la même fy llabe , el)e eft afpirée ou muette. Si. elle eft afpi-
r é e , elle donne au fon de la v o y e lle fuivante cette cxplo-
fion qui vient de l'augmentation de la force expulftve. Si
elle eft mu ette, elle n’indique aucune explofion ; elle eft
purement étymologique. Ibid. b. Notre diftinétion des deux
h répond à l’efprit rude & h l ’cfprit doux des Grecs. Il
femblc qu’il eût été raifonnablc de fupprimer tout caraétere
muet : du moins feroit-il à fouhaiter qu’on eut quelque regie
générale pour diftinguer les mots ou IV# eft afpirée de ceux
où elle eft muette, a. Lorfquc la lettre h eft précédée
d’une confonne, elle eft ou purement é tymo lo g ique, ou
purement auxiliaire, ou l’une & l’autre à la fois. Après
ta confonnc c elle eft auxiliaire , lorfqu’a v c c cette confonne
elle devient le type de l’articulation forte dont nous repré-
fentons la foiblc par Elle eft étymologique dans plusieurs
mots qui nous viennent du grec ou des langues
orientales anciennes. Ibid. 4, a. V aleu r de la lettre h après les
lettres l , p , r 6 c t . Conjeéhirc fur l’origine du nom acne
donné à la lettre h. Ibid. b.
H. Remarques fur IV# afpirée. 1. 76a. b. XV. 54.a . IX. 3 5 7 .a.
Affinité de la lettre s avec l’afpiration de IV#. X IV . 45 1 . b.
h , ( Mufiq.) les Allemands appellent lcyZ naturel H , pour
le diftinguer au [1 bémol, Suppl. III. a.
H. (E c r i t . ) Trois fortes d’/# ; l’italienne , la coulée 6c
la ronde : maniere de les former. V I I I . 4. b.
H A
HA A G , ( Géogr. ) comté d’Allemagne dans le cercle de
Baviere. Son étendue. Son lieu capital. Obfcrvations fur fes
comtes. La fucceftion féodale de ce comté parvenue à la
maifon élcétorale de Baviere. Contribution qu elle paie pour
les mois romains 6c pour la chambre impériale. Bourg nommés
Haag dans le cercle d’Autriche. Suppl. III, 285. a.
H A AN , ( Bota n.) efpece de plante, Suppl. 1. 423. a.
chthy .) V o y t[ B o n t e -H a à n .
H A B A CU C , ( Théolog. ) l’un des douze petits prophètes.
Ubiervations fur ion nom. Conjeéhirc fur le tems auquel il
a u Ca n fvv ?» * ***/*' Jérôme fur ce prophète. V I I I . 5. a.
H A B D A L A , (H ifl.m od .) cérémonie en ufage chez Ici
Juifs pour finir le jour du fabbat. E n 'quoi elle confiftc. Signification
du mot habdala. Salutation que fc donnent les
Juifs le foir du fabbat. V III. 3, a.
HAJJE, {H ifl-m o d ^ y ix c tn iim des Arabes. VIII. 3. a.
H A B E A S C O R P U S , ( Jurijpr. angtoijc ) loi qui donne
H A B
à un prifonnicr anglois la facilité d’ètre élargi fous caution.
V I I I . 3. a. Formalité en confémicncc de laquelle M e
d'habcas corpus obtient fon effet. Obfcrvation qui montre
que c’eft-là un des pins beaux privilèges de la liberté. H
y a cependant certains cas où le bien public demande qu’on
fulpcnde cette loi. Elle le fut pour un an en 172 2 ; parce
qu’il y avoir des bruits d’une conftîiration formée contre le
roi George I 6c contre l’état. Rai Ions pour 6c contre cette
fufpenfion qui furent alléguées dans la chambre haute. Réflexions
de l’auteur de l’cfprit des loix qui fc rapportent à
cet objet. Ibid. b.
Habeas corpus, voye\ fur cette loi. IX. 662. h.
H A B E D E N S I S P A G U S , ( Géogr. du tnoy, d g e ) pays
d’Ha vent, partie du Chaumontois , bâti fur la montagne ,
appcllée depuis Rémiremont : hiftoirede la fondation rcligicufc
à Rémiremont par S. Romaric. Principaux lieux du canton
d’Havent. Euppl. III. 28y a.
H A BH A Z Z IS | ( Botan. ) plante d’Afrique. Les Africains
fe nourriffent de fon fruit. Les Efpagnols l’appellent avellana.
V I I !. 6 . a.
H A B IL E , ( Grarnrn. ) étymologie de ce mot. Il fignifie
plus que capable, plus q u'tnfruit. C e mot ne convient point
aux arts de pur génie. En quel cas on le dit d’un orateur.
C e qu’on entend par un habile hiflorien. Le mot habile convient
aux arts qui tiennent à la fois de l’efprit & de la
main. Pourquoi on dit un •habile prédicateur. Dans le ftyle
comique , habile p eu t fignifier diligent, emprejfé. Un habile
homme dans les affaires eft inftruit, prudent 6c aélif. V I I I .
6 . a. L ’habile courtifan emporte un peu plus de blâme que
de louange. Signification du mot habile en jurifprudcnce.
Les particules dans 6c e n , s’emploient avec ce mot. Jbid .ô .b.
H a b il e , dotte, [a v a n t , ( Synon. ) X IV . 706. a.
H A B IL L É , ( B la fon ) fe dit d’une figure humaine qui a fes
vêtemens. Différence entre vêtu 6c habillé. Suppl. III. 283. b.
H A B 1C O T , ( N ic o la s ) anatoipiftc. Suppl. I.306. a.
HA B IL L EM EN T , équipement 6c armement des troupes ,
( A r t milit. ) cette opération doit fuivre l’enrôlement 6c précéder
l’exercice. Dans notre ancienne inftitution militaire ,
prcfque tous les corps étoient livrés à une routine arbitraire
qui fe plioit aux caprices des colonels, Scpcrpétuoit
les défeéluontés & les abus. VIII. 6. b. C e fut lotis M. le
comte d’A rgenfon que tout ce qui concerne l’h abillement,
l’équipement 6c l’armement fut enfin déterminé. Comment
fa majefté pourvoit à ces chofcs-là, lorfqu’cllc ordonne la
levée d’un, régiment. D e quelle maniere elle en a réglé l’entretien
pour enaque efpece de troupes ; 8c pour les régimens
d’infanterie étrangère qui font au fcrvicc du roi. Ibtd. 7. a.
Habillement du ca va lier , celui du huffard, celui du drag
o n , celui du foldat. Marques diftinélivcs des brigadiers 8c
carabiniers dans la cavalerie 8c dans les dragons à cheval.
Celles des fergens, caporaux 8c anfpcffades dans les dragons
à pied 8c dans l’infanterie. VIII. 7 . b. Hahillemens des
tambours. Appointemcns du capitaine retenus lorfquc les cavaliers
, huffards, dragons ou foldats d’uijc compagnie ne
fe trouvent pas équipés félon Y ordonnance. Partie de l’habillement
qu’ils emportent ayant leur congé après fix ans
de fcrvicc. Equipement du ca va lier, du huffard , du dragon
, du fantaflin. Vifitc des bcfaces 8c havrcfacs. Ibid. 8.
a. Armement du cavalier,, du huffard , du dragon, du fantafilm
Dcfcription 8c dimenfion de ces armes. On n’a pas
fupprimé l’épée du fantaflin, comme quelques perfonnes le ,
croyoient convenable ; mais on l’a dépouillée de ce qui la
rendoit embarraffante. Uftcnfilcs dont chaque chambrée doit
être pourvue. Outils ordonnés dans chaque compagnie de
dragons à pied , dans chaque compagnie d’infanterie de 40
hommes, oc dans les compagnies de grenadier^. Ibid. b. M i li ces.
Comment le roi pourvoit à l’habillement 8c armement
des milices. Par qui eft fou rni l’équipement : en quoi il
confiftc. Habillement des officiers. Leur armement dans les
différons corps de troupes. Obfcrvation fur le bauffc-col.
O/i a fouvent propofé de faire armer tous les officiers 8c
fergens d’infanterie, comme- le foldat. Raifons qui appuient
ce fentiment. On oblige le foldat à tenir fon armure dans
la plus grande propreté. Ibid. 9. a . Les habits uniformes ne
doivent pas fortir des troupes auxquelles ils _font affectés.
«Défenfcs femblables par rapport aux armes. Où font dépo-
fées les armes de réforme. M. le Maréchal de Saxe avoit
fuggéré pluficurs changcmens avantageux dans l’habilleincnt
de nos troupes : pourquoi fes idées n’ont pas été adoptées.
Obfcrvations fur l’état aéhicl de l’iiabillemcnt , oC fur ce
I qu’il y auroit encore à perfeélionner à cet égard. Ibtd. b.
Bcfaces des ca va liers, huffards 8c dragons. La chuufftire 8c
| la coëffurc font deux points dignes d'attention. Des faudales
H A B
«n galloches à femelles de cuir fort garnies de clou. Efpe-
ces de fouüers en ufage parmi les troupes employées dans
l e Canada. L e maréclial de Saxe releve avec raifon l’incommodité
8c le danger de la coëffure de nos foldats. D e l’u-
fage du calque au lieu du chapeau. Comment fe fait la coupe
des habits. Négligence des officiers par rapport à l’habille- 1
ment du foldat. Ibid. 10 . a. Moyens d’y remédier. Uniforme j
de la ca va le r ie , des dragons, de l’inuinteric, 8c des milices, 1
Ib id. b.
H A B IL L E R , ( Gramm. ) ce m o t a dans le s arts des a c c
ep tio n s bien différentes, v i l i . 10. b.
Hab iller un a n im a l, en cu ifine. VIII. 10. b.
Habiller une carde, chez les cardcurs : détails fur cette opération.
V I I I . 10. b.
H a b i l l e r , ( J ardin .) c 'c f t a v an t qu e d c .p lan te r le s jeu n e s
a r b r e s , le s c o u p e r d e hu it o u n e u f pieds d e h a u t , 8c v i f i t c r
le u r s racines p o u r les ra c cou rc ir modé rém ent. D é ta ils 8c
in f t ru à io n s fu r c e tt e p ra tiq u e , à l’é ga rd d e d ifféren tes fortes
d ’a rb re s 8c d e plantes. V I I I . 11. a.
H a b i l l e r une p ea u , (P e lle t . ) VIII. 1 1, a,
H a b i l l e r un cu ir , ( fa n n . ) ce qu'on entend pur habilleur
en général. V I I I . 1 1 . a.
H a b i l l e r , ( P o t i e r ) V I I I . 1 1 . a.
H A B IN G T O N , ( Guillaume) favant anglois. X V I I .638.b.
H A B I T , ( Modes ) tout ce qui fert à couvrir le corps.
L ’habit long étoit autrefois celui des nobles : quel en étoit
l’ornement principal. Habits armoiriés fous Charles V . D iverses
révolutions par rapport à l’habit long. Pourpoint de
François I. Habit de Henri II. Réflexions de M. de Buffon
fur les différentes modes d’habits. V I I I . 1 1 . b. Confidéra-
tiops fur l’induftrie des étoffes que le luxe a inventées.
Broderie des Phrygiens. Variétés de couleurs qu’employoient
les Babyloniens. Induftrie des ouvriers qui le formèrent à
Alexandrie. Ibid. 12 .a .
Ha b it. Origine de l’ufagc des habits. V IL 330. a , b. P remiers
habits des hommes. X V II. 220. b. Habits des Hébreux.
Ibid. Habit de Babylone. 221. a. Vêtement de deuil des
Hébreux. III. 4 0 . a , b. Avantage de l’habillement des anciens
Grecs. V II. 9x7. b. Vêtement des femmes grecques
dans l’antiquité. IL 567. b. D e s habits des premiers chrétiens.
X V I I . 2 2 t. a , b. Habit des Arabes appelle habe. VIII.
<. a. Habits des Turcs. III. 405. a. V . 18. b. Des habillc-
mens des François. V I I . 286. a. Anciens habits françois ap-
pcllés cotardies, IV . 300. a. 6c furcots. X V . 683. b. Habits
nommés angéliques. I. 459- a » L Mépris que font les fau-
vag es de tous les foins que nous prenons pour nous vêtir.
IX . 184. b. Maniere de taire un habit. Suppl. IV . 923. a ,
h . 928. a. Moyen de préierver des vers les habits. IX .
¿03. b. Ta iller un habit : tailleur d’habits. X V . 838. a , b.
Habits des modernes repréfentés vol. IX des planches, tailleur,
pl H a b i t s des Romains , ( HiJI. anc. ) quels ils étoient dans
les anciens tents. En quoi les habits annexés aux charges
éminentes de la république différoient des autres. Tuniques
amples à manches larges & courtes qui furent en ufage lorf-
mie les étoffes de laine furent introduites. W p « e de manteau
appellò to g e , qu’on mettoit par-deffus. Différentes
maniérés de porter la toge. Divcrfcs ohfervations par rapport
à l'ufage de la toge. D e la rolic prétexte. VUI. ta
i . Tunique des fénateurs nommée laticlavc , 6c celle des
chevaliers appclléc angufti-chve. Marque de difiinflion ap-
pelléc b u lla , propre aux enfims des fénateurs. Ils avoienr
encore le droit de porter la robe trabaa. Ufage dun manteau
qu'on nommoit lacerne. Efpece de manteau appelli
fvnthefe. La pollala veflis étoit un habit pour le deuil. Ha-
Bit militaire des Romains. Paludamcntum , manteau de guerre
des officiers. Ibid. i j . «. Efpece de cafaquc des fo dats ap-
pelléc fagum. Robe triomphale. Deux tuniques que es hommes
& femmes portoienr fous les différons habits quon
v ien t de décrire. Ufage que les femmes faifoicnt <lc la ceinture
sona. Le nombre des tuniques s augmenta infenfible-
ment; Augnile en avolt ¡ufqu'h quatre. Jbid. b. La mode
v in t auffi chez les femmes de porter trois tuniques. Par
deffus la trolfieme mil formoli la (to c , !c llxe ,
un manteau appelli fymare. La couleur blanche étoit la
couleur générale des habits romains 8c la pliis to iA aW e .
O n diftlngiioit les gens de qualité par la fineljh & la blancheur
de l’habit. Le menu peuple portoit des habits brin s.
Sur la fin de la république, la diftinélion dans les habits
ne s’obfervoit déjli plus à R om e ; m a is au milieu de cette
confufion , les habits étoient encore tiffus de lame pure.
C e ne fut que fous les empereur» que 1 on commença a
porter des uniques de lin. Comment on en corrompit a
3onté. In t ro d u i t^ de la foie. Ibid. U . a. Ehogabale fut le
nremiér qui porta une robe toute de foie. Aurei, en n avoit
n ascine ïeu le robe holoférique. Heur II lut le premiere,.
L a n c e (lui porta une paire de bas de foie. l
Philippe I I , d’une paire de pareils bas. En
liabhs de foie devinrent communs ir Rome. Confidératlons
H A B 887
fur la gradation du luxe des Romain* dans la parure»
Faffages dO y id c fur les couleurs en ufage de fon tenu.
Paffagc de Séneque fur les habits faits <lc gaze de Cos.
Comparaifon des divcrfcs modes du tems de la république
avec celles qui étoient en ufage du tems des empereurs. Ibid.
b. Pierreries dont Lollia Paulina avoit coutume de fc parer»
Ibid. i e . a. 1
Habits des Romains. Robe des rois de Rome enfuite
des confuís 8c des augures. X V I . 302. «. La robe étoit l’habit
des hommes libres. 743. b. Ornement appellé clavus, que
les fénateurs 6c les chevaliers portoicm fur la poitrine. III.
K ï \ . a y b . D e la robe prétexte. X V I . 369. a. Ornement que
les enfans portoient au cou. II. 462. b. Tuniques Romaines»
X V I . 746. a , b. Toges ou robes des Romains. X IV . 300. b.
X V I . 368. b. Leurs caleçons. Suppl. IÍ. 1 1 6 . a. Leur chauffure.
III. 239. b. Habit militaire appellò chlamyde. 338. b. Cotte»
d’armes. IV . 216. b. Habit militaire des généraux. XI. 803. b.
Partie de l'haBillemcnt des Romains appcllée campeftrc. II.
378. b. Habit appcllé chlcne. III. 339. a. Robe des convives.
IV . 168.b. IX. 383. a .b . Habit des fcmmtfs appeUé cyciadc.
IV . 386. a. Robe de femme appcllée fupparum. X V . 6 71. b.
Mantes de femmes. X. 34. b. Mante appcllée fymare. XV*.
726. a. Habit d’été pour les femmes Romaines, nommé T h e -
riflrc. X V I . 266. b. Habit des Grecs 6c des Romains, nommé
exomidc. V I . 269. a. Des manteaux des Romains, iroyez
ce mot. Manteau appellò lacerne. IX. 160. b. Du laticlavc 6c
de l’angufticiave. I. 467. b. IX. 301. a , b. Robe que prenoient
les Romains en forrant du bain. X V . 764. b. Ce qu’on entend
par tonnelet dans l’habit à la Romaine. X V I . 4 1 1 . a. Habit
des cfclaves. 743. b. Loix fur le luxe des habits chez les
Romains. IX. 672. b. 6>c. Contrafte entre l’habir des Romains
6c celui des Barbares qui ruinèrent l’empire. X V I . 414. a.
H a b i t eccléfiafliqucI ( Hiß. eccl. ) Epoque de la prohibition
faite aux eccléfiaftiqucs de fe parer comme les laies, Défenfcs
faites aux clercs à fégard des habits, dans le concile d’Agdc
en 30 3 , 6c dans celui de Narbonnc en 389. Peines établies
enftiitc contre les infraéfeurs. VIII. 13. a. Aucun concile
n’a jamais rien déterminé fur la couleur 6c la forme de l’habit
eccléfiaftique. Réponfc de l’évêquc Sifmnius à quelqu’un qui
lui demandoit pourquoi il portoit un habit blanc, liaronnius
croit que le brun 6c le violet furent les premieres couleurs
des habits cccléfiaftiques. Couleur 6c forme en ufage aujourd’hui.
Ibid. 13. b.
H a b i t s [acrés, ( Htjl. eccl.) Ceux des eccléfiaftiqucs dans
le fcrvicc divin. Qu els étoient ces habits dans les premiers
tems de l'églife , du tems de S. Auguftin , vers le tems de
l’empereur Valerien, 6*c. VIII. 13. b. Explications miftiques
des habits facrés, félon cjuclques auteurs. Enumération de
Suelques parties des habits /acrés, en ufage aujourd'hui.
ingnam | dans fes antiquités, s’échauffe beaucoup, pour
prouver que dans la primitive ég iife, les évêques 8c ¡es prêtres
n’avoient que leurs habits ordinaires pour célébrer le fer-
v ice divin. Ohfervations fur le fentiment de cet auteur.
Anciens habits que portoient les cccléfiaftiques. Habit appellò
birrum ; ce que dit là-deflus S. Auguftin. Ibid. 16 . a. D c f cription
du pallium, du colobium, de la dalmatiquc. Cafaquc
{jauloife. Habits appellés hemiphorium 6c omophorium. Autre
labit nommé linea. Ibid. b.
Habits [acrés. Parties de ces habits appcllécs amiét, I. 3 39. b.
aube, 863. b. chape, III. 139. b. chaluble, 234. ¿ .é to le , V I.
68. a. in/ule , VIII. 740. a. furplts , X V . 603. a.
H a b i t religieux, (Hiß. eccl.) Origine des habits que les
fondateurs d'ordres ont donnés à leurs religieux. Q u e l étoit
celui de S. Antoine , celui de S. Hilarión. Les religieux
qui fe font établis dans les v ille s , ont reçu l’habit que por-
toiertt les inftitutcurs de leurs ordres. VIII, 16. b.
Habits religieux. Capuchon. II. 640. b. Coule. IV. 325. b.
Habit de religieux & patriarches grecs. VIII. 919. a. Cordon
de S. François. IV . 239. à .- . i ;
H A B IT A C L E , ( Marine) cfpéce <1 armoire placée devant
le pofte du timonnier. Son ufàge. Les vaiffeaux du premier
rang en ont deux. Largeur.6c hauteur de l’habitacle. VIII.
1 ^H A B IT AN T , citoyen [ bôurgéois. Différence entre ces
qualités. II. 3,70. a. Comment s’acquicrt celle d’habitant. III.
486. b. Communauté d’habitans. 722, a , b. 723. a ,.b . Habit
! tans indigènes. V I I I . 676. a. . . .
H A B IT A T IO N , maifon ,/éjou r, domicile, demeure : différence
entre ces mots. VIII. t y . a.
Habitation, village, manoir. Différences dans la fignifica-
tion de ces mots. X v I I . 276. b. Habitation des ferfs , qui fut
appcllée eliòfili, III- »99- * . . •
H a b i t a t io n , ( Comm. ) éiabliffcmcnt entrepris dans des
terres nouvellement découvertes. Comment on déligne ceux
h qui la culture de la terre 8c les autres ouvrages qui en
dépendent font confiés. VIII. 17. a. . , . . .
Habitation , établiffemcnt paffager que des m b lfÆ
colonies vont faire chez des nations fauvoge» VIII. 17. b.
H A B IT U D E , ( Morale ) Effets de 1 habitude, On dtftmgu.