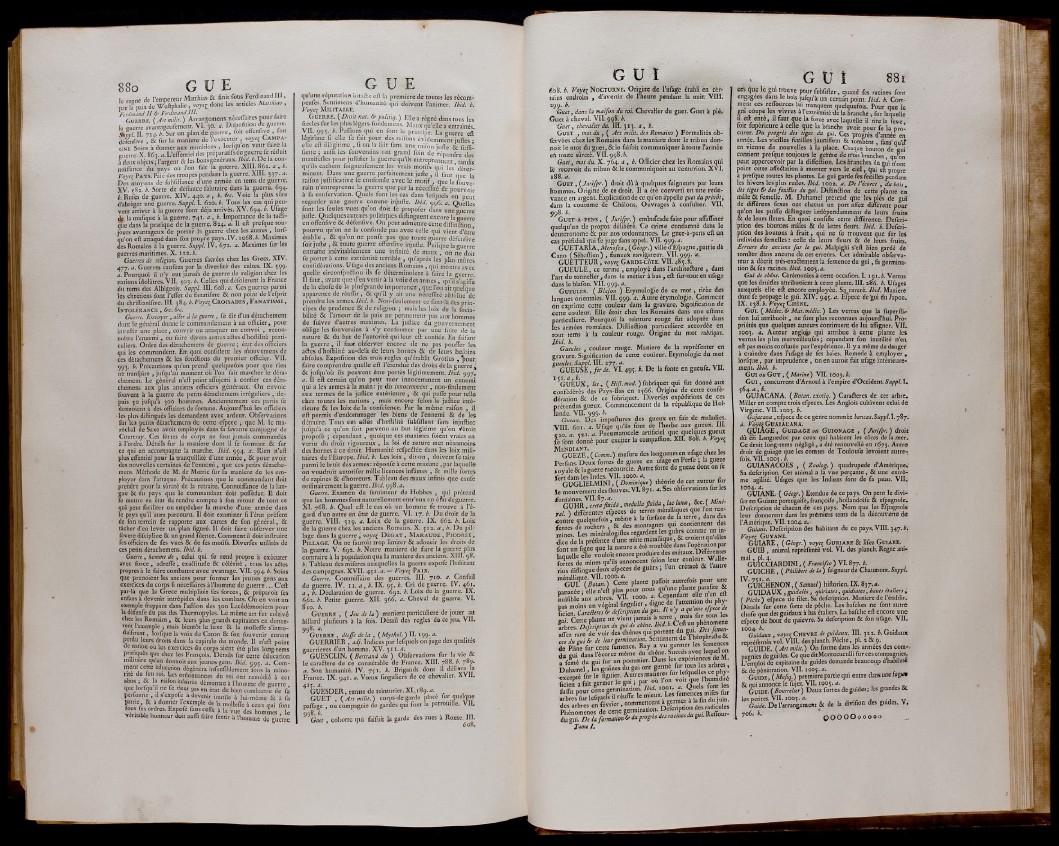
88o G U E
le régne de l’empereur Matthias & finit fous FerdinandIII,
par l f paix de Wcftphalic, veyrj donc les articles Matthias ,
Ferdinand I I & Ferdinand III. „ . c .
G u e r r e . ( A n milit. ) Arrangcmens néceffaircs pour faire
la guerre avantagé!,fcraem. V I . 30. n. Dilpof.no,! ,Je gmarre.
Sltppl. n . 724- *• Sur un plan de guerre, to n offenfive , foit
défenfive , 8c fur la maniéré de l’exécuter , voye* C am p a -
GSE. Soins à donner aux munitions, lorfqu on v eu t faire la
guerre. X. 863.rf.L’eflemiel des préparatifs de guerre fe réduit
à deux objets; l’argent & les bons généraux. Ibid.b. D e la con-
noiflance du pays où l’on fait la guerre. X 1IL 862. a ,.
Voyez P a y s . Paie des troupes pendant la guerre. X i l l . 337. a.
Des moyens de fubfiilance d’une armée en tems de guerre.
X V . <82. b. Sorte de défiance falutaire dans la guerre. 694.
b. Rufes de guerre. X IV . 440. a t b. Grc. V o ie la plus sure
d’abréger une guerre. Suppl. I. 620. b. Tous les cas qui peuvent
arriver à la guerre font déjà arrivés. X V . 694. b. Ufage
de la mufique à la guerre. 74 1 . a , b. Importance de la tactique
dans la pratique de la guerre. 824. a. I l eft prefque tou^
. jours avantageux de porter la guerre chez les autres , lorf-
qu’on eft attaqué dans fon propre pays. IV . 1068. b. Maximes
des Romains à la guerre. Suppl. IV . 672. a. Maximes fur les
guerres maritimes. X . 122. b.
Guerres de religion. Guerres facrées chez les Grecs. X IV .
47 7 . a. Guerres caufées par }a diverfité des cultes. IX. 599.
a. Pourquoi il n’y eut jamais de guerre de religion chez les
nations idolâtres. V II. 503. b. Celles qui défolerent la France
du tems des Albigeois. Suppl. III. 608. a. Ces guerres parmi
les chrétiens font l’effet du fanatifme & non point de l’efprit
du chriftianifme. III. 384. b. Voyeç C r o i s a d e s , F a n a t i s m e ,
I n t o l é r a n c e , & c . Grc.
Guerre. E n vo y er , aller à la guerre, fe dit d’un détachement
dont le général donne le commandement à un officier, pour
invertir une place, couvrir ou attaquer un convoi , recon-
noitre l’ennemi, ou faire diyers autres ailes d’hoftilité particuliers.
Ordre des détachemens de guerre ; état des officiers
qui les commandent. En*, quoi confiftenc les lAouvemcns de
ces détachemens & les fondions du premier officier. V II.
993. b. Précautions qu’on prend quelquefois pour que rien
ne tranfpire , jufqu’au moment où l’on fait marcher le détachement.
Le général n’eft point affujetti à confier ces détachemens
aux plus anciens officiers généraux. O n envoie
fouvent à la guerre de petits détachemens irréguliers, depuis
50 jufqua 300 hommes. Anciennement ces partis fe
donnoient à des officiers de fortune. Aujourd’hui les officiers
-les plus diflingués les demandent avec ardeur. Obfervations
fur les petits détachemens de cette efpece , que M. le maréchal
de Saxe avoit employés dans fa favante campagne de
Courtray. Ces fortes d e corps ne font jamais commandés
à l’ordre. Détails fur la manière dont il fe forment ,& fur
ce qui en accoitipagne la marche. Ibid. 904. a. Rien n’eft
plus effentiel pour la tranquillité d’une armée, & pour avoir
des nouvelles certaines de l’ennemi, que ces petits détachemens.
Méthode de M. de Moeric fur la maniéré de les employer
dans l’attaque. Précautions que le commandant doit
prendre pour la sûreté de la retraite. Connoiffance de la langue
& du pays que le commandant doit pofféder. Il doit
le mettre en état de rendre compte à fon retour de tout ce
qui peut faciliter ou empêcher la marche d’une armée dans
le pays qu’il aura parcouru. I l doit examiner fi l’état préfent
de fon terrein fe rapporte aux cartes de fon gén é ra l, &
tâcher d’en lever un plan figùré. I l doit faire obferver une
févere difcipline & un grand filence. Comment il doit inftruire
fes officiers de fes vues 8c de fes motifs. Diverfes utilités de
ces petits détachemens. Ibid. b.
Guerre, homme de , celui qui fe rend propre à exécuter
avec force , adreffe, exaélitude 8c célérité , tous les aéles
propres à le faire combattre avec avantage. V I I . 994. b. Soins
que prenoient les ancienspour former les jeunes gens aux
exercices du corps fi néceflaires a l’homme de gu e rre. . . C ’eft
par-là que là Grece multiplioit fes forces, 8c préparoit fes
enfans à devenir intrépides dans les combats. On en v o it un
exemple frappant dans l’aâion des 300 Lacédémoniens pour
la détenfe du pas des Thermopyles. Le même art fut cultivé
chez les Romains, 8c leurs plus grands capitaines en donnèrent
l’exemple ; mais bientôt le luxe 8c la molleffe s’intro-
duifirent, lorfque la voix de Caton 8c fon fouvenir eurent
Pcr<lu .leurs droits dans la capitale du monde. I l n’eft point
de nation où les exercices du corps aient été plus lone-tems
pratiqués que chez les François. Détails fur cette éducation
militaire qu on donnoitaux jeunes gens. Ibid. 003. a . C om ment
cette éducation dégénéra infenfiblement fous la minorité
du feu roi. Les ordonnances du roi ont remédié à cet
abus ; 8c la raifon éclairée démontre à l'homme de gu e r re ,
que lorfqu 1 ne fe tient pas en état de bien combattre de fa
perfonne , il sexpofe a devenir à lui.mime & à fa
patrie & à donner 1 exemple ÿ g molleff(. | ceux K g f
T 1 ™ & Hommes , le
v éritable honneur doit auffi fa ire fentir à l’homme de gu er re
GUE qu’une réputation intailc eft la première de toutes les récom-
penfes. Scntiniens d’humanité qui doivent l’animer. Ibid. b.
Voye^ M i l i t a i r e .
G u e r r e . (D r o i t nat. & politiq. ) Elle a régné dans tous les
fiecles fur les plus légers fondemens. Maux qu’elle a entraînés
V I I . 995. b. PafTions qtu en font le principe. La guerre eft
légitime fi elle fe fait pour des raifons évidemment juftes •
elle eft illégitime , fi on la fait fans une raifon jufte & fuffi-
fante ; auffi les fouverains ont grand foin de répandre des
manifeftes pour juftifier la guerre qu’ils entrepYennent tandis
qu’ils cachent foigneufement les vrais motifs qui les* déterminent.
Dans une guerre parfaitement jufte , il faut que la
raifon juftificative fe confonde avec le m o t if, que le fouve-
rain n’entreprenne la guerre que par la néccflité de pourvoir
à fa confervation. Q u els font les cas dans lefquels on peut
regarder une guerre comme injufte. Ibid. 99G. a. Quelles
font les feules vues qu’on doit fe propofer dans une guerre
jufte. Quelques auteurs politiques diftinguent encore la guerre
en offenfive 8c défenfive. O n peut admettre cette diftinftion
pourvu qu’on ne la confonde pas avec celle qui vient d’être
établie , 8c qu’on ne penfe pas que toute guerje défenfive
foit juffc , 8c toute guerre offenfive injufte. Puifquc la guerre
entraîne inévitablement une infinité, de maux , on ne doit
fe porter à cette extrémité terrible , qu’après les plus mûres
confidérations. Ufage des anciens Romains , qui montre avec
quelle circonfpeélion ils fe déterminoient à faire la guerre.
11 fau t, avant que d’en venir à la voie des a rmes, qu’il s’agiffê
de la ch ofed e la pluÿgrande importance , que l’on ait quefoue
apparence de réuflir, 8c qu’il y ait une néceflité abfoluc de
prendre les armes. Ibid. b. Non-feulement ce font-làdes principes
de prudence 8c de religion ; mais les loix de la focia-
bilité 8c l’amour de la paix ne permettent pas aux hommes
de fuivre d’autres maximes. La juftice du gouvernement
oblige les fouverains à s’y conformer par une fuite de la
nature 8c du but de l’autorité qui leur eft confiée. En faifant
la g u e r r e , il faut obferver encore de ne pas pouffer les
aftes d’hoftilité au-delà de leurs bornes 8c de leurs befoins
abfolus. Expofition des trois réglés qu’établit Grotius , ^>our,
faire comprendre quelle eft l’étendue des droits de la guerre l
8c jufqu’où ils peuvent être portés légitimement. Ibid. 997.
a. Il eft certain qu’on peut tuer innocemment un ennemi
qui a les armes à la main : je dis innocemment, non-feulement
aux termes de la juftice extérieure , 8c qui parte pour telle
chez toutes les nations , mais encore félon la juftice intérieure
8c les loix de la confcience. Par la même raifon , il
eft permis d'endommager les biens de l'ennemi 8c de les
détruire. T o u s ces aftes d’hoftilité fubfiftent fans injuftice
jufqu’à ce qu’on foit parvenu au but légitime qu’on ¿ é ta i t
propofé ; cependant , quoique ces maximes foient vraies en
vertu du droit rigoureux , la loi de nature met néanmoins
des bornes à ce droit. Humanité refpeétée dans les loix militaires
de l’Europe. Ibid. b. Les lo ix , dit-on , doivent fe taire
parmi le bruit des armes: réponfe à cette maxime, par laqucllè
on voudroit antorifer mille licences infâmes , 8c mille iortes
de rapines 8c d’horreurs. Tableau des maux infinis que caufe
ordinairement la guerre. Ibid. 998. a.
Guerre. Examen du fentiment de Hobbcs , qui prétend
que les hommes font naturellement entr’eux en éfctt de guerre.
X I. 768. b. Q u e l eft le cas où un homme fe trouve a l’égard
d’un autre en état de guerre. V I . 17. b. D u droit de la
guerre. V I I I . 319. a. Lo ix de la guerre. IX . 662. b. Loix
de la guerre chez les anciens Romains. X . 5 12. a , b. D u pillage
dans la g u e r re ,' voyeç D é g â t , M a r a u d e , P i c o r é e ,
P i l l a g e . On ne fauroit trop limiter 8c adoucir les droits de
la guerre. V . 692. b. Notre maniéré de faire la guerre plus
contraire à la population que la maniéré des anciens. XIII. 98.
b: Tableau des miferes auxquelles la guerre expofe l’habitant
des campagnes. X V I I . 451 . a .— V o y e[ P a i x .
Guerre. Commiffaire des guerres. III. 710. a. Confeil
de guerre. IV . 1 1 . a , b. IX. 95. b. C ri de guerre. IV . 4 6 t .
a , b. Déclaration de guerre. 60a. b. Loix de la guerre. IX .
GG2. b. Petite guerre. XII. 366. a. Cheva l de guerre. V I .
#10. b.
G u e r r e , ( Jeu de la ) maniéré particulière de jouer au
billard plufieurs à la fois. Détail des réglés de Ce jeu. V IL
998. a.
G u e r r e , dêeffe de la , ( My thol. ) II. 199. a.
GUER RIER , adj. Indices par lefquels on juge des qualités
guerrières d’un homme. X V . 3 1 1 . a.
GUESCLIN . ( Bertrand du ) Obfervations fur la v ie 8c
le caraftere de ce connétable de France. XIII. 788. b. 7° 9*
a. Son humanité. IV . 7 5 1 . b. Brigands dont il
France. IX . 941. a. Voe u x finguliers de ce chevalier. A V IL
4 15. a.
G U E S D E R , terme de teinturier. XI., 189. </.
G U E T , ( A r t m i lit .) corps-degarde placé fur quelque
partage , ou compagnie de gardes qui font la patrouille. VIL'
^ G u e t , cohorte qui faifoit la garde des rues à Rome. III.
Goot
G U ï G Ü î
€0'8. b. V oy e[ N o c t u r n e . Origine de l’ufage établi èn cèf'-
tains endroits , d’avertir de 1 heure pendant la nuit. V I I I .
299. b.
G u e t , dans la maifon du roi. Chevalier du guet. G uet à pié.
G u e t à cheval. V IL 998. b.
G u e t , chevalier du. III. 313. a , b.
G u e t , mot d u , ( A r t milit. des Romains ) Formalités obse
rvé es chez les Romains dans la maniéré dont le tribun don-
noit le mot du g u e t, 8c le faifoit communiquer à tonte l’armée
eh toute sûreté. V IL 998.i>.
G u e t , mot du. X . 764. a , b. Officier chez les Romains qui
lé recevoit du tribun 8c le commimiqüoit au ‘Centu'rioh. X VI.
188. a.
G u e t , (Ju r ifpr . ) droit dû à quelques feigneurs par leurs
hommes. Origine de ce droit. Il a été converti en une redevance
en argent. Explication de ce qu’on appelle guet du prévôt,
dans la coutume de Châlons. Ouvrages à confulter. V II.
598. b.
G u e t -a -PENS, ( J u r ifp r .) embufeade faite pour affaffmef 3uelqu’un d e propos délibéré. C e crime condamné dahs le
euteronome 8c par nos ordonnances. L e guet-à-pens eft ùh
cas préfidial qui fe juge fans appel. V I I . 999. a.
G U E T A R iA , M en o fca , (G éo g r .) ville cl E fpagne,pàtrie dè
Cano (Sébaftien) , fàmeufc navigateur. V I I . 999. a.
G U E T T E U R , vo y e i G a r d e -c ô t e . V IL 48 5
G U E U L E , c e terme , employé dans l’architefturé , dans
l’art du tohnelier, dans le métier à bas , eft fur-tout ett ufage
dans le blafon. V I I . 999. à.
G u e u l e s . ( B la jo n ) Etymologie de ce mot \ tirée des
langues orientales. V I I . 999. a. Autre étymologie. Comment
On exprime cette couleur dans la gravure. Signification de
ce tte couleur. Elle étoit chez les Romains dans une eftime
{»articuliere. Pourquoi la teinture rouge fut adoptée dans
es armées romaines. Diftinftion particulière accordée en
tout tems à la couleur rouge. Origine du mot rubrique.
m m b. , ,
Gueules , couleur rouge. Manière de la repréfenter en
gravure. Signification de cette couleur. Etymologie du mot
gueules. Suppl. III. 277. a.
G U E U S E , f e r de. V I . 495. b. D e la fonte en gueufe. V I I .
i c i , a 9b. . . , .
G U E U X , l e s t (H i f l .m o d .) fobriquet qui fut donné aux
confédérés des Pays-Bas en 1566. Origine de cette confédération
8c de ce fobriquet. Diverfes expéditions de ces
prétendus gueux. Commencement de la république de Hollande.
V I I . 999. L , r • j 1 j-
Gu eu x. Des impoftures des gueux en fait de maladies.
V I I I 601. a. Ufage qu’ils font de l’herbe aux gueux. III.
<20. a . 321. a. Pneumatpcele artificiel que quelques gueux
fe font donné pour excjter la compaflion. XII. 808. b. Voye.\
M e n d i a n t . / . , . . .
GÜE Z E ( Comm.) mefnre des longueurs en ufage chez les
Perfans. D eu x fortes de gueze en ufage en Perfe j la gueze
aoyale & la gueze raccourcie. Autre forte de gueze dont on fe
fort dans les Indes. V I I . tooo. a. .
G U G L IE LM IN I , {Dom in iq u e) théorie de cet auteur fur
le mouvement des fleuves. V I . 871. u. Ses obfervations fur les
* ° G U H R , cn ta 'flu ïd a , miJulla fia id a , lac lu t in , S c c . l Minéra
l ) différentes efpeces de terres métalliques que 1 on rencontre
quelquefois, même à la furface de fa te r re , dans des
fentes de rochers , 8c des montagnes qu, contiennent des
mines. Les minéralogiftes regardent es guhrs comme un indice
de la pféfence d une mine métallique, 8c croient qu elles
fon t un figne que la nature a été troublée dans l’opération par
laquelle efle vouloit encore produire des métaux. Différentes
fo r t e s de mines qu’ils annoncent félon leur couleur Walle
rius diffingue deux efpeces de guhrs ; lu n crétacé 8c 1 autre
mGÜ?7 i ’y c ^ r>‘ "“ Séiils'iPa <cr°;* au" efois 'm è t x c x i
oas moitis un végétal ffngulier, digne de l’attention du phy-
L e n . Caraüercs fr itfcr iption du gai. l i n y a q a une c fp ^ c d c
de Plinc fur cette fcmence. Ray a vu germer les feinences
d u gui dans l’écorcc même du chêne. Succès avec J « ® “ 1.
a femé du gui fur un pommier. Dans les expériences de M.
D uh am e l, fes graines du gui ont germé fur tous es arbres,
7 Cep,è t o germer h:
d c^ a rb ^ s e^ fé vVier, commencent à germer à la fin du ,um
ceS que le gui trouve pour fubfifler, quand fes racines font
engagées dans le bois ¡ufqu’à un certain point. Ibid. b. Comment
ces reffources lui manquent quelquefois. Pour que le
gm coupe les v iv re s à 1 extrémité de la branche, for laquelle
il eft en té , il faut que la force avec laquelle il tire la feve -
foit fepéneure a celle que la branche avoit pour fe la procurer.
D u progrès des urnes du gui. Ces progrès d’année en
année. Les viedles feuilles Jaumffent 8c tombent, fans’ qu’if
en vienne de nouvelles à la place. Chaque bouton de gui
contient prefque toujours le gefrtie de trois branches, qufon
peut appercevoir par la diffection. Les bfanches dû gui n’ont
point cette affeftation à monter vers le c ie l, ijui eft propre
à prefque toutes les plantes. L e gui garde fes feuilles pendant
les hivers les plus rudes. Ibid. 1002. a. D e l'écorce , du b o is ,
des^ tiges & des feuiUes du gui. Diftinftion de cette plante en
mâle & femelle. M. Duhamel prétend que les pies de gui
de différens fexes ont chacun un port aflez diftéreht pour
au’on les puiffe diftinguer indépendamment de leüïs fruits
& de leurs fleurs. En quoi confifte cette différence. D efc r i-
ption des bbutons mâles 8c de leurs fleurs. Ibid. b. Defcri-
ption des boutons à f ru it , qui ne fe trouvent que für les
individus femelles : celle xle leurs fleurs 8c de leurs fruits.
Erreurs des anciens fu r le gui. Malpighi s’eft bien gardé dè
tomber dàns aucune de ces errehrs. C e t admirable obferva-
teur a décrit trés-exaftement la femence du g u i, fa germination
8c fes racines. Ibid. 1003. a.
G u i de chêne. Cérémonies à cette occafion. I. l o i .b . Vertus
qüc les druides attribuoient à cette plante. III. 286. b. Ufagcs
auxquels elle eft encore employée. Sa_rareté. Ibid. Maniéré
dont fe propage le gui. X IV . 945. a. Efpece de 'güi du Japon.
IX . 138 .L Voye{ C h ê n e .
G u i . ( Mêdec. 6» M a t. mêiics ) Les vertus que la fuperrtir
tion lui attribuoit, ne font plus reconnues aujourd’hui. Propriétés
que quelques auteurs continuent de lui afligner. V I I .
1003. a. Auteur anglqp qui attribue à cette plante IcS
vertus les plus merveilleufes ; cependant fon inutilité n’en
eft pas moins conftatée par l’expérience. Il y a même du dangef
à craindre dans l’ufage de fes baies. Remede à employer ,
lorfque, par imprudence , on en auroit fait ufage intérieurement.
Ibid. b.
G u i ou G u y , (M a r in e ) VII. 1003. b.
G u i , concurrent d’Arnoul à l’empire d’Occident. Suppl. I .
364. a , b.
G U JA C AN A . ( Bbtan. exotiq. ) Caraftercs de cet arbre.
Miller en compte trois efpeces. Les Anglois cultivent celui de
Virginie. V I I . 1003. b.
Gujacnna, e fp e c e de Ce gen re nommé e bancas.Suppl.\. 787.'
a. Voy tz G u a i a c a n a .
G t/ IA G E , G u id a g e où G u io n ag e , ( Jurifpr. ) d roit
dû en Languedoc par ceux qui habitent les côtes de la mer.
C e droit long-tems négligé, a été renouvelle en 1673. Autre
droit de guiage que les comtes de Touloufe levoient autrefois.
V IL 1003- v.
G U IAN A CO E S , ( Zoolog, ) quadrupède d’Amérique*'
Sa defeription. C e t animal a la vue perçante, 8c une extrême
agilité. Ufages que les Indiens font de fa peau. V IL
1004. a.
GUIAN È. ( Géogr.) Etendue de ce pays. On peut le divi-
fer en Guiane portugaife, françoife, hollandoife 8c efpagnole.
Defeription de chacun de ces pays. Nom que les Efpagnols
leur donnèrent dans les premiers tems de la découverte de
l’Amérique. VII. 1004. a.
Guiane. Defeription des habitans de ce pays. VIII. 347.
Voyez G u y a n e .
G U IA R E , (G é o g r .) voye{ G u r ia r e & liiez G u ià r ë . -■
G Ü lB , animal repréfenté vol. V I . des planch. Regne anim
G Ù ÏC C U R D IN I , ( Tranufco ) V I . 877. i .
G U IC H E , ( Philibert d e là ) feigneurde Chaumont.Suppl.
IV . 731* a-
G U ICH EN O N , ( Scm u tl) hiftorien. IX. 8 3 7 ...
G U ID A U X , guidalés, qui ri a it s , qu idiaus, hauts italiers ,
( P c ch c ) efpece de filet. Sa defeription. Maniéré de l'établir.
Détails for cette forte de pêche. Les bafcbes ne font autre
chofe que des guidaux à bas étaliers. La bafehe eft encore une
efpece de bout de quievre. Sa defeription 8c fon ufage. V U .
1 G u id a u x, voyez CHEVRE de guidaux. III. 34a. b. Guidaux
reprêfentés vol. VIII. des planch. Pec lie, pl. a 8c 9.
GUIDE. (A r tm i li t . ) On forme dans les armées des com-.
paenies de guides. C e que ditMorttecuculli for ces compagnies.
L’emploi de capitaine de guides demande beaucoup d’habileté
8c de pénétration. V I I . to o q .u .
G u id e , (M u f iq .) première partie qui entre dans une fugu.
& Deux folie s de guide, ; les grandes 8c
' “ S e T b e ^ ’arrangemcnt 8c de la divifion des guides. V ;
7°^’ * ' D O O O O o o o o o _