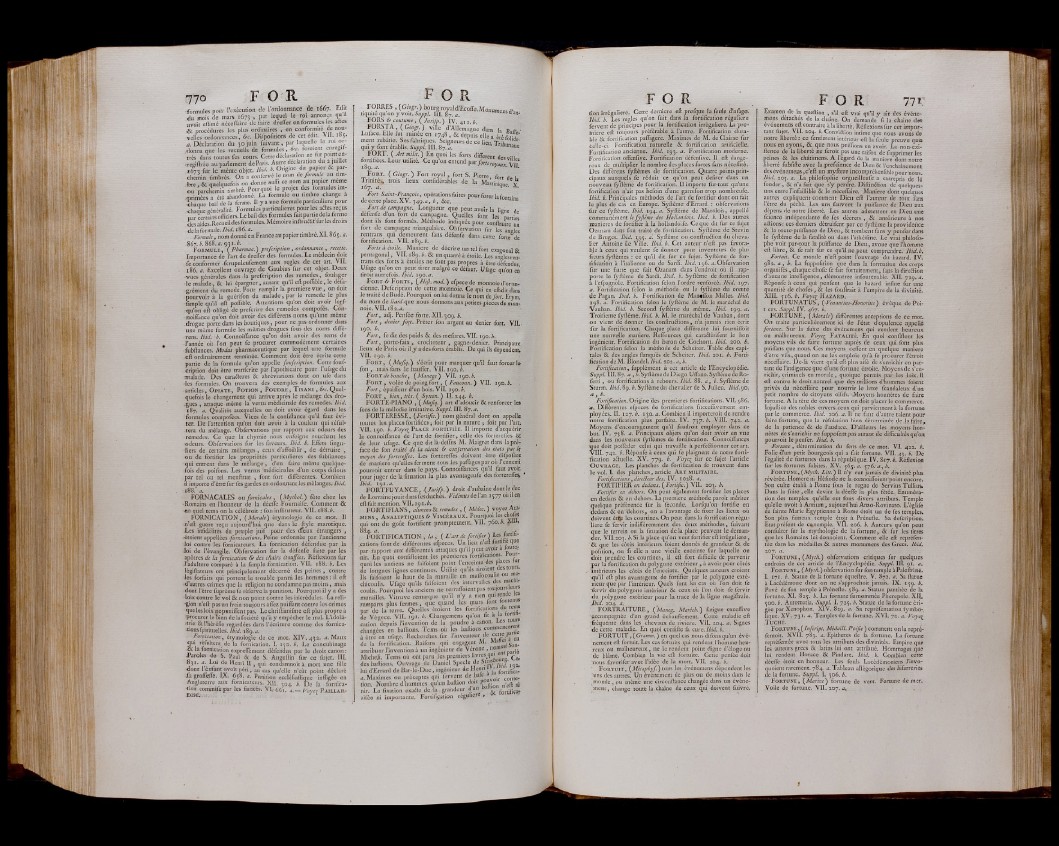
7 7 0 F O R
formules pour l'exécution de l'ordonnance de 1667. Edit
du mois do mars 1673 , par lequel le roi annonça qui!
avoit eilliné néceflaire de faire dreffer en formules les actes
& procédures les plus ordinaires , en conformité de nouvelles
ordonnances, (oc. Difpofuionsde cetédir. v i l . 185-
a. Déclaration du 30 juin fuivant, par laquelle le roi ordonna
que les recueils de formules, &c. icroicnt ct]re& l~
très dans toutes fes cours; Cette déclaration ne fut point -
.regiltréc au parlement de Paris. Autre déclaration du limiter
.673 fur le même objet. UU. A prtg.ne du papier & parchemin
timbrés. On a confervé Je nom t e f i r m i ' au m-
b r e , & quelquefois on donne suffi ce nom au papier même
ou parchemin timbré. Pourquoi le projet des formules imprimées
a été abandonné. La formule ou timbre change à
chaque bail de la ferme. Il y a une formule particulière pour
chaque généralité. Formules particulières pour les aétes reçus
par certains officiers. Le bail des formules fait partie de la ferme
des aides. Recueil des formules. Mémoire inftruétif fur les droits
delà formule. Ibid. 186. a.
Formule, nom donné en France au papier timbré. A l. 8Gç. a.
867. b. 868.a. 93»-é.
FORMULE, ( Pharmac. ) prefeription, ordonnance , recette.
Importance de l’art de dreffer des formules. Le médecin doit
,4e conformer -fcrupuleufement aux réglés de cet art. VII.
186. a. Excellent ouvrage de Gaubius fur cet objet. Deux
vues générales dans la prefeription des remedes | foulager
•le malade., & lui épargner, autant qu’il eft poflible, le défa-
grément du remede. Pour remplir la premiere v u e , on doit
pourvoir à la guérifon du malade, par le remede le plus
fimple qu’il eft poflible. Attentions qu’on doit avoir lo^f-
qu’on eft obligé de preferire des remedes compofés. Con-
noiffance qu’on doit avoir des différens noms qu’une même
.drogue porte dans les boutiques, pour ne.pas ordonner dans
une même formule les mêmes drogues fous des noms différens.
Ibid. b. Connoiffance qu’on doit avoir des tems de
l’année où l’on peut fe procurer commodément certaines
fubftances. Moius pharmaceutique par lequel une formule
eft ordinairement terminée. Comment doit être écrite cette
partie de la formule qu’on appelle foufeription. Cette fouf-
cription doit être tranicrite par l’apothicaire pour l’ufage du
¡malade. Des caraâeres & abréviations dont on ufe dans
•les formules. On trouvera des exemples de formules aux
articles, O p ia t e , Po t io n , Po u d r e , T isane, & c .Quelquefois
le changement qui arrive après le mélange des dro7
.gues , attaque même la vertu médicinale des remedes.'Ibid.
187. a. Qualités auxquelles on doit avoir égard dans les
formules composées. Vices de la conûftance qu’il faut éviter.
De l’attention qu’on doit avoir à la couleur qui réful-
tera du mélange. Obfervations par rapport aux odeurs des
remedes. Ce que la chymie nous enfeigne touchant les
■odeurs. Obfervations fur les faveurs. Ibid. b. Effets fingu-
licrs de certains mélanges ., ceux d’affoiblir, de détruire ,
ou de fortifier les propriétés particulières des fubftances
nui entrent dans le mélange, d’en faire même quelque-
ois des poifons. Les vertus 'médicinales d’un corps diflous
par tel ou tel mcnftrue , font fort différentes. Combien
il importe d’être fur fes gardes en ordonnant les mélanges. Ibid.
188. 4.
FORNAGALES ou forn ica la , (M y t lo l. ) fête chez les
fo
-Romains en l’honneur de la déeffe Fournaife. Comment 8c
en quel tems on la célébroit : fou inftituteur. VII. 188. b.
FO RN IC A T IO N , ( Morale) étymologie de ce mot. Il
n’eft guère reçu aujourd’hui que dans le ftyle marotique.
Les infidélités du peuple juif pour des dfeux étrangers ,
étoicnr appellécs •fornications. Peine ordonnée par l’ancienne
loi contre les fornicatcurs. La fornication défendue par la
loi de l’évangile. Observation fur la défenfe faite par les
apôtres de la fornication 6* des chairs étouffées. Réflexions fur
.l'adultéré comparé à la fimple fornication. VII. 188. b. Les
légiflateurs ont principalement décerné des peines, . contre
les forfaits qui portent le trouble parmi les nommes : il eft
••d’autres crimes que la religion ne condamne pas moins, mais
dont l’être fuprème fc réferve la punition. Pourquoi il y a des
-loix contre le vol 8c non point contre les incrédules. La reli-
•gioh n’eft pas un frein toujours affczpuiffant contre lcscrimcs
-que les loix nepuniffent pas. Le chriftianifmc eft plus propre à
procurer le bien de lafociété qu’à y empêcher le mal. L ’idolâtrie
8c l'héréfie regardées dans l’écriture comme des fornica-
tionsfpirituclles. Ibid. 189. a.
■Fornication, étymologie de ce mot. XIV. 43 a. a. Maux
qui rcfultent de la fornication. I. it o . b. Le concubinage
oc la fornication expreffèment défendus par le droit canon :
.Paroles de S. Paul & de S. Auguftin fur ce fujet. III.
831. a. Loi de Henri I I , qui condamnoit à mort une fille
•dont I infant «volt péri, au cas qu’elle n’eût point déclaré
gtoflefle. IX- 6ç8. a. Punition eccléfiaftique infligée en
Angleterre aux fornicatcurs. XII. 304. b. De la fornication
commife par les fiancés. VI. 6<St. a. — Voyez Pà il l a r -
m s r . • 1
F O R
“ v(vSrïCT“1f coirc-Mon“i”«“<iw FORS 6* coutume , ( Jurifp. ) IV. 411.4.
FO R S T A , ( Géogr. ) ville d’Allemagne dans la n rr
Luface. Elle fut ruinée en 1748, 8c depuis elle a été 2 *'
ment rebâtie. Ses fabriques. Seigneur« ™ 1:-.. -r. h *°hde-
q u ry font établis. SuppL III. 8y. a.
F O R T . ( A r t m û t .) En quoi les forts différent des villes
fortifiées. L eur uulité. C e qu on entend p u forts royaux.V II
» 9 - _ ■■■■■■■■
Foui-, ( Gtogr. ) Fort ro y a l, fort S. Pierre, f „ „ j . ,
Trinités, trois lieux confidérablcs de la Martinia y
167. a. ° ue* A?
Fort Saint-François t opérations foi tes pour forer la 111 •
de cetteplace.XV.340.fi, b , 8cc. fontaine
J J ori delf ampf Sne\ ^on8ueur que peut avoir la ligne de
defenfe d un fort de campagne. Quelles font les parties
dont ils font formés. Méthode indiquée pour conftmire un
fort de campagne triangulaire. Obfervation fur les anales
rentrans qui demeurent fans défenfe dans cette forte ,1.
fortification. V IL ,1189. b.
Forts à ito ik . Maniéré de décrire un tel fort cxaeonal &
pentagonal, VII. 18p. ê. & un quarré à étoile. Les anglesten-
trans des forts i étoiles ne font pas propres à être défendus
Ufage qu’on en peut tirer malgré ce délaut. Ufage qu’on en
tiroitautrefois. Ibid. 190.a .
■ Fo r t 6* Fo r t s , (_Hift.mod'. ) cfpeccde monnoied’or ancienne.
Dcfcription de cette monnoie. Ce qui en effdit dans
le traité de Budé. Pourquoi on lui donna le nom de fort. Etym.
du nom de liard que nous donnons aux petites pièces de monnoie.
VII. 182.4.
F o r t , adj. Penfée forte. XII.309. b.
F o r t , denier fo ft . Prêter fon argent au denier fort. VIL
190. b.
Fort y fc dit des poids 8c des mefurcs. VII. 190. b.
Fort y porte-faix, crocheteor, gagne-denier. Principaux
lieux de Paris où il y a des forts établis. D e qui ils dépendent»
VII. 190. b. v .
Fo r t , ( M u f t q . s’écrit pour marquer qu’il faut forcer le
fon , mais fans le liauffcr. "VII. 190. b.
Fo r t de bouche, ( Manege ) VII. 190. b.
Fo r t , volée de poing fort, ( Fauconn. ) VII. 190. b. ,
Fort y épai fleur d’un bois. V II. 190. b.
FORT , bien, tris. ( Synon. I II. 244. b.
FORTE-PIANO , ( Muftq. ) art d’adoucir 8c renforcer les
fons de la mélodie imitative. SuppL III. 87. a.
FORTERESSE, ( Fortifie.) nom général dont on appelle
toutes les places fortifiées, ioit par Ta nature , foit par l’art.
V II. 190. b. Voyc{ Place fortifiée. Il importe d’acquérir
la connoiffance de l’art de fortifier, celle des forterefles 8c
de leur ufage. C e que dit là-dcflùs M. Maigret dans la préface
de fon traité de la sûreté & conjervation des états par %
moyen des fortereffes. Les forterefles doivent être difpofées
de manière qu’elles ferment tous les paffages par où l’ennemi
pourroit entrer dans le pays. Connoiffances qu’il faut avoir
pour juger de lafituation la plus avantageufe des fortereffe* '
Ibid. 191.4. . . . JV»;
FO R T FU Y A N C E , ( Jurifp. ) droit d’aubaine dont je duc
de Lorraine jouit dans fes duchés. Vidimus de l’an 1377 où il en
eff fart mention. V II. 191. ¿. ! .
FO R T IF IAN S , alimens 8c remedes, ( Médec. ) voyez Atlr
MENS, A n a le pt iq u e s6* V is c é r au x . Pourquoi les¡choies
qui ont du goût fortifient promptement. VII. 700. b. ÿu L
FO R T IF IC A T IO N , l a , ( L ’art dt fortifier )
cations font de différentes efpcccs. U11 lieu n’eft forti qu
par rapport aux différentes attaques qu-’*iîli _pe—ut. .a.vmoiirf aà iloouutteerr
nir. Ep quoi confiftoient les premières fortifications, rour-
quoi les anciens ne faifoient point l’enceinte des p aces lur
de longues lignes continues. Utilité qu’ils tiroient.des tou .
Ils faifoient le haut de la muraille en maffocouhc ou ma7
chicoulis. Ufage qu’ils faifoient des intervalles des macmr
coulis. Pourquoi les anciens ne tcrraffoicnt pas toujours leurs
murailles. Vitruve remarque qu’il n’y a rien qui rende; 1«
remparts plus fermes, que quand h * murs font foutenui
par de la terre. Quelles étoient les fortifications du tems
de Végecc. V IL 191 .b . Changcmcns qu’on fit à h tort
cation depuis l’invention de la poudre à canon. Les to
changées en baftions. Tems où les baftions c o m m e i ..
à être en ufage. Recherches fur l’inventeur tic CQ
.dé la fortification. Raifons qui engaeent M. ^
attribuer l’invention à un ingénieur de Vérone, nom ^
MicheJi. Tems où ont paru les premiers hvrcs#qm _
des baftions. Ouvrage de Daniel Spcclc de btra ^
lui d’Errard de Bar-le-Duc, ingénieur de Henri ^ fortifica-
ast . MoMvaiixni^mse sn uo un rpécréecnetpcst eus nqi ufie rfverevnetn dt ed bea 1i e < ' „„...ation.
Nombre d'hommes qu’un baftion doit P0“ ^ " nj
nir. La fixation exaéle de la grandeur du» ■ fortjfiçajt
aifée ni importante. Fortification rcgulie »
F O R F O R 77*
tion irrégulière. Cette derniere eft prefque la feirie d’nfagei
Ibid. b. Les regies qu’on fuit dans la fortificatiou régulière
fervent de principes pour la fortification irrégulière. La 'pre-
tnierc eft toujours préférable à l’autre. Fortification dura;
blc 8c fortification, paffagerc. Maximes de M. de Clairac fur
Celle-ci. Fortification naturelle 8c fortification artificielle.
Fortification ancienne. Ibid. 193. a. Fortification moderne.
Fortification offcnftve. Fortification défenftvc. Il eft dangereux
de multiplier le nombre des places fortes fans néceflité.
Des différens fyftêmes de fortification. Quatre points principaux
auxquels fe réduit ce qu’on peut defirer dans un
nouveau fyftêmc de fortification. Il importe fur-tout qu’une
fortification n’ait pas befoin d’une garnifon trop nômbrcufe.
Ibid. b. Principales médiodes de l’art de fortifier dont on fait
le plus de cas en Europe. Syftêmc cPErrard : obfervations
fur ce fyftêmc. Ibid. 194.4. Syftêmc de Marolois, appelle
communément le fyjléme des Hollandois. Ibid. b. Des autres
manières de fortifier à la hollandoife. Ce que dit fur ce fujet
Ozanam dans fon traité de fortification. Syftéme de Stevin
de Bruges. Ibid. 59*. d. Syftéme ou conflruâion du chevalier
Antoine Se Ville. Ibid. b. Ce t auteur .n’eft pas favorable
à ceux qui veulent fe donner pour inventeurs de plu-
ficurs fyftêmes : ce qu’il dit fur ce fujet. Syftéme de fortification
à l’italienne ou de Sardi. Ibid. 196. a. Obfervation
fur une faute que fait Ozanam dans l’endroit où il rapporte
le fyftêmc de Sardi. Ibid. b. Syftêmc de fortification
à l’efpagnole. Fortification felon l’ordre renforcé. Ibid. 197.
4. Fortification felon la méthode ou le fyftême du comte
tie Pagan. Ibid. b. Fortification de Maneffon Mallet. Ibid.
198. 4. Fortification félon le fyftêmc de M. le maréchal de
Vauban. Ibid. b. Second fyftêmc du même. Ibid. 199. a.
Troifiemc fyftême.Ibid. b. M. le maréchal de Vauban, dont
on vient de donner les conftruélions, n’a jamais rien écrit
fur la fortification. Chaque place différente lui fourniffoit
une nouvelle maniéré. Rcffources qui caraélérifent le bon’
ingénieur. Fortification du baron de Coehorn. Ibid. 200. b.
Fortification felon la méthode de Scheiter. Table des capitales
8c des angles flanqués de Scheiter. Ibid. 201. b. Fortification
de M. Slondcl. Ibid. 202. a, b.
Fortification, fupplémcnt à cet article de l’Encyclopédie.
SuppL III. 87. 4 , b. Syftêmc de Diego Uffano. Syftéme de Ro-
fetti, ou fortifications à rebours. Ibid. 88. a , b. Syftéme de
Sturm. Ibid.89. b. Syftéme du chevalier de S. Julien. Ibid. 90.
a , b.
Fortification. Origine des premieres fortifications. V II. 986.
Vz. Différentes efpcces de fortifications fucceflivemcnt employées.
II. 127. b. 130.4. Combien il importeroit de rendre
notre fortification plus parfaite. IV. 737. b. VIII. 742. a.
Moyens d’encouragement qu’il faudrait employer dans ce
but. IV. 738. 4. Principaux objets qu’on doit avoir en vue
dans les nouveaux fyftêmes de fortification. Connoiffances
nue doit pofféder celui qui travaille à perfeélionner cet art.
VIII. 742. b. Réponfe à ceux qui fe plaignent de notre fortification
a&uellc. X V . 779. b. Wj/M f i l ce fojet l’article
O u vr ag e . Les planches de fortification fc trouvent dans
le vol. I. des planches, article A rt militaire.
Fortifications , dire fleur des. IV. 1028. a.
FORTIFIER en dedans. ( Fortifie. ) VII. 203. b.
Fortifier en dehors. On peut également fortifier les places
en dedans & en dehors. La premiere méthode paraît mériter
uclque préférence fur la fécondé. Lorfqu’on fortifie en
edans & cn"dchors, on a l’avantage de fixer les lieux où
doivent êtlfc les courtines. On peut dans la fortification régulière
fe fervir indifféremment des deux méthodes, fuivant 3ue le terrein ou la fituation de la place peuvent le deman-
cr. VII.203. ¿.Si la place qu’on veut fortifier eft irrégulière,
8c que les côtés intérieurs foient donnés de grandeur 8c de
pofition, ou fi elle a une vieille enceinte fur laquelle on
doit prendre les courtines, il eft fort difficile de parvenir
par la fortification du polygone extérieur, à avoir pour côtés
intérieurs les côtés de l’enceinte. Quelques auteurs croient
qu’il eft plus avantageux de fortifier par le polygone extérieur
que par l’intérieur. Quels font les cas où l’on doit fe
fervir du polygone intérieur 8c ceux où l’on doit fe fervir
du polygone extérieur pour la trace de la ligne magiftrale.
Ibid. 204. 4.
FORTR AITURE , (Maneg. Maréch.) fatigue cxcoflîve
accompagnée d’un grand échauffcmcnt. Cette maladie eft
'fréquente dans les chevaux de riviere. VII. 204. a. Signes
de cette maladie. En quoi confifte fa cure. Ibid. b.
FO R TU IT , ( Gramrn. ) en quel cas nous difons qu’un événement
eft fortuit. Les cas fortuits qui rendent l’homme heureux
ou malheureux, ne le rendent point digne d’éloge ou
de blâme. Combien la vie eft fortuite. Cette penfée doit
’nous favorifer avec l’idée de la mort. VII. 204. b.
• Fo r tu it , ( Métaphyf. ) tous les événemens dépendent les
tins des autres. Un événement de plus ou de moins dans le
’mondé, ou même une circonftance changée dans un événement,
change toute la chaîne de ceux qui doivent fuivre.
Examen de la queftion , s’il eft vrai qo’il y ait des événemens
détachés de la chaîne. On demande fi la chaîne dos
événemens eft contraire à la liberté. Réflexions fur cet important
fujet. VII. 204. b. Conyiâion intime que nous avons de
notre liberté : ce ientiment intérieur eft la feule preuve qua
nous en ayons, 8c que nous puîflions en avoir. La non-exi-
ftence de la liberté ne ferait pas une raifon de fupprimer les
peines 8c les châtimens. A l’égard de la manière dont notre
liberté fubfifte avec la prefcience <le Dieu 8c l’cnchaîncmenc
des événemens, c’eft un myftere incompréhcnfiblc pour nous.
Ibid. 205.4. La philofophie orgueilleufe a entrepris de lé
fonder , 8c n’a fait que s’y perdre. Diftinâion de quelques-
uns entre l’infaillible 8c le néceflaire. Maniéré dont quelques
autres expliquent comment Dieu eft l’auteur de tout fans
l’être du péché. Les uns fauvent la puiflànce de Dieu aux
dépens de notre liberté. Les autres admettent en Dieu une
fcience indépendante de fes décrets , 8c antérieure à nos
allions: ces derniers détruifentpar ce fyftême laprovidonce
8c la toute-puiffance de D ieu, 8c tombent fans y penfer dans
le fyftême de la fatalité ou dans l’athéifme. Le vrai philofor
phe voit par-tout lapuiffance de D ieu, avoue que l’homme
eft libre, 8c fe tait fur ce qu’il ne peut comprendre. Ibid.b.
Fortuit. Ce monde n’eft point l’ouvrage du hazard. IV.
982. 4 , b. La fuppofition que dans la formation des corps
organifés , chaque chofe fe fait fortuitement, fans la direélion
d’aucune intelligence, démontrée infoutcnable. XII. 729. a.
Réponfe à ceux qui penfent que le hazard influe fur une
quantité de chofes, & les fouftrait à l’empire de la divinité.
AlII. c i 6. ‘b. Voye^ H a z a rd .
FO R TU N A TUS, :nantius-Honorius ) évêque de Poit
ers. Suppl. IV. 467. b.
FO R TU N E, ( Morale) différentes acceptions de ce mot.
O11 traite particulièrement ici de l’état d’opulence appcllé
fortune. Sur la fuite des événemens qui rendent heureux
ou malheureux. Voyez Fatalité. En quoi confiftent les
moyens vils de faire fortune auprès de ceux qui font plus
puiffans que nous. Ces moyens ccffcnt en quelque maniéré
d’être vils, quand on ne les emploie qu’à fe procurer l’étroit
néccTTaire. De-là vient qu’il eft plus aifé de s’enrichir en partant
de l’indigence que d une fortune étroite. Moyens de s’enr
richir, criminels en morale, quoique permis par les loix. Il
eft contre le droit naturel que des millions d'hommes foient
privés du néceflaire pour nourrir le luxe fcandalcux d'un
petit nombre de citoyens oififs. \Moyens honnêtes de faire
fortune. A la tête de ces moyens on doit placer le commerce,
lnjuftice des nobles envers.ceux qui parviennent à la fortune
parle commerce. Ibid. 206.4. Il ne-faut d’autre talent pour
faire fortune, que la réfolution bien déterminée de la faire,
de la patience & de i ’audacc.. D ’ailleurs les moyens honnêtes
de s’enrichir ne fuppofent.pas autant de difficultés qu’on
pourroit le penfer. Ibid. b.
Fortune, détermination du fens de ce mot. VI. 422. b.
Folie d’un petit bourgeois qui a fait fortune. VII. 43. b. De
l’égalité de fortunes dans la république. IV. 8 ij.-b . Réflexion
fur les fortunes fubites. XV , çd.ç. a. ç y 6 :a , b.
Fortune, (Myth. Lit t. ) Il n’y eut jamais de divinité plus
révérée. Homère ni Héfiode ne la connoiffoientpoint encore.
Son culte établi à Rome fous le regne de Servius Tullius.
Dans la fuite, elle devint la déeffe la plus fêtée.. Enumération
des temples qu’elle eut fous divers attributs. Temple
qu’elle avoit à Antium, aujourd’hui Anzo-Rovinato. L’églife
de fainte Marie Egyptienne à Rome étoit un de fes ten^ples.
Son plus fameux temple étoit à Préneftc. Sa defeription.
Etat préfent de ce» temple. VÏ1. 206. b. Auteurs qu’on peut
confulter fur la mythologie de la fortune, 8c fur les titros
que les Romains lui donnoient. Comment elle eft repréfen-
tée dans les médailles 8c autres monumens des Grecs. Ibid.
207. 4.
Fo rtu ne , (Afyt/i.) obfervations critiques fur quelques
endroits de cet article de l’Encyclopédie. SuppL III. 91. a.
F ortune, (Myth.) obfervation fur fon tomplc à Paleftrine.
I. 171. b. Statue de la fortune équeftre. V. 872. 4. Sa ftatue
à Lacédémone dont on ne s’approchoit jamais. IX. 159. b.
Pavé de fon temple à Préneftc. 589. a. Statue panthéc de la
fortune. XI. 825. b. La fortune furnommée Pherepole. XIL
300. b. Automatia. SuppL I. 725. b. Statue de la fortune érigée
par Xcnophon. XIV. 820. 4. Sa représentation Symbolique.
XV. 731. 4. Temples-de là fortune. XVI. 7a. 4. Voye^
.Tuçhé.
Fortune , ( Infcript. Médaill. Poéfie ) comment on la repré-
fentoit. XVII. 783. 4. Epithetes de la fortune. La fortune
repïéfcntée avec tous les attributs des divinités. Empire que
les auteurs grecs & latins lui ont attribué. Hommages que
lui rendent Horace 8c Pindare. Ibid. b. Combien cette
déeffe étoit en honneur. Les feuls Lacédémoniens l’invo-
quoient rarement. 784. a. Tableau allégorique des bifarreries
de la fortune. SuppL I. 306. ¿,
Fortune, ( Marine) fortune de vent. Fortune de mer.
Voile de fortune. V II. 207.4.