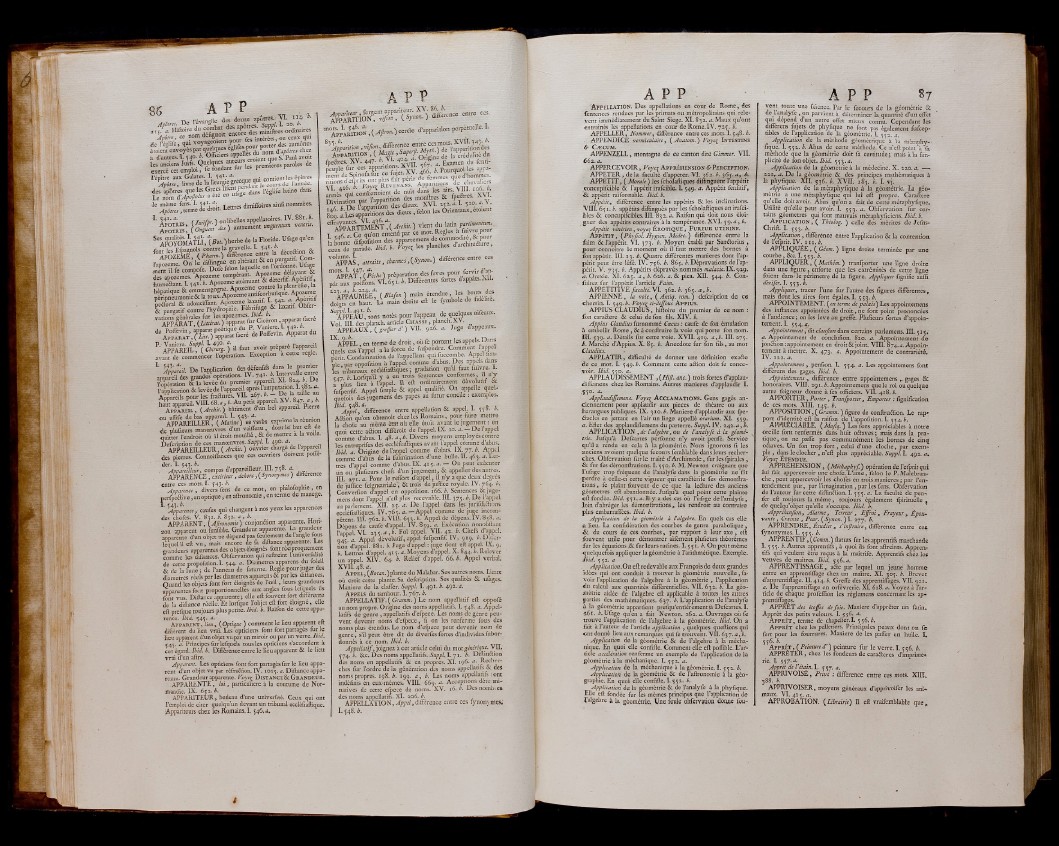
86 A P P
& a , „ De Tévangîle des doute ^ôtres.'"^. 114 .'*•
P i ï æ S S t a ç î S ë P r e - e - s paroles de
l’épitre aux Galates. I. S.41; “: c0„rient!es épitres
Apilrc, livre de la liturgie gre_q,J 3 [|t ooms de l'année.
■des apôtres que les Greies Bien p pégUie latine dans
Le nom A'ApoJIolus a été en ufage sa B
k | B | A d r o i t . Lettres dimiflbires ainftnommées.
-I. Ç41. a. . . „ libelles appellatoires. IV. 881. A
A p o S S ; [ Onguent des ) autrement unguentum venens.
S<SA ? 0 Y 0 1 ^ f f i , W . ) h e r b e de la Floride. Ufage qu’en
n P O Z & l F w f S e n r e enlrt V décoffion &
l u f e j H H H S K w
s f e S Æ - i S V î — t e ■HHnMÉiife'te* P'A P M M l Î 7 ( c Æ î u f a u . avoir préparé l'appareil
ava f d e commencer l'opération. Exception a cette réglé.
f i Avvârk De l'application des défenfifs dans le premier
ap^neti des grand^opêrations. IV. ¡ ¡ ¡ j g M g f i »
l’opération & la levée du premier appareil. XI. 824. 0. iJe
l’application de levée de l’appareU aprwlampumnon.
Appareils-pour les fraftures. VU. 2,67. •
haut aDDareU. VIII. 68.4, A. Au petit appareil. XV. °47- ? , p.
Appareil , (Archit.) bâtiment d’un bel appareil. Pierre
ou aflife de bas appareil. I. 5 4 3 . a . , , W Æ
APPAREILLER, (.Marine) ceverbe exprimelaréumon
•de plufieurs manoeuvres d’un vaiffeau, dont le but eft de
quitter l’endroit où il étoitmouiUê, & de mettre à la voile.
Defcription de ces manoeuvres. Suppl. I. 49°- f v.nnorp{]
APPAREILLEUR, ( Archit. ) ouvrier chargé de 1 appareil
des pierres. Connoiffances que ces ouvriers doivent pofféÜIÂppamÙeur,
compas d’appareilleür. HI. 758. |f
APPARENCE, extérieur, d eh ors , (Synonymes) difterence
entre ces mots. I. Ç43. A .
Apparence , divers fens de ce mot, en philofophie , en
perfpeftive, en optique, en aftronomie, en terme de manege.
' ^Apparence, caufes qui changent à nosyeuxles apparences
des chofes. V. 831. A. 832. a , b. g .
APPARENT, (Aftronomie) conjonéhon apparente. Horizon
apparent ou lenfible. Grandeur apparente. La grandeur
apparente d’un objet ne dépend pas feulement de 1 angle fous
lequel il eft v u , mais encore de fa diftance apparente. Les
grandeurs apparentes des objets éloignés font réciproquement
comme les diftances. Obfervation quireftreint l’uniyerfahté
de cette propofition. I. 544- Diamètres apparens du foleil
& de la lune ; de l’anneau de faturne. Réglé pour juger des
diamètres réels par les diamètres apparens & par les diitances.
Quand les objets font fort éloignés de l’oe il, leurs grandeurs
apparentes font proportionnelles aux angles fous lelquels ils
fozit vus. Diftance apparente; elle eft fouventfort différente
de la diftance réelle. Et lorfque l’objet eft fort éloigné, elle
eft prefque toujours plus petite. Ibid. b. Raifon de cette apparence.
Ibid. Ç4Ç. a. .
Apparent , lieu, (Optique ) comment le lieu apparent elt
différent du lieu vrai. Les opticiens font fort partagés fur le
lieu apparent d’un objet vu par un miroir ou par un verre. Ibid.
5 4 5 . a. Principes fur lefquels to u s les opticiens s’accordent à
cet égatd. fé/d. b. Différence entre le lieu apparent & le lieu
vrai d’un aftre.
Apparent. Les opticiens font fort partagés fur le lieu apparent
d’un objet vu par réfraôion. I v . ioiç. a. Diftance apparente.
Grandeur apparente. Voye^ D istance & G randeur.
APPARENTE, loi , particulière à la coutume de Normandie.
IX. 6ça. b.
APPARITEUR, bedeau d’une univerfité. Ceux qui ont
l ’emploi de citer quelqu’un devant un tribunal eccléfiaftique.
Appariteurs chez les Romains. 1. 546. a.
A P V
cn,re ccs'
, ( Aflrotu) cercle d'apparition perpétuelle. I.
Apparition , ( Mam, Suptrfi.M^) ne du
■fpeilres. XV. 447- 4x V l i 567. a. Examen du fcntipeuple
fur Ç« /PPjm 1 H H 66. j. Pourquoi les appa-
V0AW À S^ttraUs. chômes.(Synon.) différence entre ces
APPA5r 7 ( Pêche) préparation desfeves pour fervir d ap*
pâcaux poiffons. V Î.651 t. Différentes fortes d appas. XII.
2îip P A U M tk t (B h fo n ) ntÎiS étendue, les bo"'?
doigts en haut. La main droite eft le fymbole de fidélité.
S“FÎW Ï $ V , tons notés pour l’appeau de quelques oifoaux.
Vol. III. des planch.article C h a s s e , planch.XV.
APPEAUX, ( greffier d ') VII. 9=6. a. Juge d appeaux.
K A É L , en terme de droit, où fo portent les appels. Dans
quels cas l’appel a la force de fufpendre. Comment 1 appel
périt. Condamnation de l’appellam qmfoccombe.
pie, par oppofition à l’appel comme d abus. Des appels dans
les tribunaux ecdèfiaftiques ; gradation qu il finit fuivre.1.
.47. b. Lorfqu’il y a eu trois fentences conformes, il n y
a plus beu à l’appel. E eft ordinairement dèvolutif Sc
foipenfif. Appel fimple & appel qualifié. On appelle quel-
quefois des jugemens des papes au futur concile : exemples.
Appel, différence entre appellation & appel. I. çç8. b.
Aétion qu’on obtenoit chez les Romains, pour faire mettre
la chofe au même état où elle étoit avant le jugement : en
quoi cette aétion différoit de l’appel.IX. 20.4.— De 1 appel
comme d’abus. I. 48. I I I Divers moyens employés contie
les entreprifes des ecdèfiaftiques avant 1 appel comme d abus.
Ibid. a. Origine de l’appel comme d’abus. IX. 77. b. Appel
comme d’abus de la fulmination d’une bulle. II. 463. a. Lettres
d’appel comme d’abus. IX. 41 ç. a. On peut exccuter
un ou plufieurs chefs d’un jugement, & appeller des autres.
III. 271. a. Pour le reffort Rappel, il n’y a que deux degrés
de juftice feigneuriale"; & trois de juftice royale. IV. 764. b.
i Converfton oappel en oppofirion. 166. b. Sentences & jugemens
doijt l’appel n’eft plus recevable. III. 375. b. De l’appel
au parlement. XII. 25. a. De l’appel dans les jurifdiftions
ecdèfiaftiques. IV. 765. a. — Appel comme de juge incom^
pétent. III. 762. b. V lli. 653. b. Appel de dépens. IV.8ç8. a.
Dépens de caufe d’appel. IV. 859. a. Exécution nonobllant
l’appel. V I. 23 ç .a ,b . Fol appel. VII. 42. b. Chefs d appel.
o4V. a. Appel dèvolutif, appel fufpenfif. IV. 919. b. Déicr-
tion d’appel. 881. 1 Juge d’appel : juge dont eft appel. IX. 9.
b. Lettres d’appel. 41 ç. a. Moyens d’appel. X. 844. b. Relever
un appel. XIV. 64. b. Relief d’appel. 66. b. Appel verbal.
XVII. 48. a.
A p p e l, (Botan.)plante du Malabar. Ses autres noms. Lieux
où croît cette plante. Sa defcription. Ses qualités & ufages.
Maniéré de la claffer. Suppl. I. 491 .b. 492.a.
Ap p e ls du tambour. 1. 767. b.
APPELLATIF. ( Gramm. ) Le nom appellatif eft oppofé
au nom propre. Origine des noms appellatifs. I. 548. a. Appel-
latift de genre , appellatifs d’efpece. Les noms de genre peuvent
devenir noms d’efpece, fi on les renferme fous des
noms plus étehdus. Le nom d’efpece peut devenir nom de
genre , s’il peut être dit de diverfes fortes d’individus fubor-
donnés à ce nom. Ibid. b.
Appellatif, joignez à cet article celui du mot générique. VIT.
574. b. & c. Des noms appellatifs. Suppl. 1. 71. b. Diftinélion
des noms en appellatifs & en propres. XI. 196.
ches fur l’ordre de la génération des noms appellatifs & des
noms propres. 198. b. 199. a , b. Les noms appellatifs îont
indéfinis ên eux-mêmes; VIII. 669. a. Acceptions détci mi-
natives de cette efoece de noms. XV. 16. b. Des nombies
des noms appellatifs. XI. 206. b.
APPELLATION, Appel, différence entre ces fynon) mes;
I. 548. b.
t
A P P A P P 87
A p p e l l a t i o n . Des.appellations en coùr de Rome, des
fentences rendues par les primats ou métropolitains qui relèvent
immédiatement du Saint Siege. XI. 832. a. Maux qu’ont
entraînés les appellations en cour de Rome. IV. 72Ç. b.
APPELLER, Nommer, différence entre ces mots.I. Ç48. b.
. APPENDICE vermicidairc, (Anatom.) Voyc? In te s t in s
& Cæcum.
APPENZELL, montagne de ce canton dite Gimmor. VII.
662. a.
APPERCEVOIR, Voyc{ A p p ré h en s io n & P e r c e p t io n .
APPETER, de la faculté d’appeter. VI. 362. b. 36ç. a, b.
APPÉTIT, ( Morale) les fcholaftiques distinguent l’appétit
concupifcible & l’appétit irafcible. 1.549. a. Appétit fenfitif,
& appétit raifonnable. Ibid. b.
‘ Appétit, différence entre les appétits & les inclinations.
VÜI. 6 çi. b. appétits distingués par les fcholaftiques en irafei-
bles & concupifcibles. III. 832. a. Raifon qui doit nous éloigner
des appétits contraires à la tempérance. XVI. ç 9. , b.
Appétit vénérien, voyeç ÉROTIQUE, FUREUR UTÉRINE.
A p p é t i t ¡ (Phyfiol. Hygien. Médec. ) différence entre la
faim & l’appétit. VI. 373. b. Moyen établi par Sanétorius ,
pour connoître le moment où il faut mettre des bornes à
fon appétit. III. 13. b. Quatre différentes maniérés dont l’appétit
peut être léfé. IV. 756. b. 86ç. A Dépravations de l’appétit.
V. 73 ç. b. Appétits dépravés nommés malade. IX. 929.
a. Orexie. XI. 625. a , b. 626. a. & pica. XII. Ç44. b. Con-
fultez fur l’appétit l’article Faim.
APPÉTITIVE faculté. VI. 362. b. 36*. a , b.
APPIENNE, la voie, (Antiq. rom.) defcription de ce
chemin. I. 549. b. Voyez ci-dejfous Appius.
APPIUS CLAUDIUS, hiftoire du premier de ce nom :
fon caraétere & celui de fon fils. XIV. b.
Appius Claudius furnommé Ccecus : caufe de fon émulation
à embellir Rome, & à construire la voie qui porte fon nom.
Hi. <39. a. Détails fur cette voie. XVII. 419. a,b. III. 275.
b. Marché d’Appius. X. 8ç. b. Anecdote fur fon fils, au mot
Claudius. ___,.
APPLATIR, difficulté de donner une définition exaéte
de ce mot. I. Ç49. b. Comment cette aétion doit fe concevoir.
Ibid. çço. a.
APPLAUDISSEMENT, (Hift. anc. ) trois fortes d’applau-
diffemens chez les Romains. Autres maniérés d’applaudir I.
.S5°- ^
Applaudijfemens. Voyez A c c lam a t io n s . Gens gagés anciennement
pour applaudir aux pièces de théâtre - ou- aux
harangues publiques. IX. 310. b. Maniéré d’applaudir aux fpe-
étaclcs en jettant en l’air un linge appellé orarium. XI. 559.
a. Effet des applaudiffemens du parterre. Suppl.IV. 242.a, b.
APPLICATION , de l’algebre, ou de Vanalyfe à la géomé- ,
trie. Jufqu’à Defcartes perfonne n’y avoit penfé. Service
qu’il a rendu en cela à la géométrie. Nous ignorons fi les
anciens avoient quelque fecours feinblable dans leurs recherches.
Obfervation fur le traité d’Archimede, fur les ipirales,
Sc fur fes démonftrations. I. ç ço. b. M. Newton craignant que
l’ufage trop fréquent de l’analyfe dans la géométrie 11e fît
•perdre à celle-ci cette vigueur qui caraétériië fes démonftrations
, fe plaint fouvent de ce que la leâure des anciens
.géomètres eft abandonnée. Jufqu’à quel point cette plainte
eft fondée. Ibid. ç ç i. a. Il-y a des cas où l’ufage de l’analyfe,
loin d’abréger les démonftrations, les rendroit au contraire
plus embarraffées. Ibid. b.
Application de la géométrie à F algèbre. En quels cas elle
a lieu. La confidération des courbes de genre parabolique,
& du cours de ces courbes, par rapport à leur ax e , eft
fouvent utile pour démontrer aifément plufieurs théorèmes
fur les éouations Sc fur leurs racines. I. ç 51. b. On peut même
quelquefois appliquer la géométrie à l’arithmétique. Exemple.
Ibid. çç2. a
Application. On eft redevable aux François de deux grandes
idées qui ont conduit à trouver la géométrie nouvelle, fa-
voir l’application de i’algebre à la géométrie , l’application
du calcul aux quantités différentielles. VII. 632. A La géométrie
aidée de l’algebre eft applicable à toutes les autres
parties des mathématiques. 637. A L’application de l’analyfe
à la géométrie appartient prefqu’entiérementtà Defcartes. I.
261. A Ufage qu’en a fait Newton. 262. a. Ouvrages où fe
trouve l’application de l’algebre à la géométrie. Ibid. On a
fait à l’auteur de l’article application , quelques queftions qui
ent donné lieu aux remarques qui fe trouvent. VU. 637. a, A
| Application de la géométrie & de l’algebre à la mécha-
nique. En quoi elle confifte. Comment elle eft poflible. L’article
accélération renferme un exemple de l’application de la
géométrie à la méchanique. I. 352. a.
Application de la méchanique à la géométrie. I. çça. A
Application de la géométrie & de I’aftronomie à la géographie.
En quoi elle confifte. I. ç<2. A
Application de la géométrie & ae l’analyfe à la phyfique.
Elle eft fondée fur les mêmes principes que l’application de
i ’algebre à la géométrie, Une feule obfervsition donne fouvent
toute une fcicnce. Par le fecours de la géométrie &
• anmyfe, on parvient a déterminer la quantité d’un effet
SHl, Pe,l . . autre effet mieux connu. Cependant les
duierens fujets de^ phyfique né font pas également fufeep-
tibles de 1 application de la géométrie. I. ççi.
Application de la méthode géométrique à la mètaphy--
fichue. I. çça. A Abus de cette méthode. Ce n’eft point S fa
méthode que la géométrie doit fa certitude; mais à la fim-
plicité de fon objet. Ibid. ÇÇ3. a.
Application de la géométrie à la médecine. X. 220. a, — .
222r a. De la géométrie & des principes mathématiques à
la phyfique. XII. 336. A XVII. 183. A I. vj.
Application de la métaphyfique à la géométrie. La géométrie
a une métaphyfique qui lui eft propre. Caraaere
Îu’elle doit avoir. Abus qu’on a fait de cette métaphyfique»
Utilité qu’elle peut avoir. I. 533. a. Obfervation fur certains
géomètres qui font mauvais métaphyficiens. Ibid. A
A p p l i c a t io n , ( 'Théolog. ) celle des mérites de Jefas-
Chrift. I. ÇÇ3. A
Application, différence entre l’application & la contention
de l’eforit. IV. m . A
APPLIQUÉE, ( Géom. ) ligne droite terminée par une
courbe, &c. I. ç 5 3. A
APPLIQUER, (Mathém.) tranfporter une ligne droite
dans une figure, enforte que les extrémités de cette ligne
foient dans' le périmètre de la figure. Appliquer fignifie aufli
divifer. I. 553. A
Appliquer, tracer l’une fur l’autre des figures différentes,
mais dont les aires font égales. I. 553. A
APPOINTEMENT. (en terme de palais) Les appointemens>
des inftances appointées de droit, ne font point prononcées
à l’audience; on les leve au greffe. Plufieurs fortes d’appoin-
tement. I. 554. a.
Appointernent, dit claufion dans certains parlemens. III. ç 1 ç;
a. Appointernent de conclufion. 820. a. Appointernent de
jonétion : appointernent en droit & joint. VIII. 874.4. Appoin*
tement à mettre. X. 473. a. Appointernent de contrariété»
IV. 122. a.
# Appointemens , penfion. I. 554. a. Les appointemens font
différens des gages. Ibid. b.
Appointemens, différence entre appointemens ^ gages &
honoraires. VIII. 291. A Appointemens que le roi ou quelque
autre feigneur donne à fes officiers. V il. 418. A
APPORTER, Porter , Tranfporter, Emporter : lignification
de ces mots. XIII. 145. A
APPOSITION, ( Gramm. ) figure de conftru&ion. Le rap»
port d’identité eft la raifon de l’appofition. I. 534. A
APPRÉCIABLE. ( Mujîq. ) Les ions appréciables à notre
oreille font renfermés dans huit oftaves ; mais dans la pratique
, on ne paffe pas communément les bornes de cinq
octaves. Un fon trop fort, celui d’une cloche, par exemp
le, dans le clocher, n’eft plus appréciable. Suppl. I. 402.4«
VoyezÉTEm>VE.
APPRÉHENSION, (Méthapkyf.) opérationdel’eijjritqui
lui fait appercevoir une choie. L’ame, félon le P. Malebran-
che, peut appercevoir les chofos en trois maniérés ; par l ’entendement
pur, par l’imagination, par les fens. Obfervation
de l’auteur fur cette diftinoion. I. ç ç ç . L a faculté de pent
fer eft toujours la même, toujours également fpirituelle .
de quelqu’objet qu’elle s’occupe. Ibid. A
Appréhenfion, Alarme, Terreur , Effroi , Frayeur , Épou»
vante , Crainte , Peur. ( Synon. ) I. 277. b.
APPRENDRE, Étudier , s'inftruire, différence entre cet
fynonymes. I. ççç. A
APPRENTIF, (Comm.) ftatuts furies apprentifs marchands
I. ççç. A Autres apprentifs, à quoi ils font aftreints. Apprentifs
qui veulent être reçus à la maîtrife. Apprentifs chez les
veuves de maîtres. Ibid. çç6. a.
APPRENTISSAGE, aéte par lequel un jeune homme
entre en apprenriflage chez un maître. XI. jo ç . A Brevet
d’apprenriflage. II. 414. A Greffe des apprentiifages. VII. 921.
a. De l’apprentiffage en orfèvrerie. XL 628.4. Voyez à l’article
de chaque profeffion les réglemens concernant les ap-
prentiffages.
APPRÊT des étoffes de foie. Maniéré d’apprêter un fatin.
Apprêt des petits velours. I. çç6. a.
A p p r ê t , terme de chapelier.I. çç6. A
A p p r ê t chez les pelletiers. Principales peaux dont on fe
fort pour les fourrures. Maniéré de les paffer en huile. I.
çç6. A
A p p r ê t , (Peintured’ ) peinture fur le verre. I. çç6. A
APPRÊTER, chez les fondeurs de cara&eres d’imprimer
rie. I. ç Ç7- a.
Apprêt de Vétain. I. ç Ç7. 4.
APPRIVOISÉ, Privé : différence entre ces mots. XIII«
388. A
APPRIVOISER, moyens généraux d’apprivoifer les animaux.
VI. 41 ç. 4.
APPROBATION. (Librairie) H eft vraifemblable que»