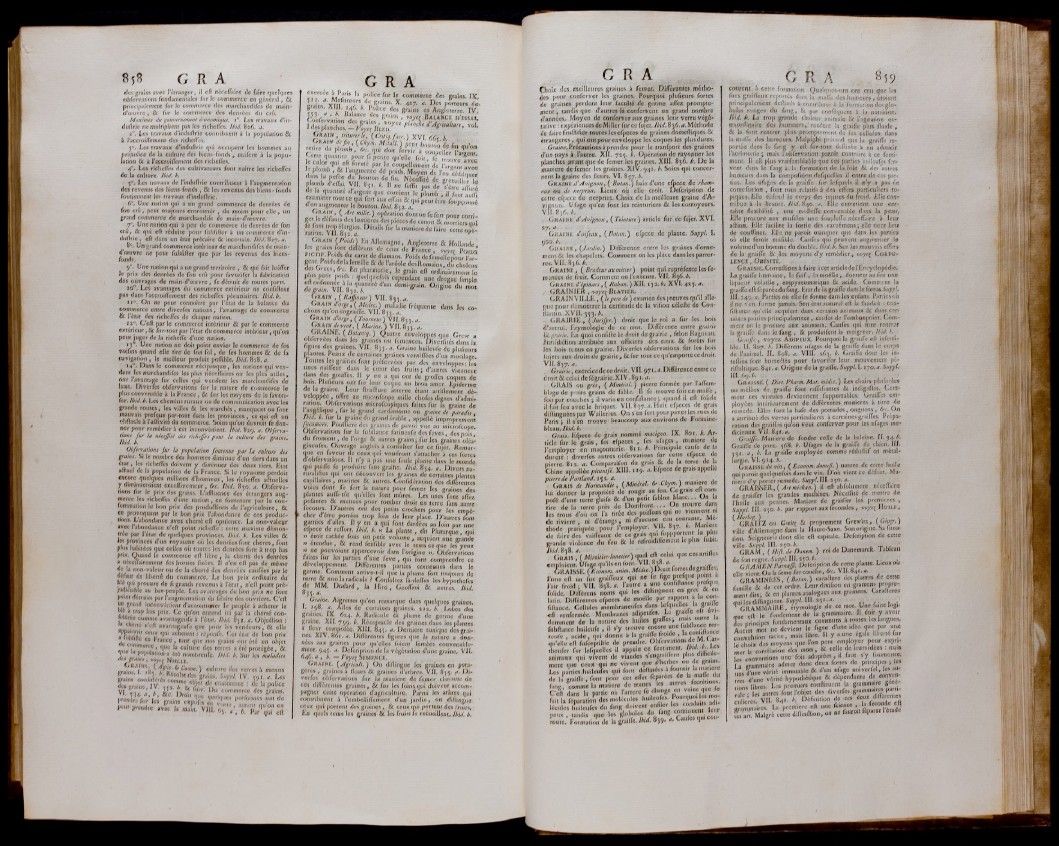
G R A G R A des grain» avec l'étranger, Il cil néceffaire de faire quelque«
ohfervation* fondamentale* fur le comme rce en généra l, 6c
principalement fur le commerce de* marchandife» de main-
d'oeuvre, 6c fur le commerce de* denrée* du crû.
Maximes du gouvernement économique, L*,*« travaux d'in-
duilrle ne multiplient pu* le* riehefles, Ibid. 6%6. a.
i ' . L e s travaux d'induArie contribuent k la population 6c
k l'accrolffement de* richeffes,
y , Le* travaux d'induArie qui occupent le* hommes au
préjudice de la culture de* bicm-fowl*, nuifenr k la population
6c it l'accrolffement de* r/chcffe*,
4". L e * rieheffe* de* cultivateur* font naître le* richeffes
de h culture. Ibid, h,
y . Le* travaux de l'induArie contribuent k l'augmentation
de* revenu» de» b ien *-fon d * . fie le» revenu» de» bien*'fond*
fouttennent le* travaux d’induArie,
6". Une nation qui a un grand commerce de denrée* de
fon c rû , peut toutour* en tr e ten ir , du moin« pour e l le , un
grand commerce de marchandife de main-d'oeuvre.
7 " . Une nation (fui a peu de commerce de denrée* de fon
e ruj J k qni efl réduite pour fuhûfler it un commerce d’in-
duflr'ie, cA dan* un état précaire lie incertain. Ibid. 8*7, a,
8". Un grand commerce intérieur de marchandife* de main-
d'oeuvre ne peut fubfiAcr que par le* revenu* de* biens-
fond*,
9". U n e nation qui a un grand territoire , 6c qui fait haiffer
Je prix de* denrée* de fon crft pour favorifer la fabrication
de* ouvrage* de main-d'oeuvre * fe détruit de route« part*.
io". Le* avantage* du commerce extérieur ne confident
pa* dan* l'accrmfTcment des richcffc* pécuniaire*. Ibid, b,
11 ", On ne peut connmtre par l’état de la balance du
commerce entre diverfe* nations, l'avantage du commerce
6c l'état des riche de* de chaque nation.
i v . Ce il par le commerce intérieur 6c par le commerce
extérieur , 6c fur-tout par l'état du commerce intérieur , qu’on
peut Juger de Ja ridiede d'une nation,
1A ■ ; Une nation ne doit point envier le commerce de fe*
vol fin* quand elle tire de fon fol f de fc* homme* & de fa
navigation , le meilleur produit pofliblc, Ibid. 858, a.
14". Dan* le commerce r éciproque , Je* nation* qui vendent
le* marchandife* les plu* néceffaire* ou les plu* utile* ,
ont l'avantage fur celles qui vendent le» tnarcmndife* de
luxe, Diverfe* ohfervation* fur la nature de commerce le
plu* convenable k la France, 6c fur les moyens de le favori-
fer, ¡bid, b, Les chemin* ruraux ou de communication avec le*
grande route*, le* ville* 6c le* marché*, manquent ou font
wî î ï va,< Pfe(üu? Pi,r'WM* dah* les province*, c e qui eA un
olmacle k l'aénvite du commerce, Soin* qu'on devroit fe donner
pour remédier k c e t inconvénient. Jbid. 8*9, <1. Obferva-
W M J nr to ntotfiìti des richeffes pour lu culture des ‘(trains,
s bol, b,
Obfervations fu r la population foutenuc par la culture des
grains. Si le nombre de* homme* diminue d’un tiers dan* un
état , le* ridiede* doivent y diminuer de* deux tiers, Lati
actuel de la population de fa France, Si le royaume perdoit
encore quelque* million* d'homme* , le* ridiede* altiielle*
y diminueroient cxcedivcmenr, W , Ibid. 830, a. Obfcrva-
tion* fur le prix de* grain*, L'adluence de* étranger* augmente
les ridiede* d'une nation, en fourenant par la con-
fommaiion le bon prix de * produélinn* de l'agriculture, 6c
en provoquant par le bon prix l'abondance de ce* productions,
L’abondance avec cherté eA opulence, La non-valeur
avec l'abondance n'eA point ridiede : cette maxime démontrée
par l’état de quelque* provinces. Ibid, b, Le* ville* 6c
Je* province* d’nn royaume ob le* denrée* font cbcrc*, font
plu* habitée* qu e celle § oh tonte* le* denrée* font k trop ha*
prix. Quand le comme rce e f l libre, la cherté des denrée*
a néceifairemcnt fe* borne» flxéc*. il n'en e fl pas de même
^fl'ydeur on de la cherté de» denrée* caufée* par le
t u ir, Ûbené du commerce. L e bon prix ordinaire du
hJé quI procure de fi grand* revenu» k l'é ta t , n’ed p o in t préjudiciable
au bas-peuple. Le* avantages du bon prix ne font
point détruit* par l'augmentation dii lalaire des ouvrier«, C'eft
Hj* grand inconvénient d'accoutumer le peuple k acheter le
entend ici par la cherté con-
jMWree comme avaniageufe k l'état, Ibid, m 1. a. Q b jeé tkm :
y cherté n e/t avantageufe que pour le* vendeur*. 6c elle
ufuUAAL §JÉ ac»ctcnt ; réponfe, ( 'et état de bon prix
. J ' ®° * ra»êe. tant que itoti grain* ont é té un objet
! ¡¡¡¡J? » que la culture de* terre* a été protégée, 6c
L * a é té nombreufé. Ibid. b. Sur le* maladies
ues gram* , voyer N 1HU.fi,
ôA in r e ù m terre* k menu«
Vi mi a h /. U n t w f v' commerce de* grain*.
p r e *2w fo /le » grain* ^ U | ? IK ,lc
1« « avec la mafn. V III, T i ' . r 'q ï " c i l
e x c r c c c a l ari» la police fur le commerce de« grain*. /X.
fer,111, X III. , a 6. Police îles grain» en Angleterre. IV .
I nnC J / , C ! :tl l'/ailli , voytr isiOE. liAI.ANCr, ll'lAlAI. - Ær«uirz ^ 'SM % C.KAIH , lr in ir , ,t . , (C r iliq .fi ic r,) XV I. ¿gî ),
O i t A in W M M w ' f i M f u l l . ) (« n i Imn innd 'e (•„,
retire dii plorai,, doit liirvir a ¿oiraeUer l'areenr
f.circ quantité POur il pciirc qu'elle (uh, l Î imnvé avec
? kUfe f,,™ 4 I» r le eoupellerneni de l'argent aree
thul i l ’ r ' f IWitis* Moyen de l'eu difiiliiiicr
l1 om1b Jocl'IfTeaiî. ÌV', 'I„I,h 'g! ! ",,0." | ll eI lr ' ,",c‘ M e e m ,t) 3d, ,e£ . grenadier ^
a- la quamiti d ameni que eo,nient le »lomb , il feui nul)!'
examiner Irait ce qui lert au* effals & qui peut dire Iraipcunné
d en augmenter le boulon. M i l . g ji.u . «rapvrame
lgoerâ le d iirfjuiisb ide»l lum iierec» der*, ,pr ii,èacesô "d!en c,man on & ml’oonrtti-e cr*o mrrii-l lin AIN ( /'« ,/, Vpn Allemagne, Angleterre & Hollande,
« grain*font di«rcn* de ceux de Iranee, r ,m V o n , ',
i l'. Poids du carat de dlamau*. Poids de femelle pour l'ar-
gem, I oui* delà lentille & de l’ariolc dc*Hoinaiii., du clioleu,
f , | l & t l S J*fntaefe, le grain cil ordinaircmcm le
P[i 1 f I , ï ' g* i|Pcfoi* cdeep,efin«dant! /iui n^e drogu e* •li mBiile Giiain , ( lìaffmmr) VU.
0«AiNd’e rg ,,(M i;/ „ , ) maladie fréquente dan* les eo-
chon* qu'on engratffe. V II. 833, rt.
(r il AIN dW g e , ( Tourneur) V II, 833, a.
( l i t AIN de ven^ {M a r in e ,) V II, 833, a.
(riX A INt7., ( / in ta n i] .) Q u a tre en v elop p e* que C r ew x
o b fe rve e * dam le» graine* ou femence*. Divcrfué» dan» la
figure d e * grame*, V II, 833, a. Graine huileufe de plu/icur*
plante*. Peaux de certaine* graine* verniffée* d'un mucilage.
Iotite* le* graine* font préiervéc* par de* enveloppe*,'Je*
une» naiifcnt dan* le coeur de» fruit«; d'autre* viennent
dan» dp* gonne». Il y en a qui ont de grolle* coque* de
bois, Pluficnr» ont fur leur coque un brou amer. Em d e r im
de la graine. Leur rtinélure interne étant artiflement développée,
offre au nùcrofcopc mille chofc* digne* d'admi»
ration, Ohfervation* microfcopiquc» laite* fur la graine de
f/îy ! v e ’1 ^G, tÈMii c'ardamome ou graine de pa radis.
Jbid, b. fur la graine du grand érable , appel lé improprement
fveomore. Vouibere de* graine» de pavot vue au microfcope.
Ohfervation* fur la fnh/lancc farineufe de*feye*, d e * p o i * ,
du from en t, de l’orge 6c autre* grains; fur Je» graine* oléa-
gineufe*. Ouvrage angloi* à conuiltcr fur ce fttjcr. Remarque
en fa veur d e ceux qui voudront s’attacher à ce* forte*
dWervation*, Il n'y a pas une feule plante dan* le monde
q»< PMÎflc fe produire fan* graihe. Jbid. 834, a, Diver* na-
furaiilte* qui ont découvert le* graine* de certaine* plante»
capillaire*, marine* 6c autre*. Confidération de* différente*
voie* dont fe fert la nature pour femer le* graine* de*
plantes uuffi-tfn qu’elle* font mûres. L e s une* font affer,
pelante* oc menue* pour tomber droit en terre fan* autre
fecours. D'autre* ont de* petit* crochet* pour Je* emué-
» cher d être portées trop loin de leur place. D'autre» font
garnie* d ailes. Il y en a qui font dardée» au loin par une
e fp e ce de refforr, Ibid. b. « La plante, dit Flutarquc, qui
» étoit cachée fous un petit volume, acquiert une grand#
» étendue, 6c rend fenfible avec le tem* ce que le* yeux
n ne poiivoienr ajipercevoir dan* l'origine ». Ohfervation*
faite* fur les partie* d'une leve, qui font comprendre ce
développement. Différente* partie* eomeuiic* dan* le
germe. Comment arrive-t-il que la plume fort toujours de
radicule ? Con fuit ex la-dcffh* le* Jiypothefcs
d e M M , Dodard , la I t i r e , Geoffrol & autres. Ibid.
835, //,
Graine. A ig rette* qu'on remarque dan9 quelque* graine*.
,J 9 f ' A^c® de certaines graines, aia, b. Urnes de»
grame*. IX ( 7 .4 , b, Radicule «, plume de germe d'une
graine, X I I , 799, b,, Réccyiacle de* graine* dans le* plante*
a Heur cotmioléc. X III, 047, y. Derniè re 1 unique de*graines,
X IV , d o t . a. Différente* ligure* que la nature a donnée*
aux graine* pour qu'elle* l'oient famée* convenablement,
947, f/, Defcription de la végétation d'une graine, V IL
646, a , b. — A'byjq’ S ïm iîn ck ,
G u à ìn e , ( /igricuh. ) O n dülingue Je* graine* en pota-
fferes, graines a /leurs graine» d'arbre*. V I L 837/ </. Diverfe
« ohfervation* fur la maniere do femer chacune de
ces différente* graines, 6c fur le* foin* qui doivent accompagner
cette opération d'agriculture. Parmi le* arbre* qui
I contribuent k l'embelliffement d'un jardin, on diflingue
c eu x qui portent des graine*, 6c ceu x qui por relu des fruit*,
En quel* teiùs les graine* 6c le* fruii» le recueillent, Ibid. b.
C R A
Choix des me illeure* graine* k femer. Différente* méthode*
pour co n fe r v e r les graine*. Pourquoi pluiteur* fortes
de graines, perdent leur faculté de germe affe/. promptement
t tandis que d'autre* la confc rven t un grand nombre
d'année*. Moyen de conferver aux graines leur vertu végétative
; expériences de Miller fur ce fu/et, Ibid. 836. a. Méth od e
de faire fruélUier toute* le* cfpeces de graines domefliques 6c
é tran g èr es«qui ont pour enveloppe le* coque* le* plu* dure*.
Graine, Précaution* k p rendre pour le tranfport de* graine*
d’un pays k l'autre, X II. 747. b, Opération de rayonner les
planche* ¡avantque de femer les graine*. X III. 830, b. D e la
maniéré de femer les graines, X IV , 941» b, Soin* qui concernent
la graine des Heur*. V I, 857, b.
C h a în e d 'A v ig n on , ( Ilot an.) haie d'une efpece de rhatn-
nus ou de nerprun, Lieux ou elle croit, Defcription de
cette efpece de nerprun. Choix de la meilleure graine d’A vignon,
Ufagc qu'en fon t les teinturier* 6c le* corroyeur*.
V II, 83(h b .
G u a iu x d 'A v ig n on , ( Teinture) article fur Ce fujet. X V I.
v j . a ,
C h a in a ( foifeau, ( Boian. ) efpece de plante, Suppl. I.
ttoo. b, ■
Gkaiwk, {Jardin.) Différence entre les graine* d ornement
6c le* chapelet*. Comment on les place dans le# parterres.
V il, 836. b.
C h a în e , { Brodeur au métier) point qui ranréfente le*'femence*
de fruit. C om m en t on 1 exécute. V il, 8 )6 . b.
C h a în e d'ipinars, ( Ruban.) X II. 131. b. X V I, 443, a.
, GRAINILR - voyer Rlatikh,
C/RAINVlLLlv, { leperc de ) examen des preuve* qu’il allègue
pour démontrer la certitude de la vilion céleAc de Con-
tlantin. X V l l . 373. b.
■ (fR A lR IK , U u r i fp r .) droit que le roi a fur le» bois
d'autrui. J.iymmogie de ce mot. Différence entre grairie
Uî gritrie. En quoi confillc le droit de grairie , félon Raxticaii,
/iiriidiélion attribuée aux officier* des eaux 6c forêt* fur
les bois tenu* en grairie. Diverfe» obfervations fur le* bois
Itijet* aux droit* de grairie, 6cfur tout ce qu’emportcccdroit,
V IL 837, a. - ^ ■
Grairie, exercice de ce droit . V II, 971 .* . Différence entre ce
droit 6 c celui de fégrairic.XIV, 89*. a.
OR AI h ou g r is f ( Minlr.il. ) pierre formée par laffem-
blagc de petit* grain* de fable. Il fe trouve (bit en maffe ,
foil par couche* ; il varie en eonfiffancei quand il eu folidc
il fait feu avec le briquet. V IL 837.^ Huit cfpcecs de grais
diliinguéc* par Wallerius, Qn *'cn fe rt pour paver les rues de
Fari* ; il s’en trouve beaucoup aux environ* de Fontainebleau,
Ibid, b. , , t v o / a Grats. Efpece de grai* nommé maetgno. IX . »01, b. Article
fur le grai», fc» efpece* , fc» ufagc*, maniéré de
¡’employer en maçonnerie, 811, b. Principale caufe déjà
dureté ; diverfe* autre* ohfervation* Air cette efpece de
pierre. 8/4. a. Comparaifon du grai*¡fit de la terre de a
Chine îijMmllée p t im t j l . X III. 119. ¡j, t f p u » l i t gm » a«|>e|l6
pierre de Portland. 134, a, ']"• 1 , .
O k a i* d , W M Ë È m {M in i ,a l . t . U y m . ) manière de
lui drainer la propriété de rougir au feu. Ce (jrai* eft corn-
wifô d’une terre glaife & d’un petit fablon blinc... On la
tire de la terre prd* de Romfront.. . . On trouve dan
le* trou» d’ob on l'a tirée de* poilTon* <|i|1 ne viennent ni
de rivière, ni d'étang., nl d'aueunc c.iu «mrautc. Mé-
tbode pratlouéc, pour l'employer, V il, 857, i. Manière
de faire de. valffeaux de e t grai*
grande violence du feu 8e le rcfroidiffement le plu» fubit.
O iJ ib , ( M ir o i i l t ,-ln n .i i„ ) quel cil celui que ce»ariiftc*
emploient. ÜfaKC qu'il* en font. V II. 83». a.
GRAISSE, iccono/n, unit», M id tc .) Deux forte* de graillé.,
l'une efl un Aie grairteux qui ne fe fige prefqne point é
l'air froid ; V II. 8a8.a . l’autre a une confiftaiice prefqne
folidc. DifTéren* nom* qui le* diftiiiguent eo gret. St e 1
linln, Diirérenic* cfpecc» de moéllc par rapnori i la ton
llllance, Cellule» niembraneufe# dans lcrqiiellc. la giabic
<11 renfermée. Membrane» adiueufe». La graiffe e f év
demment de la nature de* huile» grade» i
IlibAance huileufe , Il *’y trouve encore une g ® «
rciife, acide, qui donne il la graiffe froide, l a g l S i
qu'elle efl fulic liil.le de preudre. Ohfervation. de M. l-.r
ilienfer fur lefquelle* Il appuie ce fenumem.
animaux qui vivent de viande» »’engrallleiit p us-dlfficttu
ment que ceux qui ne vivent que ¡/'herbe, on de grelnt.
I-e» partie» huileiife* qui font deltlnéc» b fournir la mariorc
de la craldc , font pour cet effet féparée» do la maffe du
tlniv comme la matière de mutés le» autres f t t d u o n , .
S ’ I l ta partie ou l'artere fe change en veine que fc
fait la réparation de. molécule, bulleiffe». Pourquoi « m -
léeule» llulleufe» É
S i Ü P i l C a u f e , quieo».
G R A 859
c o u r e n t c e t t e , fimnamn. Q u e lque«*im» ont cru que Ici
fuc* grameux reportés d,m» U maffe des humeur*, Iw ie n t
princ/palcmcnt dcAinés a contribuer k h» formation tic* glo-
y y g è * Hu fiujg, 6c par confë<|ucnt k ia nutrition.
Jbid. b. Lu trop grande chaleur animale & l'agitation extraordinaire
des humeur»/ rendent la grai/îe plu* fluide,
6c k font rentrer plu* promptement de fc* cellule* dan*
la maffe de* humeur*. Malpighi prétend que la graiffe reportée
dan* le Au «g y eA lur-tout deflinée a en adoucir
l'acrimonie ; mai» 1 ohfervation pur/dt contraire k ce fenti*
m cm, Il c i l plu» vraifemhlable que ces partie* huilsufe» Air-
vent dans le fang k lu formation do la bile 6c de»'autres
humeur» dan» la compofnion defquelles il cntre .dc ce» parties,
Les ufagc* de. la graiffe fur Icfqucl* il n 'y a pu* de
conteflation , font toits rclaiifi» k de» effet» particulier* topiquei,
Elle défend le corps des injure* du froid. Elle contribue
k h beauté, Ibid. 840. a. Elle entretient une certaine
flexibilité , une mojlcffc convenable, dan* la peau,
Elle procure aux mufele* une foupleffe néceffiire k leur
aélion. Elle facilite la forfte dé* cxcrémen» ; elle tient lieu
de couflinet. Elle ne paroit manquer que dam le* partie*
oh elle ferait nuiflblc. Gaules qui p euven t augmenter le
\ volume d'un homme du double, Ibid. v. Sur le* mauvais effet*
i delà graiffe 6c Je» moyens d'y remédier, voyc^ (k)HPV-
MtfGE t O u b s i r L
C h a is sk , Correélion* k faire k c e t article de l’Encyclopédie.
La graiffe humaine, le fu if, lamoélle, donnent au fen une
liqueur volatile, empyreumatique 6c acide. Comment la
graiffe «A féparée du fang, Eta t de la graiffe dans le fcxtusdxnppL
III, 449. a, Partie* oh eue fe forme dan» le* enfan* Partie* oh
i! ne s'en forme jamais, Son état naturel cA la fluidité ; con-
flRance qu’elle acouiert dan* certain» awmaux 6c dan* certain
{»parties principalement, caufe* de l'embonpoint. Comment
on le procure atix animaux, Caufe* (pii font rentrer
la graiff» d.«n » le fang , 6c pradnifent la maigreur. Ibid, b.
Gratjje , voyez, A m v n v x , Pourquoi la graiffe cA infcnfi-
ble,. IL 807, b. Différeu* ufagc* de la graiffe dans le corps
de l'animal. IL 808. a. V IIL i6 y . b, Graiffe dont le» in»
teAin* font luimc^é» pour favorifer leur mouvement pé-
riflaltique, 841, //, Origine de la graiffe. Suppl. 1. 170. a. Suppl.
III, 60. b. . •
C u A m t . { Diet. Rhum. Mai. midtc. ) Les chair* pénétrée*
ou mélées de graiffe font raffafiantc* 6c indigsAe», Comment
ce * viandes ^deviennent ftipportable». Graiffe* employée*
Intérieurement de différente* manière* k titre de
remede, Elle* font la bafe des pomades , ongitcns, (/c. On
a attribué des vertu» particulières à certaine* graiffe», Préparation
des graiffe* qu on veut confcrvcr pour le» nfages médicinaux.
V /1,8 4 t .a . ' »r #
Graille. Manière de fondre celle de la baleine, II, 34. A.
Graiffe de porc. 768, b, Ufagc* de la graiffe de chien. III.
371, a , b. La graiffe employée comme r ed u tï if en métaliurgfc,
V I, 914, b.
G i tA m u . du v in . { JLconm. dornejl. ) nature de cette huile
qui parait quelquefois dan* Je vin. D ’oh vient ce défaut, Ma*
nicre d’y porter remede, Suppl. III, 43°* „ ,
GRAISSER, ( Art mlc/ian. ) il cA abfoiument néccffaire
de graiffer le* grande* machines. Néccfltté de mettre de
PhtiÎle aux petue*. Manière de craiffer les premiers* ,
S uppI. III. 450, b. par rapport aux fécondés, voye{ H u iu ,
f GKAÎ rZ ou Greit{ 6c proprement Grcwit'A, (G lo g r .)
ville d'Allemagne dan* la miuc-Saxe. Son origine. Sa fttua*
tion. Seigneurie dont elle eA capitale. Defcription de cette
ville- Suppl. III . 430. b. ^ « « - n
G RAM, ( H'tjl. de Danrn. ) roi de Dancmarck, Tableau
de fon retLne. Suppl, III. 1 * 0 ,b. .
G I IA M H N RarnaJJî. Defcription de cette plante. Lieux oh
elle vient. On la feme fur couefie, 6rc. V II, 841. a.
GRAMINÉKS, (.batan.) careflcre (la*pbmfM <1«
fiimille S i (la «< urdré. Leur rfivifirai su gramen* propre,i
ment lit») Si en plante» analogue* aux gramen*. Caraétcre»
^ ' f l R A M i v i S ' l R K I I “ mot. Une fainelogh
nue efl le fondement de la grammaire. 11 doit V avoir
i 3 c» or neipe» fondamentaux commun* i toute» le» langue». Aucun mot ne devient Hil eonvchiion tacite, mai» libre. Il y a,une égale nueite lur
S I I moyen, que l'on peut employer pour exp H
mer U corrélation de* tnot», S i celle defeur.tdée. ! mat.
1« convention, une fols adoptée» , .1 faut s, V ‘«‘"«ottre
La «ammaire admet donc deux forte» de principe* > le»
mi.S’une vérité immuable S i d'un ufagc umvcrfcl, Icipeu-
S ,1'mie vérité hypothétique Si dépendante de cenven-
S f t t o j S " conftbucnt la