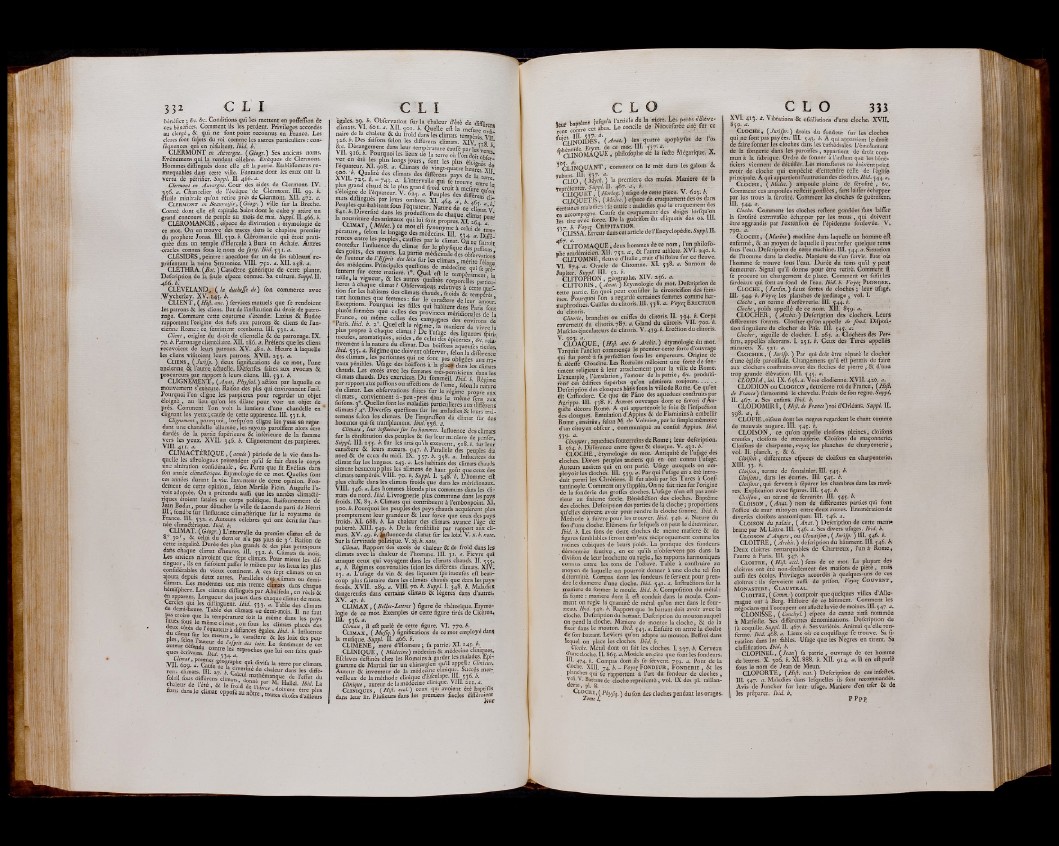
3 3 ; C L I
bénéfice ; &c. &c. Conditions qui les mettent en pofTeffion de
ces bénéfices. Comment ils les perdent. Privilèges accordés
au clergé, & qui ne font point reconnus en France. Les
clercs font fujets du roi comme les autres particuliers : con-
féquences qui en réfultent. Ibid. b'.
CLERMONT en Auvergne. ( Geogr. ) Ses anciens noms.
Evénemens qui la rendent célébré. Évêques de Clermont.
Hommes diftinguès dont elle eft la patrie. Etabliffemens remarquables
dans cette ville. Fontaine dont les eaux ont la
vertu de péirifier. SuppL II. 466. a.
Clermont en Auvergne. Coür des aides de Clermont. IV. .
356. a. Chancelier de l’évêque. de Clermont. m. 99. 4.
Huile minérale qu’on retire près de Çleriàont. XII. 472. a.
C l e rm on t en Beauyoifis[r (Geogr. ) ville fur la Breche.
Comté dont elle eft capitale. Saint dont le culte y attire un
grand concours de peuple au mois de.'mai. Suppl. II. 466. b.
CLÉROMANCIE, elpeçe de divination : étymologie de
ce mot. On en trouye'aes traces dans le chapitre premier
du prophète Jonas. III. 530. b. Cléromancie qui étoit pratiquée
dans un temple (l'Hercule à Burâ en Âchaïe. Autres
oracles connus fous le nom de fùrtd.Ibid. 531. a.
CLÉSIDÈS, peintre : anecdote fur un de fes tableaux re-
préfentant la "reine Sttatonicè. VIII. 752. à. XII. 258. a.
CLÉTHRA. (Bot. ) Caraâere générique de cette plante.
Defcripdon de la feule efpece Connue. Sa culture. Suppl. II.
466. é,
CLEVELAND, ( la. duchejfe de') fon commerce avec
.Wÿcherley. XV. 145. b.
CLIENT, ( Hifl. <wc. ) fervices mutuels que fe rendoient
les patrons 8ç les cliens. But'de l’inliitution du droit de patronage.
Comment cette coutume s’étendit. Lazius & Budée
rapportent l’origine' des fiefs aux patrons & cliens de l’ancienne
Rome: ce. fenriment combattu. III. 531. a.
Client, origine du droit de clientelle & de patronage. IX.
70. b. Patronage clientélaire. XII. 186. a. Préfetis que les cliens
recevoient de leurs patrons. XV. 481. b. Heure à laquelle
les cliens vifitoient leurs patrons, XVII. 233. a.
C l ie n s , ( Jurifp. ), deux fignifications de ce mot, l’une
ancienne. 8ç l’autre aâuelle. Défenfes faites aux avocats &
procureurs par rapport à leurs cliens. III. 531. b.
CLIGNEMENT., ( Anat. Phyjiàl. ) a ¿lion par laquelle ce
mouvement s’exécute. Raifon des plis qui environnent l’oeil.
Pourquoi l’on cligne, les paupières pour regarder un objet
éloigné, au lieu -qu’on les dilate pour voir un objet de
près. Comment l’on voit la lumière d’une chandelle en *
clignant les yeux ; caufe de cette apparence. III. 531 .b.
Clignement, pourquoi , lorfqu’on digne les yeux en regardant
une chandelle allumée, les rayons parodient alors être
dardés de la partie fupérieure & inférieure de la’ flamme
vers les yeux. XVII. 346. b. Clignotement des paupières.
VIII. 411. a.
CLIMACTÉRIQUE, ( année ) période de la vie dans laquelle
les aftrologues prétendent qu’il fe fait dans le corps
une altération confidérablè, &c. Perte que fit Evélius dans
fon année climaélérique. Etymologie de ce mot. Quelles font
ces années durant la vie. Inventeur de cette opinion. Fondement
de cette opinion, félon Marfile Ficin. Augufte l’a-
voit adoptée. On a prétendu auffi que les années elimafté-
riques étoient fatales au corps politique. Raiionnement de
Jeaij Bodin, pour détacher la ville de Laon du parti de Henri
n i , fondée fur l’infiuence climaâérique fur le royaume de
France. III. 532. a. Auteurs célébrés qui ont écrit fur l’an-,
née climaâérique. Ibid. b;
CLIMAT. {Giogr.) L'intervalle du premier climat eft de
S- 3° ; f« K du A » « r pas plus de 3 Raifon de
cette inégalité. Durée des plus grands Se des plus peritsiours
dans chaque climat d’heures. 111. 532. 4. Climatü de mois
Les anciens n avoient que fept climats. Pour mieux les dit
nnguer, ils en faifoient paffer le milieu par les lieux les plus
confidérables du vieux continent. A ces font climats on en
ajouta depuis deux autres. Parallèles desclimats ou demi-
chmats. Les modernes ont mis trente climats dans chaque
hénufphere. Les climats diftinguès par Abulfeda.en réelsSc
enapparens. Longueur des jours dans chaque climat de mois.
M Ê S l& l les diilipguent. 44W. 533. *• Table des climats
Oc demi-heure. Table des chinais ue demi-mois. Il ne faut
H P ¡8 1 température foit la même dans les pays
t f f i d E 1 “ me climat,ou fous les climats placés des
du climat f o l ^“ Steur a dillances égales. Bid. 4. Influence
K S S X !. T , ’ k cm&ae & lcS lee peu-
auteur défendu con rre t d“ ! 0lx- Le fcnthnent de cet
ques écrivains: que lui omÎ2'a 1 “ el-
,Vn. 609’ I'Sufe u ïu Ÿ 6 S I U 13 tC're Par climalsrens
climats. ïü: 27. 4 c E d!|.ch!a.eur dans tes diffé-
foleil fous d i f f i W c t i S f e 1^ fe. l’effet du
chaleur de Hallei. /4W. La
forts dans 1e climat oppofé au nôtre
C L I
égales. 29. 4. Obforvation fur la chaleur d’été de du»™,,
climats. V I. 601. U. XII. oo, 4. Quelle eft la mefute ¿ 2
naire delà chaleur & du froid dans les cUmats tempérés VIT
326.4. Des faifons félon les différais climats. XIV t
&c. Dérangement dans leur température caufé par tesve't"
VII. 316. 4. Pourquoi les lieux de la terre où l’on doit obfef"
ver en été les plus longs jours, font leà plus êIoitnés T
léquateur. XL po8. a. Climats de vingt-quatre heutes' XIT'
ï v i l , S “ i dlm,a? des dÎ,A VIL 72c. b. - 743. a. L intervallfefé rq'umi lJeP atyrso udvee la Æ f*
plus gtanj çha„t(& le plus grand froùl croît à mefute
s éloigné de Equateur. V. j | „. Peuples des d ® T
mats thfltngués par leurs ombres. XI. 464. a, Æ “ f ’
Peuples quihabitent fous l'équateur. Nature de ce WÊ V-
S4t. 4.Dtveriité dans les produRions de chaque clima noli
la noumture des anunaux qui lût font propres. XI. ig- r
C l im a t , ( Mtdtz. ) ce mot cil lynonyme à celui de* ...
pétature, félon le langage des médecins. III. 534. „ « B
rences entre les peuples , caufoes par te climat. « L e faumt
contefter 1 influence du climat for le phyfique des pafltens ’
des goûts, des moeurs. La partie médicinale des obfervadons
de 1 auteur de lEJpnt des Un* fur les climats, mérite l’éloeé
des médeems. Principales queftions dé médecine' oui fe m i
S U fur certe mat ere. r». Quel eft 1e tempérlLni £
taïUe, la vigueur, & tes autres qualités corporelles uarticu 1
rfon'f,“ Î T t - a ? 9.brervaWfts relatives à cette quef-
;“r les usbitans des climats chauds, froids & temuétés
tant hommes que femmes: fur le caraflere de leur amour
Exceptions. Pourquoi les filles qui habitent dans Paris font
f e r m -q“e es f es Provinces méridionales de la
■ W H i T n 1 t des '■"’■rons dé
e ■ l,' Q “ ' 1'*1 le régime, h maniéré de vivre la
plus propre a chaque chinât? fie l’ufage des liqueurs fpiri-
tueufes, aromatiques, acides,de celui dis épiceries &c rela-
tiyement à la nature du climat. Des boiffons aqueufes tiedes.
p. 535- “■ Kêguneque doivent.obferver, félon la différence'
des climats , les. perfonnes qui ne font pas obhgées aux .travaux
pénibles. Ufage des boiffons à la glaoftdais les climats
chauds. Les exces avec les feipmes tres-pernicieux dans les
climats chauds. Des exercices. Du fommeil. Ibid. b Régime
par rapport aux pallions ou affrétions de l’ame, félon la nature
du climat. Les obfervations faites' fur le régime propre aux
climats, conviennent à-peu-près tjans le même fens aux
faifons. 30. Quelles font les maladies particulières aux diffèrens
climats? 40. Diverfes queftions fur les maladies.&leurs trai-
temens fclon les climats. De l’imprelfion du climat fur des
hommes qui fe tranfplanteiit. Ibid.^i6.a.
Climats , leur influence fur les hommes. Influence des climats
fur la cbnftitution des peuples & fur leur maniéré de penfer,
Suppl. III. 255. b. fur les arts qu’ils exercent, 518.b. iurleur
caraétere & leurs moeurs. 947. b. Parallèle des peuples du
nord & de ceux du midi. IX. 357. é. 358. a. Influences du
climat fur les langues. 243. a. Les habitans des climats chauds
aiment beaucoup plus les alimens. de haut goût que ceux des
climats tempérés. VIII. 70. b. Suvpl. I. 248. b. L’homme eft
plus chafte dans les climats froids que dans les méridionaux.
VIII. 346* ¿.Les hommes blonds plus communs dans les climats
du nord. Ibid. L'ivrognerie plus commune dans les pays
froids. IX. 83. b. Climats qui contribuent à l’embonpoint. XI.
300. b. Pourquoi les peuples des pays chauds acquièrent plus
promptement leur grandeur & leur force que ceux des pays
froids. XI. 688. b. La chaleur des climats avance l’âge de
puberté. XIII. 549. b. De la fenfibilité par rapport aux climats.
XV. 49. ¿.Jfefluence du climat fur les loix. V. x. b. note.
Sur la fervitude politique. V. xj. b. note.
Climat. Rapport'des excès de chaleur & de froid dans les
climats avec la chaleur de l’homme. III. 31 .a . Fievre qui
attaque ceux qui voyagent dans les climats chauds. II. 53 c.
a, b. Régimes convenables félonies différons climats. XIV;
13. a. L’ufage du vin & des liqueurs ipiritueufés eft beaucoup
plus falutaire dans les climats chauds que dans les pays
froids. XVII. 289. a. VIII. 70. b. Suppl. I. 348. b, Maladies
dangereufes dans certains climats & légères dons d’autres,
XV? 47. b.
CLIMAX, ( Belles'Lettres ) figure de rhétorique.. Etymologie
de ce mot. Exemples de cette figure tirés de Cicéron,
111. 336. a.
Climax, il eft parlé de cette figure. VI. 770. b.
C l im a x , ( Mufla. ) fignifications de ce mot employé dans
1 mu fique. Suppl. ÍI. 466. b.
CLIMENE, mere d’Homere; fa patrie/ XI- ï 4ï-/\
CLINIQUE ( Médecine j médecins & médecine cliniques.
Efclaves deftinés chez les Romains à garder les malades. Epi-
gramme de Martial fur un chirurgien quu appelle Umicus,
Auteur & inventeur de la médecine clinique, buccês merveilleux
de la méthode clinique d’Êfculape. 111. 536. b.
Clinique , auteur de la médecine clinique. V 1II. 211. a.
C l in iq u e s , (Hift. eccl.) ceux qui avoient été baptifés
dans leur Ht. Plufieurs dans les premiers fiedes différoient
leur
C L O C L O 333
i. Stoí infmi’à l'article dé la nWtt. tés pérês s’êléve-
ônrtfcét J u s. Le concile de Néocéfarée cité fur ce rent conu>».......... wL'i Lj»
CHINOISES * ( -¿nat. ) lès qiiâtré àpophÿfès dé l’ds
Ètvm. de ce rtiôt. III. î 37- . BgrSraH I
c Î iN ÔM AQ Ù E í philofophé de là fdâe Mégariqüe. X.
C l in q u a n t , comment oft lë mêf dans les galoiis &
fU CLIO Myth. j la première des mufes. Maniere dé la
teprélentéb. SúppL II. 467. a| b. . - , - ,
C l i q u e t , (Hor log.) ufagè de cette piece. V. 623. b.
CLIQUETIS, IMédec■ ) efpece dé Ci'àqiiëiiient des os dans
éertainS maladies : fa caüfe : maladies que le craqueihéñt des
os accompagne. Caufe du craquement des doigts lorfqu on
les tire avec force. De la gùérifoft du cliquetis des os. 111.
<47. b. Voyer CRÉPITATION.
CLISSA. Erreur dailscef article de l’Encyclopédie.SuppUU.
46£lÎtOMAQUE , deux hommes dé ce nom > l’un philofo-
phe académicien. XII. 7 ^ - a> & rautre athlete XVl. a40- b.
CL1TOMNE, fleuve d’Italie, trait d hiftoire fur ce fleuve.
VL 874. Oracle de Cütomne. XI. 5384 a. Surnom de
Jupiter. Suppl. III. 52. b.
CLITOPHON, géographe. XIV. aÇ6. *
CLITORIS, (Anat.) Etymologie du mot. Defcnptionde
Cette partie. En quoi peut confifter la circoflcifion dès femmes.
Pourquoi l’on a regardé certaines femmes comme hermaphrodites.
Cuiffes du clitoris.III. 338. a. Vôÿe[E r e c t e ü r
du clitoris. „ , .. . ,T 1 n
Clitoris, branches ou cuiffes du clitoris. IL 394. b. Corps
caverneux du elltoris. 787. a. Gland du clitoris. VII. 700. b.
Mufcles éjaculateurs du cütoris. V . 439. b. Ereélion du clitoris.
V (?L¿AQUE, (Hifl. apc-. & Archit.) étymologie du mot.
Tarquin l’ancien commença le premier cette forte d’ouvrage
qui fut porté à fa perfeétion fous les empereurs. Origine de
la-déefle Cloacine. Les Romains mêloient une forte de fen-
timent religieux à leur attachement pour la ville de Rome.
L’exemple, l’émulation, l’amour de la pâme, &c. prodmfi-
renf ces édifices fupérbes qu’on admirera toujours.. . . . .
Defcriptíóri des cloaqueS bâtis fous la ville de Rome. Ce qu’en
dit Cafliodore. Ce que dit Pline des aqueducs conftruits par
Agrippa. III. 538. b. Autres ouvrages dont ce favori d’Au-
gufte décora Rome. A qui appartenoit le foin & l’infpeéliOii
des cloaques. Emulation d’Appius & de Flaminius à embelUr
Rome , excitée, félon M. de Voltaire, par le fimple mémoire
d’un citoyen obfcur , communiqué au confuí Appius. Ibid.
Cloaques, àquedücs fouterreins de Rome ; leur defeription.
I. 564. b. Différence entre égout & cloaque. V. 431. b.
CLOCHE, étymologie du mot. Antiquité de l’uÇage des
cloches. Divers peuples anciens qui en ont connu l’ufage.
Auteurs anciens qui en ont parlé. Ufage auxquels on em-
ployoir les cloches. III. 539. a. Par qui 1 ufage en a été introduit
parmi les Chrétiens. Il fut aboli par lés Turcs à Conf-
tantinople. Comment onyfùppléa. On ne fait rien fur l’origine
de la fonderie des grofles cloches. L’ufage n’en eft pas antérieur
au fixieme fiecle. Bénédi&ion des cloches. Baptême
des cloches. Defeription des parties de la cloche ; proportions
qu’elles doivent avoir pour rendre la cloche fonore. Ibid. b.
Méthode à fuivre pour les trouver. Ibid. 540. a. Nature du
fon d’une cloche. Etémens fur lefquels on peut le déterminer.
Ibid. b. Les fons de deux cloches de même matière & de
figures femblables feront entr’eux réciproquement comme les
racines cubiques de leurs poids. La pratique des fondeurs
démontrée fautive, en ce qu’ils n’obfervent pas dans. la
divifion de leur brochette ou reele, les rapports harmoniques
connus entre les tons de í’oaave. Table à conftruire au
moyen de laquelle on pourroit donner à une cloche tel fon
déterminé. Compas dont les fondeurs fe fervent pour prendre
le diamètre d’une cloche. Ibid. 541. a. Inftruétions fur la
maniere de former le moule. Ibid. b. Compofition du métal:
fa fonte : maniere dont il eft conduit dans le moule. Comment
on regle là quantité de métal qu’on met dans le fourneau.
Ibid. 542. b. Rapport que le battant doit avoir avec la
cloche. Defeription du baftant. Defeription du mouton auquel
on pend la cloche. Maniere de monter la cloche, & de la
fixer dans le mouton. Ibid. 543. Enfuite on arme la cloche
de- fon' battant. Leviers qu’on adapte au mouton. Beffroi dans
lequel on place les eloenes. Ibid. b.
Cloche. Métal dont on fait les cloches. L 237. b. Cerveau
d’une cloche. IL 865. a. Modele envcire que font les fondeurs.
, 474. b. Compas dont , ils fe fervent. 759. a. Pont de la
cloche. XIII. 74. b. - Voye[ F o n d e u r , F o n d e r ie , & les
planches qui fe rapportent à l’art du fondeur de clochès,
vol. V. Battant de cloche repréfemé I vol. IX des pl. taillanderie,
pl. a. - .
C l o c i i e , (P h y f lq .) dufon des'cloches pendant lesorages.
Tome I,
XVI. 415. à. Vibrations & ofefflatiora d’uiiS cloche, XVIL
850. a.
C l o c h e , ( Jurifpr.) droits du fondeur fur les cloches
qui ne font pas payées; III. 543. b. A qui appartient lé droit
de foire fonner les cloches dans lés 'cathédrales. L’émolument
de la fonnerie dans lés paroiffes, appartient de droit commun
à la fabrique. Ordre de fonnèr a l’ihftant que les bèné*
ficiers viennent dé dété'dér. LèS niohafteres ne doivent point
avoir de cloche qui empêché d’entendrè telle de leglifé
principale. À qui appartient l’entretien des clöthes; Ibid. 544. a.
C l o c h e , ( Médec. ) atnpoiile pleine dé férofité , 6*c*
Comment ces ampoulés f-èftéiit gonflées, fans làiffer échapper
f ar les trous la îérofité. Comment les cloches fe guériffentk
II. 544. a.
Cloche. Comment les cloches reftent gonflées fans laifle?
la férofité extravafée échapper par les trous, qui doivent
être aggrandis pat l’ëxtèftfiofl de l’épi derme foulevée. V»
790. a.
C l o c h e , (Marine') machiné dans laquelle un homme éfi
enfermé, & au moyen de laquelle il peut refter quelque tems
fous l’eau. Défcriptiôn de téfte machine. III. 544. a. Situation
de l’homme dans là cloche. Maniéré dé s’en férvlr. Etat où
l’homme fe trouve foUS l’eau. Durée du téms qu’il y peut
demeurer. Signal qu’il donne pour être retiré. Com'irtent it
fe procure un changement de place. Commerit on faifit les
fardeaux qui font au fond dë l’eau. Ibid. b. Voyeç PLONGER»
C l o c h e , (Jardin.) deux fortes de cloches ; leur ufage.
III. 544. b. Voye{ les planches de jardinage , voL I.
Cloche , en terme aorfévrerie. III. 544. b.
Cloche, poids appellé de ce nom. XII. 859. a.
CLOCHER, (Archit:) Defeription des clochers. Leurs
différentes formes. Clocher qu’on appelle de fond. DifpOfi*.
don finguüere du clocher dé Pife. I11. 545. a:
Clocher j aiguille de clocher. I. 263. a. Gldchérs des Per*
fans, appellés alcorans. I. 25 s. b. Ceux des Tirrcs appellés
minarets. X. 521. a.
C l o c h e r , ( Jurifp. ) Par qui doit être réparé lé clochet
d’utie églife paroiflialé. Changèmens qu’il eft permis dé foiré
aux clochers conftruits avec dés fléchés dë pierre , 8c d’une
trop grande élévation. III. 545. a.
CLODIA, loi. IX. 656.0. Voie clodienné. XVII. 420. a.
CLODION ou C l o g io n ,• deuxiemé roi de France, (HiJK
de France) fürnoiriiAé le chevelu. Précis de fon regne. Suppl»
II. 467. a. Ses enfons. Ibid. b.
CLÔDOMIRI, ( Hifl. de France) roi d’Orléans. Suppl. II»
398. a y b.
CLOFIE,oifeau dont les negresregardèrit le ehailt comme
de mauvais augure. III. 545. b.
CLOISON, ce qu’on appelle cloiforis pleines, cloifons
creufes, cloifons de menuiterie. Cloifons de maçonnerie.
Cloifons de charpente, voye^ les planches de charpenterie,
vol. II. planch. 5. 8c 6.
C loi fon , différentes efpeces de cloifons en charpenterie*
XIII. 33. b.
Cloifon y terme de fontainier. III. 545. b.
Cloifons y dans lés écuries. III. 5 45. b.
Cloifons y qui fervent à féparer les chambres dans les navires.
Explication avec figures. III. 545. b.
Cloifon ÿ en terme de ferrurier. III. 545. b.
C lo iso n , (Anat. ) nom de différentes parties qui font
l’office de mur mitoyen entre deux autres. Enumération de
- diverfes cloifons anatomiques. HI. 546. a.
C lo iso n du palais, (Anat.) Defcripdon de cette mem*
brane par M. Littre. III. 546. a. Ses divers ufages. Ibid. b.
C lo iso n d'Angers, ou Clouaifon, ( Jurifp. ) III. 546. b.
CLOITRE, (Archit.) defeription du bâtiment. III. 546. b.
Deux cloîtres remarquables de Chartreux, l’un à Rome,
l’autre à Paris. III. 347. b.
C l o ît r e , (Hifl. eccl.) fens de ce mot. La plupart des
cloîtres ont été non-feulement des maifons de piété, mais
auffi des écoles. Privileges accordés à quelques-uns de ces
cloîtres : ils fervoient auffi de prifon, Voye{ C o u v e n t ,
MONASTERE, CLAUSTRAL.
C l o ît r e , (Comm.) comptoir que quelques villes d Allemagne
ont à Berg. Hiftoire dé ce bâtiment. Comment les
négociansqui l’occupent ontaffeéléla vie de moines. III. 547.
CLONISSE, (Conchyl.) efpece de canne airifi nommée
à Marfeille. Ses différentes dénominations. Defeription de
fa coquille. Suppl. H. 467. ¿. Ses variétés. Animal qu’elle renferme.
Ibid. 468. a. Lieux où ce coquillage fe trouve. Sa fl-
tuation dans les fables. Ufage que les Negres en tirent. Sa
claffification. Ibid. b.
CLOPINEL, (Jean) fa patrie, ouvrage de cet homme
de lettres. X. 306. b. XI. 888. b. XII. 914* H en eft parlé
fous le nom de Jean de Meun.
CLOPORTE, (Hifl. nat.) Defeription de ces infeôes.
IIL 547. a. Maladies dans lesquelles ils font recommandés.
Avis de Juncker fur leur ufage. Maniéré d’en ufer & de
les préparer. Ibid, b,
1 p p p é