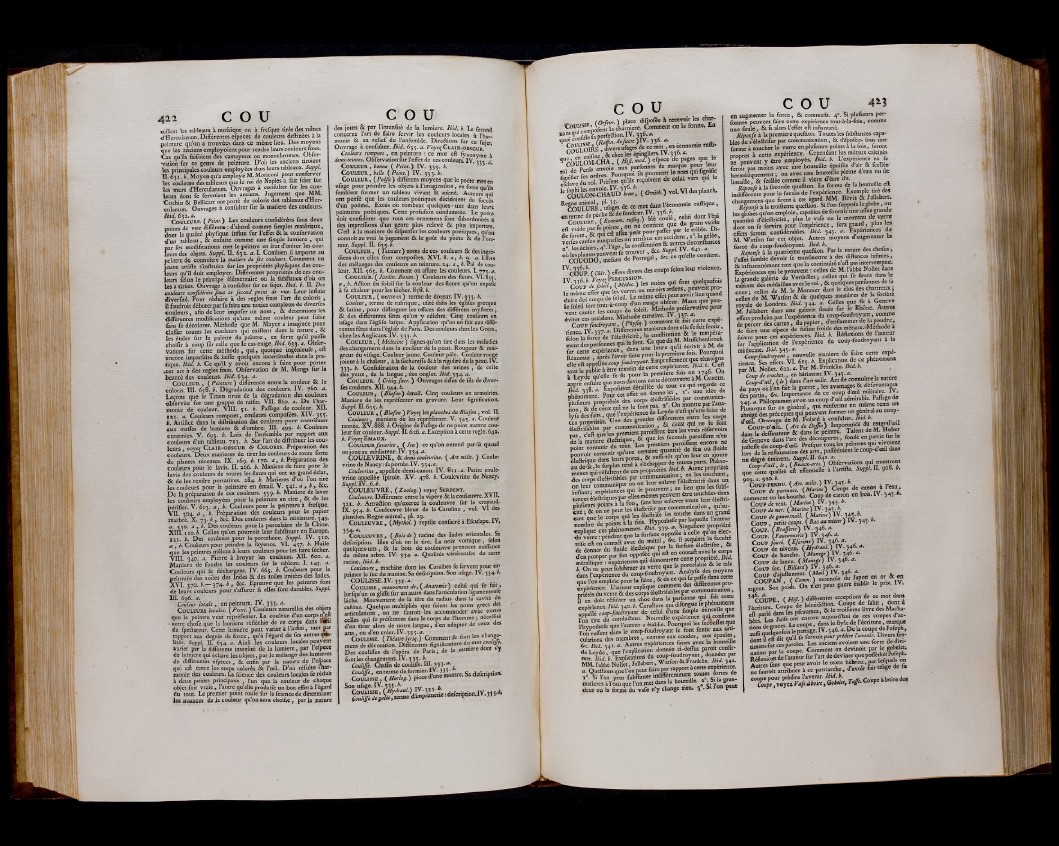
COU 4 2 2 uiffent les tableaux à mofaïque ou à frefque tirés des ruines
ti’Herculanum. Différentes eipeces de couleurs deftinées à la
peinture 2ue qu’on a trouvées dans ce même lieu. Des moyens les anciensemployoient pour rendre leurs couleursnxes.
las qu’ils faifoient des camayeux ou monochromes. Observation
fur ce genre de peinture. D’où les anciens tiroient
les principales couleurs employées dans leurs tableaux, Suppl.
H .M i. b. Moyen qu’a employé M.Moriconi pour conferver
les couleurs dis tableaux que Je roi de Naples a fan feter iur
les murs d’Herculanum. Ouvrages à confulter fur les couleurs
dont fe fervoient les anciens. Jugement que MM.
Cochin & Bellicart ont porté du colons des tableaux d Her-
oulanum. Ouvrages à confulter fur la matière des couleurs.
^ C o u leu r s . (Peint.) Les cotdeurs confidérées fous deux ile
jzr fes modifications met le peintre en état d’imiter les couleurs
des objets. Suppl. II. 63 a. a. I. Combien il importe au
peintre de coimoître la matière de fes couleurs. Comment un
jeune artifte s’inftruira fur les propriétés phyfiques des couleurs
qu’ü doit employer. Différentes propriété de ces couleurs
ielon le principe élémentaire ou la fubllance d’où on
les a tirées. Ouvrage à confulter fur ce fujet. Ibid. b. IL Des
couleurs confidérées fous ce fécond point de vue. Leur infinie
diveriké. Pour réduire à des réglés fixes l’art du coloris ,
il foudroit débuter par fe faire une notice complette de diverfes
couleurs, afin de leur impofer un nom , 8c déterminer les
différentes modifications qu’une même couleur peut fubir
fins fe décolorer. Méthode que M. Mayer a imaginée pour
daffer toutes les couleurs qui exiftent dans la' nature, &
COU des jours & par l’intenfitè de la lumière. Ibid. b. Le fecoftd
concerne l’art de feire fervir les couleurs locales à l’harmonie
& au relief de l’enfemble. Dire étions fur ce fujet.
Ouvrage à confulter. Ibid. 635. a. Voyc{ Clair-obscur.
Couleurs rompues , en peinture : ce mot eft fynonyme 4
demi-teintes. Obfervation fur l’effet de ces couleurs. IV. ■jî-» a
C o u le u r , bonne {Peint.) IV. 333. A.
C o u le u r , belle {Peint.) IV. 333. b.
C o u leu r , {Poéfie) différons moyens que le poète met en
ufage pour peindre les objets à l’imagination, en forte qu’ils
femblent former un tableau vivant oc animé. Auteurs qui
ont penfé que les couleurs poétiques décidoient du fuccès
d’un poème. Excès où tombent quelques-uns dans leurs
peintures poétiques. Cette profùfion condamnée. Le poète,
doit confidérer que tous ces omemens font fubordonnés à
des impreflions d’un genre plus relevé 8c plus important.
Ceft à la maniéré de difpenler les couleurs poétiques, qu’on
connoît au vrai le jugement 8c le goût du poète 8c de l’ora*
teur. Suppl. IL 63 5. b.
Couleur , ( Teinture) noms de ces- couleurs 8c des ingré*
diens dont elles font compofées. XVI. 8. a t b. 9. a. Effets
des mélanges des couleurs en teinture. 24. a, b. Pié de couleur.
XII. 565. b. Comment on affure les couleurs. 1. 775. a.
Couleur. ( Jardin. Botan. ) Couleurs des fleurs. VI. 855.
a, b. Aétion du foleilfur la couleur des fleurs qu’on expofe
à fa chaleur pour les fécher. 858. b.
x i imparfaite 8c laiffe quelques incertitudes dans la pratique.
Ibid. b. Ce qu’il y avoit encore à faire pour porter
,cet art à des réglés fixes. Obfervation de M. Mengs fur la
beauté des couleurs. Ibid. 634. a.
C o u le u r , ( Peinture ) différence entre la couleur 8c le
coloris. 1U. 658; b. Dégradation des couleurs. IV. 760. a.
Leçons que le Titien tiroit de la dégradation des couleurs
«bfervèe fur une grappe de raifin. VII. 860. a. De l’harmonie
de couleur. VIII. 51. b. Paffage de couleur. XIL
txx. a. Couleurs rompues, couleurs compofées. XIV. 353.
■A. Artifice dans la diftribution des couleurs pour contribuer
aux maffes de lumière 8c d’ombre. III. 499. b. Couleurs
ennemies. V. 693. b. Loix de l’enfemble par rapport aux
couleurs d’un tableau. 713. b. Sur l’art de diftribuer les cou-
ienrs, voye^ C la ir -o b scu r & C o lo r is . Préparation des
couleurs. Deux maniérés de tirer les couleurs de toute forte
rie plantes récentes. IX. 169. b. 170. a , b. Préparation des
couleurs pour le lavis. IL 266. b. Maniéré de faire pour le
lavis des couleurs de toutes les fleurs qui ont un grand éclat,
& de les rendre portatives. 284. b. Matières d’où l’on tire
les couleurs pour la peinture en émail. V. 341- a >f> &c‘
De la préparation de ces couleurs. 339. k Maniéré de laver
les couleurs employées pour la peinture en cire, 8c de les
btirifier. V . 613. a, b. Couleurs pour la peinture à frefque.
VII. 304. a , b. Préparation des couleurs pour le papier
marbré. X. 73. b , 8cc. Des couleurs dans la miniature. 349.
a. 3 30. a 9 b. Des couleurs pour la porcelaine de la Chine.
XIu. m b. Celles, qu’on .pourroit leur fubilituer en Europe.
X2i. b. Des couleurs pour la porcelaine. Suppl. IV. 510.
a ,' ¿. Couleurs pour peindre la fàyence. VI. 437. b. Huile
que les peintrés mêlent à leurs couleurs pour les faire fécher.
VIII. 340. A. Pierre à broyer les couleurs. XIL 600. a,
Maniéré de fondre les couleurs fur le tableau. I. 143. a.
Couleurs qui fe déchargent. IV. 66ç. b. Couleurs pour la
peinture des toiles dés Indes 8c des toiles imitées des Indes.
XVI. 370. ¿.— 374- b , 8cc. Epreuve que les peintres font
de leurs couleurs pour s’affurer fi elles-font durables. Suppl.
III. 696.*.
Couleur locale, . en peinture. IV. 333. a.
Couleurs locales. {Peint.) Couleurs naturelles des objets
que le peintre veut repréfenter. La couleur d’un corpsneft
• autre choie que la lumière réfléchie de ce corps dans ¥mi
du fpeâateur. Cette lumière peut varier à l'infini, tant par
rapport aux degrés de force, qu’à l’égard de fes autres qualités.
Suppl. H. 634. a. Ainfi -les couleurs locales peuvent
varier par la différente intenfité de la lumière, par l’elpece
de lumière qui éclaire, les objets, par le mélange des lumières
de différentes efpeces, 8c enfin par la nature de l’efpace
qui eft entre les corps colorés 8c- l’oeil. D’où réfulte 1 harmonie
des couleurs.JLa fcience des couleurs locales fe réduit
à deux points principaux , l’un que la couleur de chaque
objet foit vraie, l’autre qu’elle produife un bon effet à l’égard
du tout. Le premier point foule fur la fcience de déterminer
les .nuances de la couleur qu’on aura choifie, par la nature
C o u leu r , ( mettre en ) terme de doreur. IV. 333. ¿.
Couleurt terme de rubrique, ufité dans les églifes grecque
8c latine, pour diftinguer les offices des différons myfteres,
8c des différentes fêtes qu’on y célébré. Cinq couleurs en
ufage dans l’églife latipe. Application qu’on en fait aux différentes
fêtes dans l’édife de Paris. Des couleurs chez les Grecs,
chezlesAnglicans.1V. 333. b.
C o u le u r , {Médecine) fignesqu’on tire dans les maladies
des changemens dans la couleur de la peau. Rougeur 8c maigreur
du vifage. Couleur jaune. Couleur pâle. Coulenr rouge
jointe à la chaleur, à la féchereffe 8c à la rigidité de la peau. IV.
333. b. Confidération de la couleur des urines , de celle
des yeux, de la langue, des ongles. Ibid. 334. a.
Couleur. ( Critig.facr. ) Ouvrages tiffus de fils de diverfes
couleurs. XII. 944. b.
C ou leu r , {Blafon) émail. Cinq couleurs en armoiries.
Maniéré de les repréfenter en gravure. Leur fignification;
Suppl. II. 635. b.
COULEUR , ( Blafon ) Voyc[ les planches du Blafon, vol. II.
Couleurs, maniéré de les repréfenter. V . 343 .a. Couleur
tannée. XV. 888. b. Origine de 1 ufage de ne point mettre couleur
fur couleur. Suppl. II. 626. a. Exception à cette réglé. 642.
b. Voye{ ÉMAUX.
Couleur favorite, {Jeu) ce qu’on entend par-là quand
on joue au médiateur. IV. 334. a.
COULEVRINE, 8c demi coulevrine. {Artmilit. ) Coule-
vrine de Nancy: fa portée. IV. 334.a.
Coulevrine , appellée demi-canon. IV. 811. a. Petite coule-
vrine appellée fpirole. XV. 478. b. Coulevrine de Nancy.
Suppl. ÏV. 6. b.
COULEUVRE, ( Zoolog. ) voye{ Serpent. _ _ _ _
Couleuvre. Différence entre la vipere 8c la couleuvre. XVIL
321. b. Attraction qu’exerce la couleuvre fur le crapaud.
IX. 934. b. Couleuvre bleue de la Caroline , vol. VI des
planches. Regne animal, pl. 29.
C o u leu v re , {Mythol.) reptile confacréàEiculape. 1Y.
^ C o u leu v re , {Boisde) racine des Indes orientales. Sa
defeription. Ifles d’où on la tire. La noix vomique , felon
quelques-uns, 8c le bois de couleuvre prennent naiffance
du même arbre. IV. 334. a. Qualités vénéneufes de cette
racine. Ibid. b.
Couleuvre, machine dont les Caraïbes fe fervent pour exprimer
le fuc du manioc. Sa defeription. Son ufage. IV. 334- b>
COULISSE. IV. 333. a.
COULISSE, mouvement dey {Anatomie) celui qui fe tait,
lorfqu’un os gliffe fur un autre dans l’articulation ligamenteufe
lâche. Mouvement de la tête du radius dans la cavité au
cubitus. Quelque multipliés que foient les noms grecs des
articulations, on ne fauroit les accommoder avec toutes
celles qui fe préfentent dans le corps de l’homme 3 néceiiite
d’en tirer alors de notre langue, a’en adopter de ceux des
arts, ou d’en créer.IV.333.a. \ . „1,
. Coulisse. {Théâtre lyriq.) Comment fe font le JL
mens de décoration. Différentes lignifications du m / •
Des couliffes de l’opéra de Paris; de la ma y
font les changemens. IV.33 fcb.
Coulifie. Chaflis de couuffe. I I I . a' ,
Z' I : /T*_ —— zt a ÎA.rtlîi'l'. IV. 243-
Son ufage. IV. 333. é- ,
cou
mm qui co P feai0I1, IV. 336.0.
’A ^ ’"i îp c r f o envoie aux'perfonnes de marque po™ J * “
Û ■i r i ordres Pourquoi ils prennent le nom quifigiufie
Î B S ï f c i PrkensJus; reçoivent de celm vers qut le
‘ g f t i â S S S S & ’ l - l ( Omith. JvoLVIdesplanch.
H S n S & W f ÿ “ mot dam Péeonomie rufliqne
m & î? Ë ^ ÎÊ È È Ê Ê Ê Ë blé coulé, celui dont Vé
■■■ ï contient^ que ™
C qrn “ ^
COU 423
i terme de pèche & de fondeur ^ 3 g dont f e
CootURE, (Ecçnom. I blé corne, ^
eft vuide par la . oourpaffer par le crible. Di- S iiS p li^ M " oe t e ^ S f d T p o r t u g a l , M « ï “’elle
i f g S Ê j ( Chir. ) effets divers des coups félon leur violence,
IVpsé.i^wjPEROTSSlON.^ font quelquefois
. ? UP Jffet ente'les verres ou miroirs ardens, pewentpropour
éviter “ S *cidero. “ f j Æ ' j S i e m f i « t cette expé-
¿„¡ere s dont elle fe fait fenur,
rieuce. IV. 337- n’xuuaÿfôcé i . conftitution 8c le tempéra-
felon la force de lékaricne. qneditM. Muffchenbroek
& ' } r o p V d e s coqps é M M U g . ^
00? * CC*i,nÏÏeTOèrience Se Leyde n’eft qu’une fuite de
lyfedesfaiK, quelexp Jiflferences entre les corps
ces propriétés. Une aes SJ»“ « alû ne le font
éleétrifables par commumca , les vrais réfervoirs
pas c’eft.que f « ‘ nS^paroifTen. n'en
de bmauere é le& iq u e ,^ q u ^
pomt contenir du rout Ij s P Pité de feu on fluide
pouvoir contenir qu une aud|.tat qu’on leur en ajoute
» e S u S tend à s’^ b a g j Au^proprlSè
en augmenter la force, 8c commetît. 4°. Si plufieurs per-
fonnes peuvent faire cette expérience tout-à-la-fois, comme
une feule , 8t fi alors l’effet eft inftantané.
Riponfe à la première queftion. Tomes les fubftances capables
tances éleônques par f )euÇ enjCTa: toute leur éleftn-
pMems pouus a 'a f° ^ par communication, qu’aucité;
8c on ne pcm l“ les touche dans un grand
tant que le coips Hvpotbefe par laquelle l’auteur
nombre de points i j g j f e S S M g WuUerc propriété
expbque ces p''in0™ )“ 'furface oppofée à celle qu’on élec-
rin verre ipendant que la lu pg- acquiert la faculté ilIlligpaMgJs
de s'éleétrifer par communication, 8c difpofées fous une
forme à toucher le verre en plufieurs points à la fols, feront
nroores à cette expérience. Cependant les métaux calcinés
ne oeuvent y être employés. Ibid. b. L experience ne fe
feroft pas moins avec uVbouteille épuifee. d’air 8c feeUêe
hermétiquement ; on avec une bouteille pleine deau ou de
limaille ? 8c fcellée comme il vient d être dit.
Riponfe à la fécondé queftion. La forme de la bouteille eft
indifférente pour le fuccès de l'expérience. Btemple nré: d«
changemens que firent à cet égard MM. Bévis&Jallab=rt.
Riponfe à la troifieme queftion. Si l’on fuppofeleglobe, ou
les globes qu’on emploie, capables de fournir une afîez grande
quantité d'élaSticité, plus le vafe ou le morceau de verre
dont on fe fervira pour l’expérience , fera grand, plus les
effets feront confidèrables. lbti. 343- «• Expériences de
M. Watfon fur cet objet. Autres moyens d augmenter la
force du coup-foudroyant Ibid. b. . . .
Riponfe à la quatrième queftion. Par la nature des chofes j
l’effet femble devoir fe tranfmettre à des diftances infimes,
8cinftantanémenttant que la continmténeft jMsimertompue.
Expériences qui le prouvent : celles de M. I abbé Nollm dans
Uarande galerie £ Verfailles; ceües qui fe firent dans le
Z E Z des médaüles avec le roi, 8c quelques perfonnes de fa
cour; celles de M. le Monnler dans le clos des chartreux,
celles de M. Watfon 8t de quelques Vf°nevt
royale de Londres. Ibid. 344- f- Çe“ « î , Rhône Aun»
M. Jallabert dans une galerie, firaée fur Te Rhône. Aunes
effets produits par l’expMience du coup-foudroyant, comme
de Krcer des cartes, du papier, d'enflammer de la poudre ,
de i^jre une efpece de fufion froide des métaux-^lethode à
fuitnè pour ces expériences. Ibid. b Réflemo,. de tare,ur
fur l’appUcation de l’expérience du coup-foudroyant à la
médecine. Ibid. 343. a. e*né-
Coup-foudroyant, nouvelle manière de foire cette rape
riencef ses effets. VI. 613. b. ,ce Phénomenc
par M. Nollet. 622. % Par M. Frankhn. Ibid. b.
r /• . j . . L . . on Kàtiinenr. IV. a.
prêtés du verre 8c des corps éleétrifables par com“ u“ ™“ “ •
§ en doit rèfulter un choc dans la pçrfonne 5“
expérience. Ibtd. 340. b. Caraftere qui difbngue le phénomène
appellé coup-foudroyant de celui d'une fimple énncelle que
rire ddeonduaenr. Nouvelle expérience qui confirme
î’hvDothefe que l’auteur a établie. Pourquoi 1« feçjuffes que
l'on reffent Sans le coup-foudroyanr fe font fennr aux am-
culanons des membres, comme aux coudes, aux épaul«,
B S B , . Autres expériences faites avec la boutedle
« E f B B î,'„-'l’exnlication donnée ci-deffus paroit confir-
J '.l ' j j , ’c Frolicarions du coup-foudroyant, données par
MM.l’abbéNolfet, Jallabert, W a r fo n & f^ m . Æ ^ 34^
a. Queftions que l’on peut fâire par rapp tout-certes de
■ Æ l’on peut fubLuer indifféremment tomes fort« de
X M. Collet, oaa. a.. .. .... * -----
Coup de crochet., en bâtiment.IV. 343.«.
Coup-d'uil, (Je) dans l'art imite. Art de connonrela aatüre
du pays où l’on foit la guerre, les avanrages &dèfavan,a|«
desuartis, «•c. Importance de ce coup dcçil militaire, iv .
34 t a . Philopoemen avoit un coup d’oeil admirable. Paffage de
Ihitarque fin ce général, qui renferme en même rems un
abrègé des préceptes quij.euvent former un géntel au conp-
d’^ f Ouvrage de M. Folard à confulter. Ibtd. b.
Coup-d’oeil. {ArttütDeftn) Imporance du cou^md
dans le deCSnateur 8c dans le peintre. Talent de M. Hnber
de Geneve dans l’art des découpures, fondé en partie fur la
iufteffe du coup-d’oeil. Prefque tous les peintres qrn vivoient
lors de la reftauranon des arts, poflédoient lecoup-dced dans
“ ¿ S w M S t -Ë™ 0 Obfervations qui montrent
que ettequriiri eft effendeUe' à l’ardfte. Suppl. U. 908. |
y°Coup-PiiRDU. (Art.mijlt.) IV-J4Ï- L J
COUP de partance. {Marine) Coups
comment on les bouche. Coup de canon en bois.IV. 343-*-
Coup de vent. (Ma.rmc)_tv. 345-
Coup de mer. { Marine ) 1V . 34V y
, Coup de gouvernail. ( Marine) IV. 345:
Coup , petits coups. {Bas au métier) IV. 343. b.
Coup. ( Brajferie) \V-_346- a.
COUP. {Fauconnerie) IV. 346. a.
Coup fouré. {Efcrme) IV. 346* f-
Coup de niveau. {Hydraul. ) IV■ 346- *
Coup de hanche. {Manege)YV. 346. *•
COUP de lance. {Mjmege) IV. 346. *
Coup fec. ( Billard) IV. 34^,-^- ^ ,
arCgent^onO poids. fOn rien— peu. gu edr“e éàtabh1'r? le p0rr-i x. IV.
34r/lilPE f m - ) différentes aceepdons de ce mot dan.
CUUl'fc» \ « 0 . . ¿j:Aion. Coupe de falur, dont il
l’éenture- Coup .. & le troifieme livre des MachaÛ
T t l cnrore’a^onrd’hmd. ces coupes d’ac-
% ¿ “ ices La coupe, dani le ftyle de l’écriture, marque
tions de grac . ^_e jy . o46. a. De la coupe de Jofeph,
domïeft’ dit qu’il & fervoitpeer pridlrc Iavenir. Diversfcn-
m^nsfur ces paroles. Les anciensavoient uneforte dedm-
^l,ü? oar la coupe. Comment on devinoit par le g«1« 1« ’
R éflexions de l’auteur fur l’art de deviner que poffédoit Jofeph-
K b fcns que peut avoir le texte hébreu, par « f e * «
« “ Soft a . S r i ce pam.rche, d’avoir U ufage de &