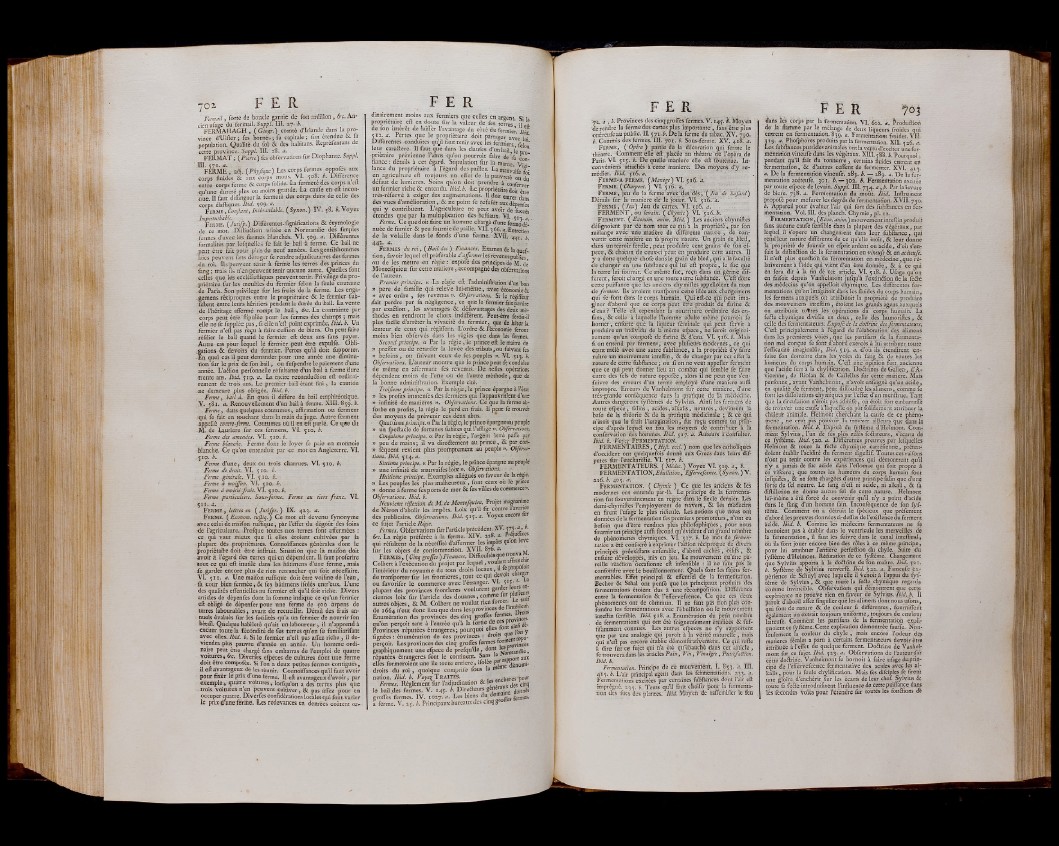
7 0 2 F E R
Fermait, forte de boucle garnie de fon ardillon, 6rc. Ancien
t
ufage du fermail; Suppl. III. 27. b.
FERMAHAGH , ( Géogr.) comté d’Irlande dans la province
d’Ulfter 5 fes bornes ; la capitale ; fon étendue 8c fa
population. Qualité du fol 8c des lubitans. Repréfentans de
cette province. Suppl. III. 28. a. . , _ 1 . .
FERMAT ; ( Fient) fes obfervations fur Diophante. Suppl.
11 FhSme' , iï\.'(PhyfV ' ) Les corRs, fcrn»es ;6® ?B “ “
corps fluides & aux corps mous. VI. î<j8. b. Différence
entre corps ferme & corps folide. La fermeté des corps n eft
qu’une dureté plus ou moins grande. La cadfe en eft inconnue.
Il faut diflinguer la fermeté des corps durs de cefle des
corps élaftiques. Ibid. 509. a. ■
F e r m e , Confiant,Inébranlable. ( Synon.) IV. 38. ¿.Voyez
Imperturbable. ■ ^ .
Ferme. ( Jurifp.) Différentes.fignificanons & étymologie
de ce mot. Diftinétion ulitée en Normandie des funples
fermes.d’avec fes fermes blanches. VI. 509. a. Différentes
formalités par lefquelles fe fait le bail à ferme. Ce bail ne
peut être fait pour plus-de. neuf années. Lés gentilshommes
laïcs peuvent fans déroger fe-rendre adjudicataires dés fermes
.du . roi. Ils'peuvent tenir à fèrfn'e les terres des princes du
fang ; mais ils n’en peuvent tenir aucune autre. Quelles font
celles que lés eccléfiaftiques peuvent tenir. Privilège du propriétaire
fur les meubles du fermier félon la feule coutume
de Paris. Son privilège fur les fruits'de la ferme. Les engà-
gemens réciproques entre le propriétaire & lé fermier fub-
liftent entre leitrs héritiers pendant la durée du bail. La vente
de l’héritage affermé rompt lé bail, &c. La contrainte par
corps peut être itipUlée pour les -fermes des 'champs ; mais
elle ne fe fupplée pas, fi elle n’eft point exprimée. Ibid. b. Un
fermier n’eft pas reçu à faire ceflion de biens. On peut faire
réfdier le bail quand le fermier eft deux ans fans payer.
Autre cas pour lèquel lé fermier peut être expulfé. Obti-
jations & devoirs du fermiër. Pertes qii’il doit fupporter.
j.n. quel cas il peut demander pour une année une diminution
fur le prix de fon bail, ou fufpendre le paiement d’une
année. L’a&iori perfonnelle réfnltanre d’un bail à ferme ‘dure
trente ans. Ibid. 310. a. La tacite reconduction eft ordinairement
de trois ans. Le premier bail étant fini, la caution
.aie demeure plus obligée, Ibid. b.
Ferme, bail à. En quoi il différé du bail emphitéotiquè.
V . 581. a. Renouvellement d’un bail a ferme. XIII. 859. b.
Ferme, dans quelques coutumes -, affirmation ou ferment
:qui fe fait en touchant dans la main du juge. Autre ferment
appelle contre-ferme. Coutumes où il en eft parlé. Ce que dit
-M. de Lauriere fur ces fermens. VI. 510. b.
Ferme des amendes. VI. 510. b. .
Ferme blanche. Ferme dont le loyer fe paie en monnoie
blanche. Ce qu’on enrendoit par ce mot en Angleterre. VI.
510. b.
Ferme d’une, deux ou trois charrues. VI. 510. b.
Ferme de.droit. VI. 310. b. ri
Ferme générale. VI. 510. b.
Fertnc à moiffon. VI. 510. b.
Ferme à moitié fruit. VI. 510. b.
Ferme particulière. Sous-ferme. Ferme au tiers franc. VI.
511. a. . ..
FERME , lettres en ( Jurifpr. ) IX. 423. a.
F e r m e . ( Econom. ruftiq.) Ce mot eft devenu fynonyme
aVec celui de maifon ruitique, pàrl’ëffet du dégoût des loins
<lé l'agriculture. Prefque toutes nos terres font affermées :
ce qui vaut mieux que fi elles étoient cultivées par la
plupart dés propriétaires. Connoiffancès générales dont le
propriétaire doit être inftruit. Situation que la maifon doit
avoir à l’égard des terres qui en dépendent. Il faut proferire
tout ce qui -eft inutile dans les bâtimens d’une ferme, mais
fe . garder encore plus de rien retrancher qui foit néceffaire.
VI. 511. a. Une maifon ruitique doit être voifine de l’eau,
• là. cour bien fermée, & fes bâtimens ifolés entr’êux. L’une
des qualités effentielles au fermier eft qu’il foit riche. Divers
articles de dépenfes dont la fomme indique ce qu’un fermier
eft obligé de dépenfer pour une ferme de 500 arpens de
terres labourables} avant de recueillir. Détail des frais annuels
évalués fur lés facilités qu’a Un fermier de nourrir fon
bétail. Quelque habileté qu’ait un laboureur * il n’apprend à
exciter toute la fécdndité de fes terres qu’en fe familiarifant
avec elles. Ibid. b. Si le fermier n’eft pas affez riche, il deviendra
.plus pauvre d’année en année. Ün homme ordinaire
peut être chargé fans embarras dé l’emploi de quatre
voitures, 6*c. Divefles efpèces de cultures dont une ferme
doit être compofée. Si l’on a deux petites fermes çontiguës,
il eft Avantageux de les réunir. Connoiffancès qu’il faut avoir
pour fixer le prix d une ferme. Il eft avantageux d’avoir, par
exemple, quàtre voitures, lorfqu’on a des terres plus qüe
•. trois, voitures n en peuvent cultiver, & pas âffez pour en
occuper quatre. Diverfes confidérations locales qui font, varier
le prix d une fërthe. Les redevances en denrées coûtent or»
F E R
dinairement moins aux fermiers que celles en argent. S‘ p
propriétaire eft en doute fur la valeur de fes terres ' il-a
de fon intérêt de laitier l’avantage du côté du fermier Ü f
Pertes que le propriétaire doit partager avec I
I«r
fel
Différentes conduites qifil faut tenir avec les fermiers fe
leur caraftere. 11 faut crue dans les claufes d’un bail le D°tt
•priétaire prévienne l’abus qu’on pourroit faire de Va c
fiance : détails a cet égard. Stipulation fur la marne.'
lance du propriétaire a l’égard des pailles. La mauvaife t '
en agriculture eft toujours un effet de la pauvreté ou d0*
défaut de lumières. Soins qu’on doit prendre à conferv **
un fermier riche & entendu. Ibid. b. Le propriétaire doit êt *"
très-réfervé à exiger des augmentations. Il doit entrer dan
des vues d’amélioration, ne point fe tefufét auxdépenfe<;
cjui y contribuent. L’agriculture ne peut avoir de fuccès
étendus que par la multiplication dès beftiaux. Vj. r r- a
Ferme. Ce que doit faire un homme chargé d’une ferme dénuée
de fumier & peu fournie de paille. V il. 366.4. Entretien
de la volaille dans le fonds d’une ferme. XVIÏ.- ’441. y
442. a.
F e r m e s du roi, ( Bail des) Finances. Examen de la question,
favoir lequel eft préférable d’ajfcrmerïes rëvënuspubliçs
ou de les méttre en régie : expbië des principes de M. de
Mônteiquieu fur cette matière, accompagné des obfervations
de l’auteur.
Premier principe. « La régie eft Tadminiftfation ‘d’un bon
» pere de. famille qui releve lui-même;, avec économie &
» avec ordre , fes revenus ». Obfervations. Si le régiflëur
/fait perdre par fa négligence, ce que le fermier fait Perdre
par exaction , les avantages & désavantages des deux méthodes
en rendront le choix indifférent. Peut-être ferûit-il
plus facile d’arrêtër la vivacité du fermier, que de hâter la
lenteur de ceux qui régiffeiir. L’ordre & l ’économie feront
moins bien obfervés dans les régies que dans les fermes.
Second .principe. « Par la régie ,1e prince eft. le-maître de
» .preffer ou de retarder -la levée des tributs, ou fuiYànt fes
» befoins, ou fuivant ceux de fes peuples ». VL.513. b.
Obfervations. L’auteur montre quë le prince peut fe conaitira
de même en affermant fes revenus. De--telles opérations
dépendent moins de l’une ou de l’autre méthode, que de
la bonne adminiftration. Exemple cité.
Troifieme principe. « Par la régie, le prince épargne à l’état
» les profits immenfes-.des fermiers qui Tappauvrmént d’une
» infinité de maniérés ». Obfervations. Ce que la ferme ab-
forbe en profits, la régie le perd en frais. 11 peut fe trouver-
des moyens de prévenir ces deux abus.
Quatrième principe, a Par la régie, le prince épargne au peuple
» un fpeâacle de fortunes fubites qui l’afflige ». Obfervation's.
Cinquième principe. « Par la régie, l’argent levé pàffe par
» peu de mains; il va direélement au prince, & par.con-
» féquent revient plus promptement au peuple j>. Obfervations.
Ibid. 314. a. _ '
Sixième principe. « Par la régie, lè prince épargne au peuplé
» une infinité de mauvaifes loix ». Obfervatiàns. • :
Huitième principe. Exemples allégués en faveur de la régie.
» Les peuples les plus malheureux, font cèux où lè prince
» donne à ferme fes ports de mer & fes villes de commerce*».
Obfervations. Ibid. b.
Neuvième réflexion de M. de Montefquieu. Projet magnanime
de Néron d’abolir les impôts. Loix qu’il fit contre 1 avarice
des publicains. Obfervations. Ibid. 513. a. Voyez encore iur
ce fujet l’article Régie. . ,
Fermes. Obfervations fur l’article précédent. XV. 57F a,? ‘
&c. La régie préférée à la ferme. XIV. 228. a. Préjudices
qui réfultent de la néceflité d’affermer les impôts qnon tev
Lur les objets de consommation. XVII. 876. u.
u r le s om e t s d e c o n iom m a n o n . a y xi. w/u. —
F e r m e s , rmu.-'— (Cinqgreffes)n\.\Finances. Difficultésqü
D if f i c u lt é s q u è tr^ ’ ’
C o lb e r t à l ’e x é c u t io n d u p r o je t par p a r lequel,l e q u e l , voulai--v ou lant
- .
l’intérieur x u ix cricu r du u u royaume ro y a u m e u de t tous m u s u droits iu i“ locaux,-----. j »! fe ,• Pr^rû^P
racr
de tranfporter fur les frontières, tout ce qui devoit
ou favorifer le commerce avec l’étranger. 5*5' 1 ,
plupart des provinces frontières voulurent garder -
ciennes loix fur l’article des douanes, comme fur p .
autres objets, & M. Colbert ne voulut rien *
de 1664 n’eut donc lieu que dans les provinces de 1 rjr0jlS
Enumération des provinces des cinq groflès nr‘oVjnCes.
qu’on perçoit tant à l’entrée qu’à la ferrie de ces p ^
Provinces réputées étrangères; pourquoi elles ion ^ y
lignées : énumération de ces provinces : droits qu
perçoit. Les provinces des cinq groffes fermes , ” ”jroVinces
graphiquement une efpece de prefqu’ile, dont W jm 0 fe 9
réputées étrangères font le continent, bans t rapport aux
elles formeroient une île toute entiere, ifolee P*: ^^dénomi-
droits du ro i, quoique comprife fous la ®
nation. Ibid. b. Voye^ T r a i t e s . -«¿hères 'pour
Fermes. Règlement fur l’adjudication & i|? • > . ¿¡¡jq
le bail .des fermes. V. 143. b. Direéleurs j 0nnés
grofles fermes. IV. 1027. a. Les biens du d rre9 famés.
à ferme. V. 2 3 . b. P rin c ip au x bureaux des cinq g™
F E R F E R 7 0 3
‘7 i. à , b. Provinces des cinq groffes fertiles. V. 143. i . Moyën
dereiidre la ferme des cartes plus importante , fans être plus
onéreufeau pUbtic.-II. 371.b. Delà ferme dti tàbac. XV. 790.
b. Commis des fermés. III. 701. b. Sous-ferme. XV, 418. a.
F e r m e , ( Opéra ) partië dè la décoration qui ferhie le
théâtre. Comment elle êft placée àu théâtre .‘dé'l’opéra, de
Paris. VI-. 513» b. De quelle manière elle eft ■fôüïè'nùè. In-
■convénreris attachés à Cëtte fiianiëre; Des mbÿens d’y remédier.
Ibid. 316. a. '
F e r m É-à f e r m e . (Manège) VI. 316. a.
F e r m e . ( Char peut. ) VI. 51‘6.' d.
F e r m e ; jeu de la fermè'aVefc'neScdésF(/^«.'Vé,‘A^>-iàf)
Détails fur la manière dè' le fôüef. VI. <16. "a.
F e r m e , ( Jéit) Jeu de cartes. VI.'316. d.
FERMENT, ou levaih. ( dhÿmie) VI. 316. b.
F e r m e n t . ( Econom. dnîm. Méd.) Les anciens chymiftcs
défignoient par 'ce hom tout cè quia la propriété’j par foii
mélange avec Une matière dé différente nature , dé 'çojir
vertir cette matière eh fa’prôpte nature. Un grain de hlëd,
dans un te>rolr fertile, peut prodùirb cènt gràinS'dè ; fon efpece,
& chacun dé ceux-ci péüt éh p'rcidùirë céht autres. Il
y a donc qùëlquè chofe dans le grain de bled, qui a-là faculté
de changer en une fubfiancé qui' lui êft propre, le ftïc què
la terre lui-fournit. Ce même fuc, reçu dans Un 'germe. «îfr
férent, feroit changé en une toute autre fubftânCë; C ’ëff dÔnc
cette puiflance que les anciens chyrtiiftés appellôiënt dù nbm
de ferment. Ils avoient tranfporté cette idée auX changemcns
qui -fe font dans le corps Humain. Qiii eft-cë qui p'éift imaginer
d’abçrd que ce corps -peut être produit de fariné &
d’eàiV? Telle eft cependant la nouftitùrè ordinaire des en-
fans, & celle à laquelle l’hbmthê adulte mêmè pourroit fo
borner-, enfortë que la liqiieur féïninâle 'qui jiéu't ferVir à
produire Un individu dé la même êfpece, ne feroit originairement
qu’un coinpofé de farine & d’eau. VI. 316. b. Mais
fi on entend par ferment, avec plufieürs 'modernés, cé qui
étant mêlé avec une autre fubftànce, a la propriété d’y faire
naître un mouvement inteftin , & de changer par cet effet là
nature dé cette fobftahce ; ou fi on ne veüt appellër ferment
que ce qui’peut donner lieu au combat qùi femble fe faire
entre des fels de nature oppofée, alors il ne pèiït que s’en-
fuivre des . erreurs d’un ternie èniployé d’iinè mànierë aufli
impropre. Erreurs de Vanhèlm'dht fur cette matière, d’ùne
très-grande conféquencë dans la pratiqué de la mé'décînc.
Autres dangereux fÿftêmés de SÿlviüS. Ainfi les ferment 'de
toute efpece , falihs, acides, alkalis, neutres , devinrent la
bafe dè la théorie & de là pratiqué ■médicinale ; & çe ^\u
n’étoit què le fruit rimagination, fut reçu cdmhfe ùn principe
d’après leqùèl on fixa lés mbÿenS de contribuer à la
confervàtion des hommes. Ibid. ^xy.'à. ÂutèUfS à'donfultër.
Ibid. b. -Voyez F f r m e n t a t iON.
FERMENT AIRES, (Hifl. éccl.) nom què lcscâ'tlioiîqû'es
d’occident ont quelquefois donné aux GrèCs dans leurs disputes
fur -l’euchariflie. VI. 317. b.
FERMENTATEURS. (Médec.) Voyez VI. 31b. a, l.
FERMENTATION,Ebullition, EJfcrvefcènce.(Synoh.) V.
âi6. b. 403. à.
F e r m e n t a t i o n . ( Chymïe ) Ce que les anciens & lés
modernes ont entendu par-là. Le. principe de la feriU'èÙfà-
tion fut fouvërainement en règne dâri's lè fïecle deïnier. Le‘s
demi-chymiftes Pemployerent de travéré, 8c le's Mdécîns
en firent l’ufage le plus ridicule. Les notions qUè n'ôtis ont
données de la rermèntation fes premîërs promoteurs, n’orit éù
befoin què d’êtrè rendues plus philofôphiqùes, pôür hbUs
fournir un principe aufli fécond qii évident d’un grand n'Onîbrè
de phénomènes chymiqUes. Vl. 317. b. Lè môt dè ferM'ri-
tation a été confacre à exprimer l’a'élioh féCipi’qque dè 'aivèrs
principes préexiftans eniemble , d’abord cachés , bififs, &
enfuite dévèlopf^s, mis eh jeu. Le mouvement qu’tfne fli-
reille réàétibn bccafionne eft infenfiblë : il nè faïit pà's lè
confondre avec lè bôuillonnement. Quels font les fûjèts fer-
mentablés. Effet principal 8c effentiel de là ’ferrrieiîtaftïori.
Becher 8c Sthal ont penfé qüe lès principaux prôâuifS dès
fermentations étbierit dûs à üiie r'écortipofition. Différèricfe
entre la fermentation & réffervèfcênce. Ce que ces ‘dènX
phénomènes ont de cômmun. Il nè fàUt pas n'on pliis 'Cbh-
fondre les fermèntations àvéc l’ébüUîtîon où le mo'ùyêiiieht
inteftin fenfiblè. Ibid. 318. a. Enumération dü petit nombre
de fermèntations qui ont été foîgnëufetnent étudiées 8c fuf-
fifammént connues. Les autres efpecës ne s’y ràppbrterit
que par une analogie qui paroîr à la vérité nàturelfe | mais
qui n’eft pas encore établie démoriftrativèmëht. Ce qui refte
à dire fur ce fujët qui n’a été qu’ébaüch'é dans Cet article,
fe trouvera dans lès articles Pain , Vin, Vinaigre, PutfèfaÙidn.
Ibid. b. .. c i '
Fermentation. Principe dè cè mùuVchlént. I. 853. d. III.
415. b. L’air principal agent dans lëà fèrhiëhtàtibns. 233. a.
Fermentations excitées par ccVtâiriês fiibftàhcéé dont l’air eft
imprégné. 23 c. I. Teins qu’il faut chdifir potir la fermentation
des fîtes des plantes. Ibid. M'oyeh fle Vâffeihbler le feu
dans 1« coi^s parala fermentation. VI.'602. ¡ ¡ ^roduéfiod
de la flamme par le mélange de deux liqueurs froides qui
entrent en fermentation 839. a. Fermehtatiôns froides. VII.
produits par la fermentation. Xll. *a6. g.
Les fùbftànces putrides animales Prit la vertu d’exciter Une fer-
me'ntâtio'rt vineufe dâhs les végétaux. XIII. 388. ¿. Fourquoi j
Ítendant qu’il fait du tonnerre , certains fluides entrent eii
ermentation, 8c d’autres ceffent de fermenter. XVI. 413.
a. De la fermentariòh vineufe. 283. b. — 289. a. De la fermentation
acéteufe. 301. b. — 3Ó2. b. Fermentation excitée
par tôütë efpccc de levain .Suppl. III. 734. a>b. Par la levure
dè biere. 738. a. Fermentation du moût. Ibid. Infiniment
pfbpôfê pour mefurer les degrés de fermentation. XVII.'730.
b. Appareil pour évaluer l’àir qui fort dés fubftances en ferr
mentanoti. Vol.III. dés platich. Chymie, pl. 12.
F e rm e n t átiov t(Ecoh.'qhim.) mouvement inteftin produit
fans âucune caufe fenfible dans la plupart des végétaux, par
lequel il s’opère un changement dans leur fubftànce, qui
rend leur nature différente de ce qu’elle étoït, 8c leur donne
la propriété de fournir Un éfprit ardent ou Acíde, d’où s’enr
fuit la diffinélion de la fermentation en vineufe 8c en acéteufe;
Il n’eft plus queffion ffè 'féfmèmâtibn en médecine ,que ré-
lativemènt à l’idée qui viènt d’ën êtrè donnée , 8c à ce qui
en fera dit à la fin dé Wt ‘ article. VI. 318.^. Ufage qu’on
en faifbit depuis Vanliehnbnt jyfqu’à l’exühâlon.Üe la fefté
des médècms qu’on appelloit chymique. Lés différentes ferr
mentations qii’on imáginoit dàhs lés fluides-du corps humain,
les fermëns auxquels^ôh attribüoit la propriété (Je produire
des mouveiheñs inteftins, étoient les grands âgens.àuxquels
on attribüoit toittes lès opérations du corps humain. La
fefte chymique diviféè en déux , celle 'dès hûmoriftes , Sc
celle des fernientateurs; Expo fé de la dd&rine des fermentateurs.
C’eft principalement à l’égard de l’élabbratióii 3;e| alimens
dans les prémierès vóiès, que lès partifans de là /fermenta--
tion mal conçue fe fpht. d’aBord exercés à lui attribuer toute
l’efficacité imaginable, Ibid. 519. a. d’oii ils étendirent en-
fuite fon domaine dans lès yoles'du 'fimk'dc de toutes les
humeurs du corps huitiain. Ç’cft ¿mb ópuiiòh fort, ancienne
que l’acide fert à la chÿlifitàtioh. Doilrines de Gallen , d’Â-
viçe'rihe -, de Riolàn 8c de ‘Caftëllus 'fur 'cette ma'tièrc. Mais
përfotihe, avant Vanhçimbht , n’avoitériïeignè qu’un a'eide,
en qualité dè ferment, pèüt diffotidre les àlimènsj comme fe
font les diffolùribnVçhÿniiqùëspàrréffèt’d’ùü menftrue; Tant
que la circulatibn n’étbit pas âcfniifé j oh etoit fort emb.arrafTé
dé trôuVer Une câme; àlaqiielle ôii pûVfolide.mërit attribuer la
chafei/r anímale. Helniònt enérenant la càùfe de ce phénomène,
né crut pas pouvoir, là trotivér aljlèiirs que dans la
fèrmehtàtiôh. Ibid. b. Expbfé du fyftèmç, anelmont. Comment
Sylvius, l’un dè fes plús zélés fcélatèurs, s’écarta de
çé fyftême. Ibid. 320. d. Différentes preuves pa'r lefquelles
Helmont 8c toute la reéle chyiüiqùe cartéfiennë, préteur
doièht établir l’acidité du ferment digèftif. Toutes ces raifons
n’ont pu tenir contre lès expériences qui démontrent qu’il
n’y a jamais de fuc àcide dans l ’eftomac qui foit propre à
ce vifcère ;. quë toutes les fiumërffs du corps humain font
infipiàes, 8c ne font chargées d’autre principe fafin que d’uné
fòrte dé fel neutre. Le fang h’éft ni acide, ni alkali, 8c fa
diftillâtibn he donné aucun fel dé cëtte nature. Helmont
lüi-même à été forcé de cóiivéñir qu’il n’y a point d’acide
dans lé. fang d’un homme fain. Inconféquence de fon fyf-
têmé. Cômmèht on à détruit le fpécieux que prèfentenc
d’abord les preuves données ci-deflùs de l’exiftence du ferment
àcide. Ibid. b. Comme les médecins fermentateurs ne fe
bornoient pas à établir dans le ventricule les merveilles de
là fermentation , il faut les fuivre dans le canal intetiinal,
où ils font jouer encore bien des rôles à cë même .principe,
pour lui attribuer rentière perféélion du chylé. Suite du
fyftême d’Helmonr. Réfutation de ce fyft’èine. Changement
que Sylvîus apporta à la doftrine de fôh maître. Ibid. 321.
b. Syftême de Sylvius rehVcrfé. Ibid. ^ 22. a. Fameufe expérience
dè Schùyl avec laquelle il Venoir à l’appui du fyf-
têmè de Sylvius, 8c que toute la feffc chyniique regarda
comme îrivincible. Obfervatiôhs qui déipòntrènt que çette
expérience ne jffôuvé rien en faveur de Sylvius. Ibid. p. Il
pàroît d’abord affez ïïngùlièr que les alfmèìis dont nous ufons,
qui font de nature 8c de coideur fi différentes , fou’rhifferit
également un extrait toujours uniforme, toujours de couleur
laitèufe. Commênt les partifans de la fermentation expîi-
quoient ce fyftême. Cette explication démontrée fauffe. Ñpn-
feulemërit ia couleur du cnyle , mais encore l’odeur des
matières fécales a paru à cèrtains fermentateurs devoir être
attribuée a l’effet ae quèlquè ferment. Doélrine de Vanhel-
mont fur ce fujet. Ibid. 323. a. Obfervations de fauteur fur
cëtte doélrihe. Vanhelmont fe bornoit à faire ufage du principe
de rëfférvèfcence fermentative des acides avec les alkalis
, pour la feule chylíficárion. Mais fes difçiples fe firent
une gloire, d’enchérir lur les écarts de leur chef. Sylvius 8ç
toute fa feÔè iritrbduifirent l’influence de cette puiflance dans
lés -fécondes voies pouf l'étèndrè fur toutés les fonctions de