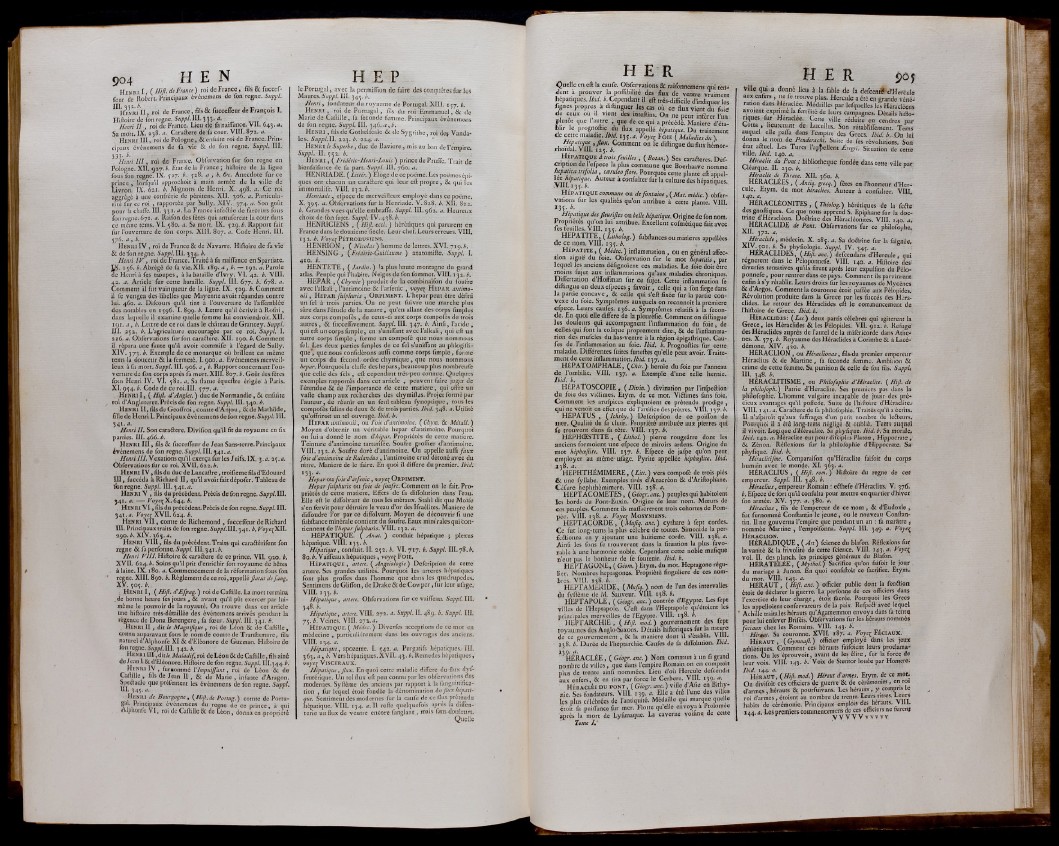
904 H E N
H£M RI I ( f f i f l , Je France ) roi de F ran ce, fils & fuccef-
feur de Robert. Principaux ívénemens de fon regne. S u f f i .
III f o i b. : '
k îN iii H , roi de France, fils & fucceffeur de F rançois I.
Hifloirc de fon regne. S u p pl.III. 333-<». ,
Henri I I , roi de France. Lieu de fanaiflance. VII. 643.0.
Sa mort. IX. 138. a. Caraâere de fa cour. VIII. 872. a.
Henri I I I , roi de Pologne, & enfuite roi de France. Principaux
événemens de fa v ie & de fon regne. S uppl. III.
333' *
Henri 111, roi de France. Obfervation fur fon regne en
Pologne. XII. 9 17 . b. Etat de la France ; hiftoire de la ligue
fous fon regne. IX. 5,0:7. b.. 528. a , b. & c . Anecdote fur ce
prince , lôrfqu’il approchoit à main armée de la v ille de
Livron. IX. Ô21. A ’Mignons de Henri. X. 498. a. C e roi
aggrégé à une confrérie de pénitens. XII. 306. a. Particularité
fur ce roi , rapportée par Sully. X IV . 374. a. Son goût
pour la clíaite. III. 331. a. La France infeiléé de farceurs fous
fou regne. 671. a. Ilaifon des fêtes qui amuferent la cour dans
ce même tems. V I . 580. a. Sa mort. IX. 529. b. Rapport fait
fur l’ouverture de fon corps. XIII. 807. a. Code Henri. III.
5 76.. a , b.
Henri I V , roi de France & de Navarre. Hiftoire de fa vie
8c de fon regne. S u p p l.W i. 334. b.
Henri I V , roi de France. T raité à fa naiffance en Spartiate.
JX. 156. b. Abrégé de fa vie. XII. 189. <*, b. — 192. a. Parole
de Henri à fes troupes, à la bataille d’Iv ry . V I . 42. b. V I I I .
42. a. Article fur cette bataille. Suppl. l l l . 6 7 7 . b. 678. a.
Comment il fut vainqueur de la ligue. IX . 520. b. Comment
il fe vengea des libelles que Mayenne avoit répandus contre
lui. 460. a. Difcours qu’il tint à l’ouverture de l’affemblée
des notables en 1596. I. 899. b. Lettre qu’il écrivit à R o fn i,
dans laquelle il examine quelle femme lui conviendroit. X II.
19 1. a , b. Lettre de ce roi dans le château de G rancey. Suppl.
l f l . 252, b. L ’agriculture encouragée par ce roi. Suppl. I.
2 16 . a . Obfervations fur fon caraéterc. X II. 190. b. Comment
il répara une faute qu’il avoir commife à l’égard de Sully.
X IV . 373. b. Exemple de ce monarque où brillent en même
tems la dou.ceur 8c la fermeté. 1. 900. a . Evénemens merveilleux
à fa mort. Suppl. III. 906. a , b. Rapport concernant l’ouverture
de fon corps après fa mort. X III. 807. b. Goût des fêtes
fous Henri IV . V i . 581. a. Sa Hat ne équeftre érigée à Paris.
XI. 954. b. Code de ce roi. III. 577. a.
H enri I , ( H ijl. d ’Ang le t. ) duc de Normandie, 8c enfuite
roi d’Angleterre. Précis de fon regne. Suppl. III. 340. b.
H en ri I I , fils de G co ffro i, comte d’A n jo u , 8cde M athilde,
fille de Henri 1. Principaux événemens de Ion regne. Suppl: 111.
3 4 1 .a .
Henri I I . Son caraéterc. Divifion qu’il fit du royaume en fix
parties. III. 466. b.
H en r i I I I , fils 8c fucceffeur de Jean Sans-terre. Principaux
événemens de fon regne. Suppl. III. 34 1 .4.
Henri I I I . Vexations qu’il exerça íu r le s Juifs. IX. 3. a. 25.a .
Obfervations fur ce roi. X V II. 6 2 2 . b.
H enri I V , fils du duc de Lancafire, troifieme fils d’Edouard
I I I 1 fuccéda à Richard I I , qu’il avoit fait dépofer. Tableau de
'fon regne. Suppl. III. 341. a.
Hen ri V , fils du précédent. Précis de fon regne. Suppl. III.
341. a. — Voye^ X . 644. b.
Henri V I , fils du précédent. Précis de fon regne. Suppl. III.
341. a. Foyer X V II. 624. b.
Hen ri V u , comte de Richemond , fuccefieur de Richard
III. Principaux traits de fon regne. Suppl.III. 341. b. V o y e (X II.
290. b. X lV . 365. a.
H en ri V I I I , fils du précédent. Traits qui caraétérifent fon
regne 8c fa perfonne. Suppl. III. 341. b.
Henri V i f t . H iftoire oc cara ¿1ère de ce prince. V I I . 920. b.
X V I I . 624. b. Soins qu’il prit d’enrichir fon royaume de bêtes
à laine. IX . 180. a. Commencement de la réformation fous fon
regne. XIII. 890. b. Règlement de ce ro i, appellé Jlatut de fan g .
X V . 303. b. ,
; H enri I , ( H ijl. d'E fpag . ) roi de Cafiille. La mort termina
..de bonne heure íes jours , & avant qu’il pût exercer par lui-
même le pouvoir de la royauté. On trouve dans cet article
une hifioirc très-détaillée des événemens arrivés pendant la
régence de Dona Berengere, fa feeur. Suppl. III. 341. b.
, Henri I I , dit le Magnifique , roi de Léon & de Cafiille f
connu auparavant fous le nom de comte de Tranfiamare, fils
naturel d Alphonfe X I & d’Eléonore de Guzman. Hiftoire de
fon regne. Suppl. 111. 342. b.
Henri I I I , dit le M a la d i f roi de Léon 8c de C a fiille, fils aîné
de Jean 18c d’Eléonore. Hiftoire de fon regne. Suppl. III.344. b.
H enri IV , furaommé Ylmpuijfant, roi de Léon 8c de
Cafiille , fils de Jean 11, 8c de Marie , infante d’A ragon.
Spectacle que préfentent les événemens de fon regne. Su ppl:
UI. 343. *.
• B l i f f f Ç Bourgogne, (H ift .d e P or tug.) comte de Portugal.
Principaux événemens au regne de ce prince, à qui
Alphonfe V I , roi de Cafiille 8c de L éon , donna en -propriété
HEP le Portugal, avec la permiflion de faire des conquêtes fur les
Maures. Suppl. III. 345. b.
H e n r i, fondateur du royaume de Portugal. XIII. 137. b.
H enri , roi de Po r tu g a l, fils du roi Emmanuel, 8c de
Marie de C a fiille , fa féconde femme. Principaux événemens
de fon regne. Suppl. III. 346 . a t b.
H en ri , fils de Gothelieale 8c de S y g r ith c , roi des Vandale
s . S u p p l .l l . 223. b. 224. a.
H en r i le Superbe, duc 'de B a v iè re , mis au ban de l’empire.
Suppl. II. 532. b.
H enri , ( Frédéric-Hcnri-Louis ) prince de Prufic. Trait de
bicnfaifancc de la part. Suppl. III. 760. a.
HENRI A D E . ( Littér. ) Eloge de ce poëmc. Les poëmcs épiques
ont chacun un caraéterc qui leur cft propre, 8c qui les
immortalité. VIII. 132. b.
Henri,idc , efpecc de merveilleux employé dans ce poëmc.
X. 393. a. Obfervations fur la Henriade. V/828. b. XII. 822.
b. Grandes vues qu’elle embrafie. Suppl. 111.9 62 . a. Heureux
choix de ibn fujet. Suppl. I V .438.b.
HENRICIENS , (H i j l . e c c l .) hérétiques qui parurent en
France dans le douzième fiecle. Leur chef. Leurs erreurs. VIII.
132. b. Voyez PÉTROBUSIENS.
H E N R IO N , ( N ico la s ) homme de lettres. X V I . 7 19 .b .
HEN SING , ( Frédéric-Guillaume ) anatomifte. Suppl. I.
410. b.
H E N T E T E , ( Jardin. ) la plus haute montagne du grand
atlas. Peuple qui 1 habite. Neiges de fon fommet. VIII. 132. b.
HE PAR , ( Chymie ) produit de la combinaifon du loufre
avec l’a lk a li, l’ântimoinc 8c l’arfenic , voye{ H e p a r antimo-
n i i , H e p a r fulphuris , O r p im e n t . L ’hepar peut être défini
un ici à trois parties. O n ne peut fuivre une marche plus
sûre dans l’étude de la nature, qu’en allant des corps fimplcs
aux corps compofés, de ceux-ci aux corps compotes de trois
au tre s, 8c fuccefiivement. Suppl. III. 347. b. A in fi, l’a c id e ,
qui eft un corps fimplc, en s’unifiant avec l’alkali, qui cft un
autre corps fimplc , forme un compofé que nous nommons
fel. Le s deux parties fimples de ce fel s’unifiant au phlogifti-
que*, que nous confidêrons aufii comme corps fimple, forme
un corps du fécond/ ordre ch ymiqu e, que nous nommons
hepar. Pourquoi la clafie des hepars, beaucoup plus nombreufe
que celle des f c l s , eft cependant trés-peu connue. Quelques
exemples rapportés dans cet article , peuvent faire juger de
l ’étendue 8c de l’importance de cette matière, qui offre un
vafte champ aux recherches des chymifizs. Projet formé par
l’auteur, de réunir en un feul tableau fynoptique, tous les
compofés falins de deux 8c de trois parties. Ibid. 348. a. Utilité
qu’offriroit un tel ouvrage. Ibid. b.
H e pa r antimonii, ou Foie d'antimoine. ( Chym. 8c M ita ll. )
Moyen d’obtenir un véritable hepar d’antimoine. Pourquoi
on lui a donné le nom àèhépar. Propriétés de cette matière.
Teinture d’antimoine tartarifée. Soufre grofiier d’antimoine.
V I I I . 132. b. Soufre doré d’antimoine. O n appelle aufii f a u x
f o i e d'antimoine de R u lan d u s , l’antimoine crud détoné avec du
nitre. Maniéré de le faire. En quoi il différé du premier/ Ibid.
13 3 .« . #
Hepar ou f o ie d a r fe n ic , yoye[ ORPIMENT. ,
Hepar fulphuris ou f o ie de foufre. Comment on le fait. P ropriétés
de cette matière. Effets de fa diffolution dans l’eau.
Elle eft le difiolvant de tous les métaux. Stahl dit aue Moiïc
s’en fer vit pour détruire le veau d’o r des Ifraélites. Maniéré de
diffoudre l’or par ce difiolvant. Moyen de découvrir fi une
fubftance minérale contient du foufre. Eaux minérales qui Contiennent
de l’hepar fulphuris. NWS.. 132. a.
H É P A T IQ U E . ( A n a t. ) conduit hépatique ; plexus
hépatique. VIII. 133. b.
Hépatique, conduit. II. 232. b. V I . 7 1 7 . b. Suppl. III. 78. b,
80. b. Vaifieaux hépatiques, voyez F o ie .
H é p a t iq u e , artere. ( Angeiologie ) Dcfcriprfon de cette
artere. Scs grandes utilités. Pourquoi les artères hépatiques
font plus grofics dans l’homme que dans les quadrupèdes.
Scntimcns de G liffon, de Drak c 8c de C ow p c r , fur leur ufage.
V I I I . 13.3. b.
Hépatique, artere. Obfervations fur ce vaifleau. Suppl. III.
348. b.
Hépatique, artere. V III. 272. a. Suppl. II. 489. b. Suppl. III.
75. é. Veines. VIII. 27a. d.
H é p a t iq u e . ( Médec. ) Diverfes acceptions de ce mot en
médecine , particulièrement dans les ouvrages des anciens.
V I I I . 134. a.
Hépatique, apozeme. I. 542. a. Purgatifs hépatiques.- III.
363. a y b. Vers hépatiques. X V I I . 43. b. Remèdes hépatiques,
voyet V is c é r a u x .
Hépatique, f lu x . En quoi cette maladie différé du flux dyf-
fentérique. Un tel flux eft peu connu par les obfervations des
modernes. Syftémc des anciens par rapport à la fanguinifica-
tion , fur lequel étoit fondée la dénomination de f lu x hépatique.
Sentiment des modernes fur la caufe de ce flux prétendu
hépatique. VIII. 134. a. I l refte quelquefois^ après la difien-
terie un flux de ventre encore fanglant, mais fans douleurs.
• Qu elle
HER Q u e lle en eft l i caufe. Obfervations & raifontleUtens du! teii-
<lcm à prouver la poffibilité des flux de ventre vraiment
hépatiques. Ibid. ¿.Cependant ¡1 eft très-difficile d’indiquer les
" fin es propres à diftinguer les cas où ce flux vient du foie
de c eu x ou il vient des intefllns. On ne peut inférer l’un
plutôt que 1 autre , que de ce qui a précédé. Maniéré d’établir
le prognoflic du flux appellé hépatique. D u traitement
«le cette maladie. Ibid. 1 3 5 ... V o y ,t F o ie ( Maladies du ).
r h o ïd f r v ïn on le diftingue du flux hémor-
H é p a t iq u e d ira is f e u i ll e s , ( Botan. ) Ses carafteres. Déf-
cription de l’efpece la plus commune que Boerhaave nomme
h a m r n c r ijo lia , curuleo flore. Pourquoi cette plante eft appel-
lé e hépatique. Au teu r à confulter fur la culture des hépatiques.
V I I I . 13 3. b. r B,
H é p a t iq u e commune ou de fo n ta in e , ( M a t. médic. ) obfervations
fur les qualités qu’on attribue à cette plante. V I IL
13 3 . b.
Hépatique dcsfleurifles ou belle hépatique. Origine de fon nom.
Propriétés qu’on lui attribue. Excellent cofmétique fait avec
le s feuilles. V I I I . 1 3 3. b.
H E P A T IT E , (L i th o lo g .) fubftances ou matières appellées
de ce npm. V I I I . 133. b. t
H é p a t i t e , ( Médec. ) inflammation, ou en général affection
aiguë du foie. Obfervation fur le mot nepatitis, par
lequel les anciens défignoient ces maladies. L e foie doit être
îîiîÎ i15 ,ie* aux inflammations qu’aux maladies chroniques.
D iflc rtîtion d Hoffman fur ce fujet. Cette inflammation fe
diftingue en deux efpeces ; fa v o i r , celle qui a fon fiege dans
la partie co n c a v e , 8c celle qui s’eft fixée fur la partie conv
e x e du foie. Symptômes auxquels on reconnoît la première
efpece. Leurs caufes. 136. a. Symptômes relatifs à la fécondé.
En quoi elle différé de la pleurefie. Comment on diftingue
le s douleurs qui accompagnent l’inflammation du fo ie , de
celles qui font la colique proprement dite., 8c de l’inflammation
des mufcles du bas-ventre à la région épigaftrique. Caufes
de l’inflammation au foie. Ibid. k. Prognoftics fur cette
maladie. Différentes fuites funeftes qu’e lle peut avoir. Traitement
de cette inflammation. Ibid. 137. a.
H É P A T OM PH A L E , (C h ir .\ hernie du foie par l’anneau
de l’ombilic. V I IL 137. a. Exemple d’une telle hernie.
Ib id. b.
H É P A T O S C O P IE , ( D iv in . ) divination par l’infpeâion
du foie des viélimes. Etym. de ce mot. V iâ im e s fans foie,
Comment les arufiùces expliquoient ce prétendu prodige ,
qui ne venoit en effet que de l’artifice des prêtres. VIII. 137. b.
H É P A TU S , ( I c h t h y .) Defcription de ce poiffon de
mer. Qualité de ià chair. Propriété attribuée aux pierres qui
fe trouvent dans fa tête. V IU . 137. b.
HÉPHÛESTITE , ( Lith ol. ) pierre rougeâtre dont les
anciens formoient une efpece de miroirs araens. Origine du
mot héphafiite. VIII. 137. b. Efpece de jafpe qu’on peut,
employer au même*ufage. Pyrite appellée héphafiite. Ibid.
1I38. a.
H E PH TH ÉM IM E R E , (L it t .'S vers compofé de trois piés
& tine fyllabe. Exemples tirés d’Anacréon 8c d’Ariftophane.
Cé fu re hcphthémimcrc. VIII. 138. a.
H E P T A C O M E T E S , (G éo g r .a n c .) peuples qui habitoient
les bords du Pont-Euxin. Origine de leur nom. Moeurs de
ces peuples. Comment ils maffacrerent trois cohortes de Pompée.
VIII. 138. a. Voyez MOSYNIENS.
H E P T A C O R D E , (M u f lq . a nc.) cythare à fept cordes.
C e fut long-tems la plus célébré de toutes. Simonide la per*
fcélionna en y ajoutant une huideme corde. VIII. 1381 a.
Ainfi les fons fe trouvèrent dans la fituation la plus favorable
à une harmonie noble. Cependant cette noble mufique
n’eut pas le bonheur de fe foutenir. Ibid. b.
H E P T A G O N E , ( Géom. YEtym. du mot. Heptagone régulier.
Nombres heptagones. Propriété finguliere de ces nombres.
V I I I . 138. *. .
H E P T AM E R ID E , (M u flq . Y nom de l’un des intervalles
du fyftême de M. Sauveur. VÎII. 138. b.
FIEPT A P O L E , ( Géogr. a n c.) contrée d’Egypte. Les fept
v illes de l’Heptapole,. C ’cft dans l’Heptapole qu’étoient les
principales merveilles de l’Egypte. VIII. 138. b. -
H E P TAR CH IE , ( H iß . mod. ) gouvernement des fept
royaumes des Anglo-Saxons. Détails hiftdriques fur la nature
de ce gouvernement, 8c la maniéré dont il s’établit. VIII.
138. b. Durée de l’hcptarchic. Caufes de fa diffolution. Ibid.
H É R A C L É E , ( G éogr. anc. ) Nom commun à un fi grand
nombre de v ille s , que dans l’empire Romain on en comptoit
plus de trente ainfi nommées. Lieu d’où Hercule defeendit
aux enfers, 8c en tira par force le Cerbere. VIII. *39* *•
H é r aCLÉe du p o n t , ( Géogr. a nc.) ville d’A fie en Bithy-
nic. Ses fondateurs. V IIL 139. 1 Elle a été l’une des villes
les plus célébrées de l’antiquité. Médaille qui marque quelle
étoit fa puiffancefur mer. Flotte qu’elle envoya à Ptolomée
après la mort de Lyfimaque. La caverne YOtune, de cette
Tome I .
H E R joj
Ville q u i,a donné lieu à la fable de la defcent&d’Hercule
aux,enfers , ne fe trouve plus. Hercule a été en grande vénération
dans Heraclée. Médailles par lefquelles les Héracléens
avoient exprimé la fertilité, de leurs campagnes* Détails hifto-
nques, fur Héraclée. Cette ville réduite en cendres par
Cotta , lieutenant de Lucullus. Son rétabliflement. Tems
auquel elle paffa dans l’empire des Grecs. Ibid. b. O a lui
donna^le.nom de>. Penderachi. Suite de fes révolutions. Son
îfi* es ^ urcs 1 appellent Éregri. Situation de cette
ville. Ibid. 140. a.
Héraclée du P ont : bibliothèque fondée, dans cette ville par
Cléarque. IL 230. b. r
Héraclée de Thrace. XII. 380. b.
H É R A C L É E S , (A n t iq . grecq.) fêtes en l’honneur d’Her-
cule. Etym. du mot héraclées. Auteur à confulter. VIII,
140. a.
H É R A C L É O N IT E S , (T h é o log .) hérétiques de la fefte
desgnoftiques. C e que nous apprend S. Epiphane fur la doc-
tnne dHéracléon. Doélrine des Héracléonites. VIII. 140. a .
H E R A CL ID E de Pont. Obfervations fur ce philofophe,
XII. 372. a.
Héraclide, médecin. X. 285. a. Sa doélrine fur la faignée.
X IV . 501. b. Sa phyfiologie. Suppl. IV . 343. a.
H É R A C L ID E S , ( H ijl. anc. ) defeendans d'Hereule, qui
régnèrent dans le Péloponnefe. VIII. 140. a. Hiftoire des-
diverfes tentatives qu’ils firent après leur expulfion du Péloponnefe
, pour rentrer dans ce pays. Comment ils parvinrent
enfin à s’y rétablir. Leurs droits fur les royaumes de Mycènes
8c d’Argos. Comment la couronne étoit paffée aux Pélopides.
Révolution produite dans la Grece par les fuccès des rléra-
clides. Le retour des Héraclides eu le commencement de
l’hiftoire de Grece. Ibid. b.
HÉRACLIDES: ( L e s ) deux partis célébrés qui agitèrent la
G re c e , les Héraclides 8c les Pélopides. V II. 9 12 . b. Refuge
des Héraclides auprès de l’autel de la miféricorde dans Athènes.
X. 373. b. Royaume des Héraclides à Corinthe 8c à Lacé-
démone. XIV . 420. b.
H É R A C L ION , ou Héraclionas, fils- du premier empereur
Héraclius 8c de Martine, fa fécondé femme. Ambition 8c
crime de cette femme. Sa punition 8c celle de fon fils. Suppl*
III. 348. b.
HÉRACLITISME , ou Philofophie d'Heraclite. ( Hijl. d t
la ph ilofoph.) Patrie d’H eradite. Ses premiers pas dans la
philofophie. L ’homme vulgaire incapable de jouir des précieux
avantages qu’il poflede. Suite de l’hiftoire d'Héraclite.
V I I I . 141 .a . Caraélere de fa philofophie. Traités qu’il a écrits.
I l n’afpiroit qu’aux fuffrages d’un petit nombre de le&eurs.
Pourquoi il a été long-tems négligé 8c oublié, Tems auquel
il vivoit. Logique d’Héraclite. Sa phyfique. Ibid. b. Ss morale*
Ibid. 142. a. Héraclite eut pour diiciplcs P laton, Hippocrate
8c Zénon. Réflexions fur la philofophie d’Hippocrate. Sa
phyfique. Ibid. b.
Héraclitifme. Comparaifon qu’Héraclite faifoit du corps
humain avec le monde. X L 363. a.
HÉRACLIUS , (H i j l . rom. ) Hiftoire du regne de cet
empereur. Suppl. l u . 348. b.
Héraclius, empereur Romain ; eéthefe d’Héraclitis. V . 376.
b. Efpece de fort qu’il confulta pour mettre en quartier d’hiver
fon armée, X V . 377. a. 380. a.
Hé ra cliu s, fils de l’empereur de ce nom , 8c d’Ëudoxie ,
fut furnommé Conftantin le jeun e, ou le nouveau Conftan-
tin. Il ne gouverna l’empire que pendant un an : fa marâtre,
nommée Martine , l’empoifonna. Suppl. III. 349, a. Voyeç
HÉRACLION.
H É R A LD IQ U E , ( A r t ) fcience du blafon. Réflexions fur
la vanité 8c la frivolité de cette fcience. VIII. 143. a. Voyeç
vo l. II. desplanch. les principes généraux du Blafon.
H É R A T E L É E , (M y th ç l .) Sacrifice qu’on faifoit le jour
du mariage à Junon. En quoi confiftoit ce facrifice. Etym*
du mot. VIII. 143. a. "
H É R A U T , ( H ijl. anc. ) officier public dont la fonction
étoit de déclarer la guerre. La perfonne de ces officiers dans
l’exercice de leur Charge, étoit facrée. Pourquoi les Grec9
les appelloient confervateurs de la paix. Refpeét avec lequel
* Achille traita les hérauts qu’Agamemnon envoya dans fa tenta
pour lui enlever Briféis. Obfervations fur les héraut9 nommés
féc iau x chez les Romains. VIII. 143. b.
Héraut. Sa couronne. X V il. 187. a, Voyeç FÉCIAUX.
HÉRAUT , ( Gymnafi. ) officier employé dans les jeux
athlétiques. Comment ces hérauts faifoient leurs proclamations.
On les éprouvoit, avant de les é lire , fur la force de
leur voix. VIII. 143. b. Voix de Stentor louée par Homère.
Ibid. 144. <*• • _ , :
H é r a u t , (H i j l . mod.) Héraut darmes. Etym. de ce mot.
On divifoit ces. officiers de guerre 8c de cérémonies, en ro*
d’a rmçs, hérauts 8c pourfuivans. Les hérauts, y compris le
roi d’armes, étoient au nombre de trente. Leurs titres. Leurs
habits de cérémonie. Principaux em p lo is des hérauts. V I I I .
144. a, Les premiers commencemens de « sofficie rs ne fureni: