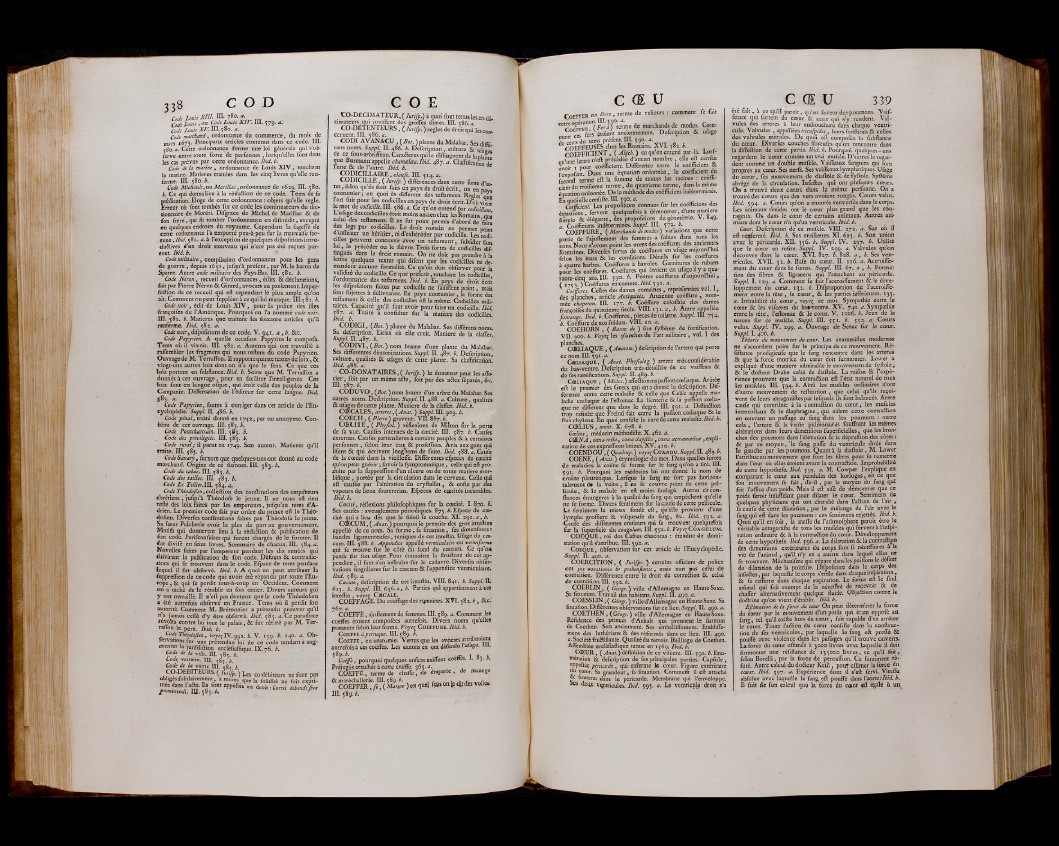
338 COD Code Louis XIIL III. 780. a.
Code Louis y on Code Louis XIV. III. 379. a.
Code Louis XV. III. 580. a. , . j
Code marchand, ordonnance du commerce, du mois de
mars 1673. Principaux articles contenus dans ce code. III.
380. a. Cette ordonnance forme une loi générale qui s’ob-
ferve entre toute forte 'de perfonnes , loriqu’elles font dans
les cas prévus par cette ordonnance. Ibid. b.
Code de la marine , ordonnance de Louis X IV , touchant
la marine. Matières traitées dans les cinq livres qu’elle renferme.
III. 580. b.
Code Michault ,ou Marillac, ordonnance de 1629. III. 580.
• Te
b. Ce qui donna lieu à la rédaétion de ce code. Tems de fa
lùblicauon. Eloge de cette ordonnance : objets qu’elle reele.
Jrrcur où font tombés fur ce code les continuateurs du dictionnaire
£1
de Moréri. Dilgrace de Michel de Marillac & de
fon freré, qui lit tomber l’ordonnance en difcrédit, excepté
en quelques endroits du royaume. Cependant la fageffe de
cette ordonnance l’a emporté peu-à-peu fur la mauvaife fortune,
lbid. 581. a.k l'exception de quelques difpofitions intro-
du&ives d’un droit nouveau qui n’ont pas été reçues partout.
Ibid. b.
Code militaire, compilation d’ordonnances pour les gens
de guerre, depuis 1651, jufqu’à préfent, par M. le baron de
Sparre. Autre code militaire des Pays-Bas. III. 581. b.
Code Néron, recueil d’ordonnances, .¿dits & déclarations,
fait par Pierre Néron & Girard, avocats au parlement. Imperfection
de ce recueil qui eft cependant le plus ample qu’on
ait. Comment on peut lùppléer à ce qui lui manque. III. 581 .b.
Code noir, édit de Louis X IV , pour la police des ifles
françoifes de l’Amérique. Pourquoi on l’a nommé code noir.
III. 581. b. Matières que traitent les foixante articles qu’il
renferme. Ibid. 582. a.
Code noir, difpofitions de ce code. V. 941. a ¡b. & c.
Code Papyrien. A quelle occafion rapyrius le compofa.
Tems où il vivoit. III. 582. a. Auteurs qui ont travaillé à
raffembler les fragmens qui nous refient du code Papyrien.
Ouvrage de M. Terraffon. Il rapporte quinze textes de loix, &
vingt-une autres loix dont on n'a que le fens. Ce que ces
loix portent en fubftance./*/</. b. Soins que M. Terraffon a
donnés à cet ouvrage, pour en faciliter l’intelligence. Ces
loix font en langue ofque, qui étoit celle des peuples de la
Campanie. Differtation de l’éditeur fur cette langue. Ibid.
583. a.
Code Papyrien y fautes à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 486. b.
Code pénal y traité donné en 1752, par un anonyme. Contenu
de cet ouvrage. III. 583. b.
Code Pontchartrain. III. 583. b.
Code des privilégiés. III. 383. b.
Code rural;'A parut en 1749. Son auteur. Matières qu’il
traite. III. 583. b.
CodeSavary, furnom que quelques-uns ont donné au code
marchand. Origine de ce furnom. III. 383. b.
Code du tabac. III. 383. b.
Code des tailles. III. 383. b.
Code Le Te/lier. III. 304. a.
Code Théodofien, colleétion des confiitutions des empereurs
chrétiens, jufqu’à Théodofe le jeune. 11 ne nous eft rien
refté des loix faites par les empereurs, jufqu’au tems d’Adrien.
Le premier Code fait par ordre du prince eft le Théô-
riofien. Diverfes confiitutions faites par Théodofe le jeune.
Sa foeur Pulcherie a voit le plus de part au gouvernement.
Motifs qui donnèrent lieu a la rédaétion & publication de
fon code. Jurifconfultes qui furent chargés de le former. Il
fut divifé en feize livres. Sommaire de chacun. III. 384. a.
Novclles faites par l’empereur pendant les dix années qui
Suivirent la publication de fon code. Défauts & contradictions
qui fe trouvent dans le code. Efpace de tems pendant
lequel il fut obfervé. Ibid. b. A quoi on peut attribuer la
fuppreffion de ce code qui avoit été répandu par toute l’Eu-
tope, & qui fe perdit tout-à-coup en Occident. Comment
on a tâché de le rétablir en fon entier. Divers auteurs qui
y ont travaillé. Il n’eft pas douteux que le code Théodofien
a été autrefois obfervé en France. Tems où il perdit fon
autorité. Comment M. Brétonnier a prétendu prouver qu’il
n’a jamais ceffé d’y être obfervé. Ibid. 383 .a. Ce paradoxe
révolu contre lui tout le palais, & fut réfuté par M. Terraffon
le pere. Ibid. b.
Code Théodofien y voyeçIV.992. ¿ .V . 139. b. 140. a. Ob-
lervations fur une prétendue loi de ce code tendant à augmenter
la jurifdiétioa eccléfiaftique. IX. 76. b.
Code de la ville. III. ,83. b.
Code, voiturui. IIL383.*.
Code de la voirie. lu . ?%? t
r‘Æ-)Les co-débiteurs ne font pas
m m Ê / s s s m roüdw „= w t «pris
i j i r appeUw | n j £ H h »
C O E
CO-DÉCIM ATEUR, ( Jurifp.) à quoi font tenus les co-dé*
curateurs: qui jouiffent des groffes dîmes. III. 386. a.
CO-DÉTENTEURS, ( Jurifp. ) réglés de droit qui les concernent.
III. <86. a. 1
COE)I AvANACU , (Pot. ) plante du Malabar. Ses différons
noms. Suppl. II. 486. b. Defcription , culture & ufaecc
de ce fous-arbriffeau. Caraôeres qui le diftinguent de la plante
que Burmann appelle chamoeloea. Ibid. 487. a. Claflification de
lune & de l’autre. Ibid. b. c
CODICILLAIRE, claufe. m . 314. a.
CODICILLE, (Jurifp.) différences dans cette forte d’actes,
félon qu ils font faits en pays de droit écrit, ou en nav«
coutumier; en quoi ils différent des teftamens. Redes aue
Ion fuit pour les codicilles en pays de droit écrit. De vient
le mot de codicille.,111. 386. a. Ce qu’on entend par codicillant
L uiage des codicilles étoit moins ancien chez les Romains, ou®
celui des teftamens. Il ne fut point permis d’abord de faire
j®5 *e8s Par codicilles. Le droit romain ne permet point
.{. tuer un héritier, ni d’exhéréder par codicille. Les codicilles
peuvent concourir avec un teftament, fubfifter fans
lui, le précéder ou le fuivre.Trois fortes de codicilles distingués
dans le droit romain. On ne doit pas prendre à la
lettre quelques textes qui difent que les codicilles ne demandent
aucune formalité. Ce qu’on doit obferver pouf la
validité du codicille. Ce que prelcrit, touchant les codicilles
1 ordonnance des teftamens. Ibid. b. En pays de droit écrit
les difpofitions faites par codicille ne faififfent point, mais
font fujettes à délivrance. En pays coutumier, la forme des
teftamens & celle des codicilles eft la même. Codicilles militaires.
Capacité .qu’il faut avoir pour faire un codicille. Ibid.
1, 7' a- Traité à confùlter fur la matière des codicilles.
Ibid. b.
CO p iG I , (Bot.) plante du Malabar. Ses différensnoms.
Sa defcription. Deux où elle croît. Maniéré de la claffer.
Suppl. II. 487. b.
COprVI y (Bot.) nom brame d’une plante du Malabar.
Ses différentes dénominations. Suppl. II. 487. b. Defcription,
culture, qualités & ufages de cette plante. Sa claifification.
Ibid. 488. a.
\ CO-DONATAIRES, ( Jurifp.) le donateur peut les affo-
cier, fbit par un même aéle, foit par des aftes féparés, &c.
III. 387. b.
CODUVO, (Bot. ) nom brame d’un arbre du Malabar. Ses
autres noms. Defcription. Suppl. II. 488. a. Culture, qualités
& ufages de cette plante. Maniéré de la claffer. Ibid. b.
ECALES, artèresy(Anat. ) Suppl. IH. 909. b.
)ECH, ( Pierre ) graveur. Vît. 887. b.
COECITÉ, ( Phyfiol. ) réflexions de Milton fur la perte
I ~ n ' e . . de fa vue. Caufes internes dJe. 1 l_a_ _c_oe__c_i_t_é_._ TITITI . 387. bF . rCfa uffes
externes. Caufes particulières à certains peuples & à certaines
perfonnes, félon leur état & profeftion. Avis aux gens qui
lifent & qui écrivent long^lems de fuite. Ibid. 388. a. Caufe
de la coecité dans la vieilleffe. Différentes efpeces de coecité
qu’on peut guérir ; favoir la fymptomatique, celle qui eft produite
par la fuppreffion d’un ulcere ou ae toute matière mor-
bifique, portée par la circulation dans le cerveau. Celle qui
eft caufée par l’altération du cryftalün, & enfin par des
vapeurs de fieux fouterreins. Efpeces de ccecités incurables.
Ibid. b.
Ses caufes : aveuglemens périodiques. 873.*. Efpece de coe?
cité qui a lieu des que le foleil fe coucne. XI. 291. a , b.
COECUM,( Anat.) pourquoi le premier des gros inteftina
appelle de ce nom. oa forme, fa fituation, fes dimenfions r
bandes ligamenteufes, tuniques de cet inteftin. Ufage du coe-
cum. III. 388. b. Appendice appellé vermiculaire ou vermiform»
qui fe trouve fur le côté au fond du coecum. Ce qu’on
penfe fur fon ufage. Pour connoitre la ftruélure de cet appendice
, il faut s’en inftruire fur le cadavre. Diverfes obfer-
vations fingulieres fur le coecum & l’appendice vermiculaire.
Ibid. 389. a.
Ccecum y defcription de cet inteftin. VIII. 841. b. Suppl. IL'
613. b. Suppl. III. 636. b. Parties qui appartiennent à cet
inteftin, voyeç C æ c a l e .
COÉFFAGE. Du coëflàge des romaines. XVI. 382. b, & c.’
767. a.
COEFFE, ajuftement de femmes. III. 389. a. Comment les
coëffes étoient comjjofées autrefois. Divers noms qu’elles
prennent félon leur forme. Voyez C o e f fu r e . Ibid. b.
COEFFE à perruque. III. 389. b. !
C o e f f e , en anatomie. Vertu s que les avocats attribuoient
autrefois à ces coëffes. L e s canons en ont défendu l’ufage. 111.
Coiffe y pourquoi quelques enfans naiffent coëffés. I. 83. b.
Préjugés attaches à cette coëffe. 363.^ \
COEFFÉ, terme de chafle, de draperie, de manege
que! f t . - n M . d « voiles.
III. 589. b.
C (E u C OE U 339
CoEFFER un livre, terme de relieurs : comment fe fait
CTn?FF£R0( f fru f terme de marchands de modes. Com-
ment ce.s. rds étoien.t anTcTieT nnement. Defcrip*tion & ufage
M S É Ê t Ê Ê Ê S ^ XVI. 38a.i.
COEFFICIENT, (Algeb.) cequ’Onentend par-là. Lorf-
mi’une lettre n’eft précédée d’aucun nombre, elle eb cenfée
avoir 1 pour coëflicient. Différence entre le coëfficient &
l’expofant. Dans une équation ordonnée, le coëfficient du
fécond terme eft la fomme de toutes les racines : coefficient
du troifieme terme, du quatrième terme, dans la même
équation ordonnée. De la méthode dès coëfficiens indéterminés.
En quoi elle confifte. III. 39° -a- „ , ,
Coefficient.* Les propofitions connues fur les coethciens des
équations, fervent quelquefois à démontrer, d’une maniéré
fimple & -élégante, des propofitions de géométrie. V. 849.
a. Coëfficiens indéterminés. Suppl. III. 372. b.
COEFFURE, (Marchande de modes) variations que cette
partie de l’ajuftement des femmes a fubies dans tous les
tems. Nous n’avons point les noms des coëffures des anciennes
Romaines. Diverfes fortes de coëffures en ufage aujoürdhiu
félon les états .& les conditions. Détails fur les coeffures
à quatre barbes. Coëffures à bavolet. Garnitures de rubans
pour les coëffures. Coëffures qui étoient en ufage il y a qua-
rante-cinq ans.III. 590. é. Petites coëffures d’aujourd’hui,
( 1733. ) Coëffures en comete. Ibid. 391. a.
Coëffures. Celles des dames romaines, repréfentées vol. I ,
des planches, article Antiquités. Ancienne coëffùre , nommée
chaperon. III. 177. b. Coëffùre coloffale des dames
françoifes du quinzième fiecle. VIII. 131 .a t b. Autre atmellée
font ange. Ibid. b. Coëffures, pièces de toilette. Suppl. IIL 734.
b. Coëffùre de nos foldats. VIII. 10. a.
COEHORN , ( Baron de ) fon fyftême de fortification.
VII. aoo. b. Voyëi les planches de l’art militaire , vol. I des
planches.
CCELÏAQUE , (Anatom.) defcription de l’artere qui porte
Ce nom. III. 391. a. r ■
C oe l ia q u e , ( Anat. Phyfiolog. ) artère tres-confidérable
du bas-ventre. Defcription très-aétaillée de ce vaiffeau &
de fes ramifications. Suppl. II. 489. b.
C oe l ia q u e , (Médec.) affeélionoupaffioncoeliaque. Arétée
eft le premier des Grecs qui en a donné la defcription. Différence
entre cette maladie & celle que Celfe appelle maladie
coeliaque de l’eftomac. La lienterie & là pamon coefia-
que ne diffèrent qiie dans le degré. III. 391. a. Diftinôion
trop rafinée que Freind fait entre la paffion coeliaque & le
flux chy leux. En quoi confifte la cure de cette maladie./*/«/.*.
CCEL1US , mont. X. 678. *.
Calius y médecin méthodifte. X. 462. a.
COENA y cctna refia t ccena dapfilis, ccena açroamatica , explication
de ces expreffions latines. XV. 410. *.
' COENDOU, ( Quadrup. ) voye[ CÛANDU. Suppl. II. 489. *.
COENE, (Anat?) étymologie du mot. Dans quelles fortes
de maladies la coëne fe forme fur le fane qu’on a tiré. III.
591. *. Pourquoi les médecins lui ont donné le nom de
croûte pleurétique. Lorfque le fang ne fort pas horizontalement
de la veine, il ne fe couvre point de cette pellicule,
& le malade en eft moins foulagé. Autres circon-
ûances étrangères à la qualité du fang qui empêchent qu’elle
ne fe forme. Divers fentimens fur la caufe de cette pellicule.
Le fentiment le mieux fondé eft, qu’elle provient d’une
lymphe groffiere & vifqueufe du fang, &c. Ibid. 392. a.
Caufe des différentes couleurs qui fe trouvent quelquefois
fur la fuperficie du coagulum. III. 392.*. Voye^ C o a g u l u m .
COEQUE, roi des Cafres chococas : étendue de domination
qu’il s’attribue. III. 592. a.
C o e q u e , ôbfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 490. a.
COERCITION, ( Jurifpr. ) certains officiers de police
ont jus vocatïonis & prehenfionis, mais non pas celui de
coercition. Différence entre le droit de correction & celui
de coercition. III. 392. *.
COERLIN, ( Geogr. \ ville d’Allemagne en Hàute-Saxe.
Sa fituation. Travail des nabitans. Suppl. II. 490. a.
COESSLIN, ( Géogr.) ville d’Allemagne en Haute-Saxe. Sa
fituation. Différentes obfervations fur ce lieu. 5«pp/. II. 490. a.
COETHEN , (Géogr.) ville d’Allemagne en Haute-Saxe,
Réfidence des princes d’Anhalt qui prennent le furnom
de Coethen. Son ancienneté. Ses embelliffcmens. Etabliffe-
mens des luthériens & des réformés dans ce fieu. III. 490.
a. Société fruétifiante. Qualité du terroir. Bailliage de Coethen.
Aflèmblée eccléfiaftique tenue en 1369. Ibid. b.
CCEUR, (Anat.) définition de ce vifeere. III. 392. *. Enu-
mtratioh & defcription de fes principales parties. Capfule,
appellèc péricarde, qui enferme le coeur. Figure extérieure
du coeur. Sa grandeur, fa fituation. Comment il eft attaché
" foutenu dans le péricarde. Membrane qui l’enveloppe.
Scs deiyç ventricules. Ibid. 393. a. Le ventricule droit n’a
été fait, à ce qu’it paroît, qu’en faVeur de? poumons. Vaif-
feaux qui fortent du coeur & ceux qui s’y rendent. Valvules
des arteres à leur embouchure dans chaque ventricule.
Valvules , appellées tricufpides, leurs fondions & celles
des valvules mitrales. De quoi eft compofée la fubftance
du coeur. Diverfes couches fibreufes qu’on rencontre dans
la diffeétion de cette partie. Ibid. b. Pourquoi quelques - uns
regardent le coeur comme un vrai mufcle. D’autres le regardent
comme un double mufde. Vaiffeaux fanguins qui font
propres au coeur. Ses nerfs. Ses vaiffeaux lymphatiques. Ufage
du coeur, fes mouvemens de diaftôle & de fyftole. Syftême
abrégé de la circulation. Infe&es qui ont plüfieurs coeurs.
On a trouvé deux coeurs dans la même perfonrie. On a
trouvé des coeurs que des vers avoient rongés. Coeurs velus.
Ibid. 594. a. Coeurs qu’on a trouvés renverfés dans le corps.
Les animaux timides ont le coeur plus grand que les courageux.
Os dans le coeur de certains animaux. Autres animaux
dont le coeur n’a qu’un ventricule. Ibid. b.
Coeur. Defcription de ce mufcle. VIII. 271. a. Sac ou il
eft reiffermé. lbid. b. Ses oreillettes. XI. 623. *. Son union
avec le péricarde. XII. 336. *. Suppl. IV. 297. *. Utilité
jue le coeur en retire. Suppl. IV. 299. a. Valvules qu’on
jécoitvre dans le coeur. XVI. 827. *. 828. a , *. Ses ventricules.
XVII. 31. *. Bafe du coeur. II. n6 . a. Accroiffe-
ment du coeur dans le foetus. Suppl. III. 67. a , *. Formai
tion des fibres & tigamens qui l’attachent au péricarde.
Suppl. I. 129. a. Comment fe fait l’accroiffement & le développement
du coeur. 132. *. Difproportion de l’accroiffe-
ment entre la tête , le coeur, & les parties inférieures. 133.
a. Irritabilité du coeur, voye^ ce mot. Sympathie entre le
coeur & les vifeeres du ba*-ventre. XV. 740. a. Sympadiie
entre la tête, l’eftomac & le coeur. V. 1006. *. Jeux de la
nature fur ce mufcle. Suppl. III. 551. *. 332. a. Coeurs
velus. Suppl. IV. 299. a. Ouvrage de Senac fur le coeur.
Suppl. I. 406. *.
Théorie du mouvement du coeur. Les anatomiftes modernes
ne s’accordent point fur le principe de ce mouvement. Ré-
fiftance prodigietife que le fang rencontre dans les arteres
& que la force motrice du coeur doit furmonter. Lower a-
expliqué d’une maniéré admirable le mouvement de fyftole y
& le dofteur Drake celui de diaftole. La raifon & l’expérience
prouvent que la contraction eft l’état naturel de tous
les mufcles. IIL 394. *. Ainfi les mufcles ordinaires n’ont
d’autre mouvement de reititution , que celui qu’ils reçoivent
de leurs antagoniftespar lefquels ils font balancés. Autre
caufe qui contribue à la contraction du coeur, les mufcles
interconaux & le diaphragme, qui aident cette contraction
en ouvrant un paffage au fang dans les poumons : outre
cela , l’artere & la veine pulmonaires fouffrent ,les mêmes
altérations dans leurs dimenfions fuperficielles, que les bronches
dès poumons dans l’élévation & la dépreffion des côtes :
6c par ce moyen, ‘le fang paffe du ventricule droit dans
le gauche par les poumons. Quant à la diaftole, M. Lower
l’attribue au mouvement que font les fibres pour fe remetac
dans l’état où elles étoient avant la contraction. Improbabilité
de cette hypothefè. Ibid. 593. a. M. Cowper l’explique en
comparant le coeur aux pendules des horloges, en ce que
fon mouvement fe fait, dit-il, par le moyen du fang qui
fait l’office d’un poids. Mais il eft aifé de démontrer que ce
poids feroit infumfant pour dilater le coeur. Senrimens de
quelques phyficiens qui ont cherché dans l’aCtion de l’air ,
la caufe de cette dilatation, par le mélange de l’air avec le
fang qui eft dans les poumons : ces fentimens rejettés. Ibid. b:
Quoi qu’il en foit, la maffe de l’athmofphere paroît être le
véritable arttagonifte de tous les mufcles qui fervent à l’infpi-
ration ordinaire & à la contraCtion du coeur. Développement
de cette hypothefe. Ibid. 396. a. La dilatation & la contraCtipn
des dimenfions extérieures du corps font fi néceffaires à la
vie de l’animal, qu’il n’y en a aucun dans lequel ehes ne
fe trouvent. Méchanifme qui répare danslespoiffonsle défaut
de dilatation de la poitrine. Difpofition dans le corps _ des
infeftes, par laquelle le corps s’enfle dans chaque infpiration,
& fe refferre dans chaque expiration. Le foetus eft le feul
animal qui foit exempt de la néceffité de recevoir & de
chaffer alternativement quelque fluide. Objcétion contre la
doftrine qu’on vient d’étahlir. Ibid. b.
Eftimation de là force du coeur On peut déterminer la force
du cùeur par le mouvement d’un poids qui étant oppofè au
fang, tel qu’il exifte hors du coeur, foit capable d’en arrêter
le cours. Toute l’aétion du coeur confifte dans la conftruc-
tion de fes ventricules, par laquelle le fang eft preffé &
pouffé avec violence dans les paffages qu’il'trouve ouverts.
La force du coeur eitimée à 3000 livres avec laquelle il doit
furmonter une réfiftance de 133O00 livres, ce qu’il fait,
félon Borelli, par la force de pereuffion. Ce fentiment réfuté.
Autre calcul du doâeur Keill, pouf eftimer la force du.
coeur. Ibid. 307. a. Expérience dont il s’eft fervi. Vîteffe
abfolue avec laquelle le fang eft pouffé dans l'aorte.*/*/</. b.
Il fuit de fon calcul que la force du cctur eft égale à un