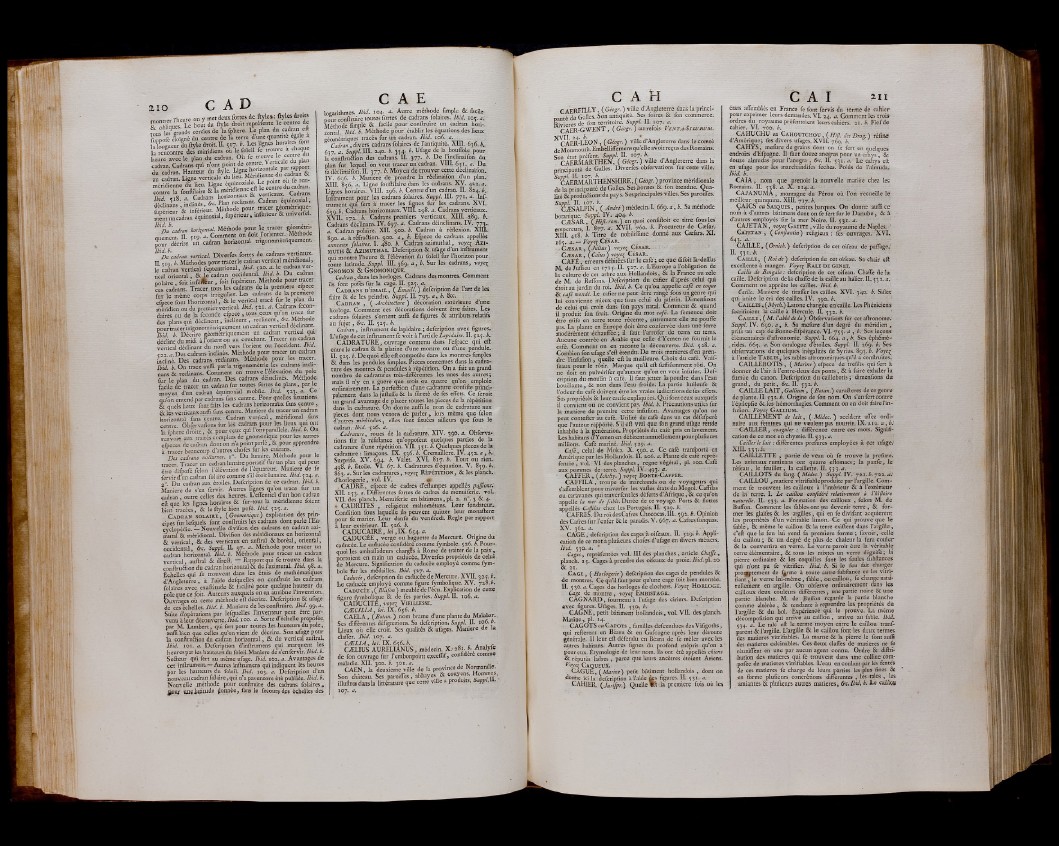
CAD 210„
„l'heure on v met deux fortes de ftyles.: ftyles droits
&°obliuues Le iout du ftyle droit repréfente le centre de
Sus t e grands cercles de lafphere. U plan du
funnofé éloigné du, centre de la terre d une quantité égale k
la longueur Quityle droit. 11. ^17. 1 Lesltgnes horaires font
la rencontre des méridiens où le foleil fe trouve a c: q
heure avec le plan dp
méridienne dît lieu. Ligue éqmnoxtale. Le point ou le r
contre 1» foultilaire
lbtd. 518. OE g ® - p ta reclinant. Cadran équinoxial,
d é ch n a n sH t tgV * Méthode pour tracer géomè;nqaelb,
1Ùu cadran hm^mU Méthode pour le tracer çéométrh
miemem. II. <19- Comment on doit1 orienter. Méthode
§ ¡ ¡ 1 décrire m cadran horizontal trigonométriquement.
31 Du cadran vertical. Diverfes fortes de. cadrans verticaux.
TT cio. b. Méthodes pour tracer le cadran vertical méridional,
le cadran vertical feptentrional, üid. cao.a. le cadran vertical
oriental, & j e cadran occidental. /M. i. Du cadran
polaire , foit ln fé * u r , foit fupérteur. Méthode pour tracer
ces cadrans. Tracer tous les cadrans de la première efpece
fur le même corps irrégulier. Les cadrans de la première
efpece font l’horizontal, & le vertical ttacé for le plan du
méridien ou du premier vertical. Ibtd. 521. a. Cadrans fécondâmes
ou de la fécondé efpece , tous.çeux qnon trace fur
des plans qui'déclinent, inclinent, ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g g g Méthode
pour tracer trigonométriquement un cadran vertical déclinant.
Ibid b Décrire géométriquement un cadran vertical qui!
décline du midi à Posent ou au couchant.,Tracer un cadran
vertical déclinant du nord vers l’orient ou i occident. Ibid.
« 2 a Des cadrans inclinés. Méthode pour tracer un cadran
incliné. Des cadrans reclinans. Méthode pour les tracer.
Ibid b. On trace aufli par la trigonométrie les cadrans tncli-
nans 8c reclinans. Comment on trouve ¡ élévation du pôle
for le plan du cadran. Des cadrans démehnés. Méthode.
Sicile de tracer un cadran for toutes fortes de plans, par le
moyen d’un cadran équinoxial mobile. Ibid. ^ 523.. a. Ce
qu?on entend par cadrans fans centre. Pour quelles fituauons
& quels lieux font faits les cadrans horizontaux fans centre,
& les verticaux aufli fans centre. Manière de tracer un cadran
horizontal fans centre. Cadran vertical, méndional fans
centre. Obfervations for les cadrans pour les lieux qui ont
la fphere droite, 8c pour ceux qui 1 ont parallèle. Ibid. b. Un
renvoie aux traités;complets de gnomonique pour les autres
efpeces de cadran dont on n’a point parlé, 8c pour apprendre-
à tracer beaucoup d’autres chofes for les cadrans.
Des cadrans noilumes. i°. Du lunaire. Méthode pour le
tracer. Tracer un cadran lunaire portatif fur un plan qui peut
être difpofé ielon l’élévation de l’équateur. Manière de fe
fervir d’un cadran Polaire comme s’il étoit lunaire. Ibid. 524. a.
2° Du cadran aux étoiles. Defcription de ce cadran. Ibid. b.
Maniéré de s’en fervir. Autres lignes qu’on trace fur un
cadran outre celles des heures. L’effentiel d’un hon cadran
eft que les lignes horaires & fur-tout la méridienne foient
bien tracées, 8c le ftyle bien pofé. Ibid. 52,5. a.
C adran solaire , ( Gnomonique) explication des principes
fur lefquels font conflruits les cadrans dont parle l’Encyclopédie.
— Nouvelle divifion des cadrans en cadran azi-
mutal & méridional. Divifion des méridionaux en horizontal
8c vertical, 8c des verticaux en auftral 8cboréal, oriental,
occidental, &c. Suffi. II. 97. a. Méthode pour tracer un
cadran horizontal. Ibid. b. Méthode pour tracer un cadran
vertical, auftral 8c direft. — Rapport qui fe trouve dans la
conftruétion du cadran horizontal 8c de l’azimutal. Ibid. 98. a.
Échelles .qui fe trouvent dans les étuis de mathématiques
d’Angleterre, à l’aide defquelles on çonftruit les cadrans
folaires avec exaélitude 8c facilité pour quelque hauteur du
pôle que ce foit. Auteurs auxquels on en attribue l’invention.
Ouvrages où cette méthode eft décrite. Defcription 8c ufage
de ces échelles. Ibid. b. Maniéré de les çonftruire. Ibid. 99. a.
Suite dlopérations par lefquelles l’inventeur peut être parvenu
à leur découverte. Ibid, 100. a. Sorte,d échelle propofée-
par M. Lambert, qui fert pour toutes les hauteurs du pôle,
aufli bien que celles .qu’on vient de décrire. Son ufage P°ur
la conftruoion du caaran horizontal, & du vertical auftral.
Ibid. 101. a. Defcription d’inftrumens qui marquent lès
heures par les hauteurs du foleil. Maniéré de s’en fervir. Ibid. b.
Se&eur qui fert au même ufage. Ibid. 102. a. Avantages de
cet inftrument.— Autres infttumens qui indiquent les heures
par les hauteurs du foleil. Ibid. 103. a. Defcription d’un
nouveau cadran folaire,qui n’a pas encore été publiée. Ibid. b.
Nouvelle méthode pour çonftruire des cadrans folaires*
pour une latitude donnée, fans le fecoiirs des échelles des
C A E
logarithmes. Ibid. 104- gs Autre méthode fimplc 8c facile
pour çonftruire toutes fortes de cadrans folaires. Ibid. îo^.a.
Méthode fimple 8c facile pour çonftruire un cadran hori-,
zontal. Ibid. b. Méthode pour , établir les équations des lieux,
géométriques tracés fur un cadran. Ibid. 106. a.
° Cadran, divers cadrans folaires de l’antiquité. XIII. 636. b,
637. a. Suffi.III. 140. b. 354. b. Ufage de la bouffole pour
la conftruoion des cadrans. H. 377. b. De l’inclinaifon du
plan fur lequel on veut tracer un cadran. VIII. 651. a. De
fadkliriiufon.il. 377. b. Moyen de trouver cette déclinaifon.
IV. 696. t. Maniéré de 'prendre la réclinaifon d’un plan.
XIII. 85G. a. Ligne fouftilaire dans les cadrans. XV. 422.a.
Lignes horaires. VIII. 206. b. Centre d’un cadran. II. 824. b.
Inftrument pour les cadrans folaires. Suffi. III. 771. a. Infiniment
qui fert à tracer les fignes fur les cadrans. XVI.
trument îeri * ^ g«»
639.> • r i. Cadransi J __VTIT horizontaux.ia x l'.'irtMnc VIII.trprfîronv
298. a. Cadrans verticaux.
XVU. 17.2.' ii. Cadrans premiers verticaux. XIII. 289. b.
Cadrans déclirians.IV. 697. a. Cadrans déinclinans. IV. 773.
a. Cadran polaire. XII. 900. b. Cadran à réflexion. XIII*
890. a. à réfraftion. 900. a , b. Efpece de cadrans appellés
anneaux folaires. I. 480. b. Cadran azimuthal, voye^ Azi-
muth 8c A zimuthal. Defcription 8c ufage d’un inftrument
qui montre l’heure 8c l’élévation du foleil fur l’horizon pour,
toute latitude. Suffi. III. 369. a , b. Sur les cadrans, voye^
Gnomon 8c G nomonique.
Cadran, dans les horloges. Cadrans des montres. Comment
ik font pofés fur la cage. II. 525. a.
C adrans d’émail , ( Ema'dl. ) defcription de 1 art de les.
faire 8c de les peindre. Suffi. II. 793. a, b. 8cc. , • . '
C adran , ( Architetiure ) décoration extérieure d’une
horloge. Comment-ces décorations doivent être faites. Les
cadrans folaires s’ornent aufli de figures 8c attributs relatifs
au fujet, &c. II. 523. b. ' a
Cadran, inftrument de lapidaire.; defcription avec figures..
L’ufage de cet ùiftrumentfe voit à l’articleLafidaïre. II. 525. b.
CADRATURE, ouvrage contenu dans l’efpace qui eft
entre le cadran 8c la platine d’une montre ou d’une pendule. -
II. <23. b. De quoi elle eft compofée dans les montres fimples
8c dans les pendules fimples. Pièces contenues dans la caara-
ture des montres 8c penaules à répétition. On a fait un grand
nombre de cadratures très-différentes les unes des autres;
mais il n’y en a guere que trois ou quatre qu’on emploie-
ordinairement. La perfection d’une caarature confifte principalement
dans la jufteffe 8c la fureté de fes effets. Ce feroit
un grand' avantage de placer toutes les pièces de la répétition
dans la cadrature. On donne aufli le nom de cadrature aux
pièces dont nous venons de parler, lors même que félon
d’autres méthodes, elles font fituées ailleurs que fous le
cadran. Ibid. 326. a.
Cadrature, roues de la cadrature. XTV. 390. a. Obfervations
fur la réfiftance qu’oppofent quelques parties de la
cadrature d’une répétition. Vil. 3 31. b. Quelques pièces de la.
cadrature : limaçons. IX. 336. b. Cremaillere. IV. 432. a , b.
Surprife. XV. 694. b. Valet. XVI. 817. b. Tout ou rien.
498. b. Étoile. VI. 67. b. Cadratures d’équation. V. 839. b„
863. a. Sur les cadratures, voye^ Répét ition, 8c les planch.
d’horlogerie, yoI. IV. . a
. CADRE, efpece de cadres d’eftampes appellés fajfions.
XII. 133. a. Différentes fortes de cadres de menuiferie. voL.
VII. des planch. Menuiferie en bâtimens, pl. 2. n°. 3 8c 4.
• CADR1TES , religieux mahométans. Leur fondateur..
Condition fous laquelle ils peuvent quitter leur monaftere
pour fe marier. Leur danfe du vendredi. Réglé par rapport
à leur extérieur. II. 326. b.
CADUCAIRE, loi,IX. 634. a.
CADUCÉE , verge ou baguette de Mercure. Origine du
caducée. Le caducée confidéré comme fymbole. 326. b. Pour-,
quoi les ambaffadeurs chargés à Rome de traiter de la paix,
portoient eri main un caducée-Diverfes propriétés de celui,
de Mercure. Signification du caducée employé comme fym-
bole for les mlaailles. Ibid. 327. a.
Caducée, defcription du caducée de Mercure. XVII. 323. br
Le caducée employé comme figure fymbolique. XV. 728. b.
C aducée , { Blafon ) meuble de l’écu. Explication de cette
figure fymbolique 8c de fes parties. Suffi, il. 106. a.
CADUCITE, voyei V ieillesse.
CÆCILIA, loi. ÏX. 636. b.
CAELA, (Botan. ) nom brame d’une plante du Malabar,,
! Ses différentes défignations. Sa deferiptioni Suffi. II. 106. b.
Lieux où elle croît. Ses qualités & ufages. Maniéré de la
clafler. Ibid. 107. a.
CÆLIA, loi. IX. 636. b. n f . , ,
CÆLIUS AURELIANUS, médecin. X.-281. A Analyfe
de fon ouvrage fur l’embonpoint exceflif, confidéré comme
maladie. XII. 300. b. 301. a. XT m -
CAEN, la deuxième ville de la province de Normandie.
Son château. Ses paroiffes, abbayes & couyens. Hommes,
illullres dans la üttéranire que cette ville a produits, Suffi, U,
107. a.
C A H
CAERFILLY, ( Ge'ogr. ) ville d’Angleterre dans la principauté
de Galles. Son antiquité. Ses foires 8c fon commerce.
Rivières de fon territoire. Suppl. II. 107. a.
CA E R -GW EN T , ( Géogr. ) autrefois Venta-Siu/rum.
XVII. 24. b. *
CÀER-LEON, ( Géogr.) ville d’Angleterre dans- le comté
de Moumoutli. Embelliflemensqu’elle avoitreçus des Romains.
Son état préfent. Suffi. II. 107. b.
CAERMARTHEN, ( Géogr.) ville d Angleterre dans la
principauté de Galles. Diverfes obfervations fur cette ville.
5T À E R m S t HENSHIRE, ( Géogr.) province méridionale
de la principauté de Galles. Ses bornes 8c fon étendue. Qualité
8c produûions'du pays. Sesprincipales villes. Ses paroiffes.
^SæSALPIN, ( André) médecin.I,, 669. a, b. Sa méthode
botanique. Suffi. IV. 404. b. _ •
CÆSAR, rom.) en quoi confiftoit ce ütre fous les
empereurs. I. 877. *. XVII. 760. A Procureur de Cæfora
XIII. 418.* b. Titre de nobiliffuue donné aux Cæfars. XI.
163. a. — Voye{ .CéSa r .
/ C æsar , ( Julius) voyei CÉSAR.
CÆSAR, ( Caîus ) voye^ CÉSAR.
CA FÉ »erreurs débitées fur le café; ce que difoit Ià-deflus
M. de Juflieu en 1713. II. 327. a. L’Europe a l’obligation de
la culture de cet arbre aux Hollandois, 8c la France au zele
de M. de Reffons. Defcription du cafier d’après celui qui
¿toit au jardin du roi. Ibid. b. Çe qu’on .appelle café en coque
& café mondé. Le cafier ne peut être rangé fous un genre qui
lui convienne mieux que lous celui du jafmin. Dimenfions
de celui qui croît dans fon pays natal. Comment 8c quand
il produit fon fruit. Origine du mot café. La femence doit
être mife en terre toute récente, autrement elle ne pouffe
pas. La plante en Europe doit être confervée dans une ferre
modérément échauffée ; il faut l’arroïcnde tems en tems.
Aucune contrée en Arabie que celle d’Yemen ne fournit le
café. Comment on en raconte la découverte. Ibid. 328. a.
Combien fon ufage s’eft étendu. De trois maniérés d’en prendre
l ’infufion , quelle eft la meilleure. Choix du café. Vaif-
feaux pour le rôtir. Marque qu’il eft fuffifamment rôti. On
ne doit en pulvérifer qu’autant qu’on en veut infofer. Defcription
du moulin h café. U faut jetter la poudre dans l’eau
bouillante, 8c non dans l’eau froide. La partie huileufe 8c
l’odeur du café doivent être les yraies indications de fes effets.
Ses propriétés 8c leur caufe expliquées. Qui fonteeux auxquels
il convient ou ne convient pas. Ibid. b. Précautions utiles fui-
la maniéré de prendre cette infùfion. Avantages qu’on ne
peut contefter au café. Utilité du café dans un cas défefperé
que l’auteur rapporte. S’il eft vrai que fon grand ufage rende
inhabile à la génération. Propriétés du café pris en lavement.
Les hàhifans d’Yemen en débitent annuellement pour plufieurs
millions. Café mariné. Ibid. 329; a.
Café, celui de Moka. X. 390. a. Ce café tranfporté en
Amérique par les Hollandois. IL 206. a. Plante de café repré-
fentée j vol. VI des planches, regne végétal, pl. 100. Café
aux pommes de-terre. Suffi IV.493. a-
CAFFER, ( Ichthy. ) voyeç B o n t e -C a f fe r .
CAFFILA, troupe de marchands .ou de voyageurs qui
s’affemblent .pour traverfer les vaftes. états du Mogol. Caflilas
ou caravanes quitraverfentles déferas d’Afrique,8c ce qu’on
appelle la mer de fable. Durée de ce voyage. Ports 8c flottes
appellés Caffilas chez lesPortugais.il. 320. b.
CAFRES. Du roidesCafres Chococas. 111.392. b. Opinion
des Cafres fur l’enfer 8c le paradis. V. 667. a. Cafres fonquas.
XV. 362. a. ■ •
CAGE, defcription des cages ù oifeaux. H. 329. b. Application
de ce mot à plufieurs chofes d’ufage en divers métiers.
Ibid. 530.it. * . _
Cages, repréfentées vol. III des planches, article Chajfe,
planch. 15. Cages à prendre des oifeaux de proie. Ibid. pl. 20
& 21.
C age , {Horlogerie) defcription des cages de pendules 8c
de montres. Ce qu’il faut pour qu’une cage foit bien montée.
H. 530. a. Cages des horloges de clochers. Voyeç Horloge.
Cage de montre, voyej Embistags.
.CAGNARDfourneau à l’ufage des ciriers. Defcription
avec figures. Ufages. II. 530. b.
CAGNE, petit bâtiment hollandois, vol. VII. des planch.
Marine, pl. 14.
CAGOTS ou Capots , familles defeendues des Vifigoths,
qui refterent en Béarn 8c en Gafcogne après leur déroute
générale. 11 leur eft défendu en Béarn de fe mêler avec les
autres habitans. Autres fignes du profond mépris qu’on a 1
pour eux. Étymologie de leur nom. Ils ont été. appellés chiens
8c réputés ladres, parce que leurs ancêtres étoient Ariens.
Ptyrç.CAQUEUX.
. CAGUE, (Marine) petit bâtiment hollandois , dont on
donne ici la defcription à laide tks figures. II. 531. a.
CAHIER. {Juriffr.) Q u e l le s la première fois où les
états affemblés en France fe font fervis du terme de cahier
pour exprimer leurs demandes. VI. 24. a. Comment les trois
ordres du royaume préfentoient leurs cahiers. 21. b. Fief de
cahier. VI. 700. b.
CAHUCHU ou C a h o u t c h o u , (Hifl. desDrog.) réfine
d’Amérique; fes divers ufages. XVII. 760. b.
CAHŸS, mefure de grains dont on fe fera en quelques
endroits d’Efpagne. Il fiiut douze anegras pour un cahys, 8c
douze abriudas pour l’anegra , 6*c. II. 5-31. a. Le canys eft
en ufage pour les mârchandifes feches. Poids de l’almuda.
Ibid. b.
CAIA , nom que prenoit la nouvelle mariée chez les
Romains. II. 538. a. X. 114.0.
CAJANUm A , montagne du Pérou où l’on recueille le
meilleur quinquina. XIIL 717. b.
ÇAICS ou Saique s , petites barques. On donne aufli Ce
nom à d’aùtres bâtimens dont on fe fort fur le Danube, 8c à
d’autres employés fur la mer Noire. II. 531 . a.
CAJETAN, voye^ G aiete , ville du royaume de Nàples. ’
C ajetàn , ( Confiantin) religieux : fes ouvrages. XVI.
643. a.
CAILLE, ( Ornith.) defcription de cet oifeau de paffage.'
II. 53 t. &
C a il le , {Roide) defcription de cet oifeau. Sa chair eft
excellente à manger. Voÿe{ Rale de genht.
Caille de Bengale : defcription de cet oifeau. Chaffe de la
caille. Defcription de la chaffe de la caille au halier. II. 532. a.
Comment on apprête les cailles. Ibid. b.
Caille. Maniéré de tiraffèr les cailles. XVI. 340. b. Siflet
qui imite le cri des cailles. IV. 390. b.
C ailles , {Myth.) Latone changée en'caille. Les Phéniciens
facrifioient la caille à Hercule. II. 532. b.
C aille , ( M. l’abbé delà) Obfervations fur cet aftronome;
Suffi. IV. 690. a , b. Sa mefure d’un degré du méridien ,
priie au cap. de Bonne-Elpérance. VI. 75 5. a , A Ses leçons
élémentaires'd’aftronomie. Suffi. I. 664. a , b. Ses éphémé-
l rides. 665. a. Son catalogue d’étoiles. Suffi. II. 269. b. Ses
obfervations de quelques inégalités de Syrius. 893. b. Voye{
à l’article T ables,' les.tables aftronomiquesqu’il a conftruites.
CAILLEBOTIS, ( Marine ) efpece de treillis • qui fert à
donner de l’air, à l’entre-deux des ponts, & à faire exhaler la
fumée du canon. Defcription du caillebotis ; dimenfions du
grand, du petit, &c. II. 532.b.
CAILLE LAIT, Gallium, ( Botan.) carafteres de ce genre
de plante. II. 532 .b. Origine de fon nom. On s’en fora contre
l’épilepfie 8cles hémorrhagies. Comment on en doit faire l’in-
fufion.. Voyez G allium.
CAILLEMENT de laitt {Médec. ) accident affez ordinaire
aux femmes qui -ne veulent pas nourrir. IX. 212. a , bJ
CAILLER, coaguler : 'différence entre ces mots. Signification
de ce mot en chymie.H. 533. a.
Cailler le lait : différentes prefores employées à cet ufage.'
XIC aH 5LETTE , .pzrric de vam où fc trouve la prefure.
Les animaux ruminans ont quatre eftomacs; la panfo, le
réfoau, le feuillet, la caillette. II. 333.a.
CAILLOTS du fang. ( Médec. ) Suffi. IV. :72i. b. 722. al
CAILLOU,-matière vitrifiable produite par l’argille. Comment
fe trouvent les cailloux à l’intérieur 8c à l’extérieur
de là" terre. I. Le caillou ■ confidéré relativement à l’hiftoire
naturelle. H. 533. a. Formation des cailloux , félon M. de
Buffon. Comment les fables ont pu devenir terre , 8c former
les glaifes 8c les argilles, qui en fe divifant acquièrent
les propriétés d’un véritable limon. Ce qui prouve que le
fable, 8c même le caillou 8c la terre exiftent dans l’argille ,
c’eft que le feu lui rend fa première forme ; favoir, celle
du caillou ; 8c un degré de plus de chaleur là fora couler
8c la convertira en verre. Le verre paroît être la véritable
terre élémentaire, 8c tous .les mixtes un verre déguifé; la
pierre ordinaire 8c les coquilles font les feules fubftances
qui n’ont pu fe vitrifier. Ibid. b. Si le feu fait changer
proqtotement de forme à toute autre fubftance en les vitrifiant
, le verre lui-même, fable, ou caillou, fo change naturellement
en argille. On obferve ordinairement dans les
cailloux deux couleurs différentes, une partie noire 8c una
partie, blanche. M. de Buffon regarde la partie blanche
comme altérée, 8c tendante à reprendre les propriétés de
l’argille 8c du bol. 'Expérience qui le prouve. La même
décompofitiôn qui arrive au caillou, arrive au fable. Ibid.
534. a. Le talc eft le.terme moyen entre le caillou tranf-
parent 8c l’argille. L’argille 8c le caillou font les deux termes
des matières vitrifiables. La marne 8c la pierre le font aufli
des matières calcinables. Ces deux claffes de matières ne fe
réunifient en une par aucun agent connu. Ordre 8c- diftri-
bution des matières qui fe trouvent dans une colline com-
-pofée de matières vitrifiables. L’eau en coulant par les fentes
de ces matières fe charge de leurs pàrties les plus fines 8c
en forme plufieurs concrétions différentes , les - talcs , les
amiantes & plufieurs autres matières, &c.Ibid, b. Le caillou