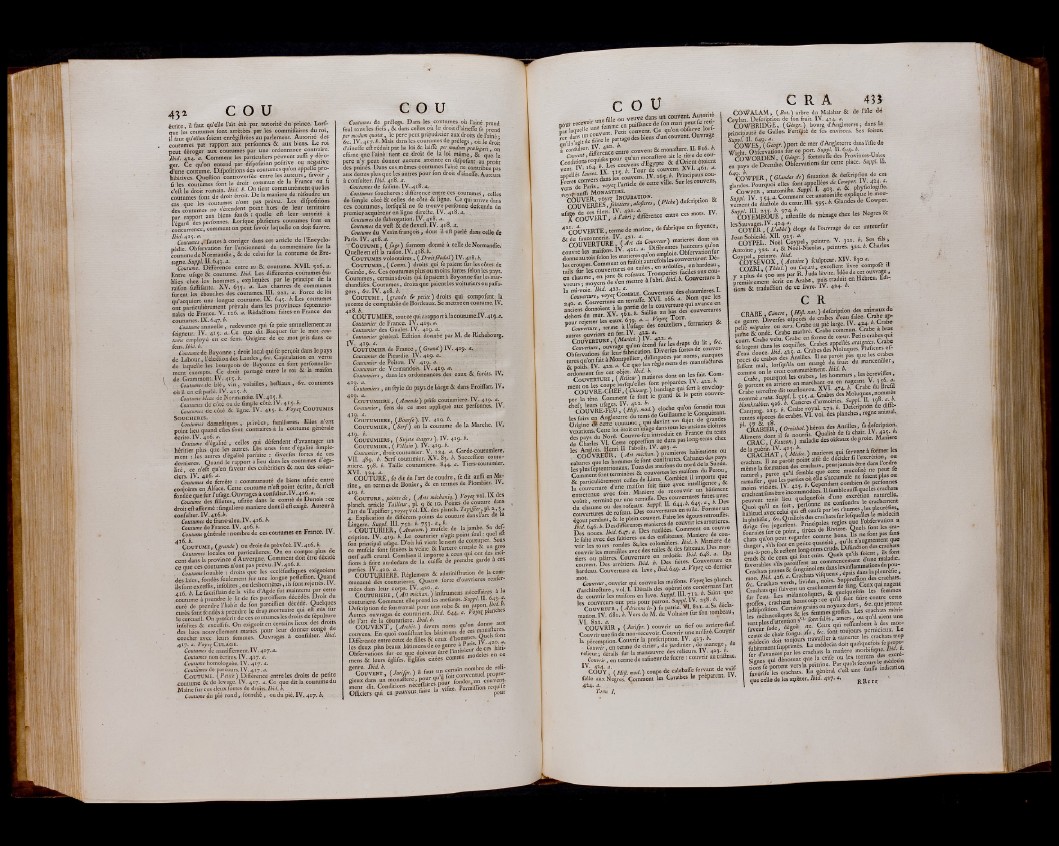
43* COU COU écrite, il faut qu’elle l’ait été par autorité du prince. Lorf-
que les coutumes/ont arrêtées par les commiffaires du roi,
il faut qu’elles foient enrégiftrées au parlement. Autorité des
coutumes par rapport aux perfonnes & aux biens. Le roi
peut déroger aux coutumes par une ordonnance contraire.
lbid. 414. a. Comment les particuliers peuvent aufli y déroger.
Ce qu’on entend par difpofition pofitive ou négative
l ’une coutume. Difpofitions des coutumes qu on appelle prohibitives.
Queftion controverfée entre les auteurs, lavoir ,
fi les coutumes font le droit commun de la France ou fi
c’eft le droit romain. lbid. b. On cent communément nue les
coutumes font de droit étroit. De la manière de réfoudre un
cas que les coutumes n'ont pas prévu. Les difpofitions
des coutumes ne s'étendent point hors de leur territoire
nar rapport aux biens fonds : quelle eft leur autorité à
l’éeard des perfonnes. Lorfque plufieurs coutumes font en
concurrence, comment on peutfavoir laquelle on doit fuivre.
Ibtd. 415 • « • 1 j ni? 1
Coutumes,^fautes à corriger dans cet article de l encyclopédie
Obfervadon fur l’ancienneté du commentaire lur la
coutume de Normandie , &de celui fur la coutume de Bretagne.
SuppL ll.643.fz.
Coutume. Différence entre us.8c. coutume. XV1L 516. «.
Entre ufage & coutume, lbid. Les différentes coutumes établies
chez les hommes, expliquées par le principe de la
raifon fuffifante. XV. 635. *.■ Les Chartres de communes
furent les ébauches des coutumes. III. 221. a. Force de loi
qu’acquiert une longue coutume. IX. 645. b. Les coutumes
ont particulièrement prévalu dans les provinces feptentrio-
nales de France. V. 126. a. Rédaélions faites en France des
coutumes. IX. 647. b. -
Coutume annuelle, redevance qui fe paie annuellement au
feieneur. IV. 4*5- M PI dit Bacquet fur le mot coutume
employé en ce fens. Origine de ce mot pris dans ce
fens. lbid.b. • . . 1 1
Coutumede Bayonne ; droit local qui fe perçoit dans le pays
de Labour,. L’éleftion des Landes, bc. Capitulation en vertu
de laquelle les bourgeois de Bayonne en font perfonnelle-
ment exempts. Ce droit partagé entre le roi & la maifon
\ de Grammont.IV. 413. é. •'
\ . . Coutumes de blé, vin, volailles, beffiaux, &c. coutumes
où il en efiparlé. IV. 415. h.
Coutume bleue de Normandie. IV. 415. é.
Coutumes de côté ou de fimple côté. IV. 415.^.
Ccutrn.es de .côté & ligne. IV. « g g Feyrç C outumes
SOUCHERES. , ,
Coutumes domeftiques, privées, familières. Elles nont
point lieu quand elles font contraires à la coutume générale
écrite. IV. 416. a.
Coutume d’égalité , celles qui défendent d avantager un
héritier plus que les autres. Ifes unes font d égalité fimple-
ment : les autres d’égalité parfaite : diverfes fortes de ces
dernieres. Quand le rapport a lieu dans les coutumes d égalité
, ce n’eft qu’en faveur des cohéritiers 8c non des créanciers.
IV. 416. a. . . ,
Coutumes de ferrête : communauté de biens ufitée entre
conjoints en Alface. Cette coutume n’eft point écrite, 8c n eft
fondée que fur l’ufage. Ouvrages à confulter.1V . 416. *.
Coutume des filletes, ufitée dans le comté de Dunois :ce
droit eft affermé : finguliere maniéré dontil eft exigé. Auteur à
confulter. IV. 416.^.
Coutumes de franc-aleu. IV. 416. b.
Coutume de France. IV. 416. b.
Coutume générale : nombre de ces coutumes en France. IV .
4 C outume , g r a n d e ) ou droit de prévôté.IV. 416. b.
Coutumes locales ou particulières. On en compte plus de
cent dans la province d’Auvergne. Comment doit être décidé
ce que ces coutumes n’ont pas prévu. IV. 416. b.
Coutume louable : droits que les ecdéfiaftiques exigeoient
des laïcs, fondés feulement fur une longue poffelfion. Quand
ils font exceftis, infolites, ou deshonnêtes, ils font rejettés. IV.
416. b. Le facriftain de la ville d’Agde fut maintenu par cette
coutume à prendre le lit de fes paroiffiens ¿¿cédés. Droit du
curé de prendre l’habit de fon paroiflien décédé. Quelques
curés font fondés à prendre le drap mortuaire qui eft mis iur
le cercueil. On proferit de ces coutumes les droits de fépulture
infolites 8c exceflifs. On exigeoiten certains lieux des droits
des laïcs nouvellement mariés joour leur donner congé de
coucher avec leurs femmes. Ouvrages à conlulter. 101 .
417. a. Voyc{ C ulage.
Coutumes de nantiffement. IV. 417.Û.
Coutumes non écrites. IV. 417. a.
Coutume homologuée. IV. 417. a.
Coutumes de parcours. IV. 417. a.
C outume. (.Petite) Différence entre les droits de petite
coutume 8c de levage. IV. 417. a. Ce que dit la coutume du
Maine fur ces deux fortes de droits, lbid. b.
Coutume du pié rond, fourché , ou du pié. IV. 417. b.
. Coutumes de prélegs. Dans les coutumes où rl’ainé prend
foui tous les fiefs, 8c dans celles où le droit d’aîneffe fe prend
per modum quota, le pere peut préjudicier. aux droits de l’ainé •
&c. IV. 417. b. Mais dans les coutumes de prélegs, où le droit
d’aîneffe eft réduit par la loi.8c laiffé per modum pralegati, on
eftime que l’aîné tient ce droit de la loi même, 8c que le
pere n’y peut donner aucune atteinte en difpofant ■ au profit
des puînés. Dans ces, mêmes coutumes l’aîné ne contribue pas
aux dettes plus que les autres pouf fon droit d’aîneffe. Auteurs
à confulter. lbid. 418. a.
Coutumes de faifinc. IV..418. a.
Coutumes foucheres : différence entre ces coutumes, celles
de fimple côté 8c celles de côté 8c ligne. Ce qui arrive dans
ces coutumes, lorfqu’il ne fe trouve perfonne defeendu du
premier acquéreur en ligne direéle, IV. .418. a. ,
Coutumes de fubrogation.IV. 418. a. ,
Coutumes de. veft oc de deveft. IV. 418 .a.
Coutume du Vexin françois, dont il eft parlé dans celle de
Paris. IV. 418. à.
" C o u t u m e , (.f&ge) furnom donné à celle .de Normandie.’
Quelle en eft la raifon. IV. 418. b.
C o u t u m e s volontaires, ( Droitféodal), IV. 418. b.
C o u t u m e s , ( Comm. ) droits qui fe paient fur les côtes de
Guinée, &c. Ces coutumes plus ou moins fqrtes félon les pays.
Coutumes, certains droits qui fepaient à Bayonne fur les marchandises.
Coutumes, droits, que paient les yoituriers ou paffa-
gers , &c. IV. 418. b.
COUTUME , ( grande & petite) droits qui compofent, la
recette de comptablie de Bordeaux. Se mettre en coutume. IV.
418. b. .
COUTUMIER, tout ce qui a rapport à la coutume.IV. 419. a.
Coutumier de France. IV. 419. a.
Coutumier des Gaules. IV. 419. a.
’ Coutumier général. Edition donnée par M. de Richebourg.
IV. 419. a. .
C o u t u m i e r de France, ( Grand) IV. 419. aA
CoutUmier de Picardie. IV. 419. a.
Coutumier de Poitou. IV 419, a. ,
Coutumier .de Vermaridois. IV. 419. a. |
Coutumier s ,.dans les ordonnances des eaux 8c forets. IV.
^^Comumurs, au flyle du pays de Liege Si dans Frpiffart. IV.
4191 a. . . . 8S
COUTUMIERE, ( Amende) prife coutumiere. IV. 419. a.
Coutumier, fens de. ce mot appliqué aux perfonnes. IV.
419. a. . . . . " ....•/,
C o u t u m i e r e , (B'ourfe). IV. 419. b. ■
C o u t u m i e r , ÇSerf) en la coutume de la Marche. IV.
419. b.
COUTUMIERS, ( Sujets étagers ). IV. 419. b.
C o u t u m i e r , ( Villain ). IV. 419. b. , -
Coutumier, droit coutumier. V. 124. a. Garde-coutumiere.
VII. 489. b. Serf coutumier. XV. 83. b. Succemon coutumiere.
598. b. Taille coutumiere. 844. a. Tiers-coutumier.
XVI. 324. *. , ,
COUTURE, fe dit de l’art de coudre, fe dit aulfi en Marine
, en termes de Bottier, 8c en termes de Plombier. IV.
41 Bouture , points de , ( Arts méchaniq. ) Vmm vol. IX des
planch. article Tailleur, pl. 0 & 10. Points de couture dans ,
Part du Tapiflier j voye{ vol. ÎX. des planch. TaptJJier, p . , J\ >
4. Explication de différons points de couture dans 1 art de »
Lingere. Suppl. III. 732. b. 753. a, b. .
- COUTURIER, ( Anatom.) mufcle de la jambe. Sa dei
cription. IV. 419. b. Le couturier n’agit point feul: <^el ett
fon principal ufage. D’où lui vient le nom de ■ *>“*
ce mufcle font fftuées la veine 8c l'artere crurale & un gros
nerf auffi crural. Combien il importe à ceux qui ont des mo
fions à faire an-dedans de la coiffe de prendre garde à ces
P’’ couTimîERï'i■ Réelemens 8c adminiftratlon de la communauté
des couturières. Quatre forte d'ouvneres renfermées
dans leur corps. IV. 410.0. a la
COUTURIERE, {Art médian. ) inftrumens néceffairps
couturière. Comment elle prend les mefures. Suffi. 11. 643- f-
Defcription de fon travail pour une robe & un luP°n- . '" î '
Autres ouvrages de couturière, lbid. 644. a. Voyc{ plan
de l'art de la ebuturiere. Uid. b. I , ux
COUVENT, \Archit.) divers noms SjLg| donne a
couvens. En quoi confiftént les bâtimens ne ce p^ôc
-Différence entre ceux de filles & ceux d homm _ • Q ^ ^
les deux plus beaux bâtimens de ce genreiiif ¿0 M(._
Obfervations fur ce que doivent être 1 int j
mens & leurs églifes. Egfifes citées comme moee.es
genre, lbid. b ¡„ nomhre de rell-
COUVEKT , (Junivr.) il faut n « convemucl propre.
gieux dans un monaffere, pour q HMN fonj cr couvent,
ment dit. Conditions néceffaire^L"f,te. Permiffion rcquifc
Officiers qui.cn peuvent, faire la viuic. ur
coü
pôuf ™ fem m e ° " p S c ^ e fon mari peutfe retipar
laquelle Peut couvent. Ce qu on obferve lorf
” ' Æ S e '= KenS d'“" C0UV“ t' ° S
à eonf“ ter‘ ,S ' r^ j entre couvent Si monaffere. II. 816. b.
CàuvM, différen monaffere ait le titre de cou-
Ccud.nons reqmfes^s ^ & d Orient étoient
vent. IV. 104. h Touf de COUVent. XVI. 461. a.
appelas Uurts. 1V. 165. é. Principaux coujsssæÈæm
m m Surl'scouvem’ . „ , fcflUffl MONASTERE.
^ m i& “ ‘'TcOUVERT ; là i£ n ; différence entre ces mots. IV.
* ’¿OUVERTE, terme de marine, de fabrique en fayence,
& " Î^ E R T U B £ IV( An du Cou.nur) matières dont on
COUVERTURE, l ^ Différentes hauteurs qu on
couvre les maifons- IV. q . emploie, Obfervanonfur
donne au toitfelon les m - . . . " ^ f ^ l c s c ouvertureff Dé-
les croupes. Comment on bit ^ „ffoifes, en bardeau,
tails fur les couycr'un ' f cauI Tromperies faciles aux cou-
vreu^l’'moyens de s’en metnre à l’abri, lbid. b. Couvemire à
a4°; “■ Ü partie de la couverture qui avance en
S d u m u 'x v . , \ . b . Saillie^au basses couvermres
couteliers, ferruriem &
du u t, 1 Couverture, ouvrage qu forPtes de couver- I
ObfervatioM fur leur febn d" é par noms, marques °rs™n?: ps&MB Site ’’’’c^UVRE’^c’IlE^C^O'ùarg.^band’agc’ qfo fert à envelop-
p e T I e Commem^c fonVle grand 8c le peut couvre-
CherfbuVRE-?EU H it lm i.) cloche qu’on fonnoit tous
Otigine: « .cette Çou'umc > | tous les „„riens cloîtres
vexauons. C e t t e lo i« o i t en u ,a g du tcms
le C o S v R îS r , " (rd» mickan ) premières habitatious ou
entretenue avec Corn. Maniéré u es faites avec
Des noues, lbid. 647. a. ues rucu'* Maniéré de coucouvert.
Des arrèuers. lbid. b. .1 _ irnv,y Ca dernier
bardeau. Couverture en lave, lbid. 649. tt.V y [
Couvreur, ouvrier qui couvre les maifons.
d’architeaure, DétaUs des^optons co^ernant 1 art
de couvrir les maifons en lave. Suppl. III. 712. b.
les couvreurs ont pris pour patron. 5app/. IV . 238. •
CO UV REU R , ( Adriennele-) fa patrie. i821. <*.î>
mation. IV. 681. b. Vers de M. de Voltaire fur fon tombeau,
V COUVRIR , {Jurifpr.) couvrir un fief »“ " " ' " f :
Couvrir une fin de non-recevoir. Couvrir une nullité. Couynr
la péremption. Couvrir la preferipnon. IV. 4*3- »■
Couvrir, en terme de ciner, de lardimer, de manege, de
relieur; détails fur la manoeuvre des reheurs. IV. 413
Couvrir, eu terme de rafineur de fucre : couvrir autriftrac.
IVC Ô " : r Hiti. moi. ) coupe de calebaffe fervant de vaif-
felle aux Negrcsi Comment les Caraïbes le préparent. IV.
414. a. ,
Tome I.
C R A 43 £
COWALAM, (Rot.) arbre du Malabar & de l’ifle dé
Ceylan. Defcription de fon fruit. IV. 424. a.
COWBRIDGE, ( Géogr. ) bourg d’Angleterre ; dans la
principauté de Galles; Fertilité de fes environs. Ses foires.
^B^OWEst^'Géogr.) port de mer d’Angleterre daiisl’iile de
Wieht. Obfervations lur ce port. Suppl. II. 649- t e
&W O R D EN , (Géogr. ) fortereffe des Ptovinces-Umes
en pays de Drenthe. Obfervations fur cette place. Suppl. lie
64<èoWPER, ( Glandes de) f.tuatibn & deférip.îon de ces
glandes. Pourquoi elles font apP
C ow p e r , anatomifte. Suppl. I. 403-.^‘ F ^ ®
Suool IV a Ç4. e. Comment cet anatomifte explique le mou-
vcnient de S o l e du coeur.III. 595- *• Glandes Se Cowper.
S”0 3 YEMbÜÙÉ f uftenfile de ménage elle/, les Negres 8c
^ Y & b h éloge de l’ouvrage de cet auteurfur
Jean Sobieski. XII. 923. a.
COYPEL. Noël Coypel, peintre. V. 3aI- " S' s ™5 ’
Antoine, yaa. «, 8cNoël-Nieolas, peintres. 3az.b. Charles
C°C&Ys£vOX, ( Antoine) fculpteur. XIV. 8300.
COZRI ( Thiol. ) ou Curari, excellent livre compofé d
y aplus de ,00 ans par R. )uda lévite. Idée de cet ouvraae,
'premièrement écrit en Arabe, pnn traduit en Hébreu. Ed..
uons Si traduction de ce livre. IV. 414- »•
C R
CRABE Contre, (Mil. nui. ) defcription des animaux de
ce ^¡eme. Diverfes efpecés de ¿abes feau f^ C r a b e■ a£
Crabe velu. Crabe en forme de coeur. Petits crabes qui
d’eau ^ “ “ K i del L f l l c r Î ne paVoi. ¿ s que les crabes
CT r l , ° p ^ " 1« hommars, les écreviffes,
fe portent enarriere e n C r a b e dulirefii
Crabe terreftre t tour o ¿es Moluques, nommés
^ m
rentesefpeces'de*crabes.VI. vol.des planches, regneanunal.
P''(X a B i I r ( OmWo/.) héron des Antilles, h defcription
derR8ACHAT 4(h ii,c . ) matières qui fervent à former les
mémelaformanondescrachan.p^^l t fe
naturel, pq A ^ f f i s’accumule ne foient plus on
ramaffer, que lespm C e„dant combien de perfonnes
moins viciées. IV. 4*5- ^ ti fembleaUfiiqUeles crachats
fourmes fur ce point, «ré , ne font pas fans
chats qu’on peut regarder . ;ik n’augmentent que
danger, slU crui-tiftinSion des crachats
peu-à-peu, 8c reltent long lein { j j font
cruds èc de ceux qui font cuib. Quels qum >
favorables s’ils Crachaujaunoep &arfao'iifgfcunut mal cns dans les p g . ionsJdupoumon.
lbid. 4*6. SuDpreflion des crachats.
fyc. Crachats verds, hvide^ ^ 'd e T n e . Ceux qui nagent
C ra c h a ts qui fuivent un cra & quelquefois les femmes
for l’eau. Les mélancohques, « faire contre cetto
B ™ " ceitains grains ou noyaux durs, &c. que ¡ettent
mdifpofiuon. Certam g femmes ffes LeS crachats mèrt-
les mèlaocohques 8c 6 qu’il aient une
cntphisffattenuon^ ^ ^
faveur fade, dègo | | fom pernicieux. Le
que celle de les avèter, lbid. 4^7- o, R i l r r r ’