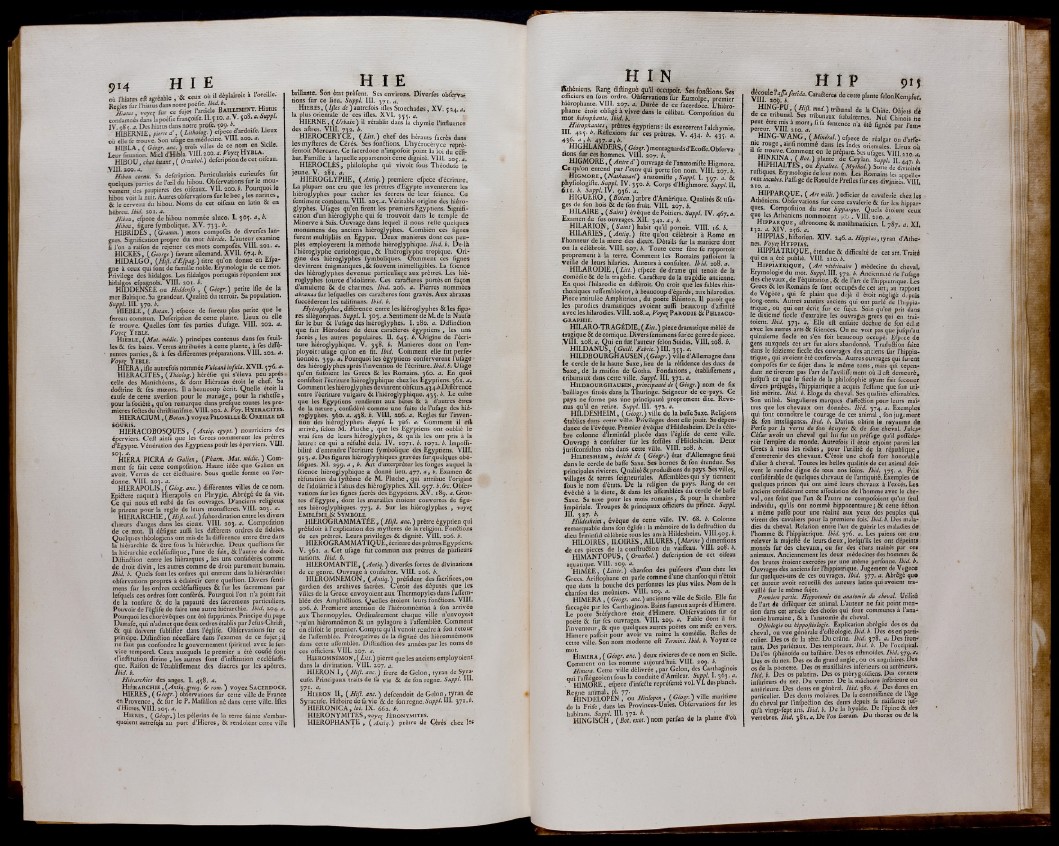
9 1 4 H I E
où l’hiatus eft agréable , '& ceux où il déplairoit à l’oreille»
Regles fur l’hiMta dsns "Otre „ tM, NT Hi, tus
L m , voyez fur ce fujet l’arlido B a i i í EMHJT. Hiatus
condamnés dans la poéfie françoifc. IL 5 10. a .V . 508. a. S u f f i .
IV . 985.0. Des hiatus dans notre proie. 509. b. . . . .
HLBERN1E , fierre d ' , (ZûAofog.) efpece dardoife. L ieux
où elle fe trouve. Son ufage en médecine. VUI. aoo. ».
H IB L A , ( Groar, une. ) trois villes de ce nom en Sicüe.
Leur fuuanon. Miel d’Hibla. VIU. aoo. a. ^ { H y b l a .
H IB O U , chut huant, ( Omithol.) defcnpnon de cet oifeau.
V I 1L 200. a . . . , . - b _
JKécn cornu. Sa defcription. Particularités curieufes lur
quelques parties de l ’ceU du hibou. Obfervations fur le mouvement
des paupières des oifeaux. V IL 100. h. Pourquoi le
hibou voit la nuit. Autres obfervations fur le b e c , les narines,
8c le cerveau du hibou. Noms de cet oifeau en latin & en
hébreu. Ibid. 201. a.
Hibou, efpece de hibou nommée aluco. I. 305. * 9P.
. H ib ou , figure fymbolique. X V . 73 3 . b.
HIBR1DES , ( Gramm. ) mots compofés de diverfcs langues.
Signification propre du mot hibride. L ’auteur examine
fi l’on a raifon de rejetter ces mots compofés. V I I I . a o i . u.
H 1CK.ES, ( George ) favant allemand. X V I I . 674. b.
H ID A L G O , (H i j l . J E fp a g .) titre qu’on donne en Efpaf
ne à ceux qui font de famille noble. Etymologie de ce mot.
rivilege des hidalgos. Les fildalgos portugais répondent aux
hidalgos efpagnols. V I I I . 201. b.
H ID D EN SÉ E ou Hiddenfo , ( Géogr. ) petite iile de la
mer Baltique. Sa grandeur. Qualité du terroir. Sa population.
Suppl. III. 370. b.
HIE BLE, ( B o ta n .) efpece de fureau plus petite que le
fureau commun. Defcription de cette plante. Lieux où elle
fe trouve. Qu elles font fes parties d’ufage. V I I I . 202. a.
V o y c [ Y e b l e .
H ie b le , ( M a t. médic. ) principes contenus dans fes feuilles
8c fes baies. Vertus attribuées à cette plante, à fes différentes
parties,8c à íes différentes préparations. V I IL 202. a,
fW ? Y e b le . t t ,
H IE R A , ifle autrefois nommée Vulcani infula. X V I I . 376. a .
H IE R A C IT E S , ( Théolog.. ) héréfie qui s’é leva peu après,
celle des Manichéens, 8c dont Hiéracas étoit le chef. Sa
doélrinc 8c fes moeurs. 11 a beaucoup écrit. Q u e lle étoit la
caufe de cette averfion pour le mariage, pour la rieheffe,
pour la foc iété, qu’on remarque dans prefque toutes les premieres
fedes du chriffianifme. VIII. 202. b. V jy . H y e r a c i t e s .
H IE R A C IU M , (B o ta n .) v o y e z P i lo s e l l e 8 c O r e i l l e d e
SOURIS.
H IE R A C O B O S Q U E S , ( A n t iq . egypt. ) nourriciers des
èperviers. C ’eft ainfi que les G r e c s nommèrent les prêtres
d’E gypte. Vénération des Egyptiens pour les èperviers. VUI.
203. a.
H IE R A P IC R A de G a lle n , (Pharm. M a t. m éd ic .) Comment
fe fait cette compofition. Haute idée que Galien en
avoit. Vertûs de cet éleéluaire. Sous quelle forme on l’o rdonne.
V I I I . 203. a.
H IE R A PO L IS , ( G log . a n c .) différentes villes de ce nom.
Epiâ c te naquit à Hierapolis en Phrygie. Ab rég é de fa vie.
C e qui nous eft reffé de fes ouvrages. D ’anciens religieux
le prirent pour la regle de leurs monafteres. VIII. 203. a.
H IE R A R CH IE , (H i j l . ceci. ) fubordination entre les divers
choeurs d’anges dans les cieux. V I I I . 203. a. Compofition
de ce mot. Il défigne aufli les différens ordres de fideles.
Quelques théologiens ont mis de la différence entre être dans
la hiérarchie 8c être fous la hiérarchie. D eu x quefiions fur
la hiérarchie eccléfiaftique, l’une de fait, 8c l’autre de droit.
DiiHnôion entre les hiérarques, les uns confidérés comme
de droit divin , les autres comme de droit purement humain.
Ib id. b. Q u e ls font les ordres qui entrent dans la hiérarchie :
obfervations propres à éclaircir cette queftion. Divers fenti-
mens fur les ordres cccléfiaftiques 8c lur les facrcmens par
lefquels ces ordres font conférés. Pourquoi l’on n’a point fait
de la tonfure 8c de la papauté des facremens particuliers.
Pouvoir de l’églife de faire une autre hiérarchie. Ibid. 204. a .
Pourquoi les cnorévêques ont été fupprimés. Principe du pape
Damafe, qui n’admet que deux ordres établis par Jefus-Chrift,
8c qui doivent fubfiiter dans l’églife. Obfervations fur ce
principe. Diftinâion néceffaire dans l’examen de ce fujet ; il
ne faut pas confondre le gouvernement fpiritucl avec le fer-
v ic e temporel. C eu x auxquels le premier a été confié font
d ’infiitution divine , les autres font d’inffitution eccléfiaftiÎue.
Raifon de l’établiffement des diacres par les apôtres.
bid. b.
Hiérarchies des anges. 1. 438. a.
H i é r a r c h i e , (A n tiq . grecq. & rom. ) v o y e z S a c e r d o c e .
HIERES, ( Géog r.) obfervations fur cette v ille de France
en Provence, 8c fur le P. Maffillon né dans cette ville, liles
d’Hicrcs. V I I I . 205. a.
H ie r e s , (G é o g r ,) les pèlerins de la terre fainte s’embar-
quoient autrefois au port d’H ic rc s , 8c rendoiént cette ville
H I E
brillante. Son état préfent. Ses environs. Diverfes obierva*
dons fur ce lieu. Suppl. III. 3 7 1 . a.
H ie r e s , ( I fle s de ) autrefois ifles Stoechades, X V . 524. a ,
la plus orientale de ces ifles. X V I . 3 « . a .
H IE R N E , ( Urbain ) il rétablit dans la chymie l’influence
des affres. V I I I . 732. b.
H IE R O C E R Y C E , ( L i t t . ) ch e f des hérauts facrés dans
les myfferes de Cérés. Ses fondions. L ’hyé rocéry cc repré-
fentoit Mercure. C e facerdoce n’impofoit point la loi du célibat.
Famille à laquelle appartenoit cette dignité. V I I I . 205.41.
H IE R O C L È S , philolophe qui v iv o it fous Théodofe le
jeune. V . 281. a.
H IE R O G L Y PH E , ( A n t i q . ) première efpece d’écriture.
L a plupart ont cru que lés prêtres d’E gypte inventèrent les
hiéroglyphes pour cacher les fecrets de leur fcience. C e
fentiment combattu. V I IL 205.41. Véritable origine des hiéroglyphes.
Ufages qu’en firent les premiers Egyptiens. Signification
d’un hiéroglyphe qui fe trouvoit dans le temple de
Minerve à Sais. Ou vrage dans lequel il nous reffe quelques
monumens des anciens hiéroglyphes. Combien ces figues
furent multipliés en Egypte. D e u x maniérés dont ces peuples
employèrent la méthode hiéroglyphique. Ibid. b. De-là
l ’hiéroglyphe cu n o log ique, 8c l’h iéroglyphe tropique. O r igine
des hiéroglyphes fymboliques. Comment ces fignes
devinrent énigmatiques,oc fouvent inintelligibles. L a fcience
des hiéroglyphes devenue particulière aux prêtres. Les hié-
roglyphes lource d’idolâtrie. C e s caraâeres portés en façon
d ’amulette 8c de charmes. Ib id. 206. a. Pierres nommées
abraxas fur lefquelles ces cara&eres font gravés. A u x abraxas
fuccéderent les talifmans. Ibid. b.
Hy¿roglyphes, différence entre les hiéroglyphes 8c les figures
allégoriques. Suppl. 1. 303. a. Sentiment de M . de la Naufo
fur le but 8c l’ufage des hiéroglyphes. I. 280. a. Diftin&ion
que fait Hérodote de deux carafteres égyptiens , les uns
la c ré s , les autres populaires. 11. 645. b. Origine de l’écriture
hiéroglyphique. V . 258. b. Maniérés dont on l’em-
ployoit : ufage qu’on en fit. Ibid. Coiument elle fut perfc-
donnée. 3 59. a . Pourquoi les égyptiens conferverent l’u fage -
des hiéroglyphes après l’invention de l’écriture. Ib id . b. Ufage
qu’en failoient les G re cs 8c les Romains. 360. a . En quoi
confiffoit l’écriture hiéroglyphique chez les Egyptiens. 361. a .
Comment les hiéroglyphes devinrent obfcurs.43 4.¿.Différence
entre l’écriture vulgaire 8c l’h iéroglyphique. 435. b. L e culte
que les Egyptiens rendirent aux bêtés 8c à d’autres êtres
de la n ature, confidéré comme une fuite de l’ufage des hié-
roglyphcs. 360. a. 438. b. V I I I . 206. a . Règles fur l’invention
des hiéroglyphes. Suppl. I . 306. a. Comment il eft
a rrivé , félon M. P lu c h e , que les Egyptiens ont oublié le
vrai fens de leurs hiéroglyphes, 8c qu’ils les ont pris à la
lettre: ce qui a réfulté delà. IV . 107 1. b. 1072. b. Impoffi-
bilité d’entendre l’écriture fymbolique des.Egyptiens. V IIL
913.47. D e s figures hiéroglyphiques gravées fur(quelques obé-
lifques. XI. 299. a , b. A r t d’interpréter les fonges auquel la
fcience hiéroglyphique a donné fieu. 47 7. a , b. Examen 8c
réfutation du fyflême de M. Pluch e, qui attribue l’origine
de l’idolâtrie à l'abus des hiéroglyphes. XII. 9 57 . b .& c . Obfervations
fur les fignes facrés des Egyptiens. X V . 189. a . G rottes
d’E g y p te , dont les murailles étoient couvertes de figures
hiéroglyphiques. 7 73 . b. Sur les hiéroglyphes , vo ycç
E m b l è m e de S y m b o l e .
H IE R O G R AM M A T É E , ( H iß . a n c .) prêtre égyptien qui
préfidoit à l’explication des myfferes de la religion. Fonctions
de ces prêtres. Leurs privilèges 8c dignité. V I I I . 206. b.
H IE R O G R AM M A T IQ U E , écriture des prêtres Egyptiens.
V . 361. a. C e t ufage fut commun aux prêtres de plufieurs
nations. Ibid. b.
H IE R OM A N T IE , ( A n t i q . ) diverfes fortes de divination*
de ce genre. Ou vrage à çonfulter. V I I I . 206. b.
H IE R OM N EM O N , ( A n t iq . ) préfident des facrifices,ou
gardien des archives facrées. C ’étoit des députés que le*
villes de la Gre ce envoyoient aux Thermopyles dans l’ad'emblée
des Amphiftions. Qu elles étoient leurs fondions. V I I I .
206. b. Premiere attention de l’hiéromnémon à fon arrivé©
aux Thermopyles. Ordinairement chaque v ille n’envoyoie
'q u ’un hiéromnémon 8c un pylagore à l’aiTemblée. Comment
on élifoit le premier. Compte qu'il venoit rendre à fon retour
de l’affemblée. Prérogatives de la dignité des hiéromnémon*
dans cette affembiée. Diffindion des années par les noms de
ces officiers. V I IL 207. a.
H i é r o m n é m o n , ( L i t t . ) pierre que les an ciens employoient
dans la divination. V I I I . 207. a.
HIERON I , (H i ß . anc. ) frere de G c lo n , tyran de Syra»
eufe. Principaux traits de fa vie 8c de fon regne. Suppl. III.
3 7 1 . a,
H i e r o n I I , ( H i ß . a n c . ) defeendoit de G e lo n , tyran de
Syracufe. Hiftoire de fa v ie 8c de fon regne. Suppl- HE 37*
H IE R O N IC A , lo i. IX . 662. b.
H IE R O N YM IT E S , voyez Jé r o n y m i t e s .
H IE R O PH AN T E , ( A n t iq . ) prêtre de Çérés ch ez Ie*
H I N
Athéniens. Rang diftingui qu’il dccitpoit. Ses fon&on s Ses
officiers en fous ordre. Obfervations fur Eumolpe, premier
hiérophante. V I I I . 107 . a. Durée de ce facerdoce. L ’hiérophante
étoit obligé à v iv re dans le célibat. Compofition du
¡mot hiérophante. Ibid. b.
Hiérophantes y prêtres égyptiens * ils exercerent l’alchymie*
III. 425. b. Réflexions fur ces prêtres. V . 434. b. 42<. a.
M 6 . a y b . 4p . a i b. * 434 ¡ ¡ | *
H IG H LAN D ER S , ( Géogr. ) montagnards d’Ecoffe.Obferva*
tions fur ces hommes. V I I I . 207. b.
H IG M O R E , ( Antre d ’ ) ouvrage de l’anatomiffe Higmore.
C e q u o n entend par l ’entre qui porte fon nom. V I I I . 207.b.
H ig m o r e , (N a th a n a t l) anatomifte , Suppl. I. 397. a. 8c
phyfiologifte. Suppl. IV . 3 50. b. Corps d’Highmore. Suppl. IL
6 1 1 . b. Suppl. IV . 936. 41.
H IG U E R O , ( Botan. ) arbre d’Amérique. Qualités 8c ufages
de fon bois 8c de fon fruit. V I I I . 207. b.
H ILA IR E , ( S a in t ) évêque de Poitiers. Suppl. IV . 4 6 7 .a.
Examen de fes ouvrages. XII. 342. a , b.
H IL A R IO N , (S a in t ') habit qu’il portoit. V I I I . 16. b.
H IL A R 1E S , ( A n t i q . ) fête qu’on célébroit à Rome en
l ’honneur de la mere des dieux. Détails fur la maniere dont
on la célébroit. V I I I . 20^. b. T o u te cette fête fe rapportoit
proprement à la terre. Comment les Romains pafloient la
y e ille de leurs hilaries. Auteurs à çonfulter. Ib id . 208. a.
H IL A R O D IE , ( L i t t . ) efpece de drame qui tenoit de la
comédie 8c de la tragédie. Caraétere de la tragédie ancienne.
En quoi l’hilarodie en diô’éroit. O n croit que les fables rhin-
thoniques reffembloient, à beaucoup d’égards, aux hilarodies.
Pie ce intitulée Amphitrion, du poëte Rhinton. 11 parott que
le s parodies dramatiques avoient aufli beaucoup d’affinité
a v e c les hilarodies. V I I I . 208.41, Voye{ Pa r o d ie 8c Ph l ia c o -
g r a p h ie .
H IL A R O -T R A G É D IE , ( L i t t . ) piece dramatique mêléé de
-tragique 8c de comique. D ivers fentimens fur cc genre dejpiece.
.VIII. 208. a. Q u i en fut l’auteur félon Suidas. V IIL 200. b.
H IL D A N U S , (G u i ll . F a b r ic.) III. 353. a.
H ILD BO U R G H A U SEN , ( Géogr. ) ville d’Allemagne dans
l e cercle de la haute Saxe > lieu de la réfidence des ducs de
S a x e , de la maifon de Gotha. Fondations, établiflemens,
tribunaux dans cette ville. Suppl. III. 372. a.
H i l d b o u r g h a u s e n de ( Géogr.) nom de fix
•Ibailliages fitués dans la Thuringe. Seigneur de ce -pays. C e
pays ne forme pas une principauté proprement dite. R e ve nus
qu’il en retire. Suppl. 111. 372. a.
H ILD E SH E IM , ( Géogr. ) v ille de la baffe Saxe. Religions
établies dans cette ville . Privilèges dont e lle jouit. Sa dépendance
de l ’évêque. Premier évêque d’Hildesheim. D e la cèlebre
colonne d Irminfal placée dans l’églife de cette ville.
O u v ra g e à çonfulter fur les foifiles aHildesheim. D eu x
iurifconfultes nés dans cette ville. V I I I . 208. b.
H ild e sheim , évêché de ( Géogr.) état d’A llemagne fitué
dans le cercle de baffe Saxe. Ses bornes 8t fon étendue. Ses
principales rivieres. Qu alité 8c productions du pays. Ses villes,
villages 8c terres feigneuriales. Affemblées qui s’y tiennent
fous le nom d’états. D e la religion du pays. Rang de cet
é v êch é à la diete, 8c dans les affemblées du cercle de baffe
Saxe. Sa taxe pour les mois romains * 8c pour la chambre
impériale. Troupes 8c principaux officiers du prince. Suppl.
Ï IL 327. bi
Hildesheim * évêque de cette ville. IV . 68. b. Colonne
remarquable dans fon églife : la mémoire de la deffruélion du
dieu Irminful célébrée tous les ans à Hildesheim. VIII.9054 b.
H ILO IR E S , ILO IR E S , A ILU R E S , (M a n n e ) dimenfions
de ces pièces de la conftruélion du vaiffeau. VIII. 208. b.
H 1M A N TO P U S , (O m it h o l. ) defcription de cet oifeau
aquatique. V I I I . 209. a.
H 1M É E , (L it t é r . ) chanfon des puifeurs deau chez les
Grecs. Ariftophane en parle comme d’une chanfon qui n’étoit
que dans la boucho des perfonnes les plus viles. Nom de la
enanfon des meûniers. VIII. 209. a.
H IM E R A , (Géogr . anc.) ancienne ville de Sicile. Elle tut
faccagée parles Carthaginois. Bains fameux auprès d’Himere.
L e poëte Stéfychore étoit d’Himere. Obfervations fur ce
poëte 8c fur fes ouvrages. VIII. 209. a. Fable dont il fut
fin v en teu r , 8c que quelques autres poètes ont mife en vers.
Himcrc paflbit pour avoir vu naître la comédie. Reftes de
cette ville. Son nom moderne eft Termini. Ibid. b. V o y e z ce
mot. . . . q . ..
H im e r a , ( Géogr. anc. ) deux rivieres de ce nom en Mené.
Comment on les nomme aujourd’hui. VIII. 200. b.
Himera. Cette v ille délivrée , par G elon, des Carthaginois
oui l’afliégeoicnt fous la conduite d’Amilcar. S u p v l. l. 363. a.
H IM O R E , efpece d’infeéle repréfenté vol. V I . desplanch»
RCJuNDELOP1iN 7, 011 H m t o fm , (G la g r . ) v ille maritime
d e la F r ife , dans les Provinces-Unies. Obfervations fur les
habitans. Suppl. III. 372. b. ■
H IN G IS C H , (B o t . exot. ) nom perfan de la plante d o u
H I P 91 $
$ Cette p,ante frlonKenipfer.
J I 1 1 N W Ê . trU>unal de ■»Cbibe. Objets d .
de c e tribunal. Ses tribunaux fubalternes. Nul Chinois h c
pere 'un'vTlI. t i T " ’ feme” Ce | été ^
H IN G -W A N G . ( Minéral. ) cfeece de rialgar ou d’arte*
nie ro u g e , amft nommé dans les fndes orteniales. Lieux où
l e Prÿ “ « - s «Ufages. V H l .a io , *
H IN K IN A , ( B o t . ). plante de Ceylan. Suppl. II a ai . h
H IPH IA L T E S , ou E p ia lies. (M y th o l. ) Sorte de divinité*
ruftiques. Etyniologiedeleur nom. Les Romains les appelle-
rent incubes. Paffage de Raoul de Preiles fur ces divinités. VIIL
210. a,
a Î P PA RQ U E ’ mi^‘ ‘ ) officier de cavalerie d té i les
Athéniens. Obfervations fur cette cavalerie & fur les hippar-
ques. Compofition du mot hipparque. Qu els étoient ceux
que les Athéniens nommoient . VIII. 210. a.
H i p p a r q u e , aftronome 8c matéhmaticien. 1. 787. a. XI*
132.47. X IV . 256.47. 7 7
H IP P IA S , hiftorien. X IV . 246. a. H ip p ia s . tyran d’A the-
nes. Voy ezH y p p i a s 4
H IP P IA T R IQ U E , étendue 8c difficulté de cet art. Traité
qui en a été publié. VIII. 210. b.
H ip p ia t r iq u e , ( A r t vétérinaire ) médecine du chevaL
Etymologie du mot. Suppl. III. 37a. b. Ancienneté de l’ufage
des ch ev au x,de l’équitation, 8c de l’àrt de l’hippiatrique. Les
Grecs 8c les Romains fe font occupés de cet art* au rapport
de V é g é c e , qui fe plaint que déjà il étoit négligé depuis
long-tems. Autres auteurs, anciens qui ont parlé de l’hippia-
trique, ou qui ont écrit fur ce fujet. Soin qu’ori prit dans
le dixième uecle d’extraire les ouvrages grecs qui en trai-
toient. Ibid. 373. a. Elle eft enfuite déchue Je fon écl.it
avec les autres arts 8c fciences. On ne voit pas que jufqu’aii
quinzième fiede on s’en foit beaucoup occupé. Efpece dé
gens auxquels cet art fut alors abandonné. Traduàion faite
dans le feizieme fiecle des ouvrages des anciens fiir l’hippiatrique
, qui avoient été confervés. Autres ouvrages qui furent
compofés fur ce fujet dans le même tems, mais qiii cependant
ne tirèrent pas l’art de l’aviliffcment où ¡1 eft demeuré,
jufqu’à ce que le fiecle de la philofophie ayant fait fecoucr
divers préjugés, l’hippiatrique a acquis l’eitime que fon utilité
mérite. Ibid. b. Eloge du cheval. Ses qualités effimables.
Son utilité. Singulières marques d’affeéVion pour leurs maîtres
que les chevaux ont données. Ibid. 374. a. Exemples
aui font connoître le courage de cet animal, fon jugement
oc fon intelligence. Ibid. b. Darius obtint le royaume de
Perfe par la vertu de fo n èç ity e r 8c d e fon cheval. J u le f*
Céfar avoit un cheval qui lui fut un préfàge qu’il pofféde-
roit l’empire du monde. Autrefois il étoit enjoint parmi les
Grecs à tous les rich es, pour l’utilité de la république,
d’entretenir des chevaux. C ’étoit une chofè fort nonorablé
d’aller à cheval. Toutes les belles qualités de cet animal doivent
le rendre digne de tous nos foins. Ibid. 3 7 5 .47. Prix
confidérable de quelques chevaux de l’antiquité. Exemples dé
quelques princes qui ont aimé leurs chevaux à l’excès. Les
anciens confidérant cette afibeiation de l’homme avec le chev
al , ont feint que l’un 8c l’autre ne compofoient qu’un feul
individu, qu’ils ont nommé hippocentaure j 8c cette fiâion
a même paffé pour une réalité aux y eu x des peuples qui
virent des cavaliers pour la première fois7 Ibid. b. Des maladies
du cheval. Relation entré l’art de guérir les maladies de
l’homme 8c l’hippiatrique. Ibid. 376. a. Les païens ont cru
relever la majefté de leurs d ieux, lorfqif ils les ont dépeint*
montés fur des ch evaux, ou fur des chars traînés par ces
animaux. Anciennement les deux médecines des hommes 8c
des brutes étoient exercées par . une même perfonne. Ibid. b*
Ouvrages des anciens fur l’hippiatrique. Jugement de Vegece
fur quelques-uns de ces ouvrages. Ibid. 3 7 7 .47. Abrégé que
cet auteur avoit recueilli des auteurs latins qui avoient travaillé
fur le même fujet4
Première partie. Hippotomie Ou anatomie du cheval. Utilité
de l’art de difféquer cet animal. L ’auteur ne fait point mention
dans cet article- des chofes qui fout communes à l’ana-
tomie humaine, 8c à l’anatomie du cheval.
Ofléologie ou hippofiéologie. Explication abrégée des tfs du
cheval, ou vue générale d'oA èo logie.Ibid . b. Des os eri particulier.
Des os de la tête. Du crâne. Ibidt 378. 47. Des frontaux.
Des pariétaux. Des temporaux. Ibid. b. D e l’occipital.
D e l’os fphénoïde ou bafilaire. Des os ethmoïdes. Ibid. 379. a*
Des os du nez. Des os du grand angle , ou os angulaires. Des
os de la pomette. Des os maxillaires inférieurs où antérieurs.
Ibid.. b. Des os palatins. Des os ptérygoïdiens. Des cornets
inférieurs du nez. D u vomer. D é la mâchoire inférieure ou
antérieure. Des dents en général. Ibid. 380. d. Des dents en
particulier. Des dent9 molaires. D e la connoiffance de l’âge
riu cheval par l’infpeftion des dents depuis ia naiffance jufqu’à
vingt-fept ans. Ibid. b. D e la hyoide. De 1 épine 8c des
vertèbres. Ibid, 38 1 .4. D e l’os iàcrum. D u thorax ou ac u