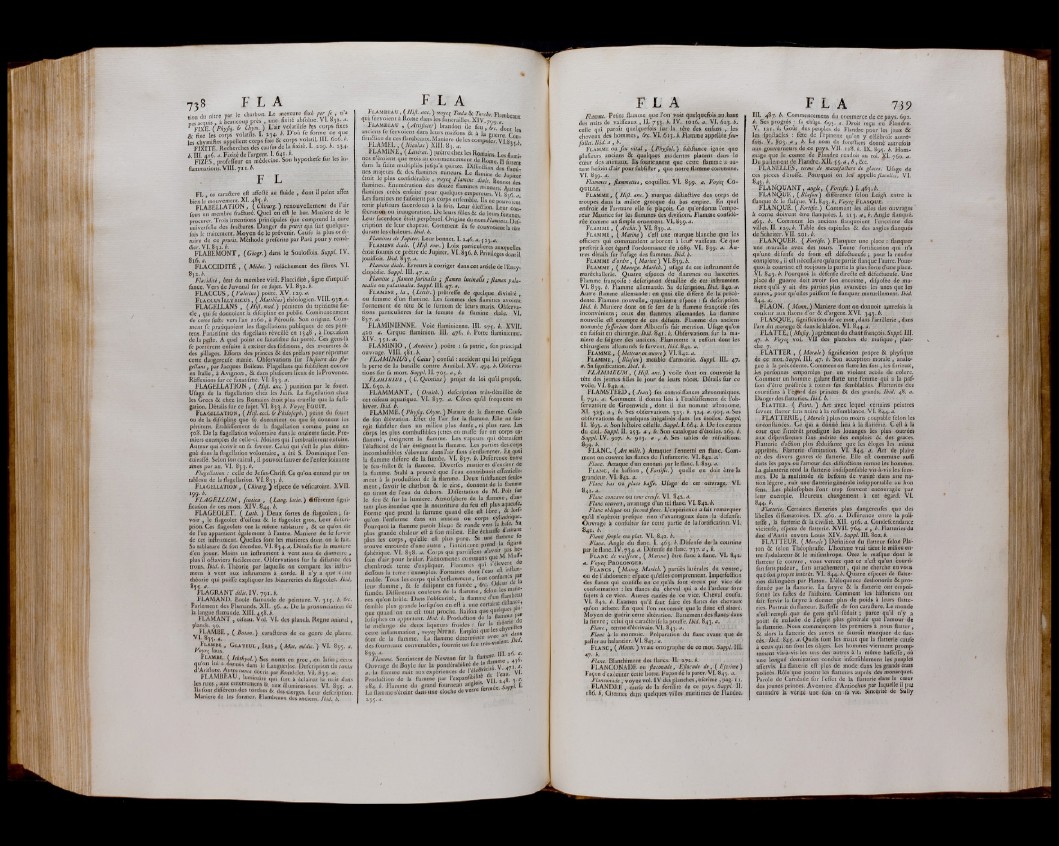
738 F L A
«ion a.< n i.« W 1« d»rfcon. U pi' fi .
nas acquis, » beaucoup pni» , une fixité abfolue. VI. 8j i . n.
FIXE ( J f i L é C M : ) Lair volanlife tes corps Bacs
& fixe i l corps volatils. I. ¡ ¡ ¡ | É D ’où fe forme ce que
les chymiftes appellent corps fixe & corps volatiL » ¡>°6’ b-
F IaITÉ. Recnerches des caufes de la fixité. I. 229. b. 234.
b. III. 416. a. Fixité de l’argent. 1.6 41 .* . r - . .
FIZES, profeffeur en médecine. Son hypothefe fur les inflammations.
VIII. 71 x. b.
F L
FL ce caratare eft affeta au fluide , dont il peint affez
bien le mouvement. XI. 485. b.
FLABELLATION, ( Chirurg. ) renouvellement de I air
fous un membre frataré. Quel en eft Je but. Maniéré de le
procurer. Trois intentions principales que comprend la cure
univerfelle des fra&ures. Danger du prurit qui fuit quelquefois
le traitement. Moyen de le prévenir. Caufe la plus ordinaire
de ce prurit. Méthode preferite par Paré pour y remé-
F L A B e I Î o N T , ( Giogr, ) dans le SoulolTois. Suppl. IV.
" f l a c c i d i t é , ( M i iu . ) relâchement des libres. VI.
$3 %.b. ; ' '
Placidité, état du membre viril. Flaccidité, figne d impuu-
fance. Vers de Juvenal fur ce fujet. VI. 83a. b.
F LA C CU S , ( Valerius) poëte. XV . 120. a.
F l accus I l ly r i c u s , (Ma tth ias ) théologien. V III. 93*-*-
FLAGELLANS , ( Htfl. mod. ) pénitens du treizième ficelé
, qui fe donnaient la difeipline en public. Commencement
de cette fe ta vers l’an 1260, à Péroufe. Son origine. Comment
fe pratiquoient les flagellations publiques de ces pénitens.
Fanatifme des flagejlans réveillé en 1348 , à l’occafion
de la pç/le. A quel point ce fanatifme fut porté. Ces gens-Ià
fe portèrent enfuite à exciter des féditions , des meurtres 6c
des pillages, Efforts des princes & des prélats pour réprimer
cette daugereufe manie. Obfervations fur Yhiftoirt tUs fla gellant
, par Jacques Boileau. Flageilans qui fubfiftent encore
en Italie, à Avignon, fle dans plufieurs lieux de la Provence.
Réflexions fur ce fanatifme. VI. 833. a.
FLAGELLATION , ( Hifl. anç. ) punition par le fouet.
Ufage de la flagellation | | chez les Juifs. La jÉ i||flagellation É Î| jH |
chez
les Grecs 6c chez les Romains étoit >it plus pim
cruelle que la fufti-
gation. Détails fur ce fujet. VI, 833.3. b.i . Voyez V
Fouet.
Flagellation , ( Hifl. eccl. 6* Pliilofophf) peine du fouet
ou de la difeipline que fe donnoient ou que fe, donnent les
pénitens. Etabliflement de la flagellation comme peine en
508. De la flagellation volontaire dans le onzième fiecle. Premiers
exemples de celle-ci. Moines qui l’embraflérem enfuite.
Auteur qui écrivit en fa faveur. Celui qui s’eft le plus diftin-
gué dans la flagellation volontaire, a été S. Dominique l’en-
cuiraffé, Selon fon calcul, il pouvoit fauver de l’enfer foixante
ames par an. VI. 833. b.
Flagellation : celle de JefusChrift. Ce qu’on entend par un
tableau de la flagellation. VI. 833. b.
Flagellation , ( Chirurg. ) efpece de véficatoire. XVII.
199. b.
F I .A G E L L U M , fcutica , ( Lang. latin.) différente lignification
de ces mots. XIV. 844. b.
FLAGEOLET. ( Luth. ) Deux fortes de flageolets ; fa-
voir , le flageolet d’oifeau 8c le flageolet gros. Leur deferi-
ption. Ces flageolets ont la même tablature , 8c ce qu’on dit
de l’un appartient également à l’autre. Maniéré de le fervir
de cet infiniment. Quelles font les matières dont on le fait.
Sa tablature 8c fon étendue. V I. 834.4, Détails fur la maniéré
d’en jouer. Moins un infiniment à vent aura de diametre ,
plus il otaviera facilement. Obfervations fur la difiance des
trous.. Ib'td. b. Théorie par laquelle on compare les inftrti-
mens à vent aux infirumens à corde. Il n’y a que cette
théorie qui puiffe expliquer les bizarreries du flageolet« Ibid,
FLAGRANT délit. IV. 791. b.
FLAMAND, Ecole flamande de peinture. V . 313. b. b c .
Parlement des Flamands. XII. 36. a. De la prononciation de
la langue flamande. XIII. 438.b.
FLAMANT , oifeau. Vol, V I. des planch. Regne animal,
planch, 30.
FLAMBE , ( Botan, ) caratare» de ce genre .de plante.
*L 835, a.
Flambe , Glaveul , I rjç , (M a t . médie. ) VI. 833, a.
Voye\ I r is ,
F lambe, ( Ichthyof.) Ses noms en g re c , en latin; ceux
V A° V m a4 dans le Languedoc. Defcription du teenia
m A im P A i î d é c r i t par Rondelet. VI, 833. a.
FLAMBEAU, luminane qui Ri 1 éclairer la nuit dans
WittreiMi» & «ux iUuminitions; VI. 833. ,/.
Ils font difiérens des torches fk des cierges. Leur dc fc ripti-
Mamere de les former. Flambeaux des anciens. Ibid h
F L A
. F lambeau , (A r t ifitm ) brandon ilo f c „ , ' ¿ 1’ Æ 1 -
anciens fe fervoient dan» leurs maifons & à la Guerre Cn
ilrnclion de ces flambeaux. Manière de les comoofer VI ï
F LAM E L , (M c o la , ) XIII. 83. «. ^ ^
F LAM IN E, ( O u tra i. ) pr&reclua les Romains, le s flan,;
nés n étoient que trois au commencement de Rome II fur '
dans la fuite multipliés p i quinze. Diftinûion des B P
nés majeurs 6c des flammes mineurs. Le flamme £e J u S r
étoit le plus confidérable, ym Flamine diale. Bonnet de*
flammes. Enumération des douze flamines mineurs Autre*
flamine» créés enfuite pour quelques empereurs VI iUf,
Les flamines ne faifoient pas corps enfemble. Ils ne pouvoiém
tenir plufieurs facerdoces a la fois. Leur éleéfjoii. U u r «on-
fécratio» ou inauguration. De leurs filles & de leurs femmes
Leur facerdoce étoit perpétuel, Origine du nom Flamines 1W-
cription de leur chapeau. Comment ils fc couyroiem la tête
durant les chaleurs. Ibid. b.
Flamines de Jupiter. Leur bonnet, I. 246,4, 323,4,
Flamine diale. ( H ifl rom.) Loix particulières auxquelles
étoit fournis ce prêtre de Jupiter. VI, 836. b. Privilèges dont il
jouiffoit. Ibid. 837,4,
Flamine diale. Erreurs à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 47.4.
Flamine ; flamen furinalis ; flamen lucinalïs ; flamtn pala-
tualis o u palatinalis. Suppl. III. 47. 4,
F lam in e « l a , ( Litùr , ) prêtreffe de quelque divinité ,
ou femme d’un flamine. Les femmes des flamines avoient
l’ornement de tête 6c le furnom de leurs maris, Obfervations
particulières fur la femme du flamine diale. VI.
837.4,
FLAMINIENNE. Voie flamlmenne. III. 273, b. XVII.
420 4. Cirque flaminien. III. 476. b. Porte flaminicnne.
XIV. 331 . 4.
F LAM IN IO , ( Antoine ) poëte : fa patrie, fon principal
ouvrage. VIII. 381 .b.
F L A M IN IU S f ( Caius) conful : accident qui lui préfiigea
la perte de la bataille contre Annibal. X V . 494. b. Obfervations
fur fa mort. Suppl. II. 703. a , b,
F i a m i n i u s , ( C. Quintius ) projet de loi qu’il propofa.
IX. 630. b.
F LAM M AN T , ( Omit h. ) defcription trés-détaillée de
cet oifeau aquatique. VI. 837. 4. Côtes qu’il fréquente en
hiver. Ibid. b.
FLAMME. ( Phyflq. Chym. ) Nature de la flamme. Caufe
de fon élévation. Efiet de l’air fur la flamme. Elle ne fau*
rojt fubfirter dans un milieu plus denfe, ni plus rare. Les
corps les plus combuftibles jettés en mafle fur un corps enflammé
, éteignent la flamme. Les vapeurs qui détruifent
l’éiaftiçité de l’air éteignent la flamme. Les parties des corps
incombufiibles s’élèvent dans l’air fan» s’enflammer. En quoi
la flamme différé de la fumée. VI. 837. b. Différence feutre
le feu-follet 6c la flamme. Diverfes manières d’exciter de
la flamme. Stahl a prouvé que l’eau contribuolt eflenttelle*
ment à la produélion de la namme. Deux fubftances feulement,
favoir le charbon 6c le zinc, donnent de la flamme
en tirant de l’eau du dehors, Differtatlon de M. Poli: fur
le feu 8c fur la lumière. Atmofpbere de la flamme, d’autant
plus étendue que la nourriture du feu eft plus aqueufe.
Forme que prend la flamme quand elle eft linre, & }
qu’on l’enferme dans un anneau ou corps cylindrique.
Pourquoi la flamme paroir bleue 6c ronde vers U baie, sa
plus grande chaleur eft à fon milieu. Elle échauffe 0 autant
plus les corps, qu’elle eft plus pure. Si une flamme >
trouve entourée d’une autre , l'intérieure prend la ngur
fphérique. V I. 838. 4. Corps qui paroiffent n’avoir pas
foin d air pour brûler. Plténomcnes communs que M- " ,
chenbroek tente d’expliquer. Flammes qui 5 ileAv®‘
deffous la terre : exemples. Fontaines dont l’eau elt tnn
niable. Tous les corps qui s’enflamment, font comume P
leur flamme, 6c fe diüipent en fumée , Odeur de
fumée. Différentes couleurs de la flamme, félon les ma
res qu’on brûle. Dans l’obfcurité, la flamme dun flaj1»
fcmble plus grande lorfqu’on en eft à une certaine autan1 »
que quand on en eft tout proche. Raifon P
lofophes en apportent. Ibid. b. Produélion de la | j i
le mélange de deux liqueurs froides : fur la thé ^
cette inflammation , voye\ Nitre. Emploi que les / <jang
font de la flamme. La flamme déterminée avec,enL jb,d,
des fourneaux convenables, fournit un feu trés-vi
^Flamme. Sentiment de Newton fur la flamm®' ^
Ouvrage de Boylc fur la pondérabilité de , , y , 471 .a .
a. la flamme nuit aux expériences de J éjpsh . * j»eau. VI-
Produélion de la flamme par l’expanfibmte . . « f .
284. b. Flamme du grand fourneau K M M : L
La flamme s’éteinr dans une cloche de verre fermée. suPF
233.4.
F L A F L A 739
Flamme. Petite flamine que l’on voit quelquefois..eu haut
des mâts de vaiffeaux , IL 733« b. IV. toié^ a. V L 6L3. b.
celle qui paroit quelquefois fur la tête des eofaos >, les
cheveux des hommes, bq. VI, 6 13 .b.Flamme appellée/»«-
follet. Ibid. a , b.r , ; v>j -j-, ¿j
Fl am m e ou feu v i ta l, ( F h y flç f ) fubftance ignée que
plufieurs anciens 6c quelques modernes placent dans le
coeur des animaux. Ils foutieqnciu que cette flamme a autant
befoin d’air pour fubfifter, que notre, flamme commune.
VI, 839. 4.
Flammes, flammtttes, coquille?, V L 839. 4 , Voy.e[ C o quille.
Flamme , ( Hifl. anc. ) marque diftin&ve des corps de
troupes dans la milice grecque du bas empire. En quel
endroit de l'armure elle fe plaçolt. Ce qu'ordonua l’empereur
Maurice fur les flammes des divifions. Flamme confidé-
rée comme unfimple ornement, VI. 839.4.
Flamme , ( Archit. ) VI. 839.4,
Flamme , ( Marine) c ’eft une marque blanche que les
officiers qui commandent arborent à leuf vaiffeau. Ce que
preferit à cet égard l’ordonnance de 1689. VI, 839. 4 . Autres
détails fur l’ufage des flammes. Ibid. b.
F lamme d'ordre, (M a r in e ) VI.839.E
F lamme , ( Manège, Maréch, ) ufage de cet inftrument de
maréchallerie. Quatre efpeces de flammes ou lancettes.
Flamme françoife : defcription détaillée de cet inftrument.
VI. 839. b. Flamme allemande. Sa defcription. Ibid. 840. a.
Autre flamine allemande : en quoi elle différé de la précédente.
Flamme nouvelle, quatiieme efpece : fa defcription.
Ibid. b. Maniéré dont on fe fert de la flamme françoife ; fes
inconvéniens ; ceux des flammes allemande?. La flamme
nouvelle eft exempte de ces défauts. Flamme des anciens
nommée fojforium dont Albucaus fait mention. Ufage qu'on
en faifoiten chirurgie. Ibid. 841.. b. Obfervations fur la maniéré
de faigner des anciens. Flammette à reflhrt dont les
chirurgiens allemands fe fervent. Ibid. S42.4.
Flamme , f Metteur en ttuvre ). V 1. 842.4.
Flamme, (B lo fo n ) meuble d’armoirie. Suppl. III. 47.
4 . Sa fignification. Ibid. b.
F L A M M E U M , (H ifl. anc.) voile dont on couvroit la
tête des jeunes filles le jour de leurs nôces. Détails fur ce
voile. VL 84», 4..
FLAMSTEED, (J e a n ) fes connoiffances aftronomiques.
I. 791. 4. Comment il donna lidu à l’établiffeinent de l’ob-
fervatoire de Greenwicb, dont il fut nommé aftronome.
XI, 323. 4 , b. Ses obfervations. 323. b. 224. a. 003.4. Ses
obfervations de quelques inégalités dans les étoiles., Suppl,
IL 891. 4. Son hiftoire cfeleftc. Su p p L l. 664. b. D e fes cartes
du ciel. Suppl. II. 233. 4 , b. Son catalogue d’étoiles. 269. b.
Suppl. IV. 907. b. 913. 4 , b. Ses tables de réfraélions.
% 9- b. ■ f
FLANC. (A r tm ilit . ) Attaquer l’ennemi en flanc. Comment
on couvre les flancs de 1 infanterie. V I .842. ai' ^
Flanc. Attaque d’un ennemi, oar le flanc. 1.8 a9.4.
Fl a n c , du baftion , (For tifie.) quelle en doit être la
grandeur, VI. 842. a.
Flanc bas ou place baffe-, Ufage- de cet ouvrage. VI.
842.4.
Flanc concave ou tour creufe, V I. 84a. a.
Flanc couvert, avantage d’un tel flanc. V I. 842. b.
Flanc oblique ou fécond flanc. L'expérience a fait remarquer
qu’il n’opéroit prefque rien d’avantageux dans 4 a défenfe.
Ouvrage à confulter fur cette partie de la fortification. VI.
842. b. '
Flanc flmple on plat. VI. 84a. b.
Flanc. Angle du flanc. I. 462. ¿. Défenfe dé/la courtine
par le flanc. IV. 734. a. Défenfe de flanc. 737. a , b.
F lanc de vaiffeau, (M a r in e ) être flanc.à flanc. VI, 842.
4, Voyt[ Prolonger.
F la n c s , (Maneg. Maréch. ) parties latérales du ventre,
ou de l’abdomen : efoace qu’elles comprennent. Imperfeûion
des flancs qui confifte en ce qu'ils font creux par vice de
conformation : les flancs du cheval qui a de l’ardeur font
fujets à ce vice. Autres caufes de ce vice. Cheval coufu.
VI. 84a. b. Examen qu’il faut faire des flancs des chevaux
qu'on acheté. En ;quoi l’on reconnoîc que le flanc eft altéré.
Moyeu de guérir cette altération. Battement des flanc? dans
la fièvre ; celui qui caraélérifc la pouffe. Ibid. 843. a.
Flanc y terme d'écrivain. VI. 843. 4.
Flanc kt la monnoie. Préparation du flanc avant que de
pafler au balancier. V I. 843; a.
F lanc , ( Monn. ) vraie ortographe de ce mot. Suppl, III.
47- b.
Flanc. Blanchiment des flancs; 11. 272. b.
FLANCONADE ou flaconade, Eflacade d e , (E jc r im e )
Façon d'exécuter cette botte. Façon de la parer. V j. 843. 4.
Flancohade, voyez vol. IV des planches, feferime, pag. 11.
F LAN D R E , caufe de la fertilité de ce pays. Suppl. II.
186. b. Citernes dajis quelques villes maritimes de Flandre.
III. 487. b. Commenccmens du commerce de ce pays, 692.
b. Ses Progrès | fa chtye. 693. 4, Droit reçu en Flandre.
V , t2 i . b, Gout des p eu p le s de Flandre pour les jeux &
les fpeéUcles : fête de lépinette qu’on y célébroit autrefois.
P ¡111! ft » A Le nom de foreftiers donné autrefois
aux gouverneurs de c e pays, VII. 128. b. IX. 893. b. Hommage
que le comte de Flandre rendoit au roi. XL 7 60. a.
Dupariemejn de Flandre. X II. 3 3.4 , b , &ç,
FLANELLES, terme de manufaélure de glaces. Ufage de
ces pièces d’étoffe. Pourquoi on la i appelle flanelles. VI.
843. b.
F LAN Q U AN T , angle, (F or tifie.) I.463.b .
F LAN Q U E , ( Blafon ) différence félon Lcigh entre la
flanque & le flafque, VI. 043, b., Voy<[ F lasque.
FLANQUÉ, ( Fortifie.) Comment les ailes des ouvrages
à corne doivent être flanquées. I, 213. a , b. Angle flanqué.
463. b. Comment les anciens flanquoient l'enceinte des
villes. II. iM .b . Table des capitales 6c des angles flanqués
de Scheiter. VU. 20i .b .
FLANQUER. ( Fortifie. ) Flanquer une place : flanquer
une muraille avec des tours. Toute fortification qui n’a
qu’une défenfe de front eft défc&ueufe ; pour la rendre
compiette, il eft uéceffaire qu’une partie flanque l’autre. Pourquoi
la courtine eft toujours la partie la plus torte d’une place.
VI, 843. b. Pourquoi la défenfe direéle eft défeftueufe. Une
place de guerre doit avoir fon enceinte, difpoféc de maniere
qu’il y ait des parties plus avancées les unes que les
autres, pour qu’elles puiffent fe flanquer mutuellement. Ibid.
844. 4.
FLAON. ( Monn, ) Maniere dont on donnoit autrefois la
couleur aux flaons d’or & d’argent. X VI. 343. b.
FLASQUE, fignification de ce mot, dans l'artillerie , dans
l’art du manège 6c dans le blafon. VI. 844. a. ■
FLATTÉ* ( Mufiq, ) agrément du chant françois.Suppl. IIf.
47. b. Voye[ vol, VIJ des planches de mufique, planche
7.
FLATTER * ( Morale ) fignification propre 6c phyfique
de ce mot. Suppl. 111. 47. b. Son acception morale , analogue
à la précéaente. Comment on flatte les fots, les furieux,
les perfonnes emportées par un violent accès de colere.
Comment un homme gahmt flatte une femme qui a la pnf-
fion d’être préférée à toutes fes femblables. Flatteries des
courtifans à l ’egbrd des princes 6c des grands. Ibid. 48. a.
Danger des flatteries. Ibid. b.
Flatter. ( Peint. ) Art avec lequel certains peintres
favent flatter fans nuire à la reffemblance. V I. 844.4.
F LATTER IE, (Mo rale) plus6u moins coupable félon les
cireonftances. Ce qui a donné lieu à la flatterie. C ’eft à la
cour que l’intérêt prodigue les louanges les plus outrées
aux difpsnfatçurs fans mérite des emplois 6c des grâces.
Flatterie d’aétion plus féduifaute que les éloges les mieux
apprêtés. Flatterie d'imitation. Vf. 844. 4. Art de plaire
né des divers genres de flatterie. Elle eft commune aufli
dans les pays ou l’amour'des diftinétions remue les hommes.
La galanterie rend la flatterie indifpenfable vis-à-vis les femmes.
De la multitude de bêfoins de vanité dans .une nation
légère, naît une flatterie générale infupportable au bon
fens. Les philofophes l’ont trop fouvent encouragée par
leur exemple. Heureux changement à cet égard. VI.
844. ||
Flatterie. Certaines flatteries plus dangereufes que des
libelles diffamatoires. IX. 460. a. Différence entre la polL
teffe , la flatterie 6c la'civilité. XII. 916. 4. Condefcendance
vicieufe, efpece de flatterie. XVII. 764. a , .b. Flatteries du
duc d’Antin envers Louis XIV. Suppl. III. 802. b.
FLATTEUR. (M o ra le ) Définition du flatteur félon Platon
6c félon Théophrafte. L’homme vrai tient le milieu entre
l’adulateur ÔC le mifimthrope. Otez le mafque dont le
flatteur fe couvre, vous verrez que ce n’eft qu’un courti-
fan fans pudeur, fans attachement, qui ne cherche en vous
quë fon propre intérêt. VI. 844, b. Quatre efpeces de flatteries
diftiuguées par Platon. L’éloquence deshonorée 6c pro-
ftituée par la flatterie. La fatyre & la flatterie ont empoi-
fonné les faftes de l’hiftoire. Comment les hiftoriens ont
fait fervir la fatyre à donner plus de poids à leurs flatteries.
Portrait du flatteur. Baffeffe de fon caratare. Le monde
n’eft '.rempli que de gens qu’il féduit ; parce qu’il n’y 3
joint de maladie de I’efprit pliis générale que l’amour de
a flatterie. Nous commençons lespremiers à nous flatter,
6c alors la flatterie des autres ne fauroit manquer de fuc-
cés. Ibid. 843. 4. Quels font les inaux que la flatterie caufe
à ceux qui -en font les.objets. Les hommes viennent promptement
vis-à-vis les uns des autres à la même baffeffe, où
une longufe domination conduit infenfiblemcnt les peuples
affervis; La flatterie eft plus de mode dans les grands états
Ïolicés. Rôle que jouent les flatteurs auprès des monarques,
arole de Camèade fur l’effet de la flatterie dans le coeur
des jeunes princes. Aventure d’Antiochus par laquelle il put
entendre la vèriié une fois en fa vie. Sincérité de Sully