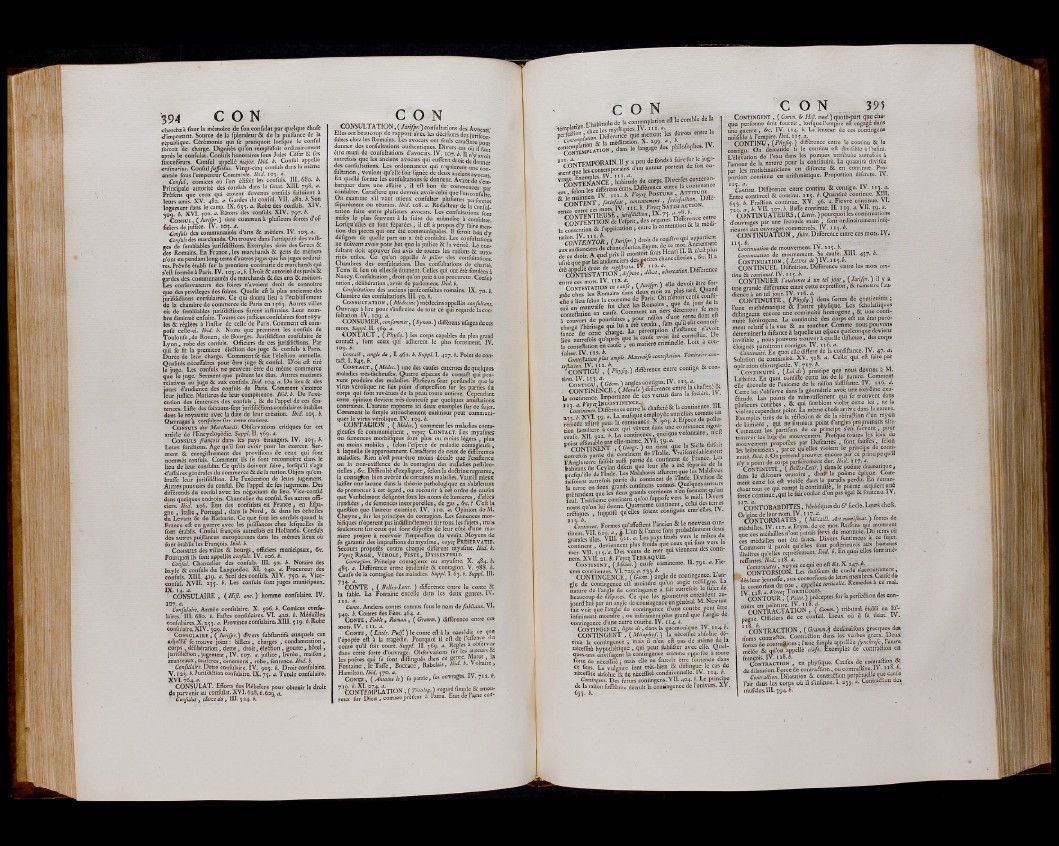
394 CON
cherchai fixer la mémoire de fon confulat par quelque Choie
d’important. Source de la fplendeur & de la puiffance de la
république. Cérémonie qui fe pratiquoit lorfque le confuí
iortoit de charge. Dignités qu’on rempliiToit ordinairement
après le confulat. Confuís honoraires fous Jules Céfar & fes
fucceffeurs. Confuí appellé major, Ibid. b. Confuí appelle
crdinarius. Confuí fuffeftus. Vingt-cinq confuís dans la même
année fous l’empereur Commode, lbïd. 103. a.
Confuí, comices où l’on élifoit les confuís. III. 680. 0.
Principale autorité des confuís dans le fénat. Xlll. 790. a.
Préfens que ceux qui étoient devenus confuís failoient a
leurs amis. XV. 482. * Garde s du confuí. VU. 482. ¿.Son
logement dans le camp. IX. 633. a. Robe des confuís. XIV.
•309. b. XVI. •¡02. a. Bâtons des confuís. XIV. 707. b.
C o n su l, ( Jurifpr. ) titre commun à plufieurs fortes d’officiers
de juitice. IV. 103.a.
Confuís des communautés darts & métiers. IV. 103.a.
Confuís des marchands. On trouve dans l’antiquité des vertiges
de femblables jurifdiftions. Exemples tirés des Grecs &
des Romains. En France, les marchands & gens de métiers
n’ont eu pendant long-tems d’autres juges que les juges ordinaires.
Prévôt établi fur la première conîrairie de marchands qui
s’eft formée à Paris. IV. 102. a tb. Droit & autorité des jurés &
gardes des communautés ae marchands &des arts & métiers.
Les confervateurs des foires n’avoient droit de connoître
que des privilèges des foires. Quelle eft la plus ancienne des
jurifdiftions confulaires. Ce qui donna lieu à l’établiffement
de la chambre de commerce de Paris en 1363. Autres villes
où de femblables jurifdiftions furent inftituées. Leur nombre
S
diminué enfuite. Toutes ces juftices confulaires font royales
& réglées à l’inftar de celle de Paris. Comment eft com-
>ofé celle-ci-. lbïd. b. Noms que prennent les confuís de
iouloufe,de Rouen, de Bourges. Jurifdiftion confulaire de
Lyon, robe des confuís. Officiers de ces jurifdiftions. Par
Îui fe fit la première éleftion des juge & confuís à Paris,
lurée de leur charge. Comment fe fait l’éleftion annuelle.
Qualités néceflaires pour être juge & confuí. D’où eft tiré
le juge. Les confuís ne peuvent être du même commerce
que le juge. Serment que prêtent les élus. Autres maximes
relatives au juge 8c aux confuís, lbïd. 104. a. Du lieu & des
tours d’audience des confuís de Paris. Comment s’exerce
leur juitice. Matières de leur compétence. Ibid. b. De l’exé-
cudon des fentences des confuís , 8c de l’appel de ces fen-
tences. Lifte des foixante-fept jurifdiftions confulaires établies
dans le royaume avec la date de leur création. Ibil. 103. b.
Ouvrages à confulter fur cette matière. .
C o n su ls dés- Marchands. Obfer varions critiques fur cet
article de l’Encyclopédie. Suppl. H. 369. a.
’ C o n su ls fiançois dans lés pays étrangers. IV. 103. b. ■
Leurs fondrions. Age qu’il faut avoir pour les exercer. Serment
8c enregiftrement des provifions de ceux qui font
nommés confuís. Comment ils fe font reconnoître dans le
lieu de leur confulat. Ce qu’ils doivent faire, lorfqu’il s’agit
d’affaires générales du commerce 8c de la narion.Objets qu’em-
brafle leur jurifdiftion. De l'exécution de leurs jugemens.
Autres pouvoirs du confuí. De l’appel de fes jugemens. Des
différends du confuí avec les négocians du lieu. Vice-conful
dans quelques endroits. Chancelier du confuí. Ses autres officiers.
Ibid. 106. Etat des confulats en France - en Efoa-
gne , Italie , Portugal, dans le Nord, 8c dans les échelles
du Levant 8c de Barbarie. Ce que font les confuís quand la
France eft en guerre avec les puiffances chez lefquelles ils
font établis. Confuí françois autrefois en Hollande. Confuís
des autres puiffances. européennes dans les mêmes lieux où
font établis les François. Ibid. b.
C o n su ls des villes 8c bourgs, offiders municipaux, &c.
Pourquoi ils font appellés confuís. IV. 106. b.
Confuí. Chancelier des confuís. IH. 92. b. Notaire des
bayle 8c confuís du Languedoc. XI. 240. a. Procureur des
confuís. Xin. 419. a. Scel des confuís. XIV. 730. a. Vice-
conful. XVII. 233. b. Les corifuls font juges municipaux.
: CONSULAIRE , (Hifi. anc.) homme confulaire. IV.
IO 7 . a. .
Confulaire. Armée confulaire. X. 306. b. Comices confulaires.
DI. 680. b. Fartes confulaires. VI. 420. b. Médailles
confulaires. X. 233. a. Province confulaire.XIII. 319. ¿. Robe
confulaire. XIV. 309. b.
C o n su la ir e , Ç Juûfpr. ) divers fubftanrifs auxquels cet
adjeétif fe trouve joint : billets, charges , condamnation ,
Corps , délibération, dette, droit, élection, goutte, hôtel,
jurifdiftton, jugement, IV. 107. a. juitice, livrée, maifon ,
manteaux, taaticres, ornemens , robe, fentence. lbïd. b. ■
' Confulaire. Dette confulaire. IV. 903. b. Droit confulaire.
V. 123. b. Jurifdiftion confulaire. IX. 73. a. Tutele confulaire.
XVI. 764.*.
CONSULAT. Efforts des Plébeïens pour obtenir le droit
de parvenir au confulat. XVI. 628. b. 629. a.
‘ Confulat', clercs du, ID. 324. b.
C O N
CONSULTATION, ( Jurifpr.) confultations des Avocate’
Elles ont beaucoup de rapport aVec les décifions des jurifeon
fuites chez les Romains. Les avocats ont feuls caraftere pour
donner des confultations authentiques. Divers cas où il fan
être muni de confultations d’avocats. IV. 107. b. Il n’y aVo t
autrefois que les anciens avocats qui euffent droit de donner
des confultations. Les ordonnances qui requièrent une con-
fultation , veulent qu’elle foit fignée de deux anciens avocats*
En quellé forme les confultations fe donnent. Avant de s’embarquer
dans une affaire , il eft bon de commencer par
confulter. Caraftere que devroit avoir celui que l’on confulte
On examine s’il vaut mieux confulter plufieurs perfonnes
féparément ou réunies. Ibid. 108. a. Rédaéleur de la conful-
tation faite entre plufieurs avocats. Les confultations font
mifes le plus fouvent à la fuite du mémoire à confulter.
Lorfqu’elles en font féparées, il eft à propos d’y faire mention
des pièces qui ont été communiquées. Il feroit bon d’v
défigner de quelle part on a été confulté. Les confultations
■ne doivent avoir pour but que la juitice & la vérité. Le con-
fultant doit appuyer fon avis de toutes les raifons 8c autorités
utiles. Ce qu’on appelle le pilier des confultations.
Chambres des confultations. Des confultations de charité.
Tems 8c lieu où elles fe donnent. Celles qui ont été fondées à
Nancy. Confultation, droit qu’on paie à un procureur. Conful-
tation, délibération, arrêt du parlement. Ibid. b.
Confultations des anciens jurifconfultes romains. IX. 70. b.
Chambre des confultations. lll. 30. b.
C o n s u l t a t i o n , ( Médecine ) médecins appellés confultans.
Ouvrage à lire pour s’inftruire de tout ce qui regarde la confultation.
IV. 109. a.
CONSUMER, confommer, (Synon.) différons ufagesdeces
mots. Suppl. II. 369. a.
CON TACT, ( Phyfiq. ) les corps capables du plus grand
contaft , font ceux qui adhèrent le plus fortement. IV.
109. b.
ContaEl , angle de , 1. 462. b. Suppl. I. 427. b. Point de contaft.
I. 843. b.
C o n t a c t , ( Médec. ) une des caufes externes de quelques
maladies très-facheufes. Quatre efpeces de contaft-qüf peuvent
produire des maladies. Plufieurs font perfuadés que le
virus vérolique ne fait point d’impreffion fur les parties du
corps qui font revêtues de la peau toute entiere. Cependant
. cette opinion devient très-douteufe par quelques atteftations
contraires. L’auteur rapporte ici deux exemples fur ce fujet.
Comment le fimple attouchement extérieur peut communiquer
le virus vérolique. IV. 109. b.
CONTAGION , ( Médec. ) comment les maladies cônta-
gieufes fe communiquent, voyez C o n t a c t . Les myafmes
ou femences morbinques font plus ou moins légers , plus
ou moins mobiles , l'elon l’eipece de maladie contagieufc,
à laquelle ils appartiennent. Carafteres de ceux de différentes
maladies. Rien n’eft peut-être moins déridé que i’exiftence
ou la non-exiftence de la contagion des maladies peitilen-
rielles, 6>c. Difficulté d’expliquer, félon la doftrinerégnante,
la contagion bien avérée de certaines maladies. Vaut-il mieux
briffer une lacune dans la théorie pathologique en.s’abftenant
de prononcer à cet égard, où recourir à cet ordre de caufes
que Vanhelmont déugnoit fous les noms de lumières, d’idées
irradiées , de femences incorporelles, de gas , &c. ? C’eft la
queftion que l’auteur examine. IV. 110. a. Opinion de M.
.heyne , fur les principes de contagion. Les femences morbifiques
n’operent pas indiftinftement fur tous les fujets, mais
feulement fur ceux qui font difpofés de leur côté d’une maniéré
propre à recevoir l’impreffion du venin. Moyens de
fe garantir des impreffions du myafme, voye^ P r é s e r v a t i f .
Secours propofés contre chaque différent myafme. Ibid. b.
Voye\ R a g e , V é r o l e , P e s t e , D y s s e n t e r i e .
Contagion. Principe contagieux ou myafme. X. 484. b.
483. a. Différence entre épidémie 8c contagion. V. 788. b.
Caufe de la contagion des maladies. Suppl. I. 63. b. Suppl. III.
734. a.
CONTE , ( Belles-Lettr. ) différence entre le conte 8c
la fable. La Fontaine excelle dans les deux genres. IV.
XXIC* omnte . Anciens contes connus fous le nom de fabliaux. -VtrIi.
349. b. Contes des Fées. 464. a.
C o n t e , Fable, Roman, ( Gramm. ) différence entre ces
mots. IV. m . a.
C o n t e , ( Littér. Poéf ) le conte eft à la comédie ce que
l’épopée eft à la tragédie. Pourquoi il eft de l’effence du
conte qu’il foit court. Suppl. II. 369. a. Réglés à obferver
dans cette forte d’ouvrage. Obfervarions fur les auteurs eç
les poètes qui fe font diftingués dans ce gen/e; 331*;?* > la
Fontaine , le TafTe, Bococe, Rabelais, ¡ g *• Voltatre,
Hamilton, Ibid. 370. a. __ TV ,
C o n - ç e , ( Antoine le) & patrie, fes ouvrages. IV. 712. ,
7IêoNTEMPLA’n O N , ÉaÉri regard fàftàNÊ reux fur Dieu , comioepriftnc à lame. Etat de lame c
C O N
p e r f é f t j o n Diflrérence que mettent les dévots entre a BPPPiv'
Vr^nNTE^ANCE', habitude du corps.Dlverfes cohtenàn-
ces fré 1l onn lie«s d“i‘f“fiérrie:n..ss éctta ts. DifférpeOncSeT UeRnEtr e Ala tctoint utednean. ce
& CONTENT /éri/ir , conLSement DtffémMcKTMmnWÈM
fisslB auxaudienciersde ch^ncellenes.y' • Henri-1I w n’eftplus
W Ê S Ê Ê Ê Ê , B M 3 $
ample. Mauvaife coiüejlatton. Témcrairecnif^
CONTIGU ^ ( W rfîO différence entre comigu &conlil'coNTtou,
“< Giom. ) angles contigus. IV. 113. «-
CONTINENCE, ( Morale ) différence entre la chaftet. &
u continence. Impomnce de ces vertus dans la foctete. IV.
11 k f i i^ D i f f é r ^ ^ em r l l a chailcté & la continence. 111.
i XVI.'59- a. La mufique emçloyée autrefois com tjin
remedeaffnrepour la contineiice.^. 905. t. Efpece de çolln-
ïton fantUiere 1 ceux qui vivent dans une continence ngou-
reufe. Xn. w . t. La continence quoique volontaire, n eft
tient *que la Sicile «foit
autrefois partie du continent de l’Itahe.
l’Angleterre faifoit auffi parue du conunent Ade.,Fra^ eVL?S
habitans de Ceylan difent que leur rile a été % aÿ e “ e la
nrefqu’ifle de lfnde. Les Malabares affurent que les Maldives
tinioLnt autrefois partie du continent de 1 Inde. Divifion de
la terre en deux grands continens connus. Quelques auteurs
orétendent que les deux grands continens n en formentqu un
ïeul Troifieme continent qu’on fuppofe vers le midi. Divers
noms qu’on lui donne. Quatrième conunent , celui des terres
arfliques , fuppofé qu’eUes foient conngues entr elles. IV.
l 'ionikeat. Formes qu’affeftent l’ancien & le nouveau continent
VII 619. a , 4. L’un & l’autre font probablement deux
grandes ifles. ?TII. K Les pays fitués vers le milieu1 du
continent, deviennent plus froids que “ ux qm font vers la
mer. VII. 313.V Des vents de mer qui viennent des conti
nens. XVII. 21. b. Voye^ T e r r a q u é e .
Continent, (Médec.) caufe commente. U. 791.*. fièvres
continentes, vl. 729. a. 733. b. x
CONTINGENCE, (Géom.) angle de contingence. Langle
de contingence eft moindre qu’un angle rectuigne. L a
nature de l’angle de contingence a frit autrefois le iujet.de
beaucoup de difputçs. Ce que lès géomètres entendent aujourd’hui
par un. angle de contingence èn général M . Newton
fait voir que l’angle de contingence d’une courbe peut etre
infiniment moindre , ou infiniment plus grand que l’angle de.,
contingence d’une autre courbe. IV. 114. a.
C o n t i n g e n c e , ligne de, dans la enomonique. IV. 114. b.
CONTINGENT , ( Métaphÿf. ) la néceffitè abfolue détruit
la contingence ; mais il n’en eft pas de même de la
néceflité hypothétique , qui peut fubfifter avec elle. Quelques
uns envifagerit la contingence comme oppofée à toute
forte de nèceffité ; mais elle ne fauroit être foutenue dans
ce fens. Le vulgaire fent très-bien & diftingue le cas de
néceffitè abfolue 8c de néceffitè conditionnelle. IV. 114- f
Contingent. Des futurs contingens. VII. 404. b. Le principe
de la raifon fuffifarite détruit la contingence de l’univers. X y.
B E
CON 3 9 5
C o n t i n g e n t , ( Comm. d* Hijl. mod. ) quote-part que chaque
perfonne doit fournir, lorfque l’empire eu engagé dans
une guerre , 6*c. IV. 114. b. La lenteur de ces contingens
nuifible à l’empire. Ibid. 113.a.
CONTINU, (Phyfiq. ) différence entre le continu 8c le
contïgu. On demande n le continu eft divifible à l’infini.
L’élévation dé l’eau dans les pompes attribuée autrefois à
l’amour de la nature pour la continuité. La quantité divifèe
par les mathématiciens en diferete 8c en continue. Proportion
continue en arithmétique. Proportion diferete. IV.
11 Continu. Différence entre continu 8c contigu. IV. 113. a.
Entre continuel 8c continu. 113. b. Quantité continue. Xlll.
633 b. Fraftion continue. XV. 96. a. Fievre continue. VI.
720. a, b. VII. 307. b. Baffe continue. II. 110. a. VII. 39. a:
CONTINUATEURS, (Littér. ) pourquoi les continuations
d’ouvrages par une fécondé main , font ordinairement inférieures
aux ouvrages commencés. IV. 113. b.
CONTINUATION, fuite. Différence entre ces mots. IV.
113. b.
Continuation de mouvement. IV. 113.*.
Continuation de mouvement. Sa caufe. Xlll. 437* *
C o n t i n u a t i o n , ( Lettres de ) IV. 113. b.
CONTINUEL. Définition. Différence entre les mots continu
8c continuel. IV. 113. é. •
CONTINUER l ’audience à un tel jour, (Junjpr. ) il y a
une grande différence entre cette expreffiOn, 8c remettre l’audience
à un tel jour. IV. 116. a. . *. • - . i , .
CONTINUITÉ, (Phyfiq.) deux fortes de continuités,
l’une mathématique & l’autre phyfique. Les fcholaftiques
diftineuent encore une continuité homogène, 8c une continuité
hétérogène. La continuité des corps eft un état purement
relatif à la vue 8c au toucher. Comme nouspouvons
déterminer la diftance à laquelle un efpace quelconque devient
invifible , nous pouvons trouver à quelle diftahee, des corps
éloignés paroîtront conrigus. IV. 116. a.
Continuité. En quoi elle différé de la confiftartce. IV . 47. a.
Solution de continuité. XV. 328. a. Celle qui eft feue par
opération chirurgicale. V. 717. b.
C o n t i n u i t é , (Loi de) principe que rtóus devons a M.
Lerbnitz. Eh quoi confifte cetté loi de la hatüre. Comment
elle découle de l’axiome de la raifon fuffifante. IV. 116. a.
Cette loi s’obferve dans la géométrie avec une extrême exa-
ftitude. Les points de rebrouffement qui fe trouvent dans
plufieurs courbes , 8c qui femblent violër Cette loi , ne la
violent cependant point. La même chofe arrive dans la nature.
Exemples tirés de la réflexion 8c de la réfraftion dun rayon
de lumière , qui ne forment point d’angles proprement dits.
Comment les partifans. de ce principe s’éri fcryént, pour
trouver les lojx du mouvement. Prefque. toutes les .loix du
mouvement propofées par Defcartes , font faùlles, félon
les leibnitóiérts , parce qu’elles violent le principe de continuité.
Ibid. b. On prétend prouver encore par cé prmcipe qu u
n’y a point de corps parifaitemént dur. Ibid.. 1 17. a.
C o n t i n u i t é , ( Belles-Lettr. ) dans le poeme dramatique ,
dans le difeours oratoire, dnuf le poëme épique. Comment
cette loi eft violée dans le paradis perdu. En retranch
an t tout ce qui rompt la continuité, le poeme acquiert uné
force continue, qui le frit couler d un pas égal 8c foutenu. IV.
11 ^ONTOBABDITES, hérétiques du 6# fiecle. Leurs chefs.
Orieinede leur nom. IV. i f 7. 4. . . N . ,
CONTORNIATES ,' (Medaill. Art numifmat.) fortes de
médailles IV. 117. a."EtVm. de ce mot. Raifons qui montrent
que ces médailles n’ont jamais fervi de monhoie. Du tems ou
ces médailles ont été feites. Divers femimeps a ce fujet.
Comment il paroît qu’elles font poftérieurcs aux hommes
iUuftres qu’elles repréfenteht. /6i^. b. En quoi elles font mté-
reffantes. 118. a. ■
Contomiates, voyez ce qui en eft dit. X. 247. *.
CONTORSION. Les datifeurs de corde s-açcoutument ,
^dès leur jeuneffe, aux contorfions de leurs membres. Caufe do
la contorfion du cou , appêlléé torticolis. Remedes a ce mal.
IV 118. a. Voyez T o r t i c o l i s . . . a . v ,
CONTOUR, (Peint. ) préceptes fur la perfection des cont0
C O N tC c T A t IÔ N , ( Comm.) tribiinal établi en Ef-
pagrié. Officiers de ce confeil. Lieux ou il fo. tient. IV.
1 CONTRACTION , ( Gramm.bj décltnrifons grecques des
noms cOntraftés. Contràftion dans lès verbes grecs Deux
fortes dé contrarions ; Priné fimple appellée-)ync/irc/e ,1 autre
mèlée 8c qù’onjappellè crafel Exemplcà de contraction en
fraCofrtRACTiON , en phyfique. Caufes dé -contraftîon &
de dilatation. Force de contràftion, ou contraftive. 1V. 11». 0.
Contraflion. Dilatation 8t contràftion perpémelle <iy.e caiîlc
l’air dans les corps où il s’infmue. 1. 233. a. Contraction des
mufclès.UL 394-