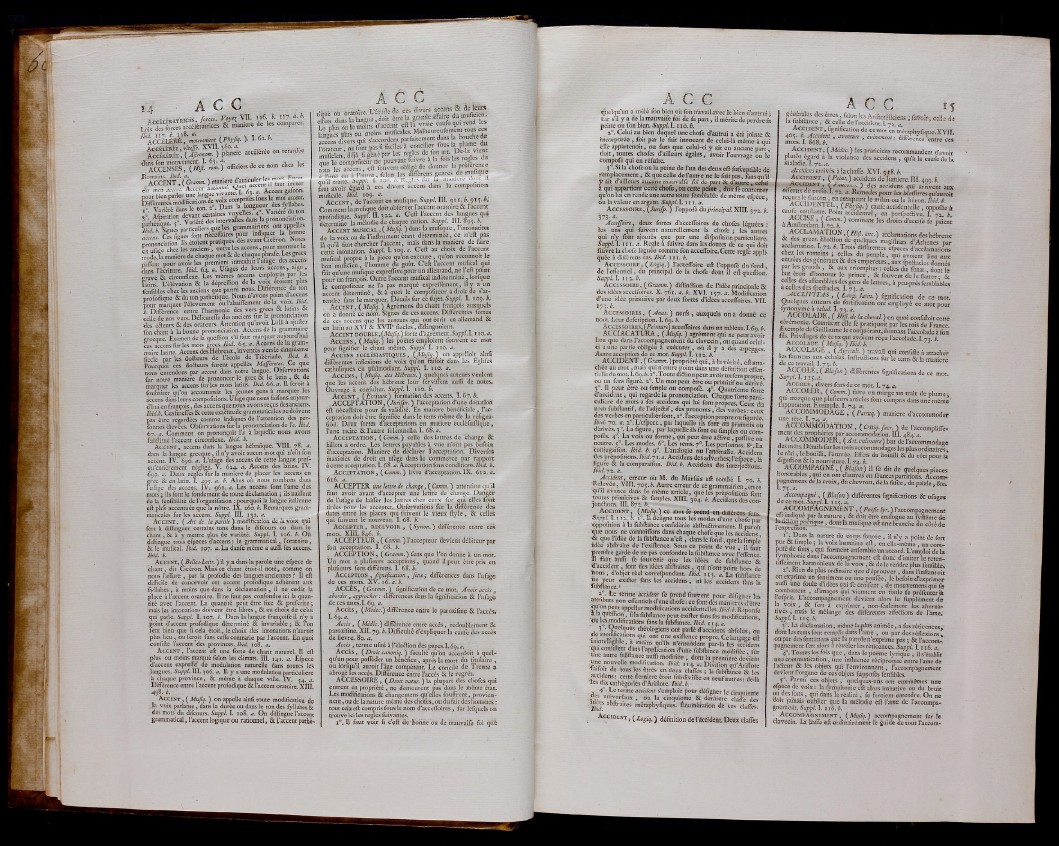
A C C A C C
■ “^parcr- ^ACCÉLÉRÉ , mouvement ( Phyfiq. ). 1 f c l 5 1SÊSS: ft™Ü-) f è»ff*ide r*sd*e I«*nosm" ¡"I1
du mot àojj/.r Accent n a t io ^ .Q Accent gafeon.
pour b i e n f o u s l o mot accent.
I H I Ces fîenes font nèceflaires pour mdtquer la bonne
Drononciation. Ils étoient pratiqués des avant Cicéron. Notes
e„ uftgè chez les anciens, outre les accens, pour montrer le
mode, nt maniéré de chaque mot&de chaque j^trafe. Les gj“ ®
pâffent pour avoir les premiers introduit lufage des accens
Sans l’écriture. Ibid. 6 4 - 1 Ufages de leurs accens, aigu,
«rave & circonflexe. Les mêmes accens employés par Us
latins.' L’élévation & la dépreflion de la voue étoient plus
fenfibles chez les anciens que parmi nous. Différence du ton
profodique & du ton pathétique. Nous navons point daccens
pour marquer l’èlevement oul’abaiffement delà voix. Ibid.
b. Différence entre l’harmonie des vers grecs & latins oc
celle de nos vers. Délicateffe des anciens fur la prononciation
des afteurs & des orateurs. Attention quavojt Lulli a ajuiter
fon chant a la bonne prononciation. Accens de la grammaire
grecque. Examen de la queftion s’il faut marquer auiourd hm
ces accens fur les mots grecs. Ibid. 6 $. <z. Accens de la grammaire
latine. Accens des Hébreux, inventés.y ers le cinquième
ftecle par les dofteurs de l’école de Tibènade. Ibid. b.
Pourquoi ces dofteurs furent appellès Majforetes. Ce que
nous entendons par accent dans notre langue. Obfervations
for notre maniéré de prononcer le grec & le latin , oe de
marquer les accens fur les mots latins. Ibid. 66. a. 11 feroit a
fouhaiter qu’dn accoutumât les jeunes gens à marquer les
âccens dans leurs compofmons. Uiagequènous faifons aujourd’hui
en françois, des accens que nous avons reçus des anciens.
Jbid.b. Cesfineifes & cette exactitude grammaticales ne doivent
pas être regardées comme indignes de l’attention des per-
lonnes élevées. Obfervations fur la prononciation de IV. Ibid.
6j. a. Comment on prononçoit IV à laquelle nous avons
fobftitué l’accent circonflexe. Ibid. b.
A ccent , accens dans la langue hébraïque. "VIII. 78. a.
dans la langue grecque, il n’y avôit aucun mot qui n’eût fon
accent. IV. 690. a. L’ufagè des accens de cette langue pref-
qu’entiérement négligé. V. 624. a. Accens des latins. IV.
690. a. Deux reeles fur la maniéré de placer les accens en
grec & en latin, f. 49t. a. b. Abus où nous tombohs dans
fuiàge des accens. IV. 962. a. Les accens font l’ame des
mots ; ils font le fondement de toute déclamation ; ils naiffeht
de la fenfibilité de l'organifation : pourquoi là langue italienne
eft plus accentuée que la nôtre. IX. 260. b. Remarques grammaticales
fur les accens. Suppl. III. 13 2. a.
ÂCCENT , ( Art de la parole ) modification dé la voix qui
fert à diftinguer certains tons dans le difeours ou dans, le
chant, & à y mettre plus de variété. Suppl. 1. to6. b. O'h
diftingue trois efpeces d’accens : le grammatical, l’oratoire,
H le mufical. Ibid. 107. a. La danfe même a auffi fes accens.
Ibid. b.
A ccent, (Beïles-Lettr.)'û y a dans la parole une efpece de
chant, dit Cicéron. Mais ce chant étoit-il noté, comme on
nous l’affure , par la profodie des langues anciennes ? Il eft
difficile de concevoir cet accent profodique adhérént aux
fyllabes, à moins que dans la déclamation, il ne cédât la
place à l’accent oratoire. Il ne faut pas .confondre ici la quantité
avec l’accent. La quantité peut être fixe 8c preferite ;
mais les intonations doivent être libres, & au choix de celui
qui parle. Suppl. I. 107. b. Dans la langue françoife il n’y à
point d’accent profodique déterminé & invariable ; 8c l’on
fent bien que fi cela étoit, le choix des intonations n’auroit
plus lieu, ou feroit fans ceffe contrarié par l’accent. En quoi
confifte l'accent des provinces. Ibid. 108. a.
A ccent , l’accent eft une forte de chant naturel. Il eft
plus ou moins marqué félon lei climats. III. 141. a. Efpece
d’accent expreflif de modulation naturelle dans toutes les
.langues. Suppl. III. 306. a. Il y a une modulation particulière
à chaque province, & même à chaque ville. IV. 54. a.
Différence entre l’accent profodique & l’accent oratoire. XIII.
498. b.
A ccent , ( Mujlq. ) on appelle ainfi toute modification de
. la voix parlante, dans la durée ou dans le ton des fyllabes &
des mots du difeours. Suppl. î. 108. a. On diftingue l’accent
grammatical, l’accent logique ou rationnel, & l’accent pathé-
.. . - t '¿t-tidr* d* ces ¿vers âccëfts & de leurs
l o p i n s ou moins
mus lés accens, eft fouvent Obligé de donner la préférence
Ü Ü H h ram » , feibii les itfférehs genres de mufique
qu’il traite. Suppl. i-ciaS., “ “«'f. “
faut avoir égard à ces divers accens dans la compofiuon
muficalc. Ibid. 109. a.
A c c e n t , del’accenten mufique.Siip/d. 111. 911. te 9iï.-ü-
Comment la mufique doit obferver l’accent oratoire & l’accent
profodique. Suppl. H. U a a. C’eft l’accent des langues qut
détermine la mélodie de chaque nation. Suppl. IIL895.Î.
AccëNt musical , (Mufiq. ) dans la mufique, 1 intonation
de la voix ou de l’inftmment étant déterminée, ce n’eft pâs
là qu’il faut chercher l’accent, maïs dans la manière de foire
cette intonation. Suppl. î. 109. *. C’eft au choix de 1 accent
mufical propre à la piécë qu’ôn exécute, qu.on reconnoit le
bon mufiden, l’homme de goût. C’eft l’accent mtifital qui
fait qu’une mufique expreifivepour uti allemand, né 1 eft pôint
pour xm françois. Outré l’accent mufical ihdéterminé, lorfque
le compofiteur ne l’a pas marqué expreffément, il y a un
accent déterminé, & à quoi le compofiteur à droit de s’attendre
fans le marquer. Détails fur ce fujèt. Suppl. L 109. b.
A cc ent , ( Mufiq. ) Àgrémens du chant françois auxquels
on a donné ce nom. Signes de ces âccens. Différèfites fortes
de ces accens que les auteurs qui ont écrit en allemànd &
en latin au XVI & XVIIe fiecles, diftinguoient.
A cc ent d o u b l e , (Mufiq.) forte d’agrement. S«pp/.I. n o . a.
A c c e n s , ( Mufiq. ) les pôëtes emploient fouvent ce mot
pour fignifier le chant même. Suppl. I. 110. a.
A ccens ec c lé siast iq u e s , ( Mujlq.) on appelloit ainfi
différentes inflexions de voix qu’on failoit dansées Églifes
catholiques en pfalmodiânt. Suppl. I. 1 id. à.
A c c en s , (Mujlq. des Hébreux. ) quelques auteurs veulent
que lés accens des hébreux leur fervifîent auffi de notes.
Ouvrage à confulter. Sùppl. l. 110. b.
A c c e n t , ( Écriture) formation dés âcceris. I. 67. b.
ACCEPTATION, (Jurifpr. ) l’àccèptàtion d’unô donation
eft néceïfaire pour fa validité. En matière bériéficiale, l’acceptation
doit être fignifiée dans le tëriis même de la réfignà-
tioni Deux fortes d’acceptations én matierè èccléfiaftique,
l’unè tacité & l’autre folèmnelle. I. 68. a.
A cc e p t a t io n , ( C'omm. ) cèllè des lettrés de change 8c
billets à ordre. .Les lettres payables à viîe n’ont pas befoin
d’acceptation. Maniéré de déclarer râcceptâtiOn. Divèrfes
maximes de droit en üfagè dans le commercé par rapport
âceitè acceptation. I. 68. a. AccèptaÜQri fous conditiqhs.7étâ. b.
A c c e p t a t io n , (Comm.) livré d’acceptation.IX. 612. a.
616. a. ...
ACCEPTER une lettre de change, (Comm.) attention qu’il
faut avoir avant d’accepter linè lettre de change. Dangèr
de l’ufage de laitier les lettres chez ceux fur qui elles font
tirées pour lès accepter..Obfervations fur la différence des
dates entre les places qui iuivent le viéux ftyle 1 & celles
qui fuivent lé nouveau. I. 68. b.
A cc e p te r , r e c e v o ir , (Synon. ) différence entre ces
mots. XULl846. b.
ACCEPTEUR, ( Comm. ) l’accepteur dévient débiteur par
fon acceptation. I. 68. b.
, ACCEPTION, ( Gramm.) fen's que l’on donne à un mot.
Un mot a plufieiirs acceptions, quand il petit être pris en
plufieurs fens différent. I. 68. b.
A c c e p t io n , Jlgnification, Jihs ; différences dans l’ufage
de ces mots. XV. 16. d. b.
ACCES, (Gramm.) fignification de ce mot, Avoir accès 3
aborder , approcher : différences dans la fignification & l ’uiàgè
de ces mots.1.69. a.
A ccès , (Médec.) différence èntre le paroxifme & l’accès.'
1 .69. a.
Accèsy (Medic.) diffêrencë entré accès, redoublement 8c
paroxifme. XII. 79. b. Difficulté d’expliquer la càüfe dès accès
de fievre. 80. a.
Accès, terme ufité à l’éleftion des papes. 1.69. a.
A ccès , ( Droit canoniq. ) facilité qu’on âccordoit à quelqu’un
pour pofféder un bénéfice, après la mort du titulaire ,
ou lorfqu’il au roi t l*âge compétent. Le concile de Trentè a
abrogé les accès. Différence entre l’accès 8c le regrès.
ACCESSOIRE , ( Droit natur. ) la plupart des chofes qui
entrent en propriété, ne demeurent pas dans le même état.
Les modifications 8c changemens qu’elles fotiffretit, proviennent,
ou de la nature même (les chofes, ou dti fait dès hommes :
tout cela eft compris fous le nom d’acceffoires, fur lefquels on
trouvé ici les réglés fuivantes.
i°, U faut voir fi c’eft de ‘Bonne ou de riiaùvaife foi qub
A C C
quelqu’un a mêlé fort bien ou ion travail aVec le bien d’autrui *
fcar S’il y a de la mauvaife foi de fa part, il mérite de perdre fa
peine ou fon bien. Suppl. 1. 110. b.
20. Celui au bien duquel une chofe d’autrui a été jointe 8c
incorporée , foit par le fait innocent de celui-là même à qui
êllè appârtendit, ou fans que celui-ci y ait eu aucune part ;
doit, toutes chofes d’ailleurs égâles, avoir l’ouvrage ou le
conipOfé qui én réfultè.
y . Si la chofe ou la peine de l’un des deux èft fufceptible de
rèiilplacemënt, 8c quécëlle de l’autre ne le foit pas, fans qu’il
y âit d’ailleurs àyume mauvaife toi de part üc. ci autre , celui
à qui appartient tetté chofe, ou cette peiné , dôît"mconteriter
qu’on lui en rèhde ühe autre toütô femblable de même efpèce,
ou la valeur én argent. Suppl. 1. 111. a.
A c c e s so ir e , (Jurifp. j l’oppofé du principal. XIII. 372. b.
$73' a‘
Accejpjire, déux fortes d’accèlfoirés de choies léguées :
lès uns qui fuivent naturellement la chofe ; les autres
qui n’y font ajoutés que par une difoofition particulière.
Suppl. 1. 111. a. Réglé à fuivré dans les doutes de ce qui doit
fuivre la chofe léguée comme fon àcceffoire. Cette réglé appliquée
à différens cas. Ibid. ï ï ï . b.
A c c e s so ir e , (Lôgiq.) l’âcceffoire eft l’oppofé du fond,
de reffentiel, dti principal de 1| Chôfo dont il eft qüeftiort.
Suppl. I. i 12. b.
A cc e s so ir e , (Gramm.) diftinétion de l’idée principale 8c
dès idées acceffoires. X. 761. a. b. XVI. 157. à. Modification
d’une idée primitive par deux fortôS d’idées àcceifoires. VII.
*73* f*' ■ H H I |
A ccessoires , ( Anat. ) nerfs, auxquels on a donné ce
nom. Leur defciiption. 1. 69. b.
A ccessoires, (Peinture) âccetibires dans nn tableati.1. 69. b.
A C C IA CA TU kA , (Mujlq. ) agrément qui ne peut avoir
lieu que dans l’accompagnement du clavecin, ou quand celui-
ci a une partie Obligée à exécuter, où il y a des arpegges.
Autre acception de cè mot. SUppl. 1. 1 12. b.
ACCIDENT ,(Grtutim. ) propriété qui, à la vérité, eft attachée
àu mot, ihàis qui n’entre point dans une définiüdn eflen-
tielle du mot. 1.69. b. 1 ".Toute diftion peut a^Oir un fens propre
ou un fens figuré. 20. Un mot peut être bu primitif ou dérivé*
3°. Il peut être ou fimple ou compofé. 40. Quatrième forte
d’accident, qui regarde la prononciation. Chaque forte particulière
de mots a fes aecideris qui lui font propres. Ceux dû
nom fubftaritif, de l’adjeôif, des pronoms, des verbes : ceux
des verbes en particulier font, i°. l’acception propre ou figurée
Ibid. 70. a. 2°. L’efpecè, par laquelle ils font ou primitif où
dérivés. 3 °. La figure, par laquelle ils font ou fimples ou cbm- ,
pofés. 40. La VOix ou forme, qui peut être a&ive , palfive où •
neutre. ç°. Les modes. 6°. Les tems. 70. Les perfonnes. 8°. La
conjugaifon. Ibid. b. | g L’analogie ou l’atiomafie. Accidens
des prépofitions. Ibid. 7 i . a. Accidens des adverbes; l ’efoèèë là
figure & la comparaîfon. Ibid. b. Accidehs dès irftferleftio’ns
Ibid. 72. à.
„■ Accident, Ètrèni- où M. dû Marûis eft tombé I. 70. S
Relevée, VIII. 705.4. Amtt erreur de ce grammairien, eiicé
quü avance dans le rnêinè article, que les prépofitions font
toutes pnmmvès & fimples. XIII. 304. 4. Accidens dés cou-
jonctions. 111. 872. b. ’
A c c id e n t , (Mujlq.) ce mot A; prend en dittérens fens.
Suppl. I. ï i 2 .1. i°. U défigrie tous les modes d’une chofe par
'bppOfirioh à là fïib'ftânce co'nfidérée àbftraêtivemént. Il pâroît
^ue nous né cônUOîflbris dans chaque chofe que lés âccidens
& que l’idée de la ftibftance n’eft , dans le fond, quela fimple*
idée àbfti-aïte de l’exiftehce. Sous ce p'oint dè vue ,• il faut
prendre gardé dé hé pas confondre lâfubftànce avëc Îéffencé.
Il foUt âüfll fe fôuvènir qùe les idées de fûbftailte &
Û’àcridèirt S font des idées abftraîtés, qui n’ont point hors de
£ous ; d’objet réel corrèfpùfidàrtt. Ibid. i t j . à. Là fùbftàncè
ne petit exiftet fèhs les accidens ; ni les accidenl fans la
ïUbftancè.*
a". Le tè'rme Hccïdent fe prend fouvent pour défifcner lés
attributs non eflçntiels d’uné chbfe : cè font dès manières d’être
tra on petit âppellermodifications àcciderttelles./éiÿ.é.Répbnfe
i l ? i l ’ fi^1 ffibftàrice peut èxifter fans fes modifications,
ou les modifications fans là (ub'fta'ncë. Ibid. 1 14. a.
3 . Qrtelqués théolbgiéhs Ont p'àrÎè d’àccidens abfolus,ôu
P une exiftence propre. Ce langage èft
3 ?¡P . S f c à m°lhs n’èntëndétit par-là les accidens
quiconfrftttit dans 1 âpplicàtiOn d’imc fob'ftancé modifiée, für
« nce auffi modifiée I dont la prèiniérè deVièfit
une nouvelle modification. Ibid. M ÎDivifibn qti’Arift'bte
1. Jt de tous les êtres ën déux claffés i là fùbftàncè 8t les
accidens : cette demiere étoit firbdiviféè en n e u f autres • de-là
les dix cathégoriès d’Ariftote. Ibid. b.
4°' Le terme accident s’emploie pour défigner le cînquienîe
univerfaux , ou la cinquième & derinere clàife des
' îb iT a a^tes métâphyfiqtiès. Énufrièration de ces claflès.
1 CCïdent , ( Logiq. ) définition de l ’âcCidèilL Deux claffes
A C C 15
’ ^flni? catl0n « m<>t en métiphÿfique. XVII.
moté. Í. «68 4 ' rC ’ n am a a : fiiftérence entre ces
A cc id en t , f Midcc. ) les ptatlcletas recommandent d'avoir
plutôt égard a la violente des accidens , qu’à la caufe de là.
maladie, i 72 .a.
Accidens arrivés à la chaffès XVI. 918. b.
A cc id en t , ( Peint. ) accidens de iumiere. m. 400. k
^■^CClj ENT l. m m é ) 1 8 accîdens Oui arrivent aux
oileaux db proiè. 1.72. a. Remedes pour les bleffiires qu’auroit
reçues le foucon, en atraquahtle milan ou le héron. Ibid. b.
^ caufe accidentelle, oppofée à
A ^ K ' í ant/ - / W 0mt,accidenteIi SSII en perfpeétive. |L 72. b.
à A m ï ï S i j. 7} g d’aCdfe P“ “
8c 1 1 HiJl- *nc' ) acclamations des hébreux
& des grecs.Eleébondeqnekrues magiftrats d’Athenes par
f e Í Trois différentes efpeces d’acclamations
ÍenStrét eós dl eSs g^éan,”érS a’u x¡ &1 d1 e s emppeeurepuIer s», Üaux afpveofiteanctl csli deuon anuésx
par les grands , & aux triomphes : celles du fénat, dont le
but étoit d honorer le prince , 8c fouvent de le flatter ■ 8c
ceiles des àffemblées des gens de lettres, à peu-près fembliles
a celles des fpeftacles. I. 73. a.
ACCLIVITAS y ( Lanpr. latin. ) fignification de ce mot*
Quelques auteurs de fortification ont employé cè mot pour
fyrionymè à tàlüd. I. 73, à.
ACCOLADE , ( JFÍJI. de la cheval. ) en quoi confiftoit cette
cérémonie. Comment elle fe pratiquoit par les rois de France,
exemple de Guillaume le conquérant, donnant l’accolade à fon
lus.privilèges de ceuxqui avoient rècu l’accolade. 1.72. b
A c co l ad e . I Mujlq J) Ibid. b. ’ '
ACCOLAGÈ , I Agricult. ) travail qui confifte à attacher
les farmens aux échalas. Inftruaions fur le tems 8c la maniere
de ce travail. 1 .73. b.
A CCO LÉ , ( B la fon ) différentes fignifications de ce mot.
Suppl. I. jrif.iz.
A c co l é , divers fens de ce mot. 1. 74. a.
ACCOLER, ( Comm.) faire en marge un trâit de plumeI
qui marque que plufieurs articles font compris dans une mêmb'
lupputatiort. Exemple. I. 74. a.
ÀCCOMM0 DAGE , ( Perruqï ) maniere d’accommddef
une tête. 1 .74. a.
ACCOMMODATION, ( Crïtiq.fdcr. ) de l’accomplifle*
ment des prophéties par accommodation. IÚ. 484.' a.
T » H ü S u a ir e ) but de l’accommOdage
des mets. Détails fur les trois accômiiioaages les plus ordinaires »
11811 > le bouilli, l’étuvée. Effets du bouilli 8c du rôti pour la.
digeftion 8c la nourriture. 1.74. b.
i. -^C^CMPAGNÉ, | Blafon ) il fe dit de quelques pièces
honorables , qui eh ont d’antres en féantes partirions. Accom-
çagnemens delà croix, du chevron, déla fafee, du pairie , &ch
Accompagné -, (Blafon) différentes fignifications 8c uiages
de ce mot. Suppl. I. 1 11| a.
ÁGNEMENT, ( Poifie lyr. ) l’accompagnement
l Aft' ^ naturei & doit être analogué au fyftême de
la4ïcUonj>ôétiqiie, dont là mufique eft une branche du côté de
iexpremon. - - . ......
1 °à ? anS ^ nararè wrps fônore , il n’y a point de fon
^ j r ple * là. voix humaine eft, en elle-même, un com-
pdléde fons , qui forment enfcmble un accord. L’emploi delà
lymphome dans l’accompagnement eft donc d’imiter le reten-
tiffement harmonieux de la voix , 8c Hele rèndre plus fenfible;
2 . Rien de plus ordinaire que d’éprouver , dans l’inftantou
on expnftie un fentiment ou ime pènfée, le befoin d’exprimer
auffi uiiè foulé d’idées qui fe croífent, de moûvemens qui jfe
combattent , d’images qui viennent en foule fe préfenterià
1 efprit. L accompagnement dévient alors le fupplément de
la voix , & fort à exprimer, non-feulement les alternativ
es ,, mais le mélange des différentes añeétions de l ’âme»'
Suppl. I. 115. b.
3°. Là déclamation, niême l.i«pius animée, a fes réticences»
dont les tems font remplis daffs l’ame , ou par des réflexions »
Ou par dés forttimefts que là parole n’exprime pas ; & l'accompagnement
fer t alors a révéler les réticences. Suppl. 1. 1 16. a.
^".Toutes les fois que, dans le pbënie lyriqùë , il s’établit
une commuiiicatiqn, Une influence réciproque entre l’ame de
1 a (fleur 8c lès objets qüi l’environnent, l’accompagnement
devient lorgane de ces objets fiippofés fenfibles.
5 . Parmi ces objets , quelques-uns ont eux*mêmes une
eipècé de voix : la fymphonie eft alors imitative ou du bruit
ou des fons , qui dans la réalité -, fe feroient entendre. On ne
üoft jamáis oublier qué la mélodie èft l’ame de l’accompa-,
gnèmèfit. Suppl. I . n 6. b.
■ A c com p a g n em en t , (Mujlq.) accompagnement for le
clavecin. Là baffe eft ordinairement lè guide de tout l’accom