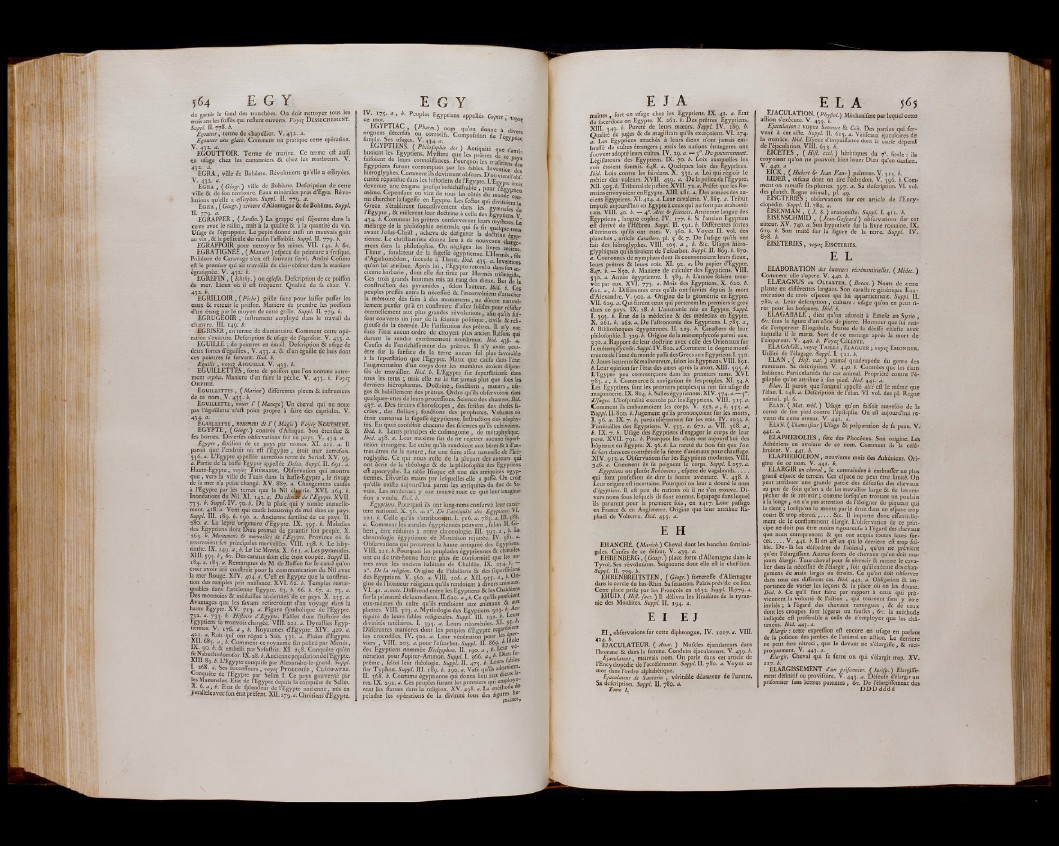
H E G Y
Je garnir le fond des tranchées. On doit nettoyer tous les
trois ans les foliés qui relient ouverts. Voyt{ D e s s è c h e m e n t .
Suppl. II. 778. b . • _•
Egoutter t terme de chapellier. V. 432. a.
Egoutter une glace. Comment on pratique cette opération.
.V. 432. a.
EGOUTTOIR. Terme de marine. Ce terme cil aulîi
en ufage chez les cartonniers 8c chez les marbrcurs. V.
432. a.
EGRA, ville de Bohême. Révolutions qu’elle à effuyées.
V . 4 3 2 . a .
E g r a , (Géogr.) ville de Bohême. Defcription de cette
ville 8c de fon territoire. Eaux minérales près d’Egra. Révolutions
qu’elle a effuyées. Suppl. II. 779. a.
Eg ra , ( Géogr. ) riviere d’Allemagne 8c de Bohême. Suppl.
EGIUPPER , (Jardin.) La grappe qui féjourne dans la
cuve avec le raÜin, nuit à la qualité 8c à la quantité du vin.
Ufage de l’égrappoir. Le pépin donne àufli un mauvais goût
au vin ,8c la pellicule duraifm l’afFoiblit. SuppL II. 779. b.
EGRAPPOIR pour nettoyer les mines. VII. 142. b. &c.
EGRATIGNÉÉ, ( Maniéré ) efpece de peinture a frefque.
Polidore de Caravage s’en eft fou vent fervi. André Conmo
eft le premier qui ait travaillé de clair-obfcur dans la maniéré
égratignée. V. 43 Zi b.
EGREFIN, ( Ichthy.) ou églefin. Defcription de ce poilTon
de mer. Lieux où il eft fréquent. Qualité de fa chair. V.
432. b.
EGRILLOIR, {Pêche) grille faite pour biffer paffer les
eaux 8c retenir le poiffon. Maniéré de prendre les poiffons
d’un étang par le moyen de cette grille. Suppl. II. 779. b.
EGRUoEOIR , infiniment employé dans le travail du
chanvre. III. 149; b.
EGRISER, en terme de diamantaire. Comment cette opération
s’exécute. Defcription 8c ufage de l’égrifoir. V. 433. a.
EGUILLE ; de peintres en émaU. Defcription 8c ufage de
deux fortes d’éguilles, V . 433. a. 8c d’un éguÙle de buis dont
ces peintres fe fervent. Ibid. b.
E gui lie , voyez AIGUILLE. V. 433. b.
EGUILLETTES, forte de poiffon qüe l'on nomme autrement
orphie. Maniéré d’en faire la pêche. V. 433. b. Voye^
O rphie.
Eguillettes, {Marine) différentes pièces8c inflrumens
de ce nom.„V. 433. b.
Eg u il l e t t e nouer l’ {Manege) Un cheval qui ne noue
pas i’êgùillèttè: n’eft point propre à faire des capriolcs. V.
434. a.
EGUILLETTE, nouement de V { Magie ) ■ Voye^ Noüi-MENT.
EGYPTE, {Géogr.) contrée d’Afrique. Son étendue 8c
fes bornes. Diverfes obfervations fuf te pays. V. 434; a.
Egypte, divifion de ce pays par nômes. XL 211. a. II
paraît que l’endroit où. eft l’Egypte , étoit mer autrefois.
336. a. L’Egyprc appellée autrefois terre de Seriad. XV. 93.
a. Partie de la baffe Egypte appellée Delta. Suppl. II. 691. a.
Haute-Egypte,,voyeç T hébaide. Observation qui montre
Sue, vers la ville de Tanis dans la baffe-Egyptc , le rivage
ela mer n’a point changé. XV. 887. a. Changemens caufes
à l’Egypte par les terres que lé Nil charrie. XVI. 164. b.
Inondations du Nil. XI. 142. a. Du c liÆ de l’Egypte. XVII.
733. b. Suppl. IV. 50. b. De la pluie qui y tombe annuellement.
418. à. Vent qui caufe beaucoup de mal dans ce pays.
Suppl. III. 189. 190. a. Ancienne fertilité de ce pays. II.
280. a. La lepre ‘originaire d’Egypte. IX. 39«. b. Maladies
des Egyptiens dont Dieu promet dé garantir ion peuple. X.
263. b. Monumerts 6* merveilles de VEgypte. Province où fe
irouvoienr fes principales merveilles’ VIII. 138. b. Le labyrinthe.
IX. 149. a, b. Le JacMoèris. X. 611. a. Les pyramides.
XIII. 393. b, 6>c. Des canaux dont elle étpit coupée. Suppl II.
184; a. 183.it. Remarques de M. de Buffon fur le canal qu’on
croit avoir été confirait pour la Communication du Nil avec
la mer Rouge. XIV. 404. a. C’eft en Egypte que la conftruc-
tion des temples prit naiffance.'XVI. 62. b. Temples rémarÏuables
dans l’ancienne Egypte. 63. b. 66. b. 67. a. 73. a.
les monnoies 8c médailles àhcieriiiêi 'de ce pays. X. 253. a.
Avantages que les favans retireraient d’un voyage dans la
haute Egypte. XV. 713. a. Figure fymbolique de l’Egypte.
732. a. 733. b. Hiftoire d’Egypte. Fables dont l’Iiifloire des
Egyptiens 1e trouvoit chargée. VIII. 221. a. Dynafties Egyptiennes.
V. 176". a , b. Royaumes d’Egypte. XIV. 420. a.
y t i' rit ^°IS ont Sais* 531» a. Pluies d’Egypte.
XII. 683. a, b. Comment ce royaume fut policé par Menés,
£ ^ embelli par Sefoftris. XI. 298. Conquête qu’en
Y ï ï î » hodonofor. IX. 28. b. Ancienne population de l’Egypte.
ëyPte conquife par Alexandrc-lc-grand. Suppl.
_ 268. a. Ses lucceffeurs. vove[ PtolomÉe , C léOpatre.
Conquête de l’Egypte par Seli
les Mammelus. Etat de l’Egypte
X. 6. a, b. Etat de fplendeur d
parallèle avec fon étatpréfent. X
m I. Ce pays gouverné par
depuis la conquête dc'Sclim.
le 1 Egypte ancienne, mis en
II. 279.4. Chrétiens d’Egypte,
E G Y
Peuples Egyptiens appellés Coptes ; Voy^
IV. 175. » .
ce mot.
EGYPTIAC euens déterfifs 1, {» Pharm.) / nopt M” qu’on ou v i r..-, donne à divers
u v u n . c .7.a
aiVers
onguens déterfifs ou corrofifs.Compofidon de 1’
iimple. Ses ufages. V. 434. a.
des ) . Antiquité que s’attricgyptiac
buoient les Egyptiens. Myfterc que les 1
faifoient de leurs çonnoiffances. Pourquo, ,cs uaaitiom h-
Egyptiens furent corrompues par les fables. Invention des
hiéroglyphes. Comment ils devinrent obfcurs. D’où vientlW
cunté répandue dans les hiftoriens de l’Egypte. L’Eevote
devenue une énigme prcfqu’indéchiffrabie, pour T&vdÏÏIÎ
même. Cependant on vint de tous les côtés du inonde Con
nu chercher la fageffe en Egypte. Les feftes qui divifoient1
Orece s établirent fucçefïïvcment dans les gymnafesdf
l’Egypte , 8c mêlèrent leur doélrine à celle des Egyptiens V
434. b. Comment les prêtres confervcrcnt leurs myfleres Le
mélange de la philofophie orientale qui fe fit quelque temt
avant Jefus-Chrift , acheva de défigurer la doftrinc éevu-
tienne. Le chriftianifme donna lieu à de nouveaux chanee
mens dans la philofophie. On négligea les livres anciens"
Theut, fondateur de la fageffe égyptienne. L’Hermês fils
dAgathomédon, fuccede à Theut. Ibid. 435. 4. Inventions
quon lui attribue. Après lu i, l’Egyptc retomba dans fon ancienne
barbarie, dont elle fut tirée par Hermès trifmérifle.
Ces trois grands hommes mis au rang des dieux. But de la
conflruélion des pyramides , félon l’auteur. Ibid. b. Ces
peuples preffés entre la néceffué 8c l’inconvénient d’attacher
la mémoire des faits à des monumens, ne durent naturellement
penfer qu’à en conflruirc d’affez folides pour réfifler
éternellement aux plus grandes révolutions, afin qu’ils fuf-
fent couverts un jour de la fcience politique, civile & reli-
gieufe de la contrée. De l’inftitution des prêtres. Il n’y eut
dans l’état aucun ordre de citoyen plus ancien. Raifons qui
durent le rendre extrêmement nombreux. Ibid. 43J». a.
Caufes de l’enrichiffement des prêtres. Il n’y avoit peut-
être fur la furface de la terre aucun fol plus favorable
à la fuperflition que l’Egypte. Maux que caufa dans l’état
l’augmentation d’un corps dont les membres étoient difpen-
fés de travailler. Ibid. b. L’Egypte fut fuperftitieufe dans
touS' les teins j mais elle ne le fut jamais plus que fous les
derniers hiérophantes. Doélrine/, fondions , moeurs, ufages
& habillement des prêtres. Ordre qu’ils obfervoient dans
quclqiies-unes de leurs proccffions. Science des chantrcs./fôf.
437. a. Des tireurs d’horofeopes , des feribes des chofes fa-
crées, des flolites ; fondions des prophètes. Volumes où
étoit contenue la fageffe égyptienne. Inftruâion des néophytes.
En quoi confiftoit chacune des fciences qu’ils cultivoxenr.
Ibid. b. Leurs principes de cofmogonie , de métaphyfique.
Ibid. 428. a. Leur maxime fut de ne .rejetter aucune fuperfr
tition étrangère. Le culte qu’ils rendoient aux bêtes 8c à d’autres
êtres de la nature, fut une fuite affez naturelle de lliié-
raglyphe. Ce qui nous refte de la plupart des auteurs qui
ont écrit de la théologie 8c de la philofophie des Egyptiens
eft apocryphe. La table Iliaque eft une des antiquités égyj*
tiennes. Diverfes mains par lefquelles elle a paffé. On croit
qu’elle exifte aujourd’hui parmi les antiquités du duc de Sa:
voie. Les modernes y ont trouvé tout ce què leur imagination
a voulu. Ibid. b.
Egyptiens. Pourquoi ils ont long-tems confervé leur caractère
national. X. 36. a* i°. De l’antiquité des Egyptiens. VI.
221. b. Celle qu’ils s’attribuoient. I. 316. a. 783.4. III. 388.
a. Comment les annales égyptiennes peuvent, lelon M. Gi-
bert, être réduites à notre chronologie. III. 393. a , b. La
chronologie égyptienne de Manéthon rejettée. IV. 98t. <t.
Obfervations qui prouvent la haute antiquité des Egyptiens.
VIII. 221. ¿.Pourquoi les peuplades égyptiennes 8c chinoifes
ont eu de très-bonne heure plus de conformité que les autres
avec les anciens habitans de Chaldée. IX. 234« "*
2". De la religion. Origine de l’idolâtrie 8c des fupcrilitions
des Egyptiens. V. 360. a. VIII. 206. a. XII. 933. o , b. On-
eine de l’honneur religieux qu’ils rendoient à divers animaux,
v I. 41.4. note. Différend entre les Egyptiens 8c les Chaldéens
fur la primauté de leurs dieux. II. 620. a t b. Ce qu’ils penfoient
eux-mêmes du culte qu’ils rendoient aux animaux 8c aux
plantes. VIII. 302.4. Mythologie des Egyptiens. 913* fe ^n‘
tiquité de leurs fables religieufes. Suppl. 111. 192. fe
divinités tutélaires. I. 393. a. Leurs néoménies. XI. 93*b'
Différentes maniérés dont les peuples d’Egypte regardoicn
les crocodiles. IV. 302. a. Leur vénération pour les ép«-
, VIII. 203. 4. pour l’<
’efearbot. Suppl. IL 869;
rIqephon. 190. a , fe E?Vr r
des Egyptiens nommée Beelqephon. II.
nération a ,b-^*^bles
on pour Jupiter-Ammon. Suppl. I. 366. a, b. D1®0 "
prême , félon leur théologie. Suppl. II. 473. b. Leurs fap
fur Typhon. Suppl. III. 180. b. 190. a, Vafe qu’ils adoroie
t i . k o l a___f.____ .1__________ * dieux wviers
II. 36S. b. Coutume égyptienne qui donna lieu aux dieux
res. IX. 202.4.f
rent les
292.4. Ces peuples furent les premiers qui emp^Y?
ftatues dans la religion. XV. 498. a. La méthode^
peindre les opérations de la divinité fous des figurmes aines.
E J A
maines , fort en ufage chez les Egyptiens; IX. 42. a. État
du facerdoce en Egypte. X. 261. b. Des prêtres Egyptiens.
XIII. 343. b. Pureté de leurs moeurs. Suppl. IV. 189. h
Qualité de juges 8c de magiftrats qu’ils exerçoient. VI. 274.
4. Les Egyptiens attachés à leurs dieux n’ont jamais em-
braffé de cultes étrangers ; mais les nations étrangères ont
fouvent adopté leurs cultes. IV. 29. a. — 3°. Du gouvernement.
Légifiateurs des Egyptiens. IX. 70. b. Loix auxquelles les !
rois étoient fournis. 648. a. Quelques loix des Egyptiens.
Ibid. Loix contre les fàinéans. X. 331. 4.'Loi qui régloir le
métier des voleurs. XVII. 439. a. De la police de l’Egypte.
XII. 903. b. Tribunal de juftice. XVII. 72.4. Préfet que les Romains
ènvoyoient en Egypte. XIII. 281.4. Des armées des anciens
Egyptiens. XI. 424.4. Leur cavalerie. V . 883. 4. Tribut
impofé aujourd’hui en Egypte à ceux qui ne font pas mahomé*
tans. VIII. 40. b. — 40. Arts 6* fciences. Ancienne langue des
Egyptiens , langue cophte. IV. 177. b. Si l’ancien Egyptien
eft dérivé de 1 rlébreu. Suppl. II. 391. b. Différentes fortes
d’écritures qu’ils ont eues. V. 360. b. Voyez II. vol. des
planches , article Caraflere. pl. 3 8c 7. De l’ufaee qu’ils ont
fait des hiéroglyphes. VIII. 203. a , b. 8cc. Ufages hiéroglyphiques
qu ils tiraient de l’efcarbot. Suppl. II. 809. ¿. 870.
4. Couronnes de nymphæa dont ils couronnoient leurs dieux,
leurs prêtres 8c leurs rois. XI. 02. a. Du papier d’Egypte.
847. b. — 830. b. Maniéré de calculer des Egyptiens. VIII.
330. 4. Année égyptienne. I. 389. b. L’année folaire trouvée
par eux. XVI. 773. a. Mois des Egyptiens. X. 620. b.
621. 4, b. Différentes eres qu’ils ont fuivies depuis la mort
d’Alexandre. V. 902. a. Origine de la géométrie en Egypte.
VII. 629.4. Qui furent ceux qui portèrent les premiers le grec
dans ce ’¡pays. IX. 28. b. L’anatomie née en Egypte. Suppl.
1. 393. b. État de la médecine 8c des médecins en Egypte.
X. 261. b. 262.4. De l’aftronomie des Egyptiens. 1. 783. 4 ,
b. Bibliothèques égyptiennes. II. 229. b. Caraélere de leur
philofophie. I. 329.4. Origine dclametempfycofeparmi eux.
330.4. Rapport de leur doélrine avec celle des Orientaux fur
la métempfycofe. Suppl. IV. 810.4.Comment le dogme monf-
trueuxde l’ame du monde paffa des Grecs aux Egyptiens. 1.230.
b. Jours heureux 8cmalheureux, félon les Egyptiens. VIII. 891.
b. Leur opinion fur l’état des ames après la mort. XIII. 393. b.
L’Egypte peu commerçante dans les premiers tems. XVI.
783. 4 , b. Commerce 8c navigation de fes peuples. XI. 34. b.
Les Egyptiens font les premiers peuples qui ont fait ufage de
maçonnerie. IX. 804. ¿..Salleségyptiennes.XIV. 374.4.— 3®.
Ufages. L’hofpitalité exercée par les Egyptiens. VlII. 313.4.
Comment ils embaumoient les corps. V . 332. a , b. 353. a.
'Suppl. II. 800. b. Jugement qu’ils prononçoient fur les morts,
1. 96. 4. IX. 7. b. particulièrement fur les rois- IV. 1033. fe
Funérailles des Egyptiens. V. 333. a. 671. a. VIL 360. 4 ,
b. IX. 7. b. Ufage des Egyptiens d’engager le corps de leur
pere. XVII. 791. b. Pourquoi les chats ont aujourd’hui des
hôpitaux en Egypte. X. 36. b. La rareté du bois fait que l’on
fe fert dans ces contrées ae la fiente d’animaux pour chauffage.
XIV. 913.4. Obfervations fur les Egyptiens modernes. VIII.
346. 4. Comment ils fe peignent le corps. Suppl. 1.237. a.
Egyptiens ou plutôt Bohémiens, efpece de vagabonds.........
qui font profemon de dire la bonne aventure. V. 438. b.
Leur origine eft incertaine. Pourquoi on leur a donné le nom
d’égyptiens. Il eft peu de nations où il ne s’en trouve. Divers
noms fous lefquels ils font connus. Equipage dans lequel
ils parurent pour la première fois, en 1417. Leur paffage
en France 8c én Angleterre. Origine que leur attribue Raphaël
de Volterre. Ibid. 439. a.
E H
EHANCHÉ. {Maréch.) Cheval dont les hanches font inégales.
Caufes de ce défaut. V. 439. a.
EHRENBERG, {Géogr.) place forte d’Allemagne dans le
Tyrol. Ses révolutions. Seigneurie dont elle eft le chef-lieu.
Suppl. II. 779. b.
EHRENBREITSTEN, ( Géogr.) fortereffe d’Allemagne
dans le cercle du bas-Rhin. Sa fituation. Palais préside ce lieu.
Cette place prife parles François en 1632. Suppl. II.779 .a.
EHUD. ( Hift. facr. ) Il délivra les Ifraélites de la tyrannie
des Moabites. Suppl. II. 194. a.
E l E J
E l , obfervations fur cette diphtongue. IV. 1017.4. VIII.
’424. b.
EJACULATEUR. ( Anat. ) Mufcles éjaculateurs dans
l’homme 8c dans la femme. Conduits éjaculateurs. V. 429. b.
Ejaculateur, mauvais nom. On parle dans cet article de
l’Encyclopédie de l’accélérateur. Suppl. II. 780. a. Voyez ce
mot dans l’ordre alphabétique.
Ejaculateur de Santorin , véritable dilatateur de l’urctre.
Sa defcription. Suppl. IL 780. o.
Tome I, >
E L A m
EJACULATION. (Phyjîol.) Mcchanlfme par lequel cette
action s exécute. V. 430. b.
Ejaculation: voyez Sauna & Coi,. Des parties qui fervent
à cet acte, iuppl. II. 6 1 5 Vaiffeimc éiaciiloires de
la tnatnee. /tu/. Efpece d impmilance dont Ut caufe dépend
de 1 éjaculation. VIII. 633. b.
EICETES , ( Hift. eccl. ) hérétiques du 7*. fiecle : ils
Croyoient qu’on ne pouvoit bien louer Dieu qu’en danfant.
V . 440. 4
EICK, {Hubert (/ Jean Van-) peintres. V. 313. b.
EIDER, oifeau dont on tire l’édrcdon. V. 396. b. Comment
ori ramaffe fes plumes. 297. a. Sa defcription. VI. vol.
des planch. Regne animal, pl. 49.
EISCTERIES ; obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. IL 780. 4.
EISENMAN y {J. S.) anatomifte. Suppl. I. 411. 'b.
EISENSCHMID , ( Jean-Gafpard ) onfervations fur cet
auteur. XV. 740.4. Son hypothefe fur la livre romaine. IX.
019. b. Son traité fur la figure de la terre. Suppl. IV.
EISETERIES, voye[ Eiscteries.
E L
ELABORATION des humeurs récrémeniiticllcs. ( Médec. )
Comment elle s’opère. V. 440. b.
ELÆAGNUS ou O leaster. ( Botan. ) Noms de cette
plante en différentes langues. Son caraélere générique. Enumération
de trois efpeces qui lui appartiennent. Suppl. II.
780. 4. Leur defcription , culture : ufage qu’011 en peut tirer
pour les bofouets. Ibid. b.
ELAGABALt, dieu qu’on adorait à Emefe en Syrie,
Oc. fous la figure d’un cône de pierre. Honneur que lui rendit
l’empereur Eliogabale. Statue de la déeffe célefte avcfc
laquelle il le maria. Sort de ce mariage après la mort de
l’empereur. V. 440. b. Voyeç C éleste.
ELAGAGE, voye[ T aille , Elaguer ; voye^ Em o n d e r ;
Utilité de l’élagage. Suppl. I. 321. b.
ELAN , ( Hift. nat. ) animal quadrupède du genre des
ruminans. Sa defcription. V. 440. b. Contrées que les élans
habitent. Particularités fur cet animal. Propriété contre l’é-
pilepfie qu’on attribue à fon pied. Ibid. 441.-a.
t Elan. Il parait que l’animal appellé alcè eft le même que
l’élan. I. 248.4. Defcription de 1 élan. V I vol. des pl. Rcgne
animal, pl. 6.
E lan. ( Mat. méd. ) Ufage qu’on faifolt autrefois de la
corné de fon pied contre Pépilepfie. On eft aujourd’hui revenu
de cette erreur. V. 441. 4.
Elan. ( Chamoifeur ) Ufage 8c préparation de fa peau. V;
44t. a.
ELAPHEBOLIES, fête des Phocéens. Son origine. Les
Athéniens en avoient de ce nom. Comment ils la célébraient.
V. 441. b.
ELAPHEBOLION, neuvième mois des Athéniens. Origine
de ce nom. V. 441. b.
ELARGIR un cheval, le contraindre à embraffer un plus
grand efpace de terrein. Cet efpace ne peut être limité. On
peut attribuer une grande partie des défenfes des chevaux
au peu de foin qu’on a de les travailler large 8c de les empêcher
de fe rétrécir ; comme lorfqu’cn trottant un poulain
à la longe, on n’a pas attention de réloigncr du piqueur qui
la tient ; lorfqu’on le monte par le droit dans un efpace trop
court 8c trop rétréci, . . . . 8cc. 11 importe donc effentiellc-
ment de le conftamment élargir. L’obfcrvarion de ce principe
ne doit pas être moins rigoureufe à l’égard des chevaux
que nous entreprenons 8c qui ont acquis toutes leurs forces
V. 441. b. Il en eft en qui le derrière eft trop foible.
De - là les défordres de l’animal, qu’on ne prévient
qu’en l’élargiffant. Autres fortes de chevaux qu’on doit toujours
élargir. Tout cheval peut fe rétrécir 8c mettre le cavalier
dans la néceifité de l’élargir, foit qu’il exécute des changemens
de main larges ou étroits. Ce qu’on doit obferver
dans tous ces différens cas. Ibid. 442. a. Obligation 8c importance
de varier les leçons 8c la place où on les donne.
Ibid. b. Ce qu’il faut faire par rapport à ceux qui préviennent
la volonté 8c l’aétion , qui tournent fans y être
invités j à l’égard des chevaux ramingues , 8c de ceux
dont les croupes font légères ou fauffes, &c. la méthode
indiquée eft préférable à celle de n’employer que les châ-
timens. Ibid. 443. a.
Elargir : cette expreffion eft encore en ufage en parlant
de la pofition des jambes de l’animal en aélion. Le derrière
ne peut être rétréci, que le devant ne s’élargiffe, 8c réciproquement.
V. 443. 4.
Elargir. Cheval qui fe ferre ou qui s’élargit trop. XV.
117. b.
ELARGISSEMENT d’un yrifonnier. { Jurifp. ) Elargiffe-
ment définitif ou provifoire. V. 443. a. Défenfe d’élargir un
prifonnicr fans lettres patentes, &>c. De l’élargiffement des
DD Dd d d d