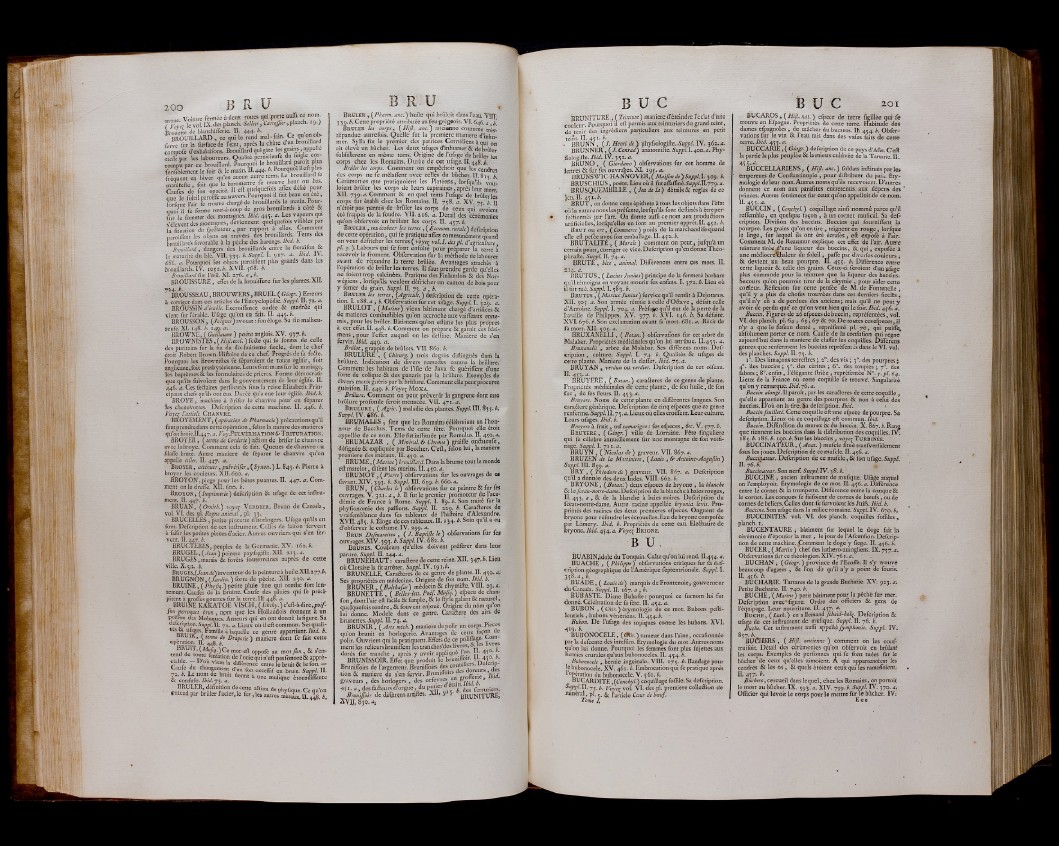
l O O B R U
Voiture fermée à deux roues qui porte attiü ce nom.
Troy'l le vol. IX. des planch. S'UUr, Carrofi'r ,planch. 19O
«rouette de blanchifferie. II. 444. b.
BROUILLARD , ce qui le rend mal-fan. JCe quonobj-
fcrve fur la furfocede Peau, après la chute dun brouillard
compofé d’exhalaifons. Brouillard qui gâte les
■nielle par les laboureurs. Qualité permcieufe du feig
-rompu par ce brouillard. Pourquoi le brouiüard paroit plus
IenlU)lement le fbir & le matin.U4« . *• Pourquoi cftpte
fréquent en hiver qu’en aucun nuire rems. Le brouillard le
maniiefte foit que le baromettre fe trouve haut ou bas.
Caufes dl fon opaché. Il efl quelquefois allez dehé pour
q u e le fo le il paroilTe au travers. P o u rq u o i diiut beau en été,
lorfque l’air fe trouve chargé de broudlards le matra. Pourquoi
il fe forme tout-à-coup de gros brouillards a coté &
fur le fonunet des montagnes. Ih i. 445. a. Les vapeurs qui
s’élèvent des montagnes, deviennent quelquefois vdibles par
la lituation du fpeSateur , par rapport H H K Comment
paroiffenr les objets au travers des brouillards, lems des
brouillards favorable à la pêche des harengs. Ibid.b.
Brouillard , dangers des brouillards entre la floraifon &
I.1 maturité du blé. VII. 555. b. Suppl. I. 917* a- Ibid. IV.
686. u. Pourquoi les objets paroiflent plus grands dans les
brouillards. IV. 1052. b. XVII. 368. b.
Brouillard fur lVfeil. XI. 276. 4 , A
BROUISSURE, effet de la brouiffure fur les plantes. XII.
7IBROUSSEAU, BROUWERS, BRUEL. ( Gtogr. ) Erreurs
à corriger dans ces articles de l’Encyclopédie. Suppl. II. 72. a.
BROUSSIN d’érable. Excroiffance ondée 8c madrée qui
vient fur l’érable. Ufage qu’on en fait. II. 445. b.
BROUSSON, | Jacques) avocat : fon éloge. Sa fin malheu-
reufe. XI. 148. b. 149. a.
BROWNE,(Guillaume) poèteanglois.XV. 937.b.
BRQWNISTES ,(Hifl.eccl. ) fette qui fe forma de celle
des puritains fur la fin du dix-nuitieme fiecle, dont le chef
croit Robert Brown. Hiftoire de ce chef. Progrès de fa fette.
Pourquoi les Browniftes fe féparoient de toute églife, foit
anglicane,foit presbytérienne.Leurs fentimens fur le mariage,
les baptêmes 8c les formulaires de prières. Forme démocratique
qu’ils fuivoient dans le gouvernement de leur églife. II.
446. a. Ces fettaires perfécutés fous la reine Elizabeth Principaux
chefs qu’ils ont eus. Durée qu’a eue leur églife. Ibid. b.
BROYE, machine à brifer le chanvre pour en féparer
les chenevottes. Defcription de cette machine. II. 446. b.
Voye[ l'artiele C hanvre.
BROYEMENT, ( opération de Pharmacie') précautions qu’il
faut prendredans cette opération, félon la nature des matières '
qu’on broie.II.447. a. J'by.PULVÎRISATIONé'TRITURATION.
BROYER, (terme de Corderïe ) attion de brifer le chanvre
avec la broyé. Comment cela fe fait. Queues de chanvre eu
filaffe brute. Autre maniéré de féparer le chanvre qu’on
appelle tiller. II. 447. a.
Bro yer, atténuer, pulvérifer, (Synon.) I. 843. b. Pierre à
broyer les couleurs. XII. 600. a.
BROYON, piege pour les bêtes puantes. II. 447. a. Comment
on le dreffe. XII. 600. b.
BiRO Y ON j ( Imprimerie ) defcription & ufage de cet infiniment.
,11. 447. b.
BRU AN, (Omith.) voyeç V erdier. Bruan de Canada,
vol. VI. des pl. Reçne animal, -pl. 33.
• BRUCELLES, petite pincette d’norlogers. Ufage qu’ils en
font. Defcription de cet infiniment. Celles de laiton | fervent
à faifir les petites pièces d’acier. Autres ouvriers qui s’en fervent.
II. 447. b.
BRUCTÉRES, peuples de la Germanie. XV. -162. b.
BRUGEL, (./m/2 ) peintre payfagifte.XII. 213. a.
BRUGES,marais oc forêts fouterreines auprès de cette
ville. X. 92. b.
Bruges,(/mtz de) inventeur de la peinture à huile.XII. 277. A
BRUGNON,(Jardin.) forte de pèche. XII. 230. a.
BRUINE | ( Phyfiq.) petite pluie fine qui tombe fort lentement.
Caufes de la bruine, Caufe des pluies qui fe précipitent
à groffes gouttes fur la terre. II! 448. a.
BRUINE KAKATOE VISCH, (Ichthy.) c’eft-à-dir e,poif-
fon perroquet brun, npm que les Hollandois donnent à un
§ppË| §¡1 Moluqucs. Auteurs qui en ont donné la figure. Sa
^ 7a*a' ^eux où ileft commun. Sesquaü-
TmTmPS/ramille à laquelle ce genre appartient. Ibid. b.
UKAJIR., (terme de Draperie) maniéré dont fe fait cette
operauon. U. 448. A
»iÜÜ»iéÉËÈlÉl üÉ mot'eft oppofé au mot fon , & s’en-
• ki rvev . tl0n I I l’ouiequin’eft pasfonore&appré-
r S S ? C d i f f é r e n d entre îe bruit & le fo n .-
S x S l S l f P S fon «Ccffif en bruit. Suppl. II.
ï ï M m Ë S È M H mnhqno étouÆante
e ™ y LER> # Sn.i,tio.n i de phyfimie. Ce qu’on
entend par brûler 1 acier, le fer.les autres mVu».IL^8. é.
BRU BRULER , ( Phafm. anc. ) huile qui brûloit dans l’eau. VRL
339.b. Cette propriété attribuée au feu grégeois. VI. 646. a b
B rûler les corps, (/fi/?, anc.) ancienne coutume très-
répandue autrefois. Quelle fut la première Maniéré d’inhumer.
Sylla fut le premier des patrices Cornéliens à qui on
ait élevé un bûcher. Les deux ufages d’inhumer & de brûler
fùbfifierent en même tems. Origine de l’ufage de brûler les
corps chez les Rojnains. Durée de cet ufage. U. 448. b.
Brûler les corps. Comment on empêchoit que les cendfes
des corps ne fe mêlaffent avec celles du bûcher. 11.81«. A
Cérémonies que pratiquoient les Platéefis, lorfou’ils vou-
loient brûler les corps de leurs capitaines, après leur mort;
XII. 739.a.Comment 8c en quel tems l’ufage de brûleries
corps fut établi chez les Romains. II. 738. a. XV. 73. b U
n’étoit pas permis de brûler les corps de ceux qui avoient
été frappés de la foudre. VII. 216. a. Détail des cérémonies
qu’on bbfervoit en brûlant les corps. II. 437. A
BRULER, ou ècobuer les terres >( Eco nom. rurale) defcription
de cette opération, qui fe pratique allez communément quand
on veut défricher les terres ( voyeç vol. 1. des pl. d'agriculture ,
pL y.). Labours qui fe font enfuite pour préparer la terre à
recevoir le froment. Obfervation fur la méthode de labourer
avant de répandre la terre brûlée. Avantages attachés ù
l’opération de brûler les terres. Il faut prendre garde qu’elles
ne foient trop calcinées. Pratique des Finlandois & des Norvégiens
, lorfqu’ils veulent défricher un canton de bois pour
y lemèr du grain. Suppl. H. 73. a , A
B rûler les terres, (Agricult.) defcription de cette Opération.
I. 188. , A Obfervation fur cet ufage. Suppl. I. 329. a.
BRULOT, ( Marine ) vieux bâtiment chargé d’artifices &
de matières combuftibles qu’on accroche aux vaiffeaux ennemis
, pour les brûler. Bâtimens qu’on eftime les plus propres
a cet effet. II. 448. A Comment on prépare & garnit ces bâtimens
| pour l’effet auquel on les delüne. Maniéré de s’en
fervir. Ibid. 449. a.
Brûlot, grappin de brûlots. VII. 860. b.
BRULURE , | Chirurg. ) trois degrés diftinguès dans la
brûlure. Indication de divers remeaes contre la brûlure.'
Comment les habitans de l’ifle de Java fe guériffent .d’une
forte de colique & des panaris par la brûlure. Exemples de
divers maux guéris par la brûlure. Comment elle peutprocuret
guérifon. II. 449. A Voyeç Moxa.
Brûlure. Comment on peut prévenir la gangrene dont une
brûlure profonde feroit menacée. VII. 471. a.
B ruluré , ( Agric. ) maladie des plantes. Suppl. III. 83 3. bi
Suppl. IV. 686. A
BRUMALES , fête que lés Romains célébroient en l’honneur
de Bacchus. Tems de cette fête. Pourquoi elle étoit
appellée de ce nom. Elle futinfiituêe par Romulus.II. 430. a.
BRUMAZAR , ( Minéral. 6» Chymie ) graiffe onftueufe,
défignée & expliquée par Beccher. Ç’eft, félon lui, la matière
première des métaux. II. 430. a.
BRUME, ( Marine) brouillard. Dans la brume tout le monde
efi matelot, difent les marins. II. 430. a.
BRUMO Y , ( Pierre ) obfervations fur les ouvrages de ce
favant. XIV. 393. A Suopl. 111.639. A 660. a.
BRUN,. ( Charles le ) obfervations fur ce peintre & fur fes
ouvrages. V. 321. d , A II fut le premier promoteur de l’académie
de France à Rome. Suppl. I. 89. A Son traité fur la
phyfionomie des paifions. Suppl. II. 229. b. Caraéteres de
vraifemblance dans fes tableaux dè l’hiftoire. d’Alexandre.
XVn. 483. A Éloge dé ces tableaux. II. 134* b- Soin qu’il à eu
d’obferver le coftume. IV. 299. a. . . .
Brun Defmarettes , ( /. Baptijle U ) obfervations fur fes
ouvrages.XÏV. 393. b. Suppl. IV. 682. A
Brunes. Couleurs Qu’elles doivent préférer dans leur
parure. Suppl. II. 244. a. .
BRUNEHAUT : carafiere de cette reine. Xll. 347. A Lieu
où Clotaire la fit arrêter. Suppl. IV. 191. b.
BRUNELLE. Caraéleres de ce genre de plante. IL 430.4.’
Ses propriétés en médecine. Origine de fon nom. Ibid. b.
BRÜNER, (Balthafar) médecin & chymifte. VIII. 20.4.
BRUNETTE, ( Belles-lett. Poéf. Muftq.) efpece de chan-
fon|dont l’air efi facile & fimple, & le ftyle galant & naturel,
quelquefois tendre, & fouvent enjoué. Origine du nôm qu on
lui donne. Modèle dans ce genre. Caraftere des airs dé
brunettes. Suppl. IL 74. a. .
BRUNIR, ( Arts méch. ) maniéré de polir un corps. Pièces
qu’on brunit en horlogerie. Avantages de cette façon e
polir. Ouvriers qui la pratiquent. Effets de ce poliffage. o
ment les relieurs bruniffent les tranchesMes livres, & les ivr ^
dorés fur tranche , après y avoir appliqué 1 or. • 45 • •
BRUNISSOIR. Effet que produit le bruniffoir. n. 450.^.
Bruniffoirs de l’argenteur. Bruniffoirs d e s couteliers, ^eicr.ption
& maniéré de «un ot maniere ae ss ’eenn îfeerrvviirr.. Buriu un*“if*f*o—n'S J „«.(farie ’ibid.
graveurs , des horlogers , des orfèvres en g ?
4SI. î , des M e u r s (l’o rgue, du P i “ “ Verruriers.
Brunijfoir de difl&çns arftftes. AU. 9 \ d u t i j j i tü R E ,
XVJJ. 830.4.
B Ü C B U C 201
BRUNITURE, ( Teinture) maniere d’éteindre l’éclat d’uiié
couleur. Poiirquoi il efi permis aux teinturiers du grand teint ,
de tenir des ingrédiens particuliers aux teintures en petit
teint. II. 431* b. ‘ , .■.. y.'-'’
• BRUNN , (/• Henri de) p h y f io l o g i f t e . I V . 362.4.
BRUNNER, (/. Conrad) anatomifie. Suppl.1.400. a. Pliy-
fiologi.fte. Ibid. IV. 3 3 2.4.
BRUNO, ( Giordano ) obfervations fur cet homme de
lettres & fur fes ouvrages. XI. 195. a.
BRUNSWIC-HANNOVER, ( Maifon de) Suppl.L 309. A
BRUSCHIUS, poète. Lieu où il fùtaffaffirié.S«/y»/.U.779i a.
BRUSQUEMBILLE , (Jeu eie la) détails & réglés de ce
jeu. II. 431. A
BRUT, on donne cette épithefce à fous les objets dans l’éfàt
où la nature nous les préfente,lorfqu’ils font defiinés à êtreper-
feétionnés par l’art. On donne aufli ce nom aux productions
artificielles, lorfqu’elles en font au premier apprêti II. 432. A
Bru t oy ort, ( Commerce ) poids de la marchandife quand
elle efi pefée avec fon emballage. II. 43 2. A
BRUTALITÉ, ( Morale) comment on peut, jufqu’àun
certain point, corriger ce vice. Defcription qu’en donne Théo-
ph rafie. Suppl. II. 74. a.
BRUTE, bête , animal. Différences entre ces mots. II.
214.4. _ '
BRUTUS, ( Lucius Junius) principe de la fermeté barbare
qu’il témoigna en voyant mourir fes enfatìs. I. 372. A Lieu où
il fut tué. Suppl. I. 303. A
B rutus , (Marcus Junius) fervice qu’il rendit à Dejotarus.
XII. 303, a. Son armée réunie à celle d’Oétave, défait celle
d’Antoine. Suppl. I. 704. a. Préfage qu’il eut de la perte.de la
bataille de Philippes. XV. 377. A AVI. 146. A Sa défaite.
XVI; 676. AS011 exclamation avant fa‘mort. 681. a. Récit de
fa mort. XII. 303. a.
BRUXANELLI, ( Botan. ) obfervations fur cet arbre du
Malabar; Propriétés médicinales qu’on lui attribue. IL 433. a.
Bruxanelli j arbre du Malabar. Ses différens noms. Defcription
, culture. Suppl. I. 74. b. Qualités & ufages de
cette plante. Maniere de la claffer. Ibid. 73; a.
BRUYAN , verdun ou verdier. Defcription de cet oifeau.
H. 433.4.
BRUYERE, ( Botan. ) caraâeres de ce genre de plante.
Propriétés médicinales de cette plante, de fon huile, de fon
fuc , dè fes fleurs. II. 433.4.
Bruycre. Noms de cette plante en différentes langues. Son
carattere générique. Defcription de cinq efpeces que ce genre
renferme. Suppl. IL 7 3. a. Lieux où elles croiffent. Leur culture.
Leurs ufages. Ibid. A
Bruyère à fruit, ou* camarigne : fés efpeces , &c. V . 377. A
B r u y e r e , ( Géogr. )’ ville de Lorraine. Fête finguliere
qui fe cèlebre annuellement fur une montagne de fon voifi-
nage. Suppl. I. 711. a.
BRUYN , ( Nicolas dè ) graveur. VIÏ. 867. a.
BRUZEN de la Martinîere , ( Louis , 6* Antoine-Augujlin )
Suppl. III. 839. 4.
BRY , ( Théodore de ) graveur. VII; 867. a. Defcription
qu’il a donnée des deux Indes. VIII.- 662. A
BRYONE, (Botan'.) deux efpeces de bryone , la blanche
8c le fceau-notre-dame. Defcription de lablanche à baies rouges,
II. 433. à , & de la blanche à baies noires. Defcription du
lceau-notre-dame. Autre racine appellée bryonia levis. Propriétés
des racines des deux premières efpeces. Onguent de
bryone pour réfoudre les écrouelles.Eau de bryone compofée
par Lémery. Ibid. b. Propriétés de cette eau. Elettuaife de
bryone. Ibid. 434.a. Voye{ Br ion e.
B U,
BUABIN,idole du Tonquin. Culte qu’tìn lui rend. 11.434- a.
BUACHE , ( Philippe ) obfervations critiques fur fa defcription,
géographique de l’Amérique feptentrionale. Suppl. 1.
338.a , A
BU ADE, (Louis de) marquis de Frontenoie, gouverneur
du Canada. Suppl. II. 167. a , A
BUBASTE. Diane Bubafte : pourquoi ce fumom lui fut
donné. Célébration de fa fête. II. 434. a.
BUBON , ( Chir. ) étymologie de ce mot. Bubons pefti-
lentiels, bubotw vénériens. II. 434. A Y
Bubon. De l’ufage des topiques contre lès bubons; XVI;
4x9- b. .
BUBONOCELE, (<Mir.) tumeut1 dans l’aine, occafionnée
par la defeente des inteitins. Étymologie du mot. Autres nonis
qu’on lui donne. Pourquoi les femmes font plus fujettes aux
hernies crurales qu’aux bubonoceles. II. 434. A
Bubonocele , hernie inguinale. VIII. 173. A Bandage pour
le bubonocele. XV. 461. b. Embrocation qui fe pratique après
1 opération du bubonocele. V. 561. .
BUCARDITE ,(Conchyl.) coquillage foflile. Sa défeription.
Suppl. II. b- Voyer vol. VI. des pl. premiere collettaon dé
Minéral, pl. 3. & farticle Cour de bceuj.
Tome I,
BUCAROS, ( Hiß. nat. ) efpece de terre figilÎée qui fé
trouve en Efpagne. Propriétés de cette terre, habitude des
dames efpagnoles, de mâcher du bucaros. IF. 434. A Obfervations
fur le vin & l’eau mis dans des vàfes faits de cette
terre. Ibid. 433.4. ,
BUÇÇARIE, ( Géogr. ) defcription de ce pays d’Afie. Ceft
la partie la plus peuplée oç. la mieux cultivée de la Tartarie. IL
45 5-*-
éüCCELLARIENS, ( Hiß. anc. ) foldats inftitués par les
empereurs de Conftantinople , pour difiribuer du paLi. Étymologie
de leur nom. Autres noms qu’ils recevoient. D’autres
donnent ce nom aux parafites entretenus! aux dépens des *
princes. Autres fentimens fur ceux qu’on appelloit de ce nom;
11.435.4. . ; y
BUCCIN, ( Conchyl. ) coquillage ainfi" nommé parce qu’il
reffemble, en quelque façon, à un cornet mufical. Sa defcription.
Divifion des buccins. Buccins qui fourniffent la
pourpre. Les grains qu’on en tire , teignent en rôuge, lorfque
le linge, fur lequel ils ont été écrafés, efi expofé à l’air:
Comment M; de Reaumur explique cet effet de l’air. Autre
teinture tirée.¿’une liqueur aes buccins, 8c qui, expofée à
une médiocrexjialeur du foleil, paffe par diverfes couleurs j
8c devient un beau pourpre. II. 433. b. Différence entre
cette liqueur 8c celle des grains. Ceux-ci feroient d’uripfage
lus commode pour la teinture que la liqueur des buccins;
ecours qu’on pourrait tirer de la chymie ,■ pour aider cette
cotfleiir. Réflexion fur cette penfée de M. de Fontenelle,
qu’il y a plus de chofes trouvées dans ces derniers fieclès^
qu’il n’y en a de perdues des anciens j mais qu’il ne peut y
avoir de perdu que* ce qu’on veut bien qui le loix.Ibid. 436. a.
Buccin. Figures de 26 eipeces de buccin, repréfentéés, vol.
VI. des planch. pl. 64 , 63 i 67 8c 70; De toutes ceseiipeces, il
n’y a que le fùfeau denté , repréfenté pl. 7Ö, qui puiffe.
abfolument porter ce nom. Caufe de la confùfion qui régné
aujourd’hui dans la maniéré de claffer les coquilles. Différens
genres que renferment les buccins repréfentés dans le VI: vol.
des .planches. Suppl. II. 73. A
i°; Des limaçons terreftres ; 20; des vis ; 30. des pourpres ;
40. 'des buccins | 50. des cérites ; 6°. des .toupies ; 70. des
fabots ; 8°. enfin, l’élégante ftriée , repréfentée N°. y. pl. 64.
Lieux de la France où cette coquille fe trouvé. Singularité
qu’on y remarque. Ibid. y6. a.
Buccin alongê. U paraît, par les caratteres de cette coquille *
qu’elle appartient au genre des pourpres 8c non à celui des
buccins. D’où on la tire. Sa defcription. Ibid. 1
Buccin feuilleté. Cette coquille efi une efpece de pourpre. Sâ
.defcription. lieux où ce coquillage efi commun. Ibid.
Buccin. Difiinttion, du murex 8c du buccin. X. 867. b. Rang
que tiennent les buccins dans la diffribution des coquilles. IV.
183. A 186. A 190. A Sur les bliccins , voyeç T u rb in ée.
BUCCINATTUR, ( Anat. ) mufcle utué tranfVerialement
fous les joues. Defcription de ce. mufcle. IL 436. a.
Buccinateur. Defcription dé ce mufcle, 8c fon ufage.Suppl.
H; 76. A
Buccinateur. Son nerf. Suppl. IV. 38. A
BUCCINE , ancien infiniment de mufiqüe. Ufdge auquel
on l’employoit. Étymologie de ce mot. II. 456.4. Différence
entre le cornet 8c la trompette. Différence entre la conque 8c
le cornet. Les conques fe fàifoient de cornes de boeufs, ou de
cornes de beliers. Celles dont fe fervoient les Juifs. Ibid. A
Buccine. Son ufage dans la milice xorraxue:Suppl. IV. 670. A
BUCCIN1TES. vol» VI. des planch. coquilles foifiles,
planch.1.
BUCENTAURE , bâtiment fur lequel le doge fait la
cérémonie d’épouier la mer , le jour de l’Afcenfion. Defcription
de cette machine. Gomment le doge y ftege; II. 456. A
BUCER, ( Martin ) chef des luthero-zuingliens. IX. 757. a.
Obfervations fut ce théologien. XIV: 761. a.
BUCHAN i (Géogr. ) province de l’Ecoffe. Il s’y trouvé
beaucoup d’agates , 8c l’on dit qu’il n’y a point de iburis:
II. 436. A
BUCHARIE. Tartares de la grande Buchafie. XV: 923. a:
Petite Bucharie. II. 740. A « .
BUCHE, ( Marine ) petit bâtiment pour la péché fur mer.
Defcription avec‘ figure: Ordre des officiers 8c gens de
l’équipage. Leur nourriture. Ü. 437. a.
B u ch e , ( Luth. ) en a llemand fcheid-hol^. Defcription 8c
ufage de cet infiniment de mufique; Suppl. il. 76: b.
Buche. Cet infiniment aufli appellé fymphoiùe. Suppl. IV.
837. A
BUCHERS , ( Hiß. ancienne ) comment ôn les conf-
truifoit. Détail des çérémpnies qu’on obfçryoit en brûlant
les corps; Exemples de perfonnes qui fe font tuées fur le
bûcher de ceux qu’elles aimoient. Â qui appartenoient les
cendres 8c les os , 8c quels étoient ceux qui les ramaffolent: •
IL b.
■ Bûchers, cercueil dans lequel, chez les Romains, on portoit
le mort au bûcher. IX. 393. a. XIV. 799. A Suppl. IV. 370. ai
Officier qui levoit le corps pour le mettre fur le bûcher. IV;