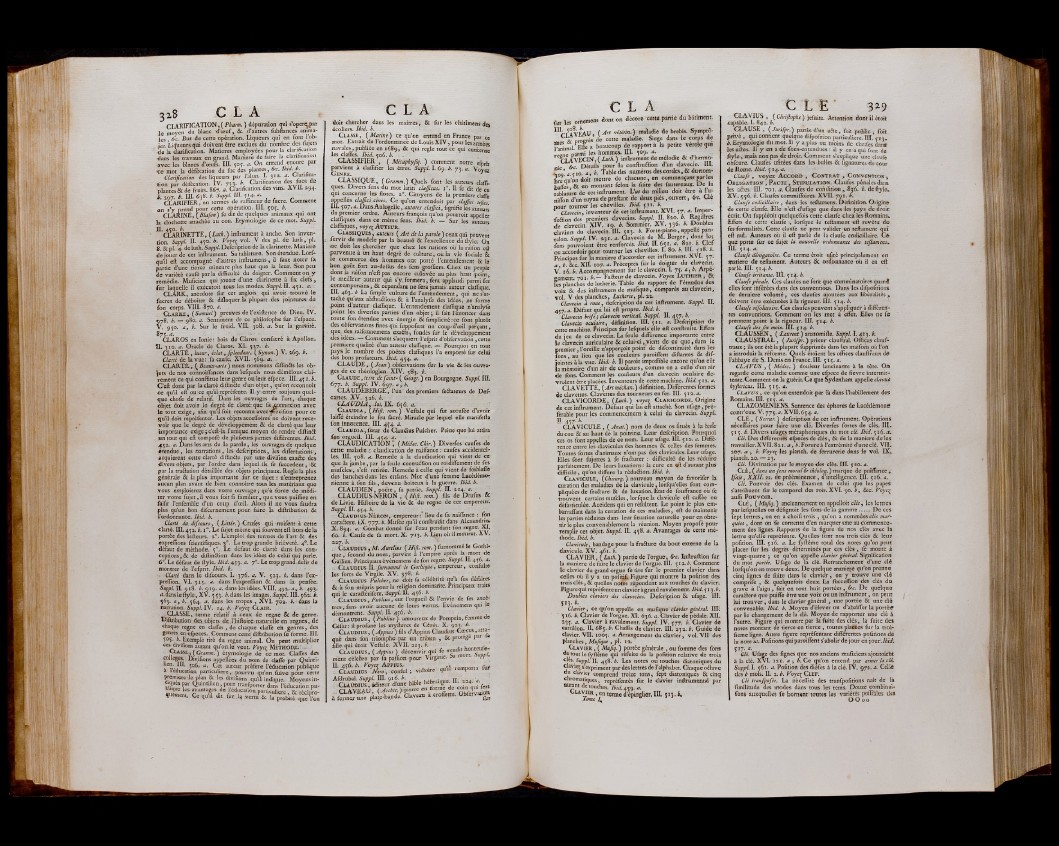
3 2 8 C L A
CLARIFICATION, ( -pharm. ) dépuration oui s'oper^par
le moyen du blanc d’oeuf, 8c d’autres fubftances animales
, &c. But de cette opération. Liqueurs qui en font l’ob-
.iet. Ligueurs qui doivent être exclues du nombre des fujets
de la clarification. Maderes employées pour la clarification
•dans les travaux en grand. Maniéré de faire la clarification
■avec les blancs d’oeufs. III. 503. a. On entend encore par
ce mot la défécation du fuc des plantes, Grc. Ibid. b.
Clarification des liqueurs par l'alun. L 314. a. Uarihca-
lion pir,défécation. IV. 733- bi Clantatoti des focs de
plantes & de fruits. 867. a. Clarification des vins. XVIL 294.
ï . 207. b. IIL «38. b. Suppl. III. f >4- “■
CLARIFIER j en termes de ramneur de fucre. Comment
on s’v prend pour certe opération. III. 305. b.
CLARlNÉ, ( Blafon) fe eut de quelques animaux qui ont
la clochette attachée au cou. Etymologie de ce mot. Suppl.
"CLARINETTE, (Luth.) infiniment à anche. Son invention.
Suppl. U. 430. b. Voyt[ v o l .V des pl. de luth, pl.
S. & pl. 4. de luth. Suppl. Defcription de la clarinette. Maniéré
dé jouer de cet infiniment. Sa tablature. Son étendue. Lorf-
qu’il eft accompagné d’autres inftrumens, il faut noter fa
partie d’une tierce mineure plus haut que la leur. Son peu
de variété caufô par la difficulté du doigter. Comment on y
remédie. Muficien qui jouoit d’une clarinette à fix clefs,
fur laquelle il exécutoit tous les modes. Suppl.U. 431. a.
CLARK, anecdote fur cet anglois qui avoit trouvé le
fecret de déboîter & difloquer la plupart des jointures de
fon corps. VIII. B70. a.
978.
C l a r k e , (Samuel) preuves de l’exiftence de Dieu. IV.
-8. b. -r 980. a. Sentiment .... J 980.--------- de ce .p hilofop. he fur l’efp. ace.
930. a, b. Sur le froid. VIL 308. a. Sur la gravité.
875. a.
CLAROS en Ionie: bois de Claros çonfacré à Apollon.
II. 310. a. Oracle ' de Claros. XI. 337. - A
CLARTÉ , lueurt éclat, J'plendtur. (Synon.) V. 269. A
Clarté de la vue:,fa caufe. &V1I. 369. x.
CLARTÉ, ( Beaux-arts) nous nommons diftinâs les objets
de nos connoiffances dans lcfquels nous démêlons clairement
ce qui conftitue leur genre ou leur efpece. III. 431. A
Ceft donc par la clarté diftinâe d’un objet, qu’on rcconnoit
ce qu’il eft ou ce qu’il repréfeote. Uy.entre toujours quelque
chofe dé relatif.. Dans les .ouvrages de l’art, chaque
objet doit avoir Je degré de clarté: que fa^onnexion avec
le tout exige, afin qu’il foit reconnu avec'pecifion pour ce
qu’il doit repréfenter. Les objets acceffoires ne doivent recevoir
que le degré de développement & de clarté que leur
importance exige ; ç’eft-là l’unique moyen de rendre diftinâ
un tout qui eft compofé de.pluueurs parties différentes. Ibid.
432. a. Dans les arts de la parole, les ouvrages de quelque
«tendue, les narrations, les deferiptions, les differtatiorisy
acquièrent cette clarté diftinûe par une divifion exaite des
divers objets, par l’ordre dans lequel.ils. fe fuccedent, *8c
par la traébtion détaillée des objets principaux. Réglé la plus
générale & la plus importante fur ce fujet : n’entreprenez
aucun plan avant de bien connoitre tous les matériaux que
vous emploierez dans votre ouvrage ; qu’à force de méditer
votre fujet, il vous foit fi familier, que vous puifiiez en
faifir l’enfemble d’un coup d’oeil. Alors il ne vous faudra
plus qu’un bon difeernement. pour; faire la diftribution &
«ordonnance. Ibid. A
.Clarté du. difeours, (Littér.) Caufes qui nuifent à cette
clarté. 111.432. A i°. Le fujet même qui fouvent eft hors de la
portée des leâeurs. 20. L’emploi des termes de l’art 8c des
expreflions feientifiques. 30. La trop grande brièveté. 40. Le
défaut de méthode. 30. Le défaut de clarté dans les conceptions,
& de diftin&ion dans les idées de celui qui parle.
C°. Le défaut .de ftyle. Ibid. 433. a. 70. Le trop grana.defir de
montrer de l’efprit. Ibid. A
•• Clarté dans le difeours. I. 376. a. V. 323. A dans l’ex-
preflion. VL 313. 4i. dans l’cxprcffion & dans la penfée.
Suppl. II. 018. A 919. a. dans les idées. VIII. 492. x, A 493.
x. dans le ftyle, XV. 333.3 33. A dans les images. Suppl. III. 362. A
363. ay x , A 364. x. dans les tropes , XVI.
702. A dans la
narration. Suppl. IV. 14. A Voyez C lair .
.CLASSE, terme relatif .à ceux de regne & de genre.
Diftribution .des..objets de l’hiftoire naturelle en régnés, de
chaque regne en claffes, de chaque claffe eh genres,.des
genres en efpeces. Comment cette diftribution fe forme. III.
5°$* .A Exemple tiré du regne animal. On peut multiplier
ces divifions autant qu’on le veut. Voyez Méthode. ' .
Classe , ( Gramm. ) étymologie de c e mot. ClafTes des
collèges. Diyitions appcllées. du nom de clafTc par Q u in ti-
Ve? ,',, ' 5°ri/ p C e t auteur préféré l’éducation publique
a L éducation particulière, pourvu qu’o n .fu iv e pour cette
première-Je plan & les divifions qu’il indique.. Mo y en s in-
H Q utntilien, pour trhnfportcr dans l’iducation pu-
S i “ jyaBtage» de Uducation particulière, & récipïo-
tfliemciu, C e q u il dit fur .1, vertu & u probitt qile ‘r ûn
C L A
doit chercher dans les maîtres, & fur lés châtimens des
écoliers. Ibid. A
C lasse , ( Marine ) ce qu’on entend en France par ce
mot. Extrait de l’ordonnance de Louis XIV, pour les armées
navales, publiée en 1689, & qui regle tout ce qui concerne
.les clafTes. Ibid. 306. A .
CLASSIFIER , ( Métaphyfiq. ) comment notre efprit
parvient à elaffifier les êtres. Suppl. I. 69. A 73. a. Vovez
G enre. 1
CLASSIQUE, (Gramm.) Quels-font les auteurs daffi-
ques. Divers fens du mot latin clajficus. i°. 11 fe dit de ce
qui concerne les flotes. 20. Citoyens de la première claffe
appellés clajfici, cives. Ce qu’on entendoit par clajfici telles.
III. 307. x. Dans Aulugelle, autores clajfici, lignifie les auteurs
du premier ordre. Auteurs françois qu’on pourroit appeller
claifiques dans ce même fens. Ibid. b. — Sur les auteurs
claftiques, voyez A uteur.
C lassiques , auteurs ( Art de la parole ) ceux qui peuvent
Jervir de modele par la beauté & l’excellence du ftyle: On
■ne doit les chercher que chez les nations où la raifon eft
parvenue à un haut degré de culture, où la vie fociale 8c
le commerce des hommes ont porté l’entendement 8c le
bon gout .fort au-deitus des fens groffiers. Chez un peuple
dont la raifon n’eft pas encore cultivée au plus haut point,
le meilleur auteur qui s’y,formera, fera applaudi parmi fes
.contemporains, & cependant ne fera jamais' auteur daifique.
M. 463. b La fimple culture de l’entendement, qui ne s’attache
qu’aux abftraâions 8c à l’analyfe des idées, ne forme
point -d’auteur daifique. L’entendement daifique n’analyfè
point les diverfes parties d’un objet ; il fait l'énoncer dans
toute fon étendue avec énergie 8c fimplicité:ce font plutôt
des obfervations fines qui fuppofent un coup-d’oeil perçant,
que des raifonnemens exaâs, fondés fur le développement
«les idées. — Comment s’acquiert l’efprit d’obfervation, cette
.première qualité d’un auteur daifique. Pourquoi en tout
pays le nombre des poètes claifiques l’a emporté fur celui
des bons profateurs. Ibid. 454. a.
CLAUDE,. ( Jean) obfervations fur la- vie 8c les ouvrages
de ce théologien. XIV. 383. A
C laude , terre de faint- ( Géogr.) en Bourgogne. Suppl. lü.
677. A Suppl. IV. 697. x , A
CLAUDEBERGE , l’iin ' des premiers fe&ateurs de Def-
cartes. XV. . 326. A
CLAUDIA, .loi. IX. 656. x.
C l a u d ia , (Hifl. rom.) -Veftale qui fût accufée d’avoir
laiffé éteindre le feu facre. Miracle par lequel elle manifefta
fon innocence. III. 4Î4- u-
C l a u d ia , foeur de Claudius Pulcher. Peine que lui attira
ion orgueil. 111. 434. a.
CLAUDICATION \ ( Médec. Chir. ) Diverfes caufes de
cette maladie : claudication de naiffance : caufes accidentelles.
III. 308. x. Remede à la claudication oui vient de ce
que la jambe, par la feule contraftion ou roidiffement de fes
m úfeles, s’eft retirée. Remede à celle qui vient de foiblofie
des hanchcS dans les enfàns. Mot d’une femme Lacédémor
nienne à fon fils, devenu boiteux à la guerre. Ibid. A
CLAUDIEN, poëte, fa patrie. Suppl. IL 214. x.
CLAUDIUS-NERON , (Hifl. rom. ) fils de Drufus &
de Livie. Hiftoirc de la vie 8c du regne de cet empereur.
Suppl. II. 434. A , _ _
C laudius-Néron, empereur: lieu de fi» naiffance : fon
caraftere. IX. 777. b. Mufée qu’il conftruifit dans Alexandrie»
X. 894. x. Combat donné fur l’eau pendant fon regne. XI.
60. b. Caufe de fa mort. X . 713. A Lieu où il mourut. XV.
. C laudius ,M. Aurelias {Hifl. rom.) fumommé le Gothique,
fécond du nom, parvint a l’empire après la mort de
Gallien. Principaux événemens de fon regne. Suppl. II. 436. x.
C laudius II. fumommé le Gothique., empereur, confulte
les forts de Virgile. XV. 378. b. , , r .
C laudius Pulcher, ne doit fa célébrité quà fes défaites
8c à fon mépris pour la religion dominante. Principaux traits
qui le caraftérifenr. Sap/’A IL 45^. A ’
C laudius , Publius, eut l’orgueil 8c l’envie de fes ancêtres,
fans avoir aucune de leurs vertus. Evénemens qui le;
démontrent. Suppl. II. 456.-A ■ ,
C laud ius , (Publius) amoureux de Pompeia, femme de
Céfar: iL profane les myfteres de 'Cérès. X. 923. A
C laud ius , (Appius) fils d’AppiusClaudius Ccccus,attaqué
dans fon triomphe par un tribun , 8c protégé par a
¿lie qui étoit Veftale. XvII. 213. A '
C laudius, (Appius) décemvir qui fe rendit h -
ment célebre par fa paifion pour Virginie. Sa mor . upp.
^ c i t v a im ^ e r o . miSoX -, vifloire qu’il remporta fui
S Ä Ä bible hébraïque. II. 224. u
r r A V H I IM n t o Vpierre en forme île coin qui fere
0WirVaT r
C L A
fo r les oriiemens dont on d écore cette partie du bâtiment.
*^ri*AVEÂU, (Art vétérin.) maladie de brebis. Symptô-
& uroerès de cette maladie. Siege dans le corps de
y 1 nhnal Eue a beaucoup de rapport à la petite vérole qui
reane parmi les hommes. III. 509. a.
CLAVECIN,(Luth.) infirument de melodle & dharmonie
&c Détails pour la conftruâion d’jin clavecin. III.
* air j sto. a , b. Table des numéros des cordes,& dunom-
tre qu’on doit mettre de chacune, en commençant par les
ïafies & «n montant félon ia fuite des fautereaux. De la
tablature de cet infirument. L’tti du milieu doit être 4 iu-
niffon d’utl tuyau de preftant de deux piés, ouvert, 6rc. Clé
pour tourner les chevilles. Ibid. 511. b.
Clavecin, inventeur de cet infirument. XVI. Ç7. a. Imper-
feâion des premiers clavecins. Suppl. II. 820. b. RegiWres
de clavecin. XIV. rp. b. Sommier. XV. 336. b. Doubles
claviers du clavecin. III. s 13. b. Forte-piano, eppeilé pantalon.
SuppL IV. 231. a. Clayecin de M. Berger, dont les
fons pouvoient être renforcés. Ibid. II. 631. x. 821. b. Ctet
1 ou accordoir ppur tourner les chevilles. I. 80. A IIL 310. b.
Principes fur la maniéré d’accorder cet inftrument. XVI. ^7.
. f. v t t t _ Ty . t —_. . . /11, Ia fI t r f r s H ii —I-------
gement. 701.------ ----------- » ' j
les planches de lutherie. Table du rapport de 1 étendue des
voix & des inftrumens de mufiaue , comparés au clavecin,
vol. V des planches, Lutherie, pl. 22.
Clavecin a roue, defcription de cet inftrument. Suppl. II.
437. a. Défaut qui lui eft propre. Ibid. A
Clavecin brife; clavecin vertical, Suppl. II. 437. A
Clavecin oculaire, définition. III. 311. x. Defcription de
cette machine. Principes fur lefquels'elle eft conftruite. Effets
du jeu de ce clavecin. La feule différence importante entre
le clavecin auriculaire & celui-ci ^vient de ce que, dans le
premier, l’oreille n’apperçoit point de difeominuité dans les
fons, au fieu que les couleurs paroiffent diftantes 8c disjointes
à la vue. Ibid. A II paroit impoffible encore qu’on eût
la mémoire d’un air de couleurs, comme on a celle d’un air
de fons. Comment les couleurs d’un clavecin oculaire devraient
être placées. Inventeurs de cette machine. Ibid. 312. x.
CLAVETjTE, (An méchan. ) définition. Différentes formes
de clavettes. Clavettes des tourneurs en fer. III. 312. x.
CLAVICORDE, (Luth.) voyez Ç laricorde. Origine
de cet inftrument. Défaut qui lui eft attaché. Son ufage, préférable
pour les commencemens à celui du clavecin. Suppl.
IL 437. A
CLAVICULE, ( Anat.) nom de deux os fitués à la bafe
du cou 8c au haut de la poitrine. Leur defcription. Pourquoi
ces os font appellés de ce nom. Leur ufage. III. 312. x. Différence
entre les clavicules des hommes 8c celles dès femmes.
Toutes fortes d’animaux n’ont pas des clavicules. Leur ufage.
Elles font fujettes à fe fraélurer : difficulté de les réduire1
parfaitement. De leurs luxations : la cure en «jft d’autant plus
difficile, qu’on différé la réduôion. Ibid. A
C la vicule, (Chirurg. ) nouveau moyen de favorifer la
curation des maladies de la clavicule, lorfqu’elles font compliquées
de fraéhire 8c de luxation. Etat de fouffrance où fe
trouvent certains mufdes, lorfque la clavicule eft caffée ou
défarticulée. Accidens qui en réfultent. Le point le plus em-
barraffant dans la curation de ces maladies, eft de maintenir
les parties réduites dans leur fituation naturelle pour en obtenir
le plus convenablement la réunion. Moyen propofé pour
remplir cet objet. Suppl. II. 438. x. Avantages de cette méthode.
Ibid. b.
Clavicule, bandage pour la frafture du bout externe de la
clavicule. XV. 461. A
CLAVIER, (Luth.) partie de l’orgue, &c. Inftruftion fur
la maniéré de faire le clavier de l’orgpe. 111. 312. A Comment
le clavier du grand orgue fe tire fur le premier clavier dans
celles où il y a un pofitifi, Figure qui montre la pofition des
trois clés, 8c quelles notés répondent aux touches du clavier.
Figure qui repréfente un clavier àgrand ravalement. Ibid. 313 .b.
Doubles claviers des clavecins. Defcription 8c ufage. III.
513C*l abv’ i-er, ce qu’on appelle en raufique clavier général. IIL
'316. A Clavier de l'orgue. XI. 636. a. Clavier de pédale. XII,
233. x. Clavier à ravalement. Suppl. IV. 377. A Clavier de
carrillon. IL 683. A Chaiîis de clavier. III. 232. A Guide de
clavier. VII. 1003. x. Arrangement du clavier, vol. VII des
planches, Mufique-, pl. 12.
Cla vier, (Mufiq.) portée générale , ou fomme des fons
de tout le fyftême qui refulte de la pofition relative de trois
clés. Supgl. II. 438. A Les notes ou touches diatoniques du
clav'iCT s expriment par des lettres de l’alphabet. Chaque oôave
du clavier comprend tfeize tons, fept diatoniques 8c cinq
chromatiques, repréfentés fur le clavier inftrumeatal par
autant de touches. Ibid. 439. x.
c la v ie r -, €n tcrme d’éoinelii
Tome I. e
n terme d’épingfier, l ü . 313. A
C L E 3*9
CLA.VIUS , (Chriflophc) jefuite. Attention dont il étoit
cap&ble. i. 042. b.
CLAUSE , (Jurifpr.) partie d’«n afte, foit public , foit
privé, qui Contient quelque difpofition particulière. III. 313.
A Etymologie du mot. 11 y a plus ou moins de claùfes dan»
les aâes. Il y en a de fôns-cntendues : il y en a qui font de
ftyle-, mais non pas de droit. Comment s’explique une claufe
obfcure. Claufes ufitées dans les bulles 8c lignatures de cour
de Rome. Ibid. 314. x.
Claufe , voyez A ccord , C ontra* , C onvention ,
Ob l ig at io n , Pact e , Stipu la t io n . Claufes pénales dans
les aâes. 111. 701. x. Claufes de condition , 836. A de •ftyle»
XV. 336. A Claufes commiftbires. XVIL 791. A
Claufe codicillaire, dans les teftamens. Définition. Origine
de cette claufe. Elle n’eft d’ufage que dans les pays de droit
écrit. On fuppléoit quelquefois cette claufe chez les Romains.
Effets de cette claufe * lorfque le teftament eft revêtu de
fes formalités. Cette claufe ne peut valider un teftament qui
eft mil. Auteurs où il eft parlé de la claufe codicillaire. Ce
que porte fur ce fujet la nouvelle ordonnance des teftamens.
III. 314. x.
Claufe dérogatoire. Ce terme étoit ufité principalement en
ipatiere de teftament. Auteurs 8c ordonnance où il en eft
.parlé. III. 314. A
Claufe irritante. III. 314. A
Claufe pénale. Ces claufes ne font que Comminatoires quand
elles font iAférées dans des conventions. Dans les difpoutions
de derqiere volonté, ces claufes ajoutées aux ‘libéralités ,
doivent être exécutées à la rigueur. 111.514.*.
Claufe réfolutoire. Ces clauies peuvent s’appliquer à différentes
conventions. Comment on les met à effet. Elles ne fe
prennent point à la rigueur. III. 314. A
Claufe des fix mois. UI. 314. A
CLAUSSÉN , ( Laurent ) anatomifte. Suppl. L 413. A
CLAUSTRAL, ( Jurifpr..) prieur clauftral. Offices claustraux
; ils ont été la plupart fupprimés dans les maifons où fort
a introduit la réforme. Quels étoient les offices clauftraux de
l’abbaye de S. Denis en France. 111. 313. x.
CLAVUS , ( Médec. ) douleur lancinante à la tète. Oh
regarde cette maladie comme une efpece de fievre intermittente.
Comment on la guérit. Ce que Sydenham appelle clavus
hyftcricus. III. 313. x.
Clavvs , ce qu’on entendoit par là dans l ’habillement des
Romains. III. 315. a.
CLAZOMLNIENS. Sentence des éphores de LacédémonC
contr’eux. V. 773. a. XVU. 634. a.
CLÉ, ( Serrur. ) defcription de cet inftrument. Opérations
néceffaires pour taire une clé. Diverfes fortes de clés. III.
313. A Divers ufages métaphoriques du mot clé. Ibid. 316. x.
Clé. Des différent^ efpeces de clés, & de la maniéré de les
travailler. XVII. 821. x , AForureà l’extrémité d’une clé. VII.
207. a-, b. Voyez les planch. de ferrurerie dans le Vol. IX.
planch. 20. — 23.
Clé. Divination par le moyen -des clés. ITT. 3 20. x.
C l é , ( dans un fens moral & théoloe. ;j -marque de puiffitncc ,
I f aïe, XXII. 22. de prééminence, a intelligence. IIL 316. x.
Clé. Pouvoir des clés. Examen de celui que les papes
s’attribuent fur le temporel des rais. XVI. 90. b, 8cc. Voyez
; auffi Po u vo ir .
C lé , (Mufiq.) anciennement on appellôit clés, les lettres
par lefquelles on défignoit les fons de la gamme De ces
fept lettres, on en a choifi trois | qu’on a nommèes c/eV marquées
, dont on Îe contente d’en marquer une au commencement
des lignes. Rapports de la figure de nos dlés avec la
lettre qu’elle repréfente. Quelles' lonr nos trais clés & leur
pofition. 111. 316. x. Le fyftême total des notes qu’on peut
placer fur les degrés déterminés par ces clés , fe monte à
vingt-quatre ; ce qu’on appelle clavier général. Signification
du mot portée. Ufage de la clé. Retranchement d’une clé
lorfqu’on en trouve deux. De quelque manière qu’on prenne
cinq lignes de fuite dans le davie'r , on y trouve une clé
comprife , & quelquefois deux. La iùcceffion des clés du
grave à l’aigu, fait en tout huit portées, Grc. De quelque
caraétere que puiffe être une voix ou un mftrumcnt, on peut
lui trouver, dans le clavier général , une portée 8c une clé
convenable. Ibid. A Moyen d’élever ou d’abatiTer la portéff
par le changement de la dé. Moyen de rapporter une clé à
l’autre. Figure qui montre par la fuite des clés , la fuite des
notes montant ae tierce en tierce , toutes placées fur la troi-
fieme ligne. Autre figure repréfehtant différentes pofitions dé
la note ut. Pofitions qui paroiffent s’abolir de jour en \oxu.Ibid.
327. m
Clé. Ufage des fignes que nos andens mufidens ajoutoieht
à la clé. XVI. 121; x ; A Ce cju’on entend par armer la clé,
Suppl I. 361. a. Pofition des diefes à la clé. IV. 972. a. Celle
des b mois. II. 2. A Voyez C lef.
Clé tranfpofée. La néceffité des tranfpofitions naît de là
fimilitude des modes dans tous les tems. Douze combinai-
fons auxquelles fé bornent toutes les variétés poffibles des
O O 0 0