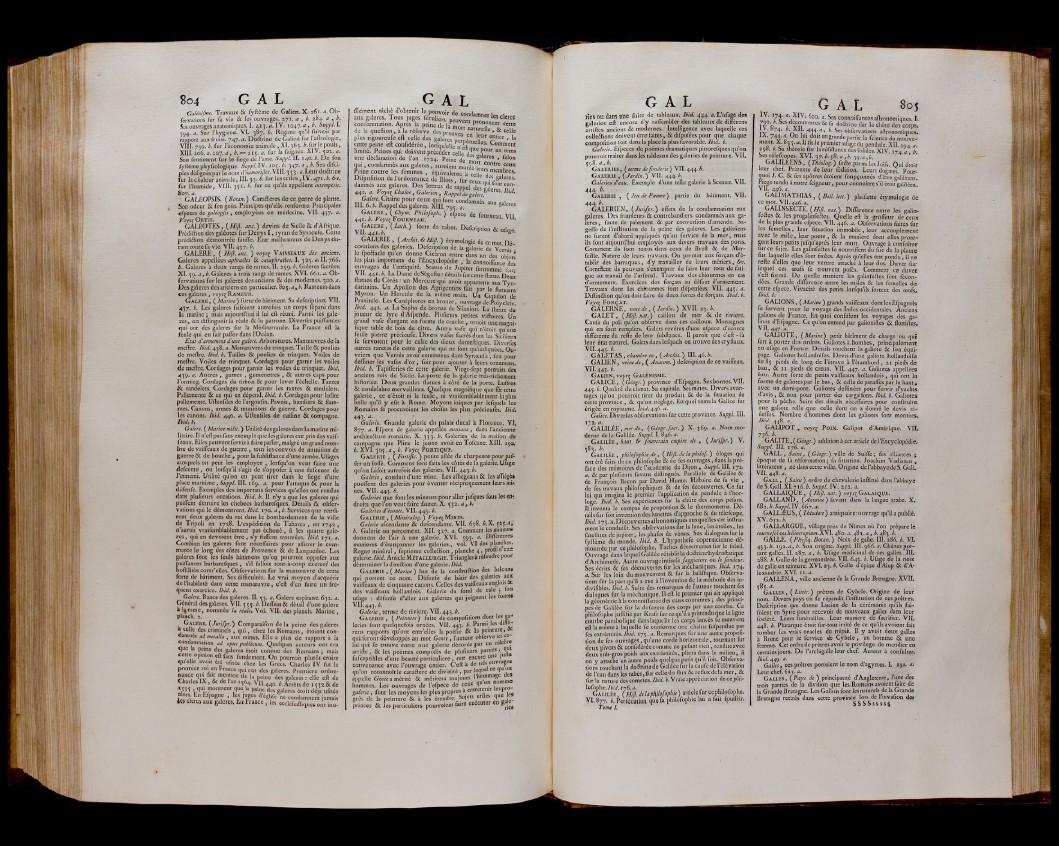
8o 4 G A L
Galénifme. Travaux 8c fyftêmc de Galien. X. a6 1 . a. Ob-
fervaiions fur fa vie & fcs ouvrages. 1 7 1 . a , b. 484. a ,
5 c s ouvrages anatomiques. I. 4x3.0. IV . 10 4 7 .* , b. Suppl. I.
394. 4. Sur l'hygiene. V I. 387. b. Régime qu’il fuivoit par
rapport aux fruits. 747. a. Doélrinc de Galien fur l’aftrologic,
VIII. 730. b. fur l’économie animale, XI. 363. b. fur le pouls,
XIII. 206.a. 207. a , b. — 2i<j. a. fur la faignéc. XIV. 302. <1.
Son fencimcnt fur le fiege de l’amc. Suppl. II. 140. b. D e fon
iyftême phyfiologique. Suppl. IV. 1 o y b. 347. a , é. Ses difei-
plcs délignes par le nom iVnumorifles.v \\\. 3 53* ^-Leur doctrine
fur la chaleur animale, III. 33' b. fw les crifes, IV. 471. b. &.e.
fur l’humide, VIII. 351. é. fur ce qu’ils appellent intempérie.
Î07. à. _
G A L E O P S IS . (B o ta n .) Caraélcrcs de ce genre de plante.
Son odeur & fon goût. Principes qu’elle renferme. Principales
efpeccs de galéopjts, employées en médecine. VII. 437. a.
Voyex O rtie.
G A LÉO T E S , ( H iß . anc. ) devins de Sicile & d’Afrique.
Prédiétion des galéotes fur Denys I , tyran de Syracufc. Cette
prédiàion démontrée faillie. Etat malheureux de Denys durant
toute fa vie. V II. 437. b.
G A L E R E , ( H iß . anc. ) voyrç VAISSEAUX des anciens.
Galères appellécs aphrafles 8c cataphrafles. 1. 525. <2; I I .766.
b. Galères à deux rangs de rames. II. 239. b. Galères facrécs.
XI. 39. a , b. Galeres à trois rangs de rames. X V L 66x. a. Ob-
fervations fur les galères des anciens 8c des modernes. 300.«.
Des galères des anciens en particulier; 805. a ,b . Rameurs dans
ces galères, voye{ R ameur.
G alere , ( Marine ) forte de bâtiment. Sa defeription. VII.
437. b. Les galères faifoient autrefois un corps léparé dans
la marine ; mais aujourd’hui il lui eft réuni. Parmi les galeres,
on diftinguoit la réale & la patrone. Divcrfes puilfanccs
qui ont des galères fur la Méditerranée. La France .elt la
iculc qui en fait palier dans l’Océan.
Eta t d ‘armement d'une galere. Arboraturcs. Manoeuvres de la
mettre. Ibid. 438. a. Manoeuvres du trinquet. Taille & poulies
de mettre. Ibid. b. Tailles & poulies de trinquet. Voiles de
mettre. Voiles de trinquet. Cordages pour garnir les voiles
de mettre. Cordages pour garnir les voiles de trinquet. Ibid.
439. a. Ancres , gumes , gumenettes , & autres caps pour
l ’ormicg. Cordages du tiihon 8c pour lever l’échelle. Tantes
& tandelcts. Cordages pour garnir les tantes & tandelcts.
Pallementc & ce qui en dépend. Ibid. b. Cordages pour ladite
pallcmentc. Uftcnfilcs de l’argoufm. Pavois, bandiers & flammes.
Canons, armes & munitions de guerre. Cordages pour
les canons. Ibid. 440. a. Uttcnfiles de cuifine 8c compagne.
Ib id. b.
Galere. ( Marine milit. ) Utilité des galères dans la marine militaire.
Il n’ettpas fans exemple que lcsgdlcres ont pris des vaif-
feaux. Elles peuvent fervir à fairepatter, malgré un grand nombre
de vaitteaux de guerre , tous les convois de munition de
guerre 8c de bouche, pour la fubfiilance d’une armée.Ufages
auxquels on peut les employer , lorfqu’on veut faire une
defeente , ou lorfqu’il s’agit de s’oppoier à une defeente de
l ’ennemi. Utilité qu’on en peut tirer dans le fiege d’une
place maritime, Suppl. 111.16 9 . a. pour l’attaque oc pour la
défenfe. Exemples des importans fcrviccs qu’elles ont rendus
dans plufxeurs occafions. Ibid. b. 11 n’y a que les galères qui
puifient détruire les chcbecs barbarefqucs. Détails 8c obier-
vations qui le démontrent. Ibid. 170. <7, b. Services que rendirent
deux galeres du roi dans le bombardement de la ville
de Tripoli en 1728. L'expédition de Tab a rca , en 1 7 4 2 ,
n’auroit vraifemblablement pas échoué, fi les quatre galères
, qui en dévoient ê t re , s y fufient trouvées, lbid. \n\ . a.
Combien les galeres font necefiaires pour afiiirer le commerce
le long des côtes de Provence 8c de Languedoc. Les
galeres fönt Tes feuls bâtimens qu’oq pourroit oppofer aux
puifiances barbarefques, s’il falloit tout-à-coup exercer des
nottilités contr’elles. Obfervations fur la manoeuvre de cette
forte de bâtiment. Ses difficultés. Le vrai moyen d’acquérir
de l’habileté dans cette manoeuvre, c’efl d’en faire un fréquent
exercice, lbid. b.
Galere. Bancs des galeres. 11. 53. a. Galere capitane. 632. a.
Général des galeres. V i l . «^.¿.DefleinÔc détail d’une galere
à lgramc, nommée la reale. Vo l. VII. des planch. Marine,
planch. 2.
, G alere. (Ju r ifpr .) Comparaifon de là peine des galeres
» celle des criminels, q u i, chez les Romains, étoient condamnés
ad metalla, aux mines. Elle a plus de rapport à la
condamnation ad opus publicum. Quelques auteurs ont cru
que u peme des galeres étoit connue des Romains ; mais
cette opinion eft fans fondement. On pourroit plutôt croire p i av°lt M "fitte chK les Greis. Charles IV fût le
premier roien France qui eut des galeres. Premiere ordon-
¡rance mi. fa,t mention de la peine6 de» galeres: elle eft de
Charles IX , & de lan 1,64. V il. ¿.Arrêts de t r t a & d e
. qu. montrent que la p.i„ c des galeres étoic dija tifitie
¿ s eWr". Pa8T ’ *CS clercs aux galeres. %Eu ’ TI ra'n ce , le, ncec ccloéniidaaftmlqnueen, to jiaimt ianius -
G A L
condamnation. Après la peine de la mort cett0
de la queftion, i la réferve des preuves Üf u ' celle
plus rigoureufe eft celle des galeres perni J iw r '" ‘° r ’ la
cette peine eft confidéréc, lorfqu’clle n’Jff Comment
limité. Peines qui doivent précéder celle- »liS*6 *î°Ur un tems
une déclaration de l’an 1724. Peine de m S * ^ on
q u i, condamnés aux galeres, auroient ?cu x
Peine contre les femmes , équivalente à c c l l Æ ? , ^ '
Difpofition de 1 ordonnance de ¿ lo is , fur ceuv r 8 cs*
damnés aux galeres. Des lettres de ranncl de«ï i î ° n"
44 .. u. r o y \ C ha in .. GaUri'n,
Gn/rre. Chaîne pour ceux qui font condamnés a .„
III. 6. b. Rappel des galeres. XIII. 795. à. “ aux Sal« «
G a l e r e , (C hym . Philofoph. ) efpecc de fourneau. VII
441. b. Voye[ Fourn eau . v u *
V I L 44EiKi .’ § rab0t- D e fo ‘P>ion &ufage.
GALERIE , ( A rd in & Hijl. ) étymologie de ce mot Decorai,
ons des galeries. Defeription de la galerie de Vcrrés •
c fpcctacle qu’en donne Cicéron entre dans un des oli®«
les plus importans, de l’Encyclopédie , la connoiflknce des
ouvrages de 1 antiquité. Statue de Jupiter furnommi t , ,,.
VII. 441. A La Diane deSégefte: détails furccttcftatue. Deux
ftatucs de Cérés : un Mercure qui avoit appartenu auxTyn-
daritams. Un Apollon des Agrigcntins fait par le ftatuaire
Myron. Un Hercule de la même main. Un Cupidon de
Praxitèle. Les Canéphorcs en bronze, ouvrage de Polyclcte.
lbid. 442. a. La Sapho de bronze de Silanion. La ftatue du
joueur de lyre d’Afpcnde. Plufieurs petites viéloircs. Un
grand vafe d’argent en forme de cruche, ornoit une magni-
tique table de bois de cjtre. Autre vafe qui n’étoit’ qu’une
feule pierre précieufe. Divers vafes facrés dont les Sicilien*
fe fervoient pour le culte des dieux domettiques. Divcrfes
autres raretés de cette galerie qui ne font qu’indiquées. Ouvriers
que Vcrrés avoit entretenus dans Syracufe , foit pour
defiiner les vafes d’o r , foit pour ajouter à leurs ornemens.
lbid. b. Tapifieries de cette galerie. Vinet-fept portraits des
anciens rois de Sicile. La porte de la galerie tres-richemcnt
hiftoriée. Deux grandes ftatues à côté de la porte. Luttres
8c candélabre merveilleux. Quelque magnifique que fût cette
galerie, ce n’étoit ni la feule, m vraifemblablement laplu9
belle qu’il y eût à Rome. Moyens iniques par lefquels les
Romains fe procuraient les chofcs les plus précicufes. Ibidt
454:3 - W m & *
Galerie. Grande galerie du palais ducal à Florence. V I j
877. a. Efpecc de galerie appelléc mentane, dans l’ancienne
architecture romaine. X. 333. b. Galeries de la maifon de
campagne que Pline le jeune avoit en Tofcane. XIII. xço,’
b. X V L 305. a , b. Voyer PORTIQUE.
G alerie , ( F o r tifie .j petite allée de charpente pourpaf-
fer un folTé. Comment font faits les côtés de la galerie. Ulage
qu’on faifoit autrefois des galeries. VII. 443. b.
Galerie, conduit d’une mine. Les afiiégeans 8c les afiiégés
pouffent des galeries pour éventer réciproquement leurs mft
ncs. V II. 443. b.
Galeries que font les mineurs pour aller jufques fous les en*
droits que 1 on veut faire fauter.X. 53 2. a , b.
Galeries d ‘¿coûte. VII. 443« b.
G a l e r ie , (Minlra log.) FoyrçMines.
Galerie afeendante 8c defeendante. VII. 638. b. X.
b. Galerie ou percement. XII. 327. <z. Comment les mineur«
donnent de l*air à une galerie. A V I . 593- a- Différentes
maniérés d’étançonner les galeries, vol. VI des Pj*”0,
Rcgne minéral, fepticmc colleétion, planche 4 , Proj " “ une
galerie. lbid. Article Métallurgie. Triangles à réfoudre pour
déterminer la direétion d’une galerie. lbid.
G a ler ie , ( Maritte) but de la conftruflion des balcons
qui portent ce nom. Défenfe de bâtir des galeries aux
vaifieaux de cinquante canons. Celles des vaitteaux anglois oc
des vaitteaux hollandois. Galerie du fond de cale | *on
ufage : défenfe d’aller aux galeries qui joignent les fontes
V IL 443 .b .
Galerie, terme de riviere. VII. 443. b.
G a l e r ie , (P ein tu re ) fuite de compofitions dont les ga
lerics font quelquefois ornées. VII. 443. b. Parmi les dinè-
rens rapports qu’ont entr’elles la poéfie 8c la peinture, oc
qui feront développés au mot Genre, l’auteur obfcrve ici j*®'
lui qui fe trouve entre une galerie décorée par un c é l e .
¡fie, 8c les poëmes compofés de plufieurs parues * Q ^
centiblcs d’une heanrê narticuliere . ont encore une J
convenance avec l’ouvrage entier. C ’eft à de tel» ‘>uvraf e'
qu’on reconnoltlecaraélere de divinité, par leque q
appelle Génie a mérité 8c méritera toujours 1 Â mmo
hommes. Les ouvrages de l’cfpece de ceux
galerie y font les moyens les plus propres à entre c 1 p
grés de la p e in t u r e ^ à Ici ¿tendre. Sujets ut, es que le*
princes 8c les particuliers pourraient fore exécuter n
G A L
TÎes ou dans Une fuite de tableaux. lbid. 444. à. L ’ufage des
galeries eft encore d’y rattembler des tableaux de dinérens
artiftes anciens 8c modernes. Intelligence avec laquelle ces
colleâions doivent être faites, 8c difpofées pour que chaque
compofition foit dans la place la olus favorable. lbid. b.
Galerie. Efpeccs de poëmes dramatiques pittorefqucs qu’on
pourroit traiter dans les tableaux des galeries de peinture. VII.
¡c jîl.a y b . . „ V : ;
G aleries , ( terme de fonderie ) VII. 444. b.
G alerie , ( Jardin. ) VII. 444. b.
Galeries d ’eau. Exemple d’une telle galerie à Sceaux. VII.
444- b.
Ga l e r ie , (J e u de Paume) partie du bâtiment. VII.
-444. b.
GALERIEN, (Ju r ifpr .) effets de la condamnation aux
galeres. Des fraudeurs 8c contrebandiers condamnés aux galè
re s, faute de paiement 8c par convcrfion d’amende. Sa-
gette de l’inftitution de la peine des galeres. Les galériens
ne furent d’abord 'appliqués qu’au fcrvice de la mer, mais
ils font aujourd’hui employés aux divers travaux des ports.
Comment ils font tenus dans ceux de Brcft 8ç de Mar-
fcillc. Nature de leurs travaux. On permet aux forçats d’établir
des barraques, d’y travailler de leurs métiers, 6rc.
Comittcnt ils peuvent s’exempter de faire leur tour de fatigue
au travail de l’arfenal. Travaux des chiourmes en cas
d’armement. Exercices des forçats au défaut d’armement.
Travaux dont les chiourmes font difpenfécs. VII. 447. a.
Diftinélion qu’on doit faire de deux fortes de forçats. lbid. b.
Voyez Fo r ç a t .
G A LERN E , vent de , (Jardin. ) XVII. 23. b.
G A L E T , (H i j l .n a t .) caillou de mer 8c de rivière.
Caufc du poli qu’on obfervc dans ces cailloux. Montagnes
qui en font remplies. Galets revêtus d’une efpecc d’écorcc
différente du refte de leur fubftancc. Il paraît que c’cft - là
leur état naturel. Galets dans lefquels on trouve des cryftaux.
V II. 44«. b.
G A L E T A S , chambre en , ( Ar chit.) III. 46. b.
G A LIEN , veine d e , ( Anatom. ) defeription de ce vaiflean.
V II. 445. b.
G alien, voye^ G alénisme.
G A L IC E , (Géo er .) province d’Efpagnc. Scs bornes. VII.
44<j. b. Qualité du climat. Sa capitale. Ses mines. Divers avantages
qu’on pourroit tirer du produit 8c de la fituation de
cette province , 8c qu’on néglige. En quel tems la Galice fut
érigée en royaume, lbid. 446. a.
Galice. Divcrfes obfervations fur cette province. Suppl. III.
17». a.
G ALILÉ E, merde, (Gèogr .facr .) X. 369. a. Nom moderne
de la Galilée. Suppl. I. 846. a.
G alilée , haut 6* fouverain empire de , (Ju r ifpr .) V .
383. b. ' ■
G alilée , philofophie d e , (H i j l .d e la p h ilo f.) éloges qui
ont été faits de ce philofophc 8c de fes ouvrages, dans la préface
des mémoires de l’académie de Dijon , Suppl. III. 172.
a. 8c par plufieurs favans diftingués. Parallèle de Galilée 8c
de François Bacon par David Hume. Hiftoire de fa vie ,
de fes travaux philosophiques 8c de fes découvertes. Ce fut
lui qui imagina le premier l’application du pendule à l’horloge.
lbid. b. Ses expériences fur la chûtc des corps pefans.
Il inventa le compas de proportion 8c le thermomètre. Détails
fur fon invention des lunettes d’approche 8c du télefeope.
lbid. 1 7 3 .VX. Découvertes aftronomiques auxquelles cet infiniment
le conduifit. Scs obfervations fur la lune, les étoiles, les
fatellitcs de jupiter, lesphafes de vénus. Ses dialogues fur le
fyftême du monde. lbid. b. LTiypothefe copcrnicienne démontrée
par ce philofophe. Taches découvertes fur le foleil.
Ouvrage dans lequel Galilée rétablit la doftHnc-hydroftatique
d’Archimcde. Autre ouvrage intitulé faggiatore ou le fondeur.
Ses écrits 8c fcs découvertes fur les mèchaniques. Ibtd. 174.
a. Sur les loix du mouvement 8c fur la baliftique. Obferva-
tions fur la part qu’il à eue à l’invention de la méthode des in-
divifiblcs U U . i. Suite (les remarques de l’auteur touchant fcs
dialogues fur la méchanique. Il eft le premier qui ait appuque
la géométrie à la connoittancc des eaux courantes j des principes
de Galilée fur la defeente des corps par une courbe. Ce
philofophe juttifié par Kraft fur ce qu’il a prétendu que la ligne
courbe parabolique dans laquelle les corps lancés fe meuvent
eft la même à laquelle fe conforme une chaîne fufpendue par
fes extrémités. lbid. 175. a. Remarques fur une autre propofi-
tion de fcs ouvrages, qu’une corde horizontale, tournant fur
deux pivots & confidéréc comme ne pcfant rien, tendue avec
deux très-gros poids aux extrémités, pliera dans le milieu, fi
on y attache un autre poids quclquepctit qu’il foit. Obfervations
touchant la doilnne de Galilée fur la caufc de 1 élévation
de l’eau dans les tubes, fur celle du flux 8c reflux de la mer, 8c
fur la nature des cometes. lbid. b. Vraie appréciation de ce philofophc.
lbid a j6 .a . . . . ... ■
G alilée , ( Hi(l. de la philofophie) article fur ce nhilofophc.
VI. 877. b. Pcrfécution que la philofophie lui a fait fouffrir.
Tome I,
G A L 8oj
a. Scs connoilTaticcs aftronètmqucs. L
* v ît “™ ’“ & f a r i n e fur la cltfim des corps,
. 74. ^ AU. 444. a , b. Ses obfervations agronomiques.
IA. 744. a. On lui doit en grande partie la fciencc du mouve-
ment. X. 83 3. a. Il fit le premier ufage du pendule. XII. 294. a
298. b. Sa théorie fur la réfiftancc des folides. XIV 174 a b
Ses télefeopes. XV I. 37. b. 38, a ,b . 39.4 ,b . ’
GALILEENS, ( Thiolog. ) fefte parmi les juifs. Qui étoit
leur chef. Prétexte de leur fédition. Leurs dogmes. Pourquoi
J. C. 8c fes apôtres étoient foupçonnés d’être galiléens.
Piege tendu à notre feigneur, pour connoître s’il étoit galilécn.
VII. 446. a.
GALIMATHIAS , ( Bell. lett. ) plaifitntc étymologie dû
ce mot. VII. 446. a.
r Jp^ y^ ^ E C TE . (H ijl. nat.) Différence entre les galin-
fectcs 8c les progalinfecles. Quelle eft la grofteur de ceux
de la plus grande cfpcce. V il. 446. a. Obfervations faites fur
les femelles, leur fituation immobile, leur accouplement
avec le mâle, leur ponte, 8c la manière dont elles protègent
leurs petits jufqu’aprês leur mort. Ouvrage à confulter
fur ce fujet. Les galinfeéles fe nourriflent dii fuc de la plante
H laquelle elles font fixées. Après qu’elles ont pondu, il ne
refte {Pelles que leur ventre attaché à leur dos. Duvet fur
lequel ces oeufs fe trouvent pofés. Comment ce duvet
s’eft formé. De quelle manière les galinfeéles font fécondées.
Grande dittércnce entre les mâles & les femelles de
cette efpecc. Vivacité des petits lorfqu’ils fortent des oeufs,
lbid. b.
G A L ION S , ( Marine ) grands vaitteaux dont lcsEfpagnols
fe fervent pour le voyage des Indes occidentales. Anciens
galions de France. En quoi confident les voyages des galions
d’Efpagnc. Ce qu’on entend par galioniftcs 8c fiottiftes.'
VII. 447. a.
G A L IO T E , (Ma rine) petit bâtiment de charge ou que
fort à porter des ordres. Galiotcs à bombes, principalement
en ufaee en France. Détails touchant la galiotc 8c fon équipage.
Galiotcs hollandoifcs. Devis d’une galiotc hollandoife
de 83 pieds de long de l’étrave à l’étambord, 21 pieds dû
bau, & 11 pieds de creux. VII. 447. a. Galiotcs appellée9
bots. Autre forte de petits vaitteaux hollandois, qui ont la
forme de galiotespar le bas, 8c celle de pinattes par le haut,
avec un demi-pont. Galiotes deftinées pour fervir d’yachts
d’avis, 8c non pour porter des cargaifons. lbid. b. Galiotes
pour la pêche. Suite des détails néccttaircs pour conftruire
une galiotc telle que celle dont on a donné le devis ci-
dettus. Nombre d hommes dont les galiotes font montées.
lbid. 448. a.
G A L IP O T , voyc{ P o ix . Galipot d’Amérique. V IL
73} .
G A L I T E , ( Ge'ogr.) addition à c e t article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 176. a.
G A LL , Sa in t, (Geogr .) ville de Suitte; fes alliances ;
époque de fa réformation ; fa fituation. Joachim Vadianus 4
littérateur, né dans cette ville. Origine de l’abbaye de S. Gall.
VII. 448.4.
G all , (Sa in t ) ordre de chevalerie inftitué dans l’abbaye
de S. Gall. XI. 7 16.b. Suppl. IV. 2 j 2. a.
G A L LA IQ Ü E , ( Hijl. nat. ) voyc{ G alaiqu e .
G A L LAN D , (Anto ine) favant dans la langue arabe. X.
682. b. Suppl. IV. 667. a.
GALLÆUS, ( Théodore) antiquaire ¡ouvrage qu’il a publié.
X V . 6 j2.é.
GALLARGUE, village près de Nîmes où l’on prépare le
tournefolou héliotropium.Xv 1.480. a. 48 1 .4 , b .483.b .■
GALLE. ( Phyjiq. Botan. ) Noix de galle. III. 286. b. V L
433. b. 192.4, b. Son origine. Suppl. III. 066.a. Chênes portant
galles. II. 2 8 7 .4 , b. Ufage médicinal de ces galles. III.
288. é. Galle de la gerraandrée. V II. 643. b. Ufage de la noix
de galle en teinture. XVI. 23. b. Galle d’épine aAlcp 8c d’A lexandrie.
XVI. 11.4.
GALLENA, ville ancienne de la Grande Bretagne. XVIL
385*
G alles , ( Littér. ) prêtres de Cybele. Origine de leur
nom. Divers pays où le répandit l’inftitution de ces prêtres;
Defeription que donne Lucien de la cérémonie qu’ils faifoient
en Syrie pour recevoir de nouveaux galles dans leur
fociété. Leurs funérailles. Leur maniéré de facrifier. V IL
448. b. Plutarque étoit fur-tout irrité de ce qu’ils avoient fait
tomber les vrais oracles du trépié. Il y avoit deux galles
à Rome pour lé fervice de C yb e le , un homihc 8c une
femme. Cet ordrede prêtres avoit le privilège de mendier en
certains jours. De l’archigalle leur chef. Auteur à confulter.
lbid. 449> a.
Galles, ces prêtres portoient le nom d’agyrtes. L 192. ai
Leur chef. 613. a. ^ ■
G a l le s , ( Pays de ) principauté d’Angleterre, l’une des
trois parties de la divifion que les Romains avoient faite dêt
la Grande Bretagne. Les Gallois font les naturels de la Grande
Bretagne retirés dans cette province lors de l’invafion des
S S S S s s s s *