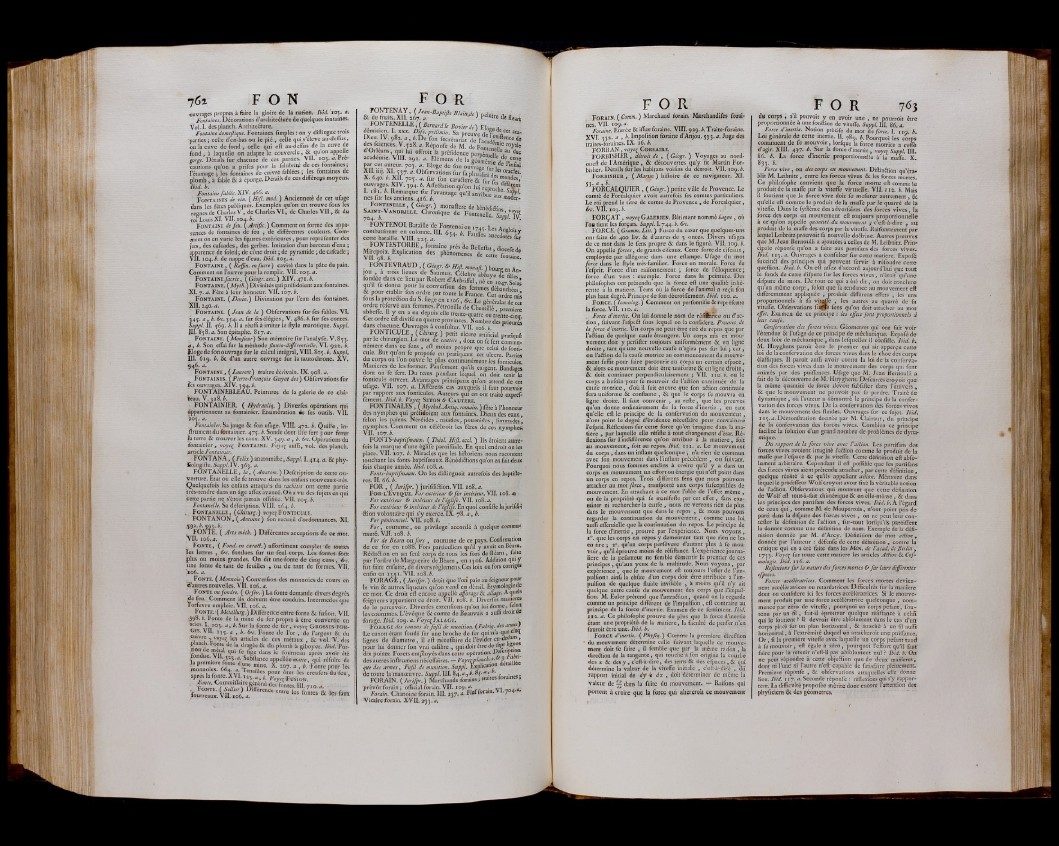
7 6 2 F O N
ouvrages propres à foire la gloire de la nation. Ib'td. 103. a.
Fontaines, Décorations d’architeâure de quelques fontaines.
Vol. I. des planch. A rchitcâure. .
Fontaine domeflique. Fontaines Amples : on y diftingue trois
parties ; celle d’en-bas ou le pié , celle qui s’eleve au-deffus,
ou la cuve de fond , celle qui eft âu-deffus de la cuve de
fon d, à laquelle on adapte le couvercle, & qu’on appelle
gorge. Détails fur chacune de ces parties. VII. 103.4. rré-
cautions qu’on a prifes pour la falubrité de ces fontaines;
l’étamage ; les fontaines de cuivre Tablées ; les fontaines de
plomb, à fable & j éponge. Dérails de ces différeys moyens.
îbid. b.
Fontaine fablée. XIV. 466. a. •
F on ta in e s de vin. ( Hijl. mod.) Ancienneté de cet ufage
dans les fêtes publiques. Exemples qu’on en trouve fous les
régnés de Chartes V , de Charles V I , de Charles V I I , & du
roi Louis XI. VII. 104. b.
F on ta in e de feu. (A r t ific .) Comment on forme des apparences
£
de fontaines de feu , dé différentes couleurs. Corn-
•ment on en varie les figures extérieures, pour repréfenter des
jets, des cafcades, des gerbes. Imitation d’un berceau d’eau ;
apparence de foleil; de cône droit ; de pyramide ; de cafcade ;
VII. 104. b. de nappe d’eau. Ibid. 103. a.
F o n ta in e , ( Raffin. en fucre) cavité dans la pâte du pain.
Comment on l’ouvre pour la remplir. VII. 105. a.
F o n ta in e facrée, ( Géogr. une.) XIV. 471. b.
F o n ta in e . ( MythJ) Divinités qui préfidoient aux fontaines.
XI. 7 . a. Fête à leur honneur. V il. 107. b.
F o n ta in e . ( Divin.) Divination par l’eau des fontaines.
XII. 240. a.
F on ta in e . ( Jean de l a ) Obfervations furfes fables. VI.
43. a , b. 6>c. 3 74. a. fur fes élégies, V . 486. b. fur fes contes.
Juppl. II. 769. b. Il a réufli à imiter le ftyle marotique. Suppl.
III. 878. a. Son épitaphe. 817. a.
. F o n ta in e . ( Monfuur) Son mémoire fur l’analyfe. V . 873.
a , b. Son effai fur la méthode fluxio-différentielle. VI. 922. b.
Èlogede fon ouvrage fur le calcul intégral, VIII. 807. b. Suppl.
III. 619. b. 8c d’un autre ouvrage fur la tautochrone. X V .
946. a.
F o n ta in e , ( Laurent) maître écrivain. IX. 908. a.
. F on ta in e s . ( Pierre-François Guyot des ) Obfervations fur
fes ouvrages. XIV. 394. é.
FONTAINEBLEAU. Peintures de la galerie de ce château.
V . 318. b.
FONTAINIER. ( Hydrauliq. ) Diverfes opérations qui
appartiennent au fontainier. Enumération de fes outils. VII.
207. a.
Fontainier. Sa jauge 8c fon ufage. VIII. 472. b. Q u ille , in-
ftrument du fontainier. 477. b. Sonde dont iife fert pour forer
la terre 8c trouver les eaux. X V . 349.4 , b. &c, Opérations du
fontainier, voye[ F o n ta in e . Voyc[ auffi, vol. des planch.
article Fontainier.
FO N T AN A , ( F é l i x ) anatomific, Suppl. 1. 414. a. 8c phy-
fiologifle. Suppl. IV. 363. a.
FONTANELLE, la , ( Anatom.) Defcriprion de cette ouverture.
Etat où elle fe trouve dans les enfans nouveauX-nés.
Quelquefois les enfans attaqués du raehüis ont cette partie
trés-tendre dans un âge affez avancé. On a vu des fujets en qui
¡cette partie ne s’étoit jamais offifiéc. VII. 103. b.
Fontanelle. Sa deTcription. VIII. 264. b.
F o n t a n e l le , ( Chirurg.-) vo v î^ F o n ticu le .
FO N T AN O N , (A n to in e ) fon recueil d’ordonnances. XI. mm: ( Ar ts méch. ) Différentes acceptions de ce mot.
VII. 106.4.
F o n te , ( Fond, en carafl. ) affortiment complet de toutes
les lettres , & c . fondues fur un feul corps. Les fontes forit
¡plus ou moins grandes. On dit une fonte de cinq cen s , &c.
une fonte de tant de feuilles , ou de tant de formes. VU.
'106. 4.
, F o n t e . ( Monnaie) Converfion des monnoies de cours en
«i’aütres nouvelles. VII. 106. a.
F o n te ou fondre. ( Orfév.î) La fonte demande divers degrés
de feu. Comment ils doivent être conduits. Intermedes que
l ’orfevre emploie. VU. 106.4.
F o n te .(Mé ta llu i'g.) Différence entre fonte 8c fufion. VII.
•398.¿.Fonte de la mine de fer propre à être convertie en
ac,er' I03* a. » b. Sur la fonte de f e r , voyc{ G ro s s e s - fo r -
Ges. VU. 133. 4 , b. &c. Fonte de l’o r , de l’argent 8c du
cmvre voys* les articles de ces métaux , 8c vol. V . des
S S l f c e îa^ r# e & du plomb à giboyer. lb id J Por-
W d u e VII <lU‘ c danS jondue. v il. Sübftance aplcp cfloléUer mnc4a«ue ,a Pqruèis raéfvuolirre édtée
mine. £ ra 7.1 g S i «
aapnrrèéss llaà ftoonnttee. XA VVIi. Ti ii ï,a.l", ' iip p^ou™r .ÔiFIeUr sllOcsB «eufets du feu ,
. fonte. CommtlTaire général de. fontes. 111.71
Cmre ta fonre! & ¥***
f o r
& d S i BlarnJ' S> de flcurt
F O N T E N E L L E I Bernard,. B on i,rd c)
denncicn. I xxx. D ite , frilimin. Sa preuve t f f V “ * *•
Dieu IV. 9 8 1 0 , A. D e ton f c c r é J ï ï e I M p * * t
des factices. V . 518.0. Réponfc de M. dc P o n S “ r0Xal?
dOrléans, qui lui offroit la préfidence p e r u é S f duc
académie. VIII. 191. „ . E lé ien s de là géo‘ rf “ i * ,.«««
Ê K * ' ™ f ur- 7° 3- ». Eloge de fon ouvrage
XII. ni). XI. 5 ,7 . a. Obfervations fur fa nluralM ï onde«.
X. 640;b. XII. 705. a. fur fon caraétere & I f . - f e f f i S j S
ouvrages. XIV. 394. b Affeélation qu'on lui reproàhe f f ?
F o n te n e lle , ( Giopr. ) monaftere de bénédiélins
7o T î ' qiie i e
FONTENOI. Bataille de Fontenolen 174. Les .
combattirent en colonne. III. 614. 4. Fauffi» j 8 e *
cette bataille. VIII. n r . î f ,lu“ es “necdotes fur
FON TE STO R B E , fontaine prés de Belleftat, diocefcde
Mjrerçtx.Explteannn des phénomènes de eetle S | É
I f o n t e v r a u d I Gtogr. bou| S i
tou , à trois heues de Saumur. Célébré abiaye <É fflkà
fondée dans ce heu par Robert d’Arbrlflel, né Z to47 So' m
qntl fe donna pont la converfion des femmes débauchée,
& pont établit fon ordre pat toute la France. Cet ordre mû
fous la proteaion du S. fiege en I t o i , 6 c . Le générale“ de c«
x îw r n aUX !” es- Itonllic de Chemlllé, premicm
abbeffe 11 y en a eu depuis elle trcnte-quaire ou treüte-clnq
Cet ordre eft divifé en quatre provinces. Nombre des prieurés
dans chacune. Ouvrages à confultcr. VII. 106 4
FONTICUEE ( Chirurg. ) petit ulcere artificiel pranqué
par le chirurgien. Le mot de cmicrc, dont on fe fert comiim-
nement dans ce fens, eft moins propre que celui de fonti-
cule. But qu on fepropofe en pratiquant cet ulcere. Parties
du corps ou l on ouvre le plus communément les fonticules
Manières de les former. Panfement qu’ils exigent. Bandages
dont on fe fort. Du tems pendant lequel on doit tenir le
fonticule ouvert. Avantages principaux qu’on attend de cet
ufage. VII. 107. 4. Différens cas auxquels il faut pourvoir
par rapport aux fonticules. Auteurs qui en ont traité expref-
fément. Ibid. b. Voyez Seton 6* C autere.
FON T IN A LE S, ( Mythol.Antiq. romain. ) fète à l’honneur
des nymphes qui prélidoient aux fontaines. Dieux des eaux,
félon les païens. Néréides , naïades, potamides, limmades,,
nymphes. Comment on célébroit les fêtes de ces nymphes;
VII. 107. b.
¥ONTS-baptif/naux. ( Thiol. Hijl. eccl. ) Us étoient autrefois
la marque d’une églifo paroiffiale. En quel endroit on les
place. VII. 107. b. Miracles que les hiftoriens nous racontent
touchant les fonts-baptifmaux. Bénédi&ions qu’on en fait deux
fois chaque année. Ibid. 108. a.
Fonts-baptifnaux. On les diftinguoit autrefois des baptifte-
res. II. 66. b.
F O R , ( Jurifpr. ) jurifdiétion. VII. 108. a.
F o r -l’Evequ e. For extérieur & fo r intérieur. VII. 108. ai
For extérieur 6* intérieur de l ’églife. VII. 108. a.
For extérieur & intérieur de VéglUe. En quoi conAfte la jurifdH
étion volontaire qui s’y exerce. IX. 78. a , b.
For pénitenciel. VII. 108. b.
F o r , coutume, ou privilège accordé à quelque communauté.
V U . ! 08. b. . . .. # »
For de Béarn ou fors , coutume <le ce pays. Confirmation
de ce for en 1088. Fors particuliers qu’il y avoit en Béarn.
Rédaétion en un foui corps de tous les fors de Béarn, fane
par l’ordre de Marguerite de Béarn, en 1306. Addition qui y
fut faite enfuite, de divers réglemcns.Ces loix ou fors corriges
enfinen 13 3 1 .V II. 108 .b.
F O R A G E , ( Jiirifpr. ) droit que l’on* paie au feigneur pour
le vin & autres liqueurs qu’on vend en détail. Etymologiedc
ce mot. C e droit eft encore anpcllé afforage 8c allage. A quels
feigneurs appartient ce droit, v i l . 108. b. Diverfes manières
de le percevoir. Diverfes extenftons qu’on lui donne, folon
les coummcs. L’évêque 8c comte deBeauvais a au/A droit de
forage. Ibid. 109. a. Voy eçJALAGE. L
F o r a g e des canons de fu ftl de munition. (Fabriq. des armes}
Le canon ét^nt foudé fur une broche de for q u i n’a quec/nq
lignes de diametre, il eft ncccffaire de l’évider en-dedau^»
pour lui donner fon vrai calibre , qui doit être de f«P£ .‘8
dix point». Forets employés dans cette opération. ¿
des autres inftrumens néceffaires. — Voyerplancl.p■ “ ’J '
que des armes, Fufil de munition. Suppl. Explicutton
de toute la manceiivre. Suppl. III. 84.4., b. oq-a * ’ • .
FORAIN. (Ju r ifpr .) Marchands-forains; traites foraines,
prévôt forain ; official forain. V II. 109. a. , _rt
/br4/«. Chanoiiie forain. III. 137. a. Ficffor»n- *7 ^ *
•Vicaire forain. XVII. 23 3 . a. ’
F O R
F orain. ( Comm. ) Marchand forain. Marchandées forai-
^Foraine. Entrée 8c iffue foraine. VIII. 929. b. Traite-foraine.
XVI. 732. 4 , b. ImpoAtion foraine d’Anjou. 733.4. Juge des
traites-foraines. IX. 16. b.
FORBAN, voye[ C orsaire.
FORBISHER, détroit de , (Géogr. ) Voyages au nord-
oueft de l'Amérique, 8c découvertes qu’y fit Martin For-
bisher. Détails furies habitans voifins du détroit. VU. 109.b.
F o r b ish e r , ( Martin ) biftoire de ce navigateur. XI.
5 3 - a
FO R C A LQ UIER , ( Géogr. ) petite ville de Provence. Le
comté de Forcalquier avoit autrefois fes comtes particuliers.
Le roi prend le titre de comte de Provence, de Forcalquier,
&c. VII. 109. b. , e^-
FO R Ç A T , voyei GALERIEN. Bâtiment nommé bagne , où
l’oa tient les forçats. Suppl. 1. 744. b. &c.
FORCE. ( Gramm. L itt. | Force du coeur que quelques-uns
ont faite de 400 liv. 8c d autres de 3 onces. Divers ufages
<le ce mot dans le fons propre 8c dans le figuré. VII. 109. b.
On appelle forces, de grands cifoaux. Cette forte de cifoaux,
employée par allégorie dans une eftampe. Ufage du mot
force dans le ftyle très-familier. Force en morale. Force de
l’efprit. Force d’un raifonnement ; force de l’éloquence;
force d’un vers : exemple. Force dans la peinture. Des
philofophcs ont prétendu que la force eft une qualité inhérente
à la matière. Tems où la force de l’animal a reçu fon
plus haut degré. Principe de fon décroiffcment. Ibid. n o . a .
Force. ( Iconolog. ) Comment on perfonnifie 8c repréfonte
la force. VII. 1 10. a.
, Force d ’inertie. On lui donne le nom de réfiftince ou d'action
, fuivant l’afpeél fous lequel on la confidere. Preuves de
la force d ’inertie. Un coros ne peut être tiré du repos que par
l'action de quelque caufe étrangère. Un corps mis en mouvement
doit y perfifter toujours uniformément 8c en ligne
droite', tant qu'une nouvelle caufo n’agira pas fur lu i; ca r,
ou l’aétion de la caufo motrice au commencement du mouvement
Aiffit pour faire parcourir au corps un certain efpace,
8c alors ce mouvement doit être uniforme 8c en ligne droite,
& doit continuer perpendiculairement ; VII. 110'. b. ou le
corps a befoin pour fo mouvoir de l’àétiôn continuée de la
caufe motrice, d’où il fuit encore que fon aétion continuée
fora uniforme 8c confiante , 6c que le corps fo mouvra en
ligne droite. Il faut convenir , au refte, que les preuves
qu’on donne ordinairement de la force d'inertie , en tant
qu’elle eft le principe de la conforvation du mouvement,
n’ont point le degré d’évidence néceffairc pour convaincre
l’efpnt. Réflexions fur cette force qu’on imagine dans la matière
, par laquelle elle réfifle à tout changement d’état. Réflexions
fur l’indifférence qu’on attribue h la matière, foit
au mouvement, foit au repos. Ibid. 1 1 1 . a. Le mouvement
du corps, dans un inftant quelconque , n’a rien de commun
avec fon mouvement dans l’inftant précédent, ou fuivant.
Pourquoi nous fommes enclins à croire qu’il y a dans un
corps en mouvement un effort ou énergie qui n’eft point dans
un corps en repos. Trois différens fons que nous pouvons
attacher au mot fb r e e , tranfporté aux corps fufceptibles de
mouvement. En attachant à ce mot l’idée de l’effet même ,
ou de la propriété qui fo manifefte par cet effet, fans exa-
îriiuer ni rechercher la caufe , nous ne verrons rien de plus
dans le mouvement que dans le repos , 8c nous pouvons
regarder la continuation du mouvement, comme une loi.
•auffi effentielle que la continuation du repos. Le principe de
la force d’inertie, prouvé par l’expérience. Nons v o yo n s ,
i° . que les corps en repos y demeurent tant que rien ne les
en tire ; 2°. qu’un coros perfévere d’autant plus à fo mouvoir
y qu’il éprouve moins de réfiftance. L ’expérience journalière
de la pefanteur ne fomble démentir le premier de ces
principes, qu’aux yeux de la multitude. Nous voyons, par
expérience , que le mouvement eft toujours l’efter de l’iin-.
pulfion: ainft la chûtc d’un corps doit être attribuée à l'iin-
pulfion de quelque fluide inviiible , à moins qu’il n’y ait
quelque autre caufe du mouvement des corps que rimpul-
non; M. Eulcr prétend que l'attraélion, quand on la regarde
comme un principe différent de l’impulfion , eft contraire au
principe de la force d’inertie. Examen de ce fentiment. Ibid,
n i . a. Ce philofophe prouve de plus que la force d’inertie
étant une propriété.de la matière, la faculté de penfor n'en
fauroit être une. Ibid. b.
Force d ‘inertie. ( Phyfiq. ) Comme la première direction
• du mouvement détermine celle fuivant laquelle ce mouvement
doit fo faire , il fomble que par la même roifon , la
direction de la tangente, qui touche & fon origine la courbé
des x 8c des y , c’eft-à-dire, des tcms & des efpaces, 8c qui
détermine la valeur de la vîteffe initiale , c*eft-à'-diriê , du
rapport initial de d y à d x , doit déterminer de même la
valeur de ~ dans la fuite du mouvement. — Raifons qui
portent à croire que la force qui altérerait ce mouvement
F O R 763
du corps , s il pouvoit y en avoir une , ne pourrait être
proportionnée à une fonSion de viiefte. Suppl. 111 86 a
Force ¿inertie. Notion préciïc du mot de force. I. ir a . 4.
Loi générale de celte inertie. 11. 789. 4. Pourquoi les corps
continuent de 1e mouvoir, torique la force motrice a ce fe
d'agir. XIII. 437. 4. Sur la force d’inertie, voycr S u f fi. III.
86. 4. La force d’inertie proportionnelle à la maffe. X
833. 4.
Force v iv e , ou des corps en mouvement. Diftînâion qu’établit
M. Leïbnitz, entre les forces vives 8c les forces mortes.
Ce philofophe convient que la fo r c e morte eft comme lé
produit de la maffe par la vîteffe virtuelle. VII. 112. b. Mais
il foutient que la force vive doit fo mefurer autrement, 8c
qu’elle eft comme le produit de la maffe par le quarré de la
vîteffe. Dans le fyftême des adverfaires des forces v iv e s , la
force des corps en mouvement eft toujours proportionnelle
a ce’ qu’on appelle quantité du mouvement ; c ’eft-à-dire , au
produit de la maffe des corps par la vîteffe. Raifonnement par
equel Leïbnitz prouvoit fa nouvelle doélrine. Autres preuves
que M. Jean Bernoulli a ajoutées à celles de M. Leïbnitz. Principale
réponfo qu’on a faite aux partifans des forces vives.
Ibid. 113. 4. Ouvrages à confulter fur cette matière. Expofé
fuccinél des principes qui peuvent fervir à réfoudre cette
queftion. Ib'td. b. On eft affez d’accord aujourd’hui que tout
le fonds de cette difputc fur les forces vives, n’éroit qu’une
difpute de mots. D e tout ce qui a été d it , on doit conclure
u’un même corps, félon que fa tendance au mouvement eft
ifféremment appliquée , produit différens effets , les uns
proportionnels à fa v ita le , les autres' au quarré de fa
viteffe. Obfervations fùijjpë fons qu’on doit attacher au mot
effet. Examen de ce principe : les effets Jont proportionnels à
leur caufe.
Confcrvation des forces vives. Géomètres qui ont fait voir
l’étendue 8c l’ufage de ce principe de méchanique. Expofé de
deux loix de méchanique , dans lefquelles il conAfte. Ibid. b.
M. Huyghens paraît être le premier qui ait apperçu cette
loi de la conforvation des forces vives dans le choc des corps
élaftiques. Il parait aufli avoir connu la loi de la conforvation
des forces vives dans le mouvement des corps qui font
animés par des puiffances. Ufage que M. Jean Bernoulli a
fait de la découverte de M. Huyghens. Defcarres croyoit que
la même quantité de force devoir fubfifter dans l’univers ,
8c que le mouvement ne pouvoit pas fo perdre. Traité de
dynamique, où l’auteur a démontré le principe de la conforvation
des forces vives. De la conforvation des forces vives
dans le mouvement des ftuides. Ouvrages fur ce fujet. Ibid.
113 .4. Démonftration donnée par M. Clairaut, du principe
de ia conforvation des forces vives. Combien ce principe
facilite la folution d’un grand nombre de problèmes de dynamique.
D u rapport de la force vive avec l ’aflion. Les partifans des
forces vives avoient imaginé l’aâion comme le produit de la
maffe par l ’efpace 8c par la vîteffe. Cette définition cftabfo-
lument arbitraire. Cependant il eft poffiblc que les partifans
des forces vives aient prérendu attacher, par cette définition ,
quelque réalité à ce qu’ils appellent aflion. Mémoire dans
lequel le prôfoffeur W olf croyoit avoir fixé la véritable notion
de l’aâion. Obfervations qui montrent que cette définition
de W o lf eft tout-à-fait chimérique 8c en elle-même ,• 8c dans
les principes des partifans des forces vives. Ibid. b. A l’égard
de ceux qui, comme M. de Maupertuis, n’ont point pris de
parti dans la difputc des forces v iv e s , on ne peut leur con-
tefter la définition de l’aétion , fur-tout lorfqu’ils paroiffent
la donner comme une définition de nom. Exemple de la définition
donnée par M. d’Arcy. Définition du mot aflion,
donnée par l’auteur : défonfo de cette définition , contre la
critique qui en a été faite dans les Mém. de l ’acad. de Berlin ,
1733. Voyc{ Air toute cette matière les articles Aflion 8c Cof-
mologit. Ibid. 1 16. 4.
Réflexions fur la nature des forces mortes 6* fu r leurs différentes
efpeccs.
Forces accélératrices. Comment les forces mortes deviennent
accélératrices ou retardatrices. Difficultés fur la maniéré
dont on confidere ici les forces accélératrices. Si le mouvement
produit par une force accélératrice quelconque , commence
par zéro de vîteffe, pourquoi un corps pefant , fou-
tenu par un f i l , fait-il éprouver quelque réfiftance à .celui
qui le foutient ? Il devroic être abfolumcnt dans le Cas d’un
corps piiicé fur un plan horizontal, 8c attaché à un fil auffi
horizontal, à l’extrémité duquel on attacherait une pmflànce.
Or | fi la première vîteffe avec laquélle un corps pefant tend
à fo mouvoir , eft égale a zéro, pourquoi l’effort qu’il fauf
faire pour la retenir n’eft-il pas abfolument fiul ? Ibid. b; On
ne peut répondre à cette obje&ion que de deux manières,
dont ni’ l’une ni l’autre n’eft capable de fatisfairc pleinement.
Première réponfo , 8c obfervations auxquelles elle donne
lieu. Ibid. 117.4 . Seconde réponfo : réflexions qui s’y rapportent.
La difficulté propofée mérite donc encore l’attention des
phyfteiens 6c des géomètres.