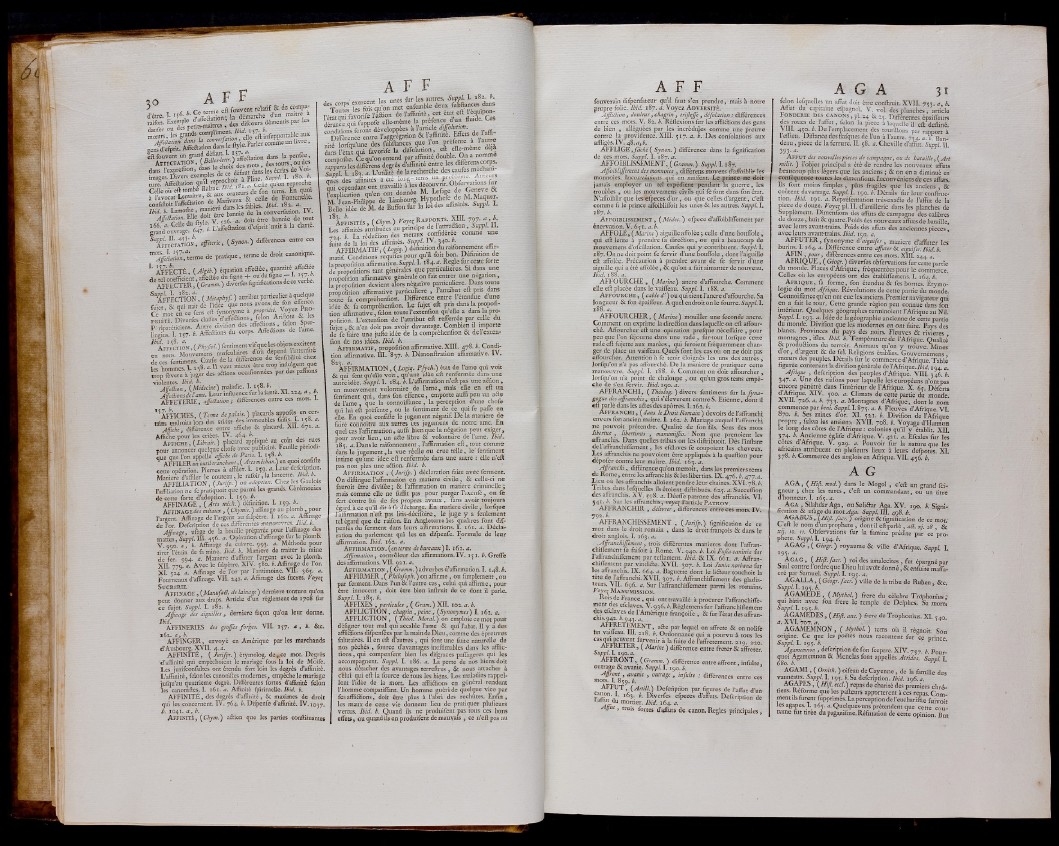
■
,o A F F
tfê.re. I |i| P i m S ^ S Ê B Ê Ê des difcours démentis par les
moeurs, les grands compliment ttt ■ 157^ ¿ f porraHe aux
gJ $ llÿle-'Parler comme un livre, ¡1« dans l’expreffion, dans_le & dans les écrits de V01-
images. divers exempletde ce « ¡ ¡ g g Supp, j l8o i.
ture. Affefiauon qu il reproch g. & ]le .Qn reproche
C eU e où eft tombe B.*aeu / ^ Kiire(le f<m Km s E n ™ ol
à l’avocat Leniaitre, & M - & ceue de Fontenelle.
confiftoirraffetoion f g f e g g « « i
ll i i . b. Lamothe: , maniéré to s le s converfation. 1V.
Afficiiotttm. EUe: doit ^ jg lt être bannie de tout
I p f l S I i C a u t i o n d’efprit 'nuit à la clarté.
^FECTATION, afféterie, | | | | | différences entre ces
de Prati<lu e ’ Krmede drdt Can0ni<itte
S À Ï fE C TÉ (Algih.) équation affeSée, quantité affeflée
Ce mot en ce fens eft fynonyme à propriété. Voyez FRO
p r ïf té Diverfes claffes d’affeüions, félon Annote & les
'SiidSPIisilR^® decesfentimens. Caufe delà différence de fenfibiUtè chez
les hommes 1. 138. ¿ .Il vaut mieux être trop indulgent que
trop C è^ e àjuger des aidons oecafionnèes par des pallions
violentes. Ibid.b.
M'eElïon, IMédecine) maladie. 1. xï 8-** „ ,
Affeftions de l’ame. Leur influence fur laiantè.Xl. aa4- •
AFFETERIE, affectation ; différences entre ces mots. 1.
’ ’ A f f i c h e s , (Terme W j S È p l* “ * qppofés en certains
endroits lors des criées des immeubles fadis. I. 158. a.
Affiche, différence entre affiche & placard. XII. 671.0.
Affiche pour les criées. IV. 464. i. .
A f f i c h e , (Libtoir.) placard appliqué au coin des rues
pour annoncer quelque choie avec publicité. Feuille périodique
que l’on appelle affiche de Paris. I. I <8. b.
AFFILER m outil tranchant, ( Arts mechan.) en quoi coniifte
cette opération. Pierres à affiler. I 159. a Leur deferipnon.
Maniéré d’affiler le couteau, le rafoir, la lancette. Ibti.b
AFFILIATION, (M / p .) ou adoption. Chez les Gaulois
l ’affiliation ne leprariquoit que parmi les grands. Cérémonies
de cette forte d’adoption. 1. 159.
AFFINAGE, (Arts mich.) définition. 1. 159. ».
A f f in a g e des métaux, { Chymieaffinage au plomb »pour
l’argent. Affinage de l’argent au falpêrre. I. 160. a. Affinage
de l’or. Defcription de ces différentes manoeuvres..Utd. h.
Affinage, ufage de la houUle préparée pour 1 affinage des
maries, Suffi. III. ¡ a l I Opération d’affinage fur le plomb.
V q q o . a , b. Affinage du cuivre. 993. a. Méthode pour
tirer l’étain de famine. Ibid. b. Maniéré de traiter la mine
de fer 994. a. Manière d’affiner l’argent avec le plomb.
XII. 7 7 9 ? Avec le falpêtre. XIV. 580. ¿.Affinage de l’or.
XI <24 a. Affinage de l’or par l’antimoine. VII. 365. a.
Fourneaux d’affinage. VII. g g g g Affinage des fucres. Voye^
S u c r e r ie . . , . ,
A f f i n a g e , (.ManufaR. de lainage) dermere tonture q u on
peut donner aux draos. Article d’un règlement de 1708 fur
ce fujet. Suppl I. 182. b.
Affinage des aiguilles * derniere façon quon leur donne.
Ibid. s , ___ .
AFFINERIES des groffes forges. VII. 157. a , b. &c.
162. a, b.
AFFINGER, envoyé en Amérique par les marchands
d’Ausbourg. XVII. 4. a.
AFFINITÉ, ( Jurifpr. ) étymolog. de.ee mot. Degrés
d’affinité qui empêchoient le mariage fous la loi de Moïfe.
Les jurifconfultes ont étendu fort loin les degrés d’affinité,
i affinité, félon les canoniftes modernes, empêche le mariage
jufqu’au quatrième degré. Différentes fortes d’affinité félon
les canoniftes. I. 161. a. Affinité fpirituclle. Ibid. b.
AFFINITÉ, des degrés d’affinité, & maximes de droit
qui les concernent. 1VT 764. b. Difpenfe d’affinité. IV. 1037.
b. 1041. a, b.
A f f in i t é , ( Chym.) a&ion que les parties conftituantes
A F F
WKÊËÊfi&&SÊIËÈi
nité lorfqu’une des fubftances que Ion p U a m à 1 autre
S S qui favorife la diffolution, A elle-même déjà
compofée I ! qu’on entend p a r affinité,double. On a nommé
rapports les différens degrés l affinité entre les
Suppl. I. 185. ». L’uril’né de larecherche des caufes méchant^
ques des affinités ^ ¿ S « qui cependant ont travaiUe° àt oleüs wdémcouOvrbtrf e rgv. a t i o n s fu&r.
K Ä T Ä U y P f V e M M a q a t r .
Belle i d é e  . de Buffon fur la loi des affinités. Suppl. I.
l8L L > iT f s (C hut.) VoyerR a p p o r t s . XIII. 797. a , l .
Les affinités attribuées au principe de l’atnaffion, Suppl. II.
y l 6 La réduâion des métaux confiderée comme une
fuite de la loi des affinités. Suppl. IV. 34° -^
AFFIRMATIF, (Logiq.) définition duraifonnement affir-
matif. Conditions requifes pour qu’U foit bon. Défimnon de
lapropofirion affirmative. Suppl. 1. 184. a. Regle furmette forte
de propofraons tant générales que particulières. Si dans une
propofition affirmanve générale on fiut entrer une neganon ,
fa propofition devient alors négative particulière. Dans toute
propofition affirmative particulière , latnabut eft pris dans
toute fa compréhenfion. Différence entre 1 étendue dune
idée & fa compréhenfion. Le fujet eft pris dans la propofi-
tion affirmative, félon toute l’extenfion qu’elle a dans la propofition.
L’extenfion de l’attribut eft refferrée par celle du
fujet, & n’en doit pas avoir davantage. Combien il importe
de fe faire une jufte idée de la compréhenfion & del’exten-
fion de nos idées. Ibid. b. _ i r j-
A f f i r m a t i f , propofition affirmative. X lll. 47° - % condition
affirmative. ÙI. 837. b. Démonftration affirmative. IV.
823.. a. . . . . .
AFFIRMATION, {Logiq. Pfych.) état de Tarne qui voit
& qui fent qu’elle voit, qu’une idée eft renfermée dans une
autre idée. Suppl. I. 184. b. L’affirmation n’eft pas une aôion,
un mouvement volontaire de l’ame, mais elle en eft un
fentiment qui, dans fon effence, emporte auffi peu un acte
de l’ame , que la connoiflance , la perception d’une chofe
qui lui eft préfente, ou le fentiment de ce qui fe paffe en
elle. En quoi confifte le jugement négatif. De la maniéré de
faire connoître aux autres ces jugemens de. notre ame. En
quel cas l’affirmation, auffi bierique la négation peut exiger,
pour avoir lieu, un afte libre & volontaire de Tarne. Ibid.
18 ç. a. Dans le raifonnement, l’affirmation eft, tout comme
dans le jugement,la vue réelle ou crue telle, le'fentiment
intime qu’une idee eft renfermée dans une autre : elle n’eft
pas non plus une aétion. Ibid. b.
A f f ir m a t i o n , ( Jurifp.) déclaration faite avec ferment.
On diftingue l’affirmation en matière civile, & celle-ci ne
fauroit être divifée ; & l’affirmation en matière criminelle ;
mais comme elle ne fuffit pas pour purger l’accufé, on fe
fert contre lui de fes propres aveux, fans avoir toujours
égard à ce qu’il dit à fa décharge. En matière civile, lorfque
l'affirmation n’eft pas litis-décuoire, le juge y a feulement
tel égard que de raifon. En Angleterre les qualcres font dif-
penfés du ferment dans leurs affirmations. I. 161. a. Déclaration
du parlement qui les en difpenfe. Formule de leur
affirmation. Ibid. 162. a.
A f f ir m a t i o n , {en terme de bureaux")!. 162. a.
Affirmation, contrôleur des affirmations. IV. 151. b. Greffe
des affirmations. VII. 921. a.
A f f ir m a t i o n , ( Gramm. ) adverbes d’affirmation. I. 148. b.
AFFIRMER, ( Philofoph.) on affirme, ou fimplement, ou
par ferment. Dans l’un & l’autre cas, celui qui affirme, pour
être innocent , doit être bien inftruit de ce dont il parle.
S|u ppii. IA.. 118055.. Pb.
AFFIXES î particules, ( Gram.) XIT. 102. a. b.
AFFLICTION, chagrin, peine, |Synonymes) I. 162. a.
AFFLICTION, ( Théol. Moral.) on emploie ce mot pour
dsfigner tout mal qui accable l’ame & qui l’abat. Il y a des
afflictions difpenfées par la main de Dieu, comme des épreuves
falutaires. Il en eft d’autres , qui font une fuite naturelle de
nos péchés , fource d’avantages ineitimables dans les afflictions
, qui compenfent bien les difgraces paffageres qui les
accompagnent. Suppl. I. 186. a. La perte de nos biens doit
nous détacher des avantages terreftres , & nous attacher à
cêlui qui eft la fource de tous les biens. Les maladies rappellent
l’idée de la mort. Les affligions en général rendent
l’homme compatiffant. Un homme guéri de quelque vice par
fes affligions, doit être plus à l’abri des rechutes. Enfin,
les maux de cette vie donnent lieu de pratiquer plufieurs
vertus. Ibid. b. Quand ils ne produifent pas tous ces bons
effets, ou quand ils en produifent de mauvais , ce n’eft pas au
A F F
(ouverain difpenfateur qu’il faut s’en prendre, mais à notre
propre folie. Ibid. 187. a. Voyez A d v e r s it é .
AffüÜion 3 douleur , chagrin , trijleffe , déflation : différences
entre ces mots. V. 82. ¿.Réflexions fur les affligions des gens
de bien , alléguées par les incrédules comme une preuve ■
contre la providence. XIII. 51 y. a. b. Des confolations aux
affligés. IV. 48, a, b.
AFFLIGE, fâché(Synon.) différence dans la fignification
de ces mots. Suppl. I. 187. a.
AFFOIBLISSEMENT, {Gramm.) Suppl.!. 187.
Affoiblijfement des monnoies , différens moyens d’affoiblir les
monnoies. IncouK^uie.iis qui en naiilênt. Le prince- ne doit
jamais employer un tel expédient 'pendarit la guerre, les
troubles , ou . les mouvemens civils qui fefont dans fon état.
N’affoiblir que les^efjieces d’o r , ou que celles d’argent, c’eft
comme fi le prince aifoibliffoit les unes & les autres. SûppL I.
187. b.
A f f o i b l i s s e m e n t , ( Médec. ) efpece d’affoibliffement par
énervation. V . 6ç 1. a. b.
AFFOLÉ, {Marine) aiguille affolée ; celle d’une bouffole,
qui eft lente à prendre fa direction, ou qui a beaucoup de
mouvemens d’olcillation. Caufes qui y contribuent. Suppl. I.
287. On ne doit point fe fervir d’une bouffole , dont l’aiguille
eft affolée. Précaution à prendre avant de fe fervir d’une
aiguille qui a été affolée, oc qu’on a fait aimanter de nouveau.
Ibid. 188. a.
AFFOURCHE , {Marine) ancre d’affourche. Comment
elle eft placée dans le vaiffeau. Suppl. I. 188. a.
A f f o u r c h é , ( cable d' ) ou qui tient l’ancre d’affourche. Sa
longueur & fon épaiffeur. A quel endroit on le fourre. Suppl. I.
188. a.
AFFOURCHER, ( Marine ) mouiller une fécondé ancre.
Comment on exprime la direâion dans laquelle on eft affourché.
Affourcher eft une opération prefque néceffaire , pour
peu que Ton féjourne dans une rade , fur-tout lorfque cette
rade eft fujette aux marées, qui feroient fréquemment changer
de place un vaiffeau. Quels font les cas où on ne doit pas
affourcher. Attention à fe tenir éloignés les uns des autres ,
lorfqu’on n’a pas affourché. De la maniéré de pratiquer cette
manoeuvre. Suppl. I. 188. b. Comment on doit affourcher ,
lorfqu’on n’a point de chaloupe , ou qu’un gros tems empê-
che de s’en fervir. Ibid. 190. a.
AFFRANCHI, ( Théolog. ) divers fentimens fur la fyna-
gogue des affranchis, qui s’élevèrent contre S. Etienne, dont il
eft parlé dans les aétes des apôtres. 1 .162. b.
A f f r a n c h i , {dans le Droit Romain) devoirs de l’affranchi
envers fon ancien maître. I-. 162. b. Mariage auquel l’affranchi
né pouvoit prétendre. Qualité de fon fils. Sens des mots
liber tus , libertinus , manumiffio. \ Nom que prenoient les
affranchis. Dans quelles tribus on les diftribuoit. Dès l’inftant
de Taffranehiffement, les efdaves fe coupoient les cheveux.
Les affranchis ne pouvoient être appliques à la queftion pour
dépofèr contre leur maître. Ibid. 163. a.
Affranchi, différence qu’on mettoit, dans les premiers tems
de Rome »entre les afïfancltis & les libertins. IX. 476. b. 477. a.
Lieu où les affranchis alloient pendre leur chaînes. XVI. 78. b.
Tribus dans lefquelles ils étoient diftribués. 625. a. Succeffion
des aff ranchis. XV. 598. a. Déeffe patrone des affranchis. VI.
541. b. Sur les affranchis, voye^ l'article P a t r o n .
AFFRANCHIR , délivrer, différences entre ces mots. IV.
¡ ¡ B Ë y
AFFRANCHISSEMENT , {Jurifp.) fignification de ce
mot dans le droit romain , dans le droit françois & dans le
droit anglois. I. 163. a.
Affranchijfcmcnt, trois différentes maniérés dont l’affran-
chiflement fe faifoit a Rome. V . 940* ¿* Loi Fufia caninia fur
Taffranehiffement par teftament. Ibid. & IX. 661. a. Affran-
chiffement par vindi&e. XVII. 307. b. Loi Junia norbana fur
les affranchis. IX. 664. a. Baguette dont le lideur touchoit la
tete de lWranchi. XVII. 307. b. Affranchiffement des gladia-
teurs. VIL 696. a. Sur Taffranehiffement parmi les. romains.
r M a n um is s io n .
Rois de France, qui ont travaillé à procurer l’affranchiffe-
ment des efclaves. V. 936. b. Réglemens fur Taffranehiffement
des elclaves de l’Amérique françoife , & fur l’état des affran-
chis.942. ¿^43.
. S f f n ENJ ? aj*e Par lequel on affrété & on nolife
tin vaiffeau. III. 218. ¿. Ordonnance qui a pourvu à tous les
“ f c r D A v e n ir a la fuite de l’affretement. 219. 220.
AFFRETER, ( Marine) différence entre fréter & affréter.
Suppl. 1. 190. a.
AFFRONT, {Gramm.) différence entre affront, infulte,
outrage & avanie. Suppl. 1. 190. b.
-Affront 3 avanie , outrage , infulte : différences entre ces
mots. I. Sj q . b.
De/criP«bn Par„ % lres de l’affin d’un
1 *%• H Diverfes efpeoes d affûts. Defcription de
1 a," " du mortier. Ibid. 164.*.
Mut 9 trois fortes d’affuts de canon. Réglés principales,
A G A 3t felon lefquelles un affût doit être confirait. XVII. 7x3. a , l .
Affût du capitaine efpagnol. V . vol. des planches, article
F o n d e r ie d e s c a n o n s , pl. 24 & a,. Différentes épaiffeurs
des roues de laffut, félon la piece à laquelle il eft deftiné.
y 111. 450. b. De 1 emplacement des tourillons par rapport à
Teflieit Diftance des flafques de l’un à l’autre. 754. a. b. Bandeau
, piece de la ferrure. II. 58. a. Cheville d’affùt. Suppl II
393. .
AFFUT des nouvelles pièces de campagne 3 ou de bataille, {Art
milït. ) l’objet principal a été de rendre les nouveaux affûts
beaucoup plus légers que les anciens ; & on en a diminué en
conféquence toutes les dimenlions. Inconvéniensde ces affûts.
UsA font moùis fifflples, plus fragiles que les anciens , &
coûtent davantage. Suppl. 1. 190. b. Détails fur leur conftruc-*
tion. Ibid. 191. a. Repréfentation très-exaéle de l’affut de la
piece de douze. Voyc^ pl. II. d’artillerie dans les planches de
Supplément. Dimenfions des affûts de campagne des calibres
de douze, huit & quatre. Poids des nouveaux affûts de bataille,
avec leurs avant-trains. Poids des affûts des anciennes pièces ,
avec leurs avant-trains. Ibid. 192. a.
AFFUTER, fynonyme d aiguifer , maniéré d’affuter les
burins. 1. 164. a. Différence entre affûter & aiguifer. Ibid. bf
AFIN , pour 3 différences entre ces mots. XlIL 244. a.
AFRIQUE, ( Géogr. | diverfes obfervations fur cette partie
du monde. Places d’Afrique, fréquentées pour le commerce.
Celles où les européens ont des établiflemens. I. 164. b.
A f r i q u e , fa forme, fon étendue & fes bornes. Étymologie
du mot Afrique. Révolutions de cette partie du monde.
Connoiffance qu’en ont eue les anciens. Premier navigateur qui
en a fait le tour. Cette grande région peu connue dans ion
intérieur. Quelques géographes terminoient l’Afrique ail Nil.
Suppl. 1. 193./z. Idée de la géographie ancienne de cette partie
du monde. Divifion que les modernes en ont faite. Pays des
blancs. Provinces du pays des noirs. Fleuves & rivieres
montagnes , ifles. Ibid. b. Température de l’Afrique. Qualité
& productions dû terroir. Animaux qu’on y trouve. Mines
d’or, d’argent & de fel. Religions établies. Gouvernemens,
moeurs des peuples. Détails fur le commerce d’Afrique. Table
figurée contenant la divifion générale de l’Afrique. Ibid. 194. a.
Afrique , defcription des peuples d’Afrique. VIII. 346. ¿.
347. a. Une des raifons pour laquelle les européens n’ont pas
encore pénétré dans l’intérieur de l’Afrique. X. 6ç. Déferts
Afrique. XIV. 500. a. Climats de cette partie du monde.
XVII. 726. a. b. 733. a. Montagnes d’Afrique,, dont le nom
commence par beni. Suppl. 1. 875. a. b. Fleuves d’Afrique. VI.
870. b. Ses mines d’or. XI. 521. ¿. Divifion de l’Afrique
propre, félon les anciens. XVII. 708. ¿. Voyage d’Hannon
le long des côtes de l’Afrique : colonies qu’il y établit. XII.
374. b. Ancienne éelife d’Afrique. V. 421. a. Efcales fur les
côtes d’Afrique. V. 929. a. Pouvoir fur la nature que les
africains attribuent en plufieurs lieux à leurs delpotes. XI.
378. ¿. Commerce des anglois en Afrique. VII. 45 b. b.
A G
A G A , {Hifi. mod.) dans le Mogol , c’eft un grand fei-
gneur ; chez les turcs, c’eft un commandant, ou un titre
a’honneur. I. 163. a.
A g a , Silahdar Aga, ou Selifrar Aea. XV. 190. b . Signification
& ufage du mot Aga. Suppl. ifi. 498. ¿..
^,-^1GlABUS > ( Hifl- f acr- ) origine & fignification de cemor;
G elt le nom d un prophète, dont il eft parlé , aff. xj. 28, &
xij. 10. 11. Obfervations fur la famine prédite par ce prophète.
Suppl. I. 194. b.
AGAG , ( Gcogr. ) royaume & ville d’Afrique. Suppl. L
195. a.
A g a g , ( Hifi. facr.) roi des amalecites , fiit épargné par
Saul contre 1 ordre que Dieu lui avdlt donné, 8c enluite mafia-
cré par Samuel. Suppl. 1. 193. a.
AG AL LA , ( Géogr. facr. ) ville de la tribu de Ruben, &c.
Suppl. 1. 193. b.
ÀGAMEDE , ( Mythol. ) frere du célébré Trdphonius 2
qui bâtit avec fon frere le temple de Delphes, Sa mort1
Suppl. 1. 193. b.
AGAMEDES, {Hift. anc. ) frere deTrophonius. XI. 340.
a. XVI. ^707. a. ; -
AGAMÉMNON, ( Mythol. ) tems où il régnoit. Son
origine. Ce que les poètes nous racontent fur ce prince.
Suppl. I. 193. b.
Agamemnon 3 defcription de fon feeptre. XIV. 737. b. Pourquoi
Agamemnon & Menelas font appellés Atridcs. Suppl !
680. b. r r • •
AG AM I, I Omith. ) oifeau de Cayenne, de la famille des
vanneaux. Suppl. I. 193. ¿. Sa defcription. Ibid. 196. a.
• ecc^') de charité des premiers chrétiens.
Réforme que les pafteurs apportèrent à ces repas. Comment
ils furent fupprimés. La perception de Teuchariitie fuivoit
les agapes. I. 163. <*. Quelques-uns prétendent que cette coutume
fût tirée du paganifme. Réfutation de cette opinion. But