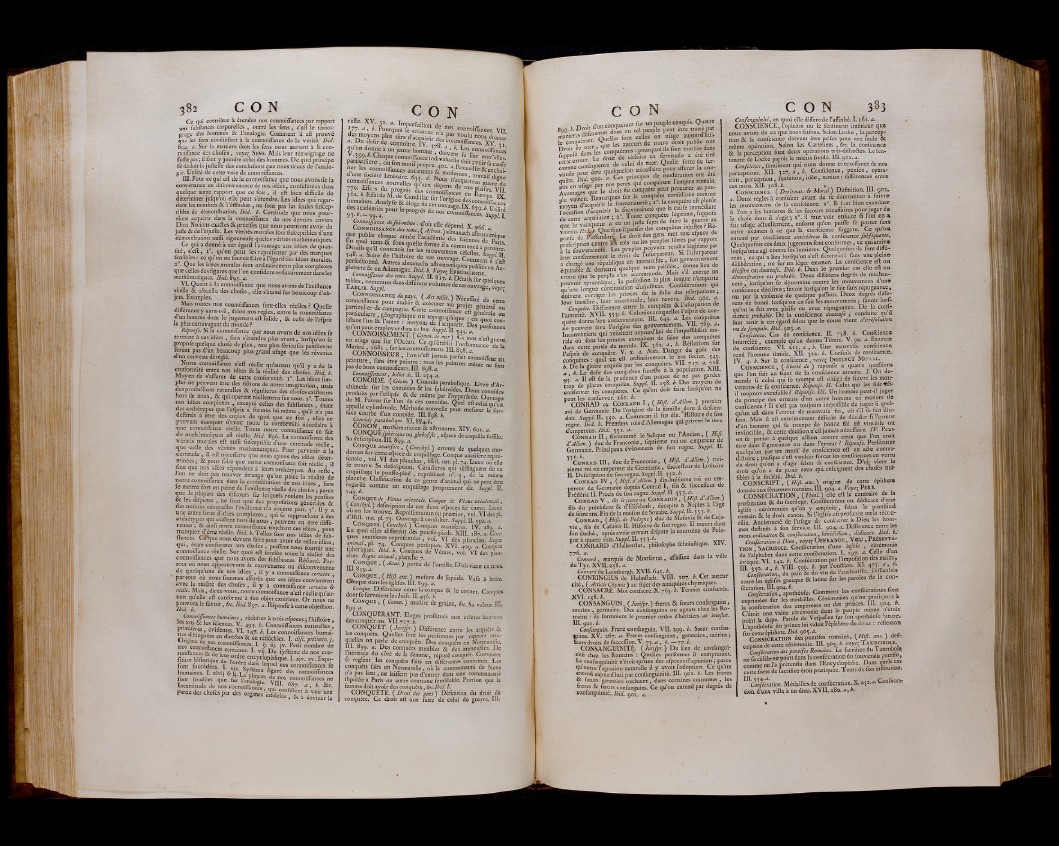
3 8 2 CON Ce qui contribue à étendre nos connoiiTances par rapport
anx fubftances corporelles , outre les fens, c’eft le témoignage
des hommes & l’analogie. Comment il eft prouvé
que Jes fens conduifent à la connoiiTance de la vérité, lbid.
894. a. Sur la maniéré dont les fens nous mènent à là con-
noilfancc des chofes , voye^ S e n s . Mais leur témoignage ne
fuffitpas; il faut y joindre celui des hommes. De quel principe
fc déduit la juileife des conclufions que nous tirons de l’analogie.
Utilité de cette voie de connoiiTances.
III. Pour ce qui eft de la connoiiTance que nous avons de la
convenance ou difconvenance de nos idées, confidérées dans
quelque autre rapport que ce foit, il eft bien difficile de
déterminer jufqu’où elle peut s’étendre. Les idées qui regardent
les nombres & l ’étSndue , ne font pas les feules fufcep-
zibles de démonftration. lbid. b. Certitude que nous pourrions
acquérir dans la. connoiiTance de nos'devoirs envers
Dieu. Notions exaâes Sc précifës que nous pourrions avoir du
jufte &dermjufte. Les vérités morales font fufceptibles d’une
démonftration auiîi rigoureufe queles vérités mathématiques.
Ce qui a donné a cet égard l’avantage aux idées de quan-
Ç eft, i°. qu’on peut les repréfenter par des marques
lenfibles : ce qu’on ne lauroit foire à l’égard îles idées morales.
20. Que les idées morales font ordinairement plus complexes
que celles des figures que l’on confidere ordinairement dans les
mathématiques. lbid. 895. a.
1 y 1' 9 ua«1 a la connoiffance que nous avons de l’exiftence
réelle & aétuelle des chofes, elle s’étend fur beaucoup d’objets.
Exemples.
Mais toutes nos connoiiTances font-elles réelles? Quelle
différence y aura-t-il, félon nos.réglés, entre la connoiiTance
<1 un homme dont le jugement eft folide, & celle de l’efprit
le plus extravagant du monde ?
Réponfe. Si la connoiiTance que nous avons de nos idées fe
termine à ces.idées, fans s’étendre plus avant, lorfqu’on fe
.propofe quelque chofe de plus, nos plus férieufes penfées ne
feront pas d un beaucoup plus grand ufage que les rêveries
<1 un cerveau déréglé.
Notre connoiiTance n’eft réelle qu’autant qu’il y a de la
conformité entre nos idées & la réalité des chofes. lbid. b
Moyen de s affûter de cette conformité. i°. Les idées fini,
pies ne peuvent être des fiffions de notre imagination, mais
des produâtons naturelles & régulières des chofes exillentes
hors de nous, & qui opèrent réellement fur nous. 2°. Toutes
■nos idées complexes , excepté celles des fubftances, étant
des archétypes que l'efprit a formés lui-même , qu’il Ü pas
deftmés a être des copies de quoi que ce foit , elles ne
peuvent manquer d’avoir toute la conformité néceffaire à
•une connoiiTance réelle Toute notre connoiiTance en fait
de mathématiques eft réelle lbid. 896. La connoiiTance des
vérités morales ell auffi fufceptible d’une certitude réelle
•que celle des véntes mathémanques. Pour parvenir à là
certitude ¡1 eft néceffaire que nois ayons d e s ^ E d é ’ eÎ!
mmecs ; ü pour faire que notre connoiiTance foit réelle il
mut que nos idées répondent à leurs archétypes. Au relie
°n doit pas trouver étrange qu’on place la réalité dé
notre connoiiTance dans la confidération de nos idées , fans
le mettre fort en peine de l’exiftence réeüe des chofes : parce
me la plupart des difcours fur lefquels roulent les penfées
oc les difputes , ne font que des propofitions générales &
des nouons auxquelles l’exiftence n’a aucune paît, II v a
une autre forte d’idées complexes, qui fe rapprochant à des
archétype? qui exiftent hors de nous, peuvent en être différentes
, & amû noue connoiiTance touchant ces idées peut
n ^ !.Uerr j t tr' Telles font nos idées !'
¡ ¡ S l l nous devons faire pour avoir de telles idées,
qui, étant conformes aux çhofes , puiffent nous fournir uné
connoiiTance réede. Sur quoi eft fondée toute la réalité des
connoiliances que nous avons des fubftances. Réfumé Par
tout ou nous appercevons la convenance ou difconvenance
de quelqu une de nos idées , il y a connoiiTance «naine ■
par tout ou nous fommes affûtés que ces idées conviennent
avec la réahté des chofes , il y a connoiiTance ccruine S,
rtcllc. Mais, direz-vous, notre connoiiTance n’eft réelle qu’autant
queUe eft conforme à fon objet extérieur. Or nous ne
pouvons le favoir, &c. lbid. 897. 4 . Réponfe i cette objeffion.
I Î “™“ " . réduites à trois efpeces ; l’hifloire,
urimMvï 1 Y/,4” ' b- ConnoiiTances naturelles ,
nés S “ ’ i “i “ ’J 1’ # b- connoiiTances humai
O r t em T 165 e" d,re« « & en réfléchies. I. ¡ B g
I- .ü- a jv. Petit nombre L
noiffances & de leur o T ” ' Vf § 18®= de nos con-
iition hiftorique de l’ordre? i°P<Î qUe' I X^V* XV‘ ExP0'
font fuccédées. I. x; â | É P Î nos connoiiTances fe
humaines. I. xlvij & ij Y a ni ?uré des connoiiTances
font fondées que for l’aiSlJS* * Tnos¿nnoilTances ne
Incertitude de nos connoiiTances; qui i I •
parue des chofes par des « W i n U l ï f ^ Æ ^
CON
ï f i j f ’’ ^ ô u r q u o T c r t ^ ^ colmotlTances. VIT
S É l l É É sûrs d'acquérir des cÔnmfff “■ ,Du delir de connoitre. IV collnot(Tanc”e0sU. SX <V,o.n nse,r'
H o o é° r Î 4 ™ ' emie ■'“ 'uute , d r tv « , “ ” ” oiffances'
oàrd?9i- Chaque connoiiTance individuelil V • er “ tr’elles.
particulière , ou Ton motif propre. doit avoir fa caufe
d W F “ “ “ ffiutces anciennes & modemeCsUeUI,r&e,,chaî-
dune Ibcéte littéraire. 6a 3. d Nom ’ ,ravail digne
connoiiTances nouvelles qu’aux dépens de’ no?"? de
7 7 0 . Lffeis du progrès des nOS P®rs V I I
162. b. Effai de M til ,en Europe. #
des anémies pour le progrès denos c o I n o i L ^ l p ”? '"
mËÈÊÊÈ^ ÉSls ?• m I qu■eO ppuubblliiee cchhaaqquuee année íL d ém ie l l Í É É ¡
En quel tems& fous quelle forme il a commencés
o ï contenoit iur les mouvemens cébiï i ar0ltre’
54«. u. Suite de l’hiftoire de cet ouvmge Comm ” IP
perfeéhonné. Autres almanachs aft™ 2 Comment il s’ell
humaines. Analyfe & éloge de cet ouvr!» l y 5? ” "01'16"«*
d9e3s- éa.c —ad é9m9.i eus. pour le probg rès de nos ccoonnn nooii Tira’ nc3e 9s.' SuUptpUl.i Jti,
:# o Z i ' c P S S ' f Néceflité de cet,-,
particulier de campagne. Cette connoiffil,?. n °u
particulière, géographique ou topographique • Î “ " ! ' 0U
fdlent l’un & l’autre : moyens de l’a c S n Ï Ï
,Urri^IxitrvSïl0J'erdilnSCeh"t.ilippÆ S49 a S w I SW
CONNOISSEMENT. ( Comm. d iL r ) 5Cc9m; , n, -
en ufage que fur l’Océan. Ce qu’établit lW o n L
Marine , 1681 , furlesconnoiffemens III 8q8 a
CONNOISSEUR , l’on n’eft jamais pX'eonnoiffeur en
peinture, fans être peintre : tous les peintres rnêm? c U
pas de bons connoiffeurs. 111. 898. a. f°m
Connolffement, billet de. II. 254. a.
n C°NO Id E. ( Gèom. ) Conoïde parabolique. Livre d’Ar
chunede fur les conoides & les fphéroïdes: Deux conoidés
S i même par l’hyperbole. Ouvrage
de M Parent fur 1 un de ces conoïdes. Quel eft celui qu’on
wpelle cylindroide. Méthode nouvelle pour mefurer lafur.
foce courbe dun conoïde. III. 898. b.
Conoïde parabolique. XI. 884. b.
rnSRirè- ™ ^ ématicien & aftronome. XIV. 601. M
S a d c f c r ? ,™ f l l7 “ “U ’ rfP 'Ce de “ =•'
C o n q u e anatîftre , ( Conchyl.) erreurs de quelques mofentTe
voï'-SÎ P 6!? 1 GKqiië anatiÆe repréfentée
, vol. VI des planches, Hift. nat. pl. 74. Lieux où elle
fe trouve. Sa defcnption. Carafteres qui diflinguent de ce
n”. 9 , dl la même
planche. Clallihcation de ce genre d’animal qui ne peut être
54! i COmnM: 11,1 coquillage proprement dit. Suffi. II.
COBQmdt Wnus oritntuli. Conçut de yinusoccidml.de,
(. oiiiiciM.) defcnpnon de ces deux efpeces de came. Lieux
! Î J lcs tro“ ve. Repréfentation du premier, vol. VI des pi.
d Hift. nat. pl. 73. Ouvrage à confulter. Suppl. II. 150. t.
C o n q u e s , (iConchyl. ) Conques anariferes. IV. 189. S
Sjêi S “ dl®erent des pouffe-pieds. XIII. 187. a. Con-
2^ 1 /“" “? “ repréfentées, vol. VI des planches. Rcgac
unmal, pl. 74 Conques periiques. XVI. 409. a. Conques
fphénques. fin/, b Conques de Vénus, vol. VI des plan-
cnes. Kegne animal, planche 7. ■
g g f S ’ ) perde de l’oreille. D ’où vient ce nom.
Gh^?düa L ' l L ^ S Î im899.4 deHtIUide- Vafe à i !
& IecorMt-
C o n q u e , (Conuu.) mefure de grains, S-c.Sa valeur.III.
099. a.
CONQUÉRANT. Eloges proftitués aux crimes heureux
des conquérons. VII. 717.
CONQUÊT. ( Jurifpr. ) Différence entre les acquêts &
les conquêts. Quelles font les perfonnes par rapport aux-
quelles on parle de conquêts. Des conquêts en Normandie.
iM.1 . 99* j ' ° e s conquêts meubles & des immeubles. De
1 héritage du coté de la femme, réputé conquêr. Comment
fe règlent les conquêts faits en différentes coutumes. Lcs
conquêts foits en Normandie, où la communauté de biens
n a pas lieu , ne laiffent pas d’entrer dans une communauté
flipulée à Paris ou autre coutume femblable. Porrion que la
femme doit avoir des conquêts, bc.lbid. b.
CONQUÊTE. ( Droit, des gens ) Définition du droit de
conquête. Ce droit eft une fuite de celui de guerre. III*
C O N
« • ronouérant fur un peuple conquis. Quatre
899. b. ¡ S g i y a dj nt „ „ tel peuple peut être traité par
manières différent ¿eUès en ufage au]Ourdhui.
le conquérant’ Q ^ auKUIS notre droit public ont
P r0,‘i e<faM 1« conquérans : pourquoi ils font tombés dans
fuppoft droitHde réduire en fervitude a été tiré
cette erreur.- Le ^ ^ Que„ e fortc de fer.
comme confequen efou néceiraire pour affurcr la con-
, S 000 u. Ces principes de modération ont été
ufage9par nos peres qui conquirent l’empire romain,
nus en mage p 1 conauête peut procurer au peu-
Avantages chnfidérêe comme
-pie vameu. Remarques tur ia 4^. ^ uête eft plutôt
r ° yeL Î d ’ïïqüérir la fouveraineté que la caufe immédiate
t i r i S r a m t le
a changé une république en monarcm , 5. .n n ( 1 ¿e
équitable & ’ ccom'mode?' Mais’ s’ü exerce un
croire que le pe p pofl-eflion la plus longue n’emporte ^SSêi-ï» S^tïgi l'autorité. XVII. W .b.
quête donna lieu anciennement. III. 649- «• X !
ne peuvent être l’origine des gouvernemens. VIL ?»9- a-
Inconvéniens qui réfultent aujourd’hm delîmpoffibilité morale
où font les princes européens de foire ^conquêtes
dans cette partie du inonde. lX. , * .
Tefprit de conquête. V. x. «. No„. Danger du gout des
conquêtes : quel en eft ordinairement le but fecret. 545-
b. De la gloire acquife par les conquêtes. VII. 71?* *•/ *
a b. Le defir des conquêtes funefte a la populanon. XIII.
.c a II eft de la prudence d’un prince de ne pas garder
?rop de places conquifes. Suffi. IL .58. i. Des moyens de.
coiServer fes'conquêtes. Ce quon doit faire lorfquon ne
PeCONRAD ou C o n r a r d I , B » V d C e n ’
roi de Germanie. De l’origine g f t g N M B B É a B & f e
doit. Suppl.ü . 550. 4 .Comment il fut élu. Hiftoired-fou
regne. lbid. b. f remiers rois d'AUemagne qm prirent le mre
“*‘ CONRAD n'ffiimommé leSalique ou l’Ancien, (
d’Allem. ) duc de Franconie, fepueme roi ou empereur de
Germanie. Principaux événemens de fon regne. Suppl. 11.
5ÎConrad III, duc de Franconie, (
zieme roi ou empereur de Germanie , fucceffeur de Lothaire
IL Defcription de fon regne. Suppl. II. 5 jM b-
Conrad IV , ( Hijl.d'Allem.) dix-hmtieme roi ou empereur
de Germanie depuis Conrad I,, fik & fucceffeur de
Frédéric II. Précis de fon regne. Suppl. I l $53/ *'rn .. .
C o n r a d V , dit le jeune ou C o n r a d i n , ( m . d Allem. )
fils du précédent & d’Elifobeth, décapité à Naples a lage
de feize ans. Fin de la maifon de Souabe. Suppl. 11. 553- • .
C on rad , (Hift. de Pologne) duc de Mafovie& deCuja-
vie , fils de Cafimir II. Hiftoire de fon regne. Il meurt dans
fon duché, après avoir envain difputé la couronne de Folofcholaftique.
XIV.
CON 383 Confanguinité, en quoi elle différé de l’affinité. 1. 161. u.
CONSCIENCE,l’opinion ou le fentiment intérieur que
nous avons de ce que nous foifons. Selon Locke, la perception
77 Conrard, marquis de Monferrat, affaffmé dans la ville
de Tyr. XVII. 258. a.
Conrard de Leonbergh. XVII. 645 • ^ _
CONRING1US de Helmftadt. VIII. 107. b. Cet auteur
cité, ( Article Oiymie ) au fujet'des antiquités chymiques.
CONSACRÉ. Mot confacré. X. 763. b. Termes confacrés.
XVI. 158 .b. KbmMBI
CONSANGUIN, (Jurifpr.) freres & foeurs confangums,
utérins , germains. Des confanguins ou agnats chez les Romains
: ils formoient le premier ordre d’héritiers ab inteftat.
UI. 901. ê.
Confanguin. Frere confanguin. VII. 299. b. Soeur confan-
cuine. XV. 267. a. Freres confanguins, germains, utérins ;
leurs droits de lucceffion. V. 75. a , b. — 77. b.
CONSANGUINITÉ. (Jurifpr.) Du lien de confangui-
nnè chez les Romains* : Quelles perfonnes il comprenoit.
La confanguinité n’êtoit qu’une des efpeces d’agnation ; parce
qu’outre l’agnation naturelle il y avoit l’adoption. Ce qu’on
entend aujourd’hui par confanguinité. III. 901. b. Les freres
& foeurs ecrmains excluent, dans certaines coutumes , les
freres & loeurs confanguins. Ce qu’on entend par degrés de
confanguinité. lbid. 902. a. •
& la confcience doivent être prifes pour une feulé &
même opération. Selon les Cartéliens , &c. la confcience
& la perception font deux opérations très-diftinftes. Le fen-
liment de Locke paroît le mieux fondé. ÜI. 902.4.
ConCcicuct, fentiment qui nous donne connoiiTance de nos
perceptions. XII. 3 2 7 .4 , i. Confcience, Mnfée, ppera-
îion .perception, fenfation, idée, notion : différences entre
ces mots. XII. 308. b. * . . 7TT__
C o n s c i e n c e . ( Droit nat < 6* Moral) Définition. III. 902.
a. Deux regles à confulter avant de fe déterminer à iuivre
les mouvemens de fa confcience. i°. Il fout bien examiner
fi l’on a les lumières 8c les fecours néceffaires pour juger de
la chofe dont il s’agit ; 20. il fout voir enfuite fi 1 on en a
foit ufage actuellement, enforte qu’on puiffe fe porter fans
autre examen à ce que la confcience függere. Ce qu ou
entend par confcience antécédente 8c confcience fubjequente.
Quelquefois ces deux jugemens font conformes, ce qui arrive
lorfqu’on a agi contre fes lumières. Quelquefois ils fontdiffê-
rens ce qui a lieu lorfqu’on s’eft déterminé fans ime plemo
délibération, ou fur un léger examen. La confcience eft ou
i décifive ou douteufe. lbid. b. Dans le premier cas elle eft ou
démonftrative ou probable. Deux différens degrés de méchanceté
lorfqu’on fe détermine contre les mouvemens dune
confcience décifive j favoir lorfqu’on le foit fans répugnant ,
ou par la violence de quelque paffion. Deux degrés dme-
rens de bonté lorfqu’on en fuit les mouvemens i fovoir lorl-
qu’on le fait avec plaifir ou avec répugnance. De la coni-
cience probable. De la confcience douteufe i conduite quu
fout tenir à cet égard félon que le- doute vient dirrijohuion
ou de fcrupule. lbid. 903. a. .
Confcience. Cas de confcience. II. 73 S. b. Confcience
bourrelée, exemple qu’en donneTibere. V.oo. a. Examen
de confcience. VI. 215. a , b. Une mauvaife confcience
rend l’homme timide. XII. 322. b. Confeils de confcience.
IV. 4. b. Sur la confcience, voye[ I n s t i n c t M o r a l .
C o n s c i e n c e , ( liberté de ) réponfe à quatre quefuons
que l’on foit au fujet de la confcience errante. I. On demande
fi celui qui fe trompe eft obligé de fuivre les mouvemens
de fa confcience. Réponfe. II. Celui qui les íiut «lt-
il toujours excufable? Réponfe. 111. U n homme peut-il juger
du principe des erreurs d’un autre homme en matière de
confcience? Il n’eft pas toujours impoffible de juger fi quelqu’un
eft dans l’erreur de mauvaife foi , ou s il le fait îllu-
fion. Mais il eft extrêmement difficile de décider fi 1 erreur
d’un homme qui fe trompe de bonne foi eft vincible ou
invincible, & cette décifion n’eft jamais néceffaire. IV. Fcuton
fe porter à quelque aftion contre ceux que 1 on croit
être dans l’ignorance ou dans l’erreur ? Réponfe. Perlécuter
quelqu’un par un motif de confcience eft un aéte contra-
aiéloire ; puifque c’eft vouloir forcer les confidences en vertu
du droit qu’on a d’agir félon fa confcience. Doy v.ent le
droit qu’on a de punir ceux qulenfeignent des chofes nui-
fibles à la fociété. lbid. b. .
CONSCRIPT, (Hift. anc.) origine de cette épithet*
donnée aux fénateurs romains. I1L 904. a.Voyei PERE.
CONSÉCRATION, (Théol.) elle eft le contraire de la
profonation & dufacrilege. Confécration ou dédicace dune
éelife : cérémonies qu’on y emploie, félon le pontifical
romain 8c le droit canon. Si l’églife eft profanée onia récon-
cille. Ancienneté de l’ufage de confacter à Dieu les hommes
deftmés à fon fervice. 111. 904. a. Différence '" J « 1“
mots ordination.& confécration, bcncdtllton ’ d‘ *“ % '-Jb'“ - bm
Confécration à Dieu, vom O f f r a n d e , V oe u , ? “ » >’T a
t i o n , S a c r i f i c e . Confécranon dune éghfe , cérémome
de l’alphabet dans cette confécranon. I. 297.^^4 C d led u n
évêque. VI. 142. b. Confécranon par 1 împolmon des mains ,
III KO a . b. VIII. 599. b. par l’onihon. X L 473. •a , f-
Coificration, du pain & du vin de l’euchariflie. Dtfficultés
entre les éjdifes grecque & latine fur les paroles de la con
SiC< S b ra th fÍ t¿M o (o . Comment les confécrations font
exprimées fur leîmédailles. Cérémonies quon pratiquoità
la confécranon des empereurs on des pnnees., ttL 904. fc
C’étoit une vaine cérémonie dont le peuple meme nétoit
H dupe. Parole de Vefpafien fyr fon apothéofe future,
i ’apothéofe du prince lui valoitl épithete de divus . reflexion
fur cette épithete. lbid. 905. a. _ / tr.a „ „r \
C o n s é c r a t io n des pontifes romains, (Hjft- anc' ) 1161 •
cripüon de cette cérémo.ùe. UI. 905. ¿ * T O T a u r o b o ^
Confécration des pontifes Romains. Le facnfice du Tanrobolq,
ne fe célébroit point dans la confécration du fouveram ponnte,
comme on l’a prétendu dans l’Encyclopédie. Dans quels cas
c e tte forte de focrifice étoit pratiquée. Tems de fon mllitunon.
m 'cllfkr'ation. Médailles de confécration. X 231.4. Confécra.
tion d’une ville à un dieu. XVII. a£o. <*, b.