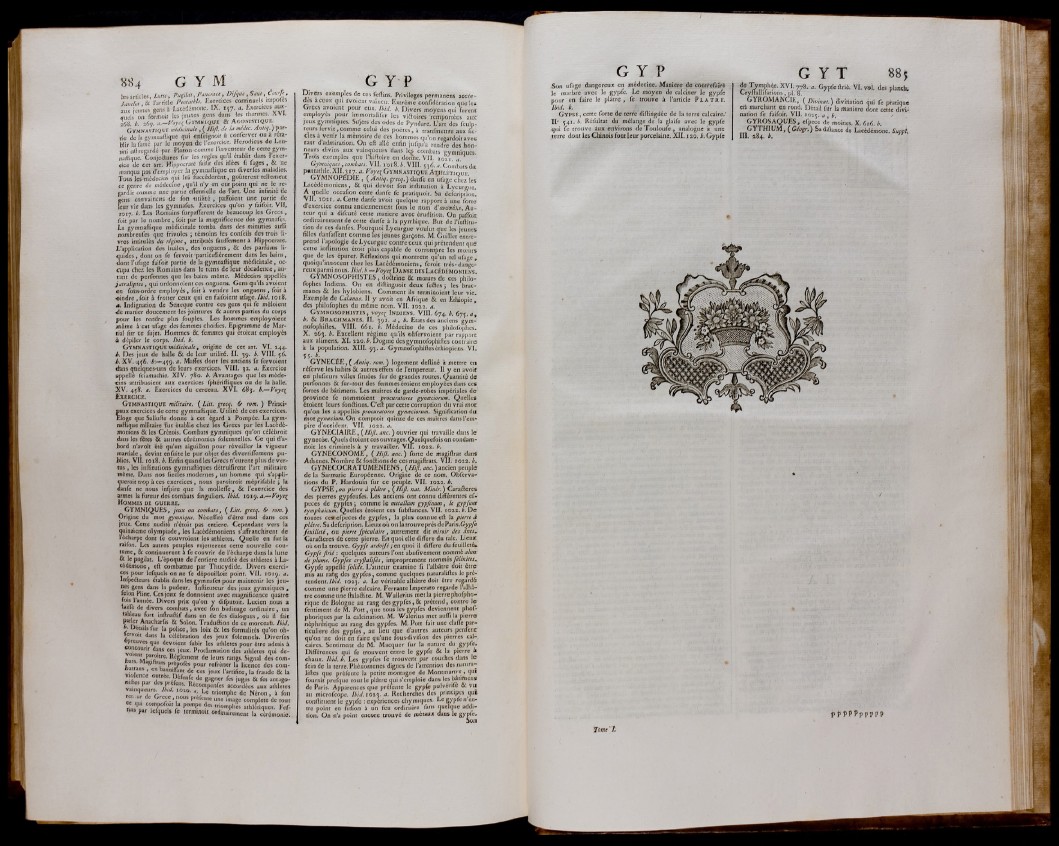
««4 G Y M
les article*, Lutte, Pugilat, Panera«, Difque, Saut t^ u r j é >
itivelot 6c l'article Pentathle. E x e rcic e s continuels impolc*
au x jeunes gens h 'latédémone. IX. 15y. a. Exe rcices a u x quels
on fon n o it les jeunes gens dans les thermes. X V I .
168. b. Æ , a . - Voyez G ym n iq u e & A c o u s t i q u e .
G y m n a s t iq u e médicinale, ( t i ï f l . de la médec. A n t iq .) partie
de la gymnaflique qui enfeignoir h c o n ferv e r ou a rétablir
la famé par le moyen de l’exercice. Herodicus de Len-
tini e/l regardé par Platon comme l’inventeur de cette:gym-
nadique. Conje&ures fur les règles qu’il établit dans 1 exercice
de cet art. Hîppocrate fallu des idées fi fa g e s , 8c ne
manqua pas d’cmpJoycr la gymnaflique en diverfes maladies.
Tous les m édecins qui lui /accédèrent, goûteront tellement
c e g enre de médecine , qu’il n 'y en eut point qui ne le regardât
comme une partie e/Tentielle de l ’art. Une infinité tic
gens convaincus de fon 'Utilité , pa/Toient une partie de
leur vie dans les gymnafes. Exercices qu’on y faifoir. VII,
1017. b. Les Romains furpa/Terent de beaucoup les Grecs ,
foit par le nombre, foit par la magnificence des gymnafes.
La gymnaflique médicinale tomba dans des minuties aufli
itomoreufes que frivoles j témoins les confeils des trois livres
intitulés du régime, attribués fauffement à Hîppocrate.
L ’application des hu iles, des onguens, & des parfums liquides
, dont on fe fer voit 'particulièrement dans les bains,
dont l’ufage faifoit partie de la gymnaflique médicinale, occupa
chez les Romains dans le teins de leur décadence, autant
de perfonnes que les bains même. Médecins appellés
ja tralip tes , qui ordonnoient ces onguens. Gens qu’ils avoient
en fotis-ordre employés, foit à vendre les onguens, foit à
■oindre, foit à frotter ceux qui en faifoient ufage. Ibid. tô t 8.
a Indignation de Seneque contre ces gens qui fe mêloient
d e manier doucement les jointures & autres parties du corps
pour les rendre plus fouples. Les hommes employoient
même à cet ufage des femmes eboifies. Epieramme de Martial
fur ce fujer. Hommes 6c -femmes qui croient employés
à dépiler le corps. Ibid. b.
G ym n a s t iq u e médicinale, origine de cet art. V I . 244.
b. Des jeux de balle 8c de leur utilité. II. 39. b. V I I I . 36.
b. X V . 436. /».— 439. e . Mafies dont les anciens fe fer voient
dans quelques-uns de leurs exercices. V I I I . 32, a . Exercice
appellé fciamachie. X IV . 780. b. Avantages que les médecins
attribuoient aux exercices fphérifliques ou de la balle.
X V . 438. a. Exercices du cerceau. X V I . 683. b.— Voye^
Ex er c ic e .
G y m n a s t i q u e militaire. ( Lite, greca. b rom. ) Principaux
exercices de cette gymnaflique. Utilité de ces exercices.
Eloge que Sailufle donne à cet égard k P om p é e . La gym-
nulhque militaire 'fut établie chez les Grecs par les Lacédé-
momens & les Crétois. Combats gymniques qu'on célébroit
dans les fêtes 6c autres cérémonies folemnelles. C e qui d’abord
n’avoit été qu’un aiguillon pour réveiller la vigueur
martiale, devint enfuite le pur objet des divertiffemens publics.
VII, 1018. b. Enfin quand les Grecs n’eurent plus de v e r tus
, les inflitutions gymnafliques détruiflrent l’art militaire
même. Dans nos fieefes modernes, un homme qui s’appli-
qucroit trop à ces exercices, nous paraîtrait méprifable ; la
flanfe ne nous infpire que la molleiTe, & l'exercice des
armes la fureur des combats fînguliers. Ibid. 1019. a.— Voye^
Hommes d e g u e r r e .
G YM N IQ U E S , je u x ou combats, ( Lite, greca. rom .)
Origine du mot gymnique. NécefTtté d’être nud dans ces
jeux. Cette nudité n’étoit pas entiere. Cependant vers la
quinzième olympiade, les Lacédémoniens s affranchirent de
1 écharpe dont fe couvraient les athletes. Q u elle en fut la
raifon. Les autres peuples rejetterent cette nouvelle coutume,
6c continuèrent a fe couvrir de l’écharpe dans la lutte
6c le pugilat. L ’époque de l'entiere nudité des athletes k La-
cédémone, c il combattue par Thucydide. Divers exercices
pour lefquels on ne fe dépouilloit point. V i l . 10 19. a.
Infpeâeurs établis dans les gymnafes pour maintenir les jeunes
gens dans la pudeur, tnflituteur des jeux gymn iques ,
félon Pline. Ces jeux fe donnoient avec magnificence quatre
j 0? * l’année. Divers prix qu’on y difputoit. Lucien nous a
*ame de divers combats, avec fon badinage ordinaire, un
tableau fort inflruélif dans un de fes dialogues, où il fait
5* r\t 4 ,nacbatiis 8c Solon. Traduction de ce morceab. Ibid.
• Détails fur la police, les loix 6c les formalités qu’on ob-
»crvoit dans la célébration des jeux folemneïs. Diverfes
©preuves que dévoient fubir les athletes pour être admis à
„ ■fOUrir ™n% ces jeux. Proclamation des athletes qui de-
harc V T " ' % P e,went de leurs rang*. Signal des corn-
li'irrâu« 1“ pr|P0Ï^8 Pour tefréner la licence des coin-
* " H | de c e . jeux l’artifice, la fraude & la
riihÜ m , n E W * r i“ ge» & fe» antagorothw
par de. prifen«. lUeompenfes accordée, aux athletes
r é T H r ” ■ re,.,ur de G re c e .n o u . p ,ifc „K t rutnoe> nplie de N éron , à fon { comp|ctc’dc Iout
hu 'u l . ' î T T ' r 1 p8n,|?C " ,riomP1’ « athlétique.. Fef-
«Bu par lefqueU fe lertnmott ordinairement la cérémonie.
G Y P
D iv er s exemples de ces feflins. Privilèges permanens accordes
a ceux qui avoient vaincu. Extrême cohfidération que les
G recs avoient pour eux. Ibid. b. Divers moyens qui furent
employés y o u r immortalifer les vifloires remportées aux
jeux gymniques. Sujets des odes de Pyndare. L'art des fculp-
reurs f c r v it , comme celui des poètes , à tranfmettrc aux ficelés
a venir la mémoire de ces hommes qu’on regatdoit avec
tant d admiration. O n e/l allé enfin jufqu’à rendre des honneurs
divins aux vainqueurs dans lqs combats gymniques.
T ro is exemples que lhifloire en donne,VII, t o x i . a.
Gymniques .combats. V II. io i8 .é . VIII, 3 36.,;. Combats du
pentathle. X II.3 1 7 . a. fo y e r GYMNASTIQUE A th l i ;t io u e
G YM N O P É D IE , ( A n t iq . grccq.) danfe en ufage chez les
Lacédémoniens, & qui devoit fon inflirution k Lycurgue.
A quelle occafton cette danfe fe pratiquoit. Sa defeription!
V i l . î0 2 i . a .C e t t e danfe avoir quelque rapport à une forte
d’exercice connu anciennement fous le nom d’ anürdxn. A u teur
qui a difeuté cette matière avec érudition. On paffoit
ordinairement de cette danfe à la pyrrhique. But de l’inflitu-
tion de ces danfes. Pourquoi LycUrgue voulut que les jeunes
filles danfaffent comme les jeunes garçons. M. G uillct entreprend
l’apologie d eL y cu fgu e contreceux qui prétendent que
cette inflitution étoit plus capable de corrompre les moeurs
que de les épurer. Réflexions qui montrent qu’un tel u fage,
quoiqu’innocent chez les Lacédémoniens, ferait très-dangereux
parmi nous, Ibid. b — Voyez D anse DES LACÉDÉMONIENS.
G YM N O SO PH IS T E S , doélrine 8c moeurs de ces philo-
fophes Indiens. O n en niflinguoie deux feétes j les brac-
manes 6c les hylobiens. Comment ils terminoient leur vie.
Exemple de Calanus. Il y avoit en Afrique 8c en Ethiopie,
des pnilofophes du même nom. V II. 1022. a.
G ym n o s o p h is t e s , v o y e i In d iens. V I I I . 674. b. 6y<. a ,
b. 8c B r a c h m a n e s . II, 391, r f , b. Etats des anciens gym-
nofophifles. V I I I . 6 6 1 . b. Médecine de ces philofbphes.
X . 263. b. Excellent régime qu’ils obfervoicnt par rapport
aux alimens. X I. 220. b. Dogme des gymuofophifles contraire
à la population. XIII. 93. a. Gymnofophifleséihiopiens. V I .
33. b.
G Y N E C E E , ( A n t iq . rom.) logement defliné à mettre en
réferve les habits 8c autres effets de l’empereur. Il y en avoit
en pluficurs villes fttuées fur de grandes routes. Quantité de
perfonnes 8c fur-tout des femmes éroient employées dans ces
fortes de bâtimens. Les maîtres de garde-robes impériales de
province fe nommoient procuratores gynaciorum. Quelles
étoient leurs fondions. C ’eft par cette corruption du vrai mot
qu’on les a appellés procuratores gynaciorum. Signification du
mot gynacium. O n comptoit quinze de ces maîtres dans l’empire
d’occident. V I I . 1022. a.
G Y N E C IA IR E ,(£ f i/ 7. anc. ) ouvrier qui travaille dans le
g ynecée. Q u els étoient ces ouvrages. Quelquefois on condam-
noit les criminels à y travailler. V IL 1022. b.
G Y N E C O N O M E , ( ffîïjl. anc. ) forte de magiflrat dans
Athènes. Nombre 8c fondions de ces magiflrat*. V i l . 1022. b.
G Y N E C O C R A T U M E N IE N S , (H i j t .a n c .)ancien peuple
de la Sarmatie Européenne. Origine de ce nom. Obferva-
tions du P. Hardouin fur ce peuple. V II. 1022, b.
G Y P S E , ou pierre à plâtre , (jfdijl. nat. M in é r .) Caradercs
des pierres gyofcufes. Les anciens ont connu différentes ef-
pcces de gypfes ; comme le metallum gypfinum, le gypfunt
tymphaicum. Quelles étoient ces fubflances. V IL 1022. b. D e
toutes c e v e fp e c e sd e g y p fe s , la plus connue c/l la pierre à
plâtre. Sa defeription. Lieux où on la trouve prés de P zm .G y p fe
fe u ille t é , ou pierre fp écu la ire, autrement ait miroir des ânes„
Caraderes de cette pierre. En quoi elle différé du talc. Lieux
où on la trouve. Gy pfe ardoifé ; en quoi il différé du feuilleté»
G y p fe jlrié : quelques auteurs l’ont abufivement nommé alun
tendent. Ibid. 1023. a. Le véritable albâtre doit être regardé
comme une pierre calcaire. Ferrante Imperato regarde l albâtre
comme une fbladite. M. W allerius met la pierre phofpho-
rique de Bologne au rang des g yp fe s , 8c prétend, contre le
fentiment de M. P o t t , que tous les gypfes deviennent phof-
pboriques par la calcination. M. Walerîus met auffi la pierre
néphrétique au rang des gypfes. M. Pott fait une claue particulière
des g y p fe s , au lieu que d’autres auteurs penfenc
qu’on '11c doit en faire qu’une fous-divifion des pierres calcaires.
Sentiment de M. Macquer fur la nature du gypfe-
Différences qui fe trouvent entre le g ypfe 8c la pierre a
chaux. Ibid. b. Les gypfes fe trouvent par couches dans le
féin de la terre. Phénomènes dignes de l’attention des natura-
lifles que préfente la petite montagne de Montmartre , qui
fournit prcfquc tout le plâtre qui s’emploie dans les bâtimcns
de Paris. Apparences que préfente le gypfe pulvénfé 8c vu
au microfcope. Ibid. 1023. a. Recherches des principes qui
conflituent le gypfe : expériences ebymiques. Le gypfe n entre
point en fiiuon à un feu ordinaire fans quelque addition.
O n n’a point encore trouvé de métaux dans le gyj>fe- P P P P P p p P P V
Jome " h
G Y P
Son ufage dangereux en médecine. Manière d e côhtfefairè
le marbre avec le g ypfe. Le moyen de calciner le gypfe
pour en faire le p lâ t re , fe t r o u v e k l’article P l â t r e .
Ib id. b,
G y p s e , cette forte de terre diflingiiée de la te rr e calcai r e.'
II* 341. b. Réfultat du mélange de la glaife avec le gypfe
qui fe trouve aux environs de T o u lo u ie , analogue a une
terre dont les Chinois font leur porcelaine. XII. 1 20. b. G y p fe
G Y T 885
t É i É S É F 8-1 Gypfc v i vo1 ti“ piancbi
G Y R O M A N C IÉ , ( Divinat. ) divination qui fe pratique
en marchant en rond. Détail fur la manière dont cette dtvi-
nation fc faifoit; V I I . 1023. a . b.
G Y R O S A Ô U E S , efpece de moines. X. 6 16 . b.
G Y T H IU M , (G é o g r .) Sadiftance de Lacédémone. Suppl,
111. 284. b.