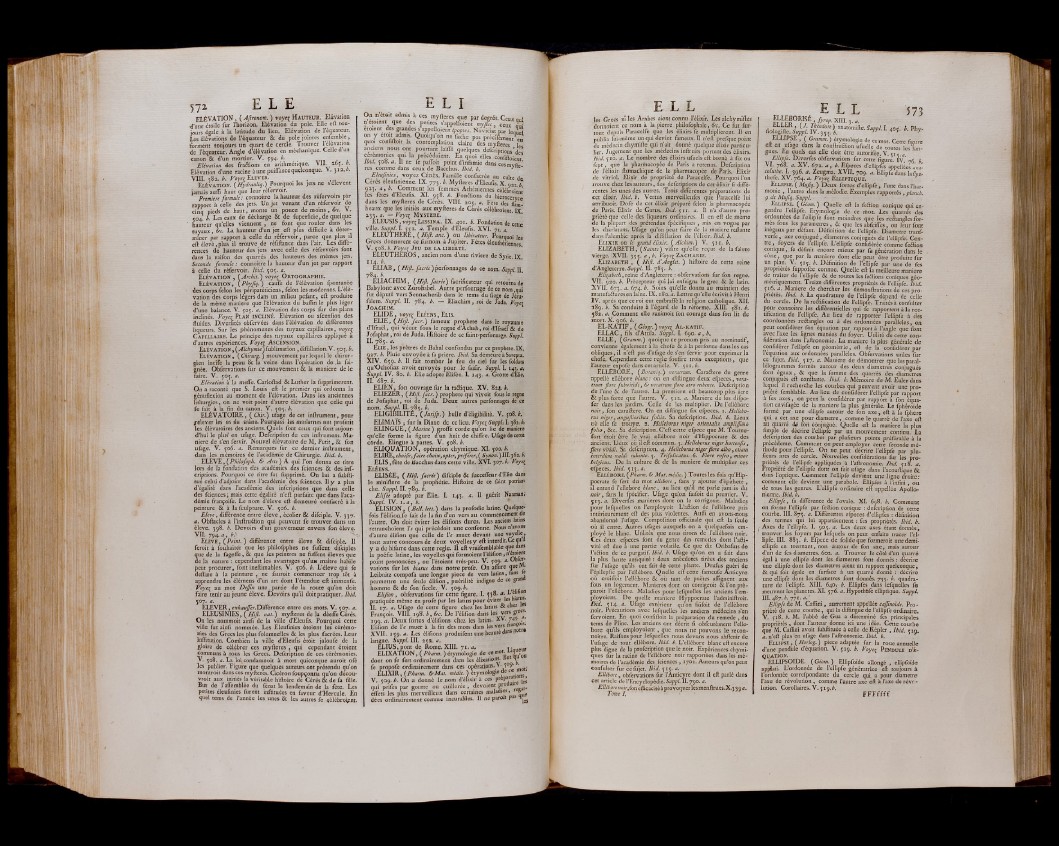
572 E L E
ÉLÉVATION, ( Ajlronom.) voye[ H a u t e u r . Elévation
tTune étoile fur l’horizon. Elévation du çole. Elle eft toujours
égale à la latitude du lieu. Elévation de l’èguateur.
£cs élévations de l’équateur & du pôle jointes enieinble,
forment toujours un quart de cercle. Trouver rélévation
de l’équateur. Angle d élévation en méchanique. Celle d un
canon & d’un mortier. V. 594- %. , . , . TT > ,
Elévation des fraétions en arithmétique. VIL 265. b.
Elévation d’une racine à une puiflancc quelconque. V. 31 i.b.
VIII. 58a. b. Voyez E le v e r . .
E lé v a t io n . ( Hydrauliq.) Pourquoi les jets ne s ¿lèvent
jamais auffi haut que leur réfervoir.
Première formule: connoitre la hauteur des rclervoirs par
rapport à celle des jets. Un jet venant d’un réfervoir de
cinq pieds de haut, monte un pouce de moins, &c, V.
<04. b. Les eaux de décharge & de fuperficié,de quelque
hauteur qu’elles viennent , ne font que rouler dans les
tuyaux, &c. La hauteur d’un jet eft plus difficile à déterminer
par rapport à celle du réfervoir, parce que plus il
eft élevé, plus il trouve de réfiftance dans l’air. Les différences
de hauteur des jets avec celle des réfervoirs font
dans la raifon des quarrés des hauteurs des mêmes jets.
Seconde formule : connoîtrc la hauteur d’un jet par rapport
à celle au réfervoir. lbid. 505. a.
E lé v a t io n , ( Archit.) voye^ O r t o g r a p h ie .
E l é v a t io n , (Phyfiq.) caufe de l’élévation fpontanée
des corps félon les péripatéticicns, félon les modernes. L’élévation
des corps légers dans un milieu pefant, eft produite
de la même maniéré que l’élévation du baffin le plus léger
d’une balance. V. 303. a. Elévation des corps fur des plans
inclinés. Voyez P lan in c lin é . Elévation ou afcenfion des
fluides. Divcrlités obfcrvées dans l’élévation de différentes
liqueurs. Sur les phénomènes des tuyaux capillaires, voye{
C a p i l la i r e . Le principe des tuyaux capillaires appliqué à
d’autres expériences. Voyez Ascension.
E lé v a t io n , (yi/cAy/n/cJ fublimation, diftillation. V. 505. b.
E lé v a t io n , ( Chirurg. ) mouvement par lequel le chirurgien
incife la peau & la veine dans l’opération de .la fai-
gnée. Obfervadons fur ce mouvement oc la maniéré de le
faire. V. 303. a.
Elévation à la méfie. Carloftad & Luther la fupprimerent.
On a raconté que S. Louis eft le premier qui ordonna la
Î;énuflexion au moment de l’élévation. Dans les anciennes
ithurgies, on ne voit point d’autre élévation que celle qui
fe fait à la fin du canon. V. 505. b.
ELÉVATOIRE, ( Chir.) ulage de cet inftrumcnt, pour
jxlevcr les os du crâne. Pourquoi les modernes ont proferit
les élévatoires des anciens. Quels font ceux qui font aujour*
d’hui le pluÿ en ufage. Defcription de ces inftrumens. Manière
de s’en fervir. Nouvel élévatoire de M, Petit, & fon
ufage. V. 306. a. Remarques fur ce dernier inftrumcnt,
dans les mémoires de l’académie de Chirurgie, lbid. b.
ELEVE, ( Philofoph. & Arts) A qui l’on donna ce titre
lors de la fondation des académies des fciences & des inf-
criptions. Pourquoi ce titre fut fupprimé. On lui a fubfti-
tué celui d’adjoint dans l’académie des fciences. Il y a plus
d’égalité dans l’académie des inferiptions que dans celle
des fciences ; mais cette égalité n’eft parfaite que dans l’académie
françoife. Le nom a’éleve eft demeuré confacré à la
peinture & à la fculpture. V. 506. b.
EUve, différence entre élève, écolier & difciple. V. 337.
a. Obftaclcs à Pinftruttion qui peuvent fe trouver dans un
éleve. 398. b. Devoirs d’un gouverneur envers fon éleve.
VII. 794. a , b>
E le v e , (Peint.) différence entre éleve & difciple. Il
feroit à fouhaite'r que les philofpphes ne fuffent difciples
que de la fageffe, & que fes peintres ne fuffent éleves que
de la nature : cependant les avantages qu’un maître habile
peut procurer, font ineftimables. V. 300. b. L’éleve qui fe
deftine à la peinture , ne fauroit commencer trop tôt à
apprendre les élémens d’un art dont l’étendue eft immenfe.
Voye{ au mot Dejfui une, partie de la route qu’on doit
faire tenir au jeune éleve. Devôirs qu’il doit pratiquer, lbid.
5°7* a- _ •
ELEVER, exhaujfer.Différence entre ces mots. V. 507. a.
ELEUSINIES, ( Hifi. nat.) myfteres de la déefle Cérés.
On les nommoit ainfi de la ville d’Elcufis. Pourquoi cette
ville fut ainfi nommée. Les Eleufinics étoient les cérémonies
des Grecs les plus folemnelles & les plus facrées. Leur
inftitution. Combien la ville d’Eleufis ¿toit jaloufe de la
gloire de célébrer ces myfteres , qui cependant étoient
communs à tous les Grecs. Defcription .de ces cérémonies.
V. 308. a. La loi condamnoit à mort quiconque auroit ofé
les publier. Figure que quelques auteurs ont prétendu qu’on
montroit dans ces myfteres. Cicéron foupçonna qu’on découvrait
aux initiés la véritable hiftoire de Cérés & de fa fille.
But de 1 affemblée du fénat le lendemain de la fête. Les
petites éleufinies furent inftituées en faveur d’Hcrcule. En
quel tems de l’année les unes & les autres fe célébraient.
E L I
On n'étoit admis à ces myfteres que par degrés. Ceiix oui
néroient que des petites s’appeUoient myfis, ceux T i
étoient des grandes s appeUqienr tpopus. Noviciat par F é S
on y étoir admis. Quo.qu’on ne fâche pas préciiimoat „
quoi conftftott la contemplation claire des myfteres 1,
anciens nous ont pourtant laiffé quelques deferiptions d „
cérémonies ou. la nrécédoient. En quoi elles confift0i.„V
ItiJ. 508. a. Il ne le paffoit point d’infamie dans cesmvlt.
res comme dans ceux de Bacchus. Ibid. b. y
Eleufinies, voyez Cé rés . Famille confacrée au culte da
Cérés éleufinienne. IX. 773. b. Myfteres d’Eleufis. X. o22 y
923. a , b. Comment les femmes Athéniennes célébrons,,
les fêtes d’Eleufis. XI. 058. b. Fondions du hieroccrvce
dans les myfteres de Cerjés. VIII. 203. a. Fête des flambeaux
que les initiés aux myfteres de Cérés célébroient. IX*
233. a. — VoyC{ MYSTERE.
ELEUSIS, voyrçLESSiNA. IX. 401. b. Fondation de ce»«,
ville. Suppl. I. 552. a. Temple d’Eleufis. XVI. 71. a.
ELEUTHERÉ, ( Hifi. anc. ) ou libérateur. Pourquoi les
Grecs donnèrent ce furnom à Jupiter. Fêtes éleuthériennes
V. 308. b. Voye[ Jeu de l a l ib e r t é .
LLEUTHËllOS, ancien nom d’une rivière de Syrie. IX.
114. b.
ELI AB , (Hifi. focrée) perfonnages de ce nom. Suppl. II.
784. b.
ELIACHIM, (Hifi. facrée) facrificateur qui retourna de
Babylonc avec Zorobabel. Autre perfonnage de ce nom,qui
fut député vers Sennacherib dans le tems du fiege de Jéru-
falem. Suppl. II. 784. b. — Eliachim, roi de Juda. Voyez
Joach im.
ELIDE, voye{ Eléens , Elis.
ELIE, (Hifi. facr.) fameux prophète dans le royaume
d’Ifraël, qui vécut fous le regne d’Achab, roi d’Ifraël & de
Jofaphat, roi de Juda. Hiftoire de ce faint-perfonnage. Suppl.
II. 785. jË "
Ë lie , les prêtres de Bahal confondus par ce prophète. IX.
927. b. Pluie envoyée à fa pricre. Ibid. Sa demeure à Sarepta.
XlV. 630. I l II fait tomber le feu du ciel fur les foldats
qu’Ochouaz avoir envoyés pour le faifir. Suppl. I. 143. a,
Suppl. IV. 80. b. Elie adopte Elifée. I. 143. a. Grotte d’Elie.
II. 687. b.
ELIEN, fon ouvrage fur la taäique. XV. 824. b.
ELIEZËR, (Hifi. facr. ) prophète qui vivoit fous le regne
de Jofaphat, roi de Juda. Deux autres perfonnages de ce
nom. Suppl. II. 785. b.
ELIGIBILITE, ( Jurifp. ) bulle d’éligibilité. V. 308. b.
ELIMAIS , fur la Diane de ce lieu. Voye^ Suppl. 1. 382. b.
ELINGUE, (Marine) groffe corde quon lie de maniéré
qu’elle forme la figure d un huit de chiffre. Ufage de cette
corde. Elingue à pattes. V. 308. b.
ELIQUATION, opération chymique. XI. 50o. b.
ELIRE,choiftr,faire choix,opter,préférer,( Synon.)llîy62.b.
ELIS, fête de Bacchus dans cette ville. XVI. 307. b. Voye[
Eléens.
ELISÉE, (Hifi. facrée) difciple & fucceffeur d’Elie dans
le miniftere de la prophétie. Hiftoire de ce faint patriarche.
Suppl. II. 789. b.
Elifée adopté par Elie. L 143. a. Il guérit NaamanJ
Suppl. IV. 1. a, b.
ELISION, (Bell, lett.) dans la profodie latine. Quelquefois
l'élifion.fc fait de la fin d’un vers au commencement de
l’autre. On doit éviter les élifions dures. Les anciens^ latins
retranchoient Ys qui précédoit une confonne. Nous n’avons
d’autre élifion que celle de l’e muet devant une voyelle,
tout autre concours de deux voyelles y eft interdit. Ce qu»
y a de bifarre dans cette regle. Il eft vraifemblable que dans
la poéfie latine, les voyelles qui formoient l’élifion, n’etoient
point prononcées , ou l’étoient très-peu. V. 309. o. Obier*
varions fur les hiatus dans notre proie. On allure que M.
Lcibnitz compofa une longue piece de vers latins, fans >
permettre une feule élifion, puérilité indigne de ce gran
homme & de fon ficcle. V. 309.b. _,,..rnn
Elifion, obfervations fur cette figure. I. 338. a.
iratiquée même en profe par les latins pour éviter les hiatu*
î *i
1. 17. a. Ufage de cette figure chez les latins & chez
François. VIIl. 198. b, &c. De l’élifion dans les vers V e f
199. a. Deux fortes d’élifions chez les latins. XV. 741- *
Elifion de Ye muet à la fin des mots dans les vers ,
XVII. 139. a. Les élifions produisent une beauté dans n
langue. Suppl. III. 252. a.
' ~1S-, pont de Rome. Aill. 71.8*. . . ,,lf
ELIXATION, ( Pharm.1x 1 1 iw i i , 1 j iiuiih. )1 é«tlyymu ivoiluoggiive d« ve ce moLO Ltri qtlulleur
dont on fe fert ordinairement dans les ¿fixations, i» \
fe propofe ordinairement dans ces opérations. ». 309- •
ELIXIR .{.Pharm. &Mat. mijic. ) étymologie de «: no
V. 309. b. On a donné le nom d’élixir à ces prepa ^
qui prifes par goutte ou cuillerée, dévoient pro
effets les plus merveilleux dans certaines maladie», £>
dées ordinairement comme incurables. Il ne pafoit p ^
E L L
les Grecs nî les Arabes aient connu l’élixir. Les dlchymiftes
donnoient ce nom à la pierre philofophale, &c. Ce fut fur-
tout depuis Paracelfe que les élixirs fe multiplièrent. Il en
publia lui-même un qui devint fameux. Il n’eft prefque point
de médecin chymifte qui n’ait donné quelque élixir particulier.
Jugement que les médecins inftruits portent des élixirs.
Ibid. 510. a. Le nombre des élixirs ufucls eft borné à fix ou
fept, que la pharmacopée de Paris a retenus. Defcription
de l’élixir ftomachique de la pharmacopée de Paris. Élixir
de vitriol. Elixir de propriété de Paracelfe. Pourquoi l’on
trouve chez les auteurs, des deferiptions de cet élixir fi différentes
les unes des autres. Trois différentes préparations de
cet élixir. Ibid. b. Vertus merveilleufcs que raracelfe lui
attribuoit. Dofc de cet élixir préparé félon la pharmacopée
de Paris. Elixir de Garus. Ibid. <11. a. Il n’a d’autre propriété
que celle des liqueurs ordinaires. Il en eft de même
de la plupart des prétendus fpécifiqucs , mis en vogue par
les charlatans. Ufage qu’on peut faire de la maticre reliante
dans l’alcmbic après la diftillation de l’éüxir. Ibid. b.
E l i x i r ou le grand élixir. (Alchim.) V. 511. b.
ELIZABETH, ( Sainte ) vifitc qu’elle reçut de la fainte
vierge. XVII. 353. a,b. Voyeç Z a c h a r i e .
E liz a b e th , ( Hifi. d’Anglet. ) hiftoire de cette reine
d’Angleterre. Suppl. II. 783. b.
Elisabeth, reine d’Angleterre : obfervations fur fon regne.
VII. 920. b. Précepteur qui lui enfeigna le grec & le latin.
XVII. 673. a. 674. b. Soins qu’elle donna au maintien des
manufactures en laine. IX. 180.0. Lettre qu’elle écrivit à Henri
IV. après que ce roi eut enibraffé la religion catholique. XII.
189. b. Sa conduite à l’égard de la réforme. XIII. 581. b.
582. a. Comment elle ranimoit fon courage dans fon lit de
mort. X. 906. b.
EL-KATIF, (Géogr.)voyei A l - k a t i f .
ELLAC, fils d’Attila. Suppl. I. 690. a, b.
ELLE, ( Gramm. ) quoique ce pronom pris au nominatif,
convienne également a la chofe & à la perfonne dans les cas
obliques, il n’eft pas d’ufage de s’en fervir pour exprimer la
choie. Cependant cette regle fouffre trois exceptions, que
l’auteur expofe dans cet article. V. 511 .b.
ELLEBORE, (Botaniq.) veratrum. CaraClcre du genre
appellé ellébore blanc : on en diftingue deux elpeces, veratrum
flore fubvirïdi, 6* veratrum flore atro rubente. Defcription
de l’une & de l’autre. La première eft beaucoup plus âcre
& plus forte que l’autre. V. 312. a. Maniéré de les difpo-
fer dans les jardins. ' Celle de les multiplier. De l’ellébore
noir, fon caraélere. On en diftingue fix efpeces. 1. Hellebo-
rus niger, anguflioribus foliis. Sa defcription. Ibid. b. Lieux
où elle fe trouye. 2. Helleborus niger orientalis amplijfimo
folio, &c. Sa defcription. C’eft cette eipccc que M. Tourne-
fort croit être Je vrai ellébore noir d’Hippocrate & des
anciens. Lieux où il eft commun. 3. Helleborus niger hortenfis,
flore virïdi. Sa defcription. 4. Helleborus niger flore albo, ctiarn
interdit ni valdc rubente. 3. Trifolic.it us. 6. Flore rofeo, minor
belgicus. De la culture & de la maniéré de multiplier ces
elpeces. lbid. 513. a.
E llé b o r e . (Pharm. & Mat. médic. ) Toutes les fois qu’Hip-
pocrate fe fert du mot ellebore, fans y ajouter d’épithete,
il entend l’ellebore blanc, au fieu qu’il ne parle jamais du
noir, fans le fpécificr. Ufage qu’on faifoit du premier. V.
313. a. Diverics maniérés dont on le corrigcoit. Maladies
pour lefquelles on l’employoit L’aélion de l’ellébore pris
intérieurement eft des plus violentes. Auffi en avons-nous
abandonné l’ufagc. Compofition officinale qui eft la feule
où il entre. Autres ufages auxquels on a quelquefois employé
le blanc. Utilités que nous tirons de l’ellébore noir.
Ces deux elpeces font du genre des remedes dont l’aéti-
vité eft due a une partie volatile. Ce que dit Oribafius de
l’aélion de ce purgatif, lbid. b. Ufage qu’on en a fait dans
la plus haute antiquité : deux anêcdotes tirées des anciens
fur l’ufage qu’ils ont fait de cette plante. Drufus guéri de
Î’épilepfic par l’ellébore. Quelle eft cette fameufe Anticyre
où croiffoit l’ellébore & où tant de poètes a (lignent aux
fous un logement. Maniérés dont on coFrigeoit oc l’on préparait
l’ellébore. Maladies pour lefquelles les anciens 1 cm-
ployoient. De quelle manière Hyppocrate l’adminiftroit.
Ibid. 514. a. Ulage extérieur qu on faifoit de l’ellébore
noir. Précautions avec lefquelles les anciens médecins s’en
fervoient. En quoi confiftoit la _ préparation -du remede, du
tems de Pline. Les anciens ont décrit fi obfcurémcnt l’elle-
bore qu’ils employoienr, que nous ne pouvons le recon-
noître. Raifons pour lefquelles nous devons nous abftenir de
l’ufage de tout ellébore. Ibid. b. L’ellébore blanc eft encore
plus digne de la profeription que le noir. Expériences chymi-
ques fur la racine de l’ellébore noir rapportées dans les mémoires
de l’académie des fciences ,1701. Auteurs qu’on peut I
confultcr fur céfujet. Ibid. 313- a-
Ellébore, obfervations fur l’Anticyre dont il eft parlé dans
cet article de l’Encyclopédie. Suppl. II. 790. a.
Ellébore noir, fon efficacité àprôYoquer les menftrues. X.3 39 a.
Tome I, ' - 1 " •
précédente. Comment on peut employer cette fécondé méthode
pour l’ellipfe. On ne peut décrire l’ellipfe par plu-
fieurs arcs de cercle. Nouvelles confidérations fur les propriétés
de l’ellipfe appliquées'à l’artronomie. lbid. <18. a.
Propriété de l’ellipfe dont on fait ufage dans YacouWque Sc
dans l’optique. Comment l’ellipfe devient une ligne droite;
comment elle devient une parabole. Ellipfes à l’infini, ou
de tous les genres. L’ellipfe ordinaire eft appellée Apolla-
nienne. lbid. b.
Ellipfe, fa différence de l’ovale. XI. 698. b. Comment
on forme l’cllipfe par feâion conique : defcription de cette
courbe. III. 873. a. Différentes efpeces d’cllipfes : définition
des termes qui lui appartiennent : fes propriétés. lbid. b.
Axes de l’ellipfe. I. 903. a. Les deux axes étant donnés',
trouver les foyers par lefquels on peut enfuite tracer l’ellipfe.
III. 883. b. Efpece de folide que formerait une demi-
ellipfe en tournant, non autour de fon axe, mais autour
d’un de fes diamètres. 602. a. Trouver le côté d’un quarré
égal à une ellipfe dont les.diamètres font donnés: décrire
une ellipfe dont les diamètres aient un rapport quelconque,
& qui (oit égale en furface à un quarré donné : décrire
une ellipfe dont les diamètres font donnés. 755. b. quadrature
de l’ellipfc. XIII. 640. b. Ellipfes dans lefquelles fe
meuvent les planctes. XI. 376. a. Hypothefe elliptique. SuppL
III.487. b. 771. a.'
Ellipfe de M. Caffini, autrement appellée cajfinoide. Projeté
de cette courbe, qui la diftingue de l’ellipfe ordinaire.
8. b. M. l’abbé de Gua a déterminé fes principales
propriétés, dont l’auteur donne ici une idée. Cette courbe
que M. Caffini avoit fubftituée à celle de Képlcr , lbid. 319.
a. n’eft plus ’en ufage dans l’aftronomie. lbid. b.
E llip s e , (Horlog.) piece adaptée fur la roue annuelle
d’une pendule d’équation. V. 319. b. Voyeç Pendule d’é-
QUATION.
ELLIPSOÏDE. ( Géom. ) Ellipfoïde allongé , ellipfoïde
appiati. L’ordonnée de l’elfipfe génératrice eft toujours à
l’ordonnée corrcfpondantc du cercle qui. a pour diamètre
l’axe de révolution, comme l’autre axe eft à l’axe de révolution.
Corollaires. V. 3 xo. b.
F F F f f f f