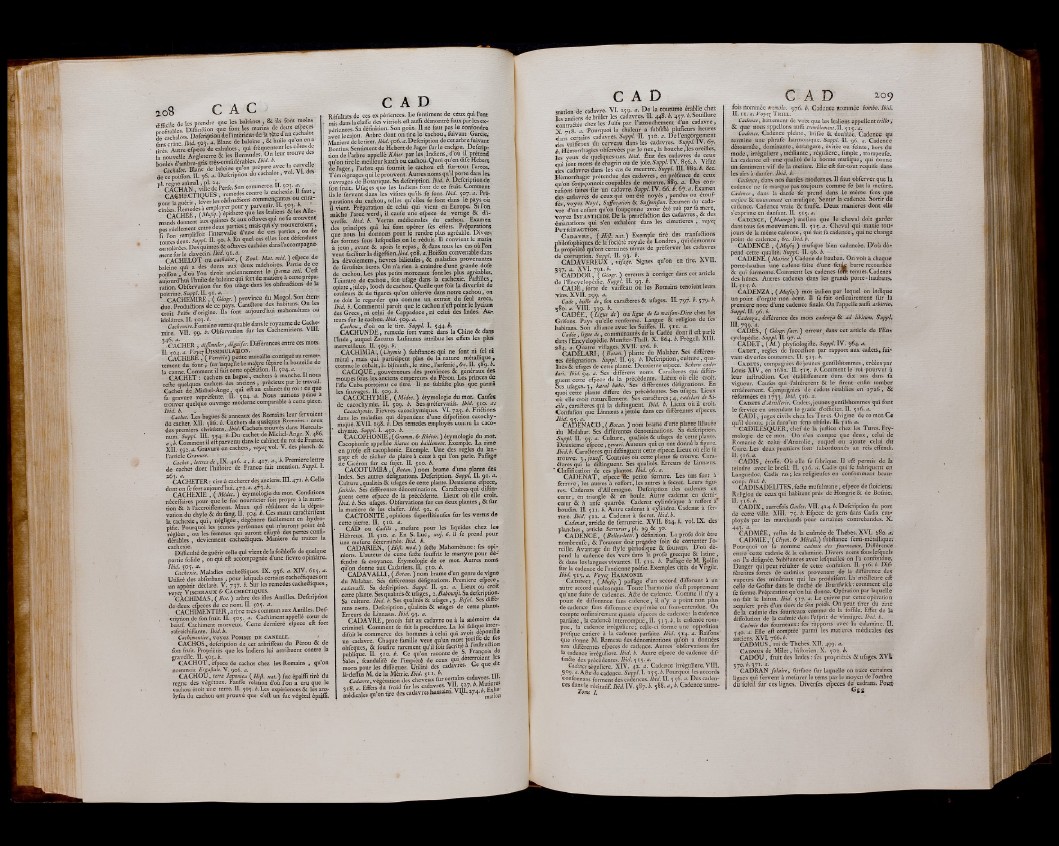
io8 C A C
: Se cachalôB. Defcripnon defintérieur de la.tête d un cachalot
Inc crâne! M . m .a . Blanc de baleine g & hurle qu’on en a
M Autre efpece de cahalots, qui fréquentent les côtesidc
ja n o o t l Angleterre & les Bermuderr On leur trouve des
boules «rambre-gris tres-çonfrdérables IM.h. ^ ;
Cachalot- Blanc de baleine qu on prépare ave
de ce poiffon. 11. 36. a. Oefcripdon du cachalot, vol. VI. des
^3te«isi8®BEsfî3i
1 I.0n „„pbffolt l'intervalle d’une de ces parties , ou de
. Suppl. II. 00. é. En quel cas elles font défendues
ou tolérées. Des quintes & oflaves cachées dans l’accompagne-
ment fur le clavecin. Ibid. ai.a. _ _
CACHELOT ou cachalot, ( Zool. Mat. med.) efpece de
baleine qui a des dents aux deux mâchoires. Parue de ce
noiffon, d'où l’on droit anciennement le [permet cctt. Celt
Aujourd’hui l’huile de baleine qui fcrt de piauere à cette préparation.
Obfervation fur fon ufage dans les obftruaions de la
P” cT chÊm Î rE \ Gcogr. ) province du Mogol. Son èten-
due. Produidons de ce pays. Caraftere des habitans. On les
croit Juifs d’origine. Ils font aujourd’hui mahométans ou
W° c S i i v . fontaine remarquable dans le royaume de Cache-
mire. VII. 99. h. Obfervadon fur les CachemineiB. VU1.
^CACHER , diffmatUr, digtùfir. Différences entre ces mots.
II. 504. a. Feyrr D issimulation.
CACHERE, (Verrerie) petite muraille contigue au remets
tement du four , fur laquçlle lemaftre fépare la bouteille de
la canne. Comment il fait cette opéfanon. 11. 504. a. R »
CACHET : cachets eh bague, cachets à manche. 11 nous
refte quelques cachets des anciens, précieux par le travail.
Cachet de Michel-Ange, qui eft au cabinet du roi : ce que
fa gravure' repréfente. H. 504- *• Nous aurions peine à
trouver quelque ouvrage moderne comparable à cette piece.
Ib'Cachet. Les bagues & anneaux des Romains leur fervoient •
de cachet. XII. 586. b. Cachets de quelquesRomains : ceux
des premiers chrétiens. Ibid.Cachets trouvés dans Hercula-
num. Suppl. HI. 3H- cachet.deMichchAnge.X.486.
* i b. Comment il eft parvenu dans le cabinet du rot de France.
XII. t9a.di. Gravurè en cachets, voy«£vol. V. des planch. oc
1’article Gravure. .
Cachet, lettres Je , 1X. 416. a, b. 417- h- Première lettre
de cachet dont l’hiftôire de France fait mention. Suppl. 1.
^¿ACHETER : cire à cacheter des anciens. IH.471.¡g Celle
dont on fe fert aujourd’hui. 472. a. 473. b.
CACHEXIE , ( Mcdec. ) étymologie du mot. Conditions
néceffaircs pour que le fuc nourricier foit propre à la nutrition
& à l’accroiffement. Maux qui réfultent de la dépravation
du chyle &du fang. II. 504. b. Ces maux caraftenfent
la cachexie, qui, négligée, dégénéré facilement en hydro-
pifie. Pourquoi les jeunes perionnes qui n’auront point été
réglées, ou les femmes qui auront eiïuyé des pertes confi-
dérables , deviennent cachectiques. Maniéré de traiter la
cachexie. * ■ ,
CAD Réfultats de ces ex périences. Le fentiment de ceux qui l’ont
mis dans la clalîe des vitriols eft auffi démontré faux par les expériences.
Difficulté de guérir celle qui vient de la foibleffe de quelque
partie folide , ou qui eft accompagnée d’une fievre opiniâtre.
Cachexie. Maladies cacheftiques. IX. 936. a. XIV. 615, a.
Utilité des abforbans , pour lefquels certains cacheftiques ont
un appétit déclaré. V. 737- % $ur les «medes cacheftiques,
voyez V is c é r a u x & C a ch e c t iq u e s . . *
CACHIMAS, ( Bot. ) arbre des ifles Antilles. Defcnption
de deuxefpecesde cenom.il. 505. a. ' ... ~ .
CACHIMENTIER, arbre très-commun aux Antilles. Description
de fon fruit. IL. 505.^ a. Cachiment appellé coeur de
boeuf. Cachiment morveux. Cette dernierè efpece elt tort
rafraichiffante. lbid.b.
Cachimcnlier, voyez POMME DE CANELLE. *
CACHOS, defcnption de cet arbriiTean du Pérou & de
fon fruit. Propriétés que les Indiens lui attribuent contre la
gravelle. IL 505.
CACHOT, efpece de cachot chez les Romains , qu’on
nommoic Ergaftule. V. 906. a.
CACHOU, terra Japonica {Hift. nat.) fuc épaifti tiré du
regne des végétaux. Fauffe relation d’où l’on a cru que le
cachou étoit une terre. II. 503. ¿.Les expériences & les ana-
lyfes du. cachou ont prouvé que c’eft un fuc végétal épajffi.
Sa définition. Son goût. Il ne fout pas le confondre-
avec le cajou. Arbre dont on tire le cachou, fuivant Garcie.
Maniéré de le tirer .Ibid. 506.*. Defcription de cetarbre fuivant
Bontius. Sentiment de Hebert de Jager fur le cacljpu. Defcrip-
tion de l’arbre appellé Khier par les ¿Indiens, d’ou il .prétend
qu’on tire le meilleur kaath ou cachou. Quoi qu’en dife Hebert
de Jager , l’arbre qui fournit le cachou eft fur-tout l’areca.
Témoignages qui le prouvent. Autres noms qu’il porte dans les
ouvrages de Botanique. Sa défCription. Ibid. b. Defcription de
fon fruit. Ufoges que les Indiens font de ce fruit. Comment
ils le fervent dans les vifites qu’ils fe font. Ibid. 507. a. Préparations
du caphou, telles qu’elles fe font dans le Ptysmj
il vient. Préparation de celui qui vient en Europe. Si l’on
mâche l’arec verd, il caufe une efpece de vertige & d’ivre
ffe. Ibid. b. Vertus médicinales du cachou. Examen
des principes qui lui font opérer fes effets. Préparations
que nous lui donnons pour le rendre plus agréable. Diver-
fes formes fous lefquelles on le j réduit. Il convient le matin
à jeun, avant & après le repas, & dans tous les cas où l’on .
î veut faciliter la digeftion./éü. 508. *. Boiffon convenable dans
les dévoiemens, nevres bilieufes, • & maladies provenantes
de férofités: âcres. On n’a rien à craindre d’une grande dofe
de cachou. Les plus petits morceaux font les plus agréables.
Teinture de paçliQU, fon ufage dans la cachexie. Paftilles,
opiate jjûîept, lôoch de cachou. Quelle que foit la diverfité de
couleurs & de figures qu’on obferve dans notrè cachoù, on
ne doit le regarder que comme un extrait du feul areca«
Ibid. b. Comment il paroît que le cachou n’eft point le lycium
des Grecs, ni celui de Cappadoce,ni celui des Indes. An-,
teurs fur le cachou. Ibid. 509. a.
Cachou, d’où on le tire. Suppl. I. 544. b.
CACHUNDE, remede fort vanté dans la Chine & dans
l’Inde, auquel Zacutus Lufitanus attribue les effets les plus
merveilleux. II. 509. b. . . .
. ÇACHIMIA', {Chymie ), fubftanCes qui ne font ni fel ni
métal, mais qui participent plus de la nature métallique ,
pomme le cobalt, le bifmuth, le zinc, l’arfenic, &c. II. 589. b.
CACIQUE, gouverneurs des provinces & généraux des
troupes fous les anciens empereurs du Pérou. Les princes de
l’ille Cuba portoient ce titre. 11 ne fubfifte plus que parmi
les fauvages. II. 509. b.
CACOCHYMIE, ( Médec. ) étymologie du mot, Caufes
de cacochymie. II. 509. b. Ses -préfervatifs. Ibid. çio. as
Cacochymie. Fievres cacochymiques. VI. 725. b. Friétions
dans les maladies qui dépendent a’une difpofition cacochy-
mique.XVU. 198. b. Des remedes employés contre la cacochymie.
Suppl. I. 450. b.
1 CACOPHONIE, ( Gramm. & Rhèto'r. ) étymologie du mot
Cacophonie appellée hiatus ou bâillement. Exemple. La rime
en proie eft cacophonie. Exemple. Une des réglés du langage
eft de tâcher de plaire à ceux à qui l’on parle. Paffage
de Cicéron fur ce fujet. IL 510. b.
CACOTUMBA, (Botan.) nom brame d’une plante des
■ Indes. Ses autres défignations. Defcription. Suppl. II. q i.a.
Culture, qualités & ufoges de cette plante. Deuxième efpece,
faikilo. Ses différentes dénominations. Carafteres qui diftin-
guent cette efpece de la précédente. Lieux où elle croit.
Ibid. b. Ses ufoges. Obfervations fur ces deux plantes, & fur
la maniéré de les daffer. Ibid. 92. a.
CACTON1T E , opinions fuperftitieufes fur les vertus de
cette pierre. H. 510. a.
CAD ou Cadils , mefure pour les liquides chez les
Hébreux, f j f <10. a. En S. Luc, xvj. 6. il fe prend pour
une mefure déterminée. b.
CADARIEN, ( ttft. mod:) fefte Mahométane : fes opinions.
L’auteur de cette fefte fouffrit le martyre pour défendre
fa croyance. Etymologie de ce mot. Autres noms
qû’on donne aux Cadariens. IL 510. b.
CADAVALLI, {Botan.) nom brame d’un genre de vigne
du Malabar. Ses différentes défignations. Première efpece ,
cadavalli. Sa defcription. Suppl. II. 92. a. Lieux où croît
cette plante. Ses qualités & ufoges, 2. Babounji. Sa defcription.
Sa culture. Ibid. b: Ses qualités & ufoges, 3. Bifol. Ses diffé-
rens noms. Defcription, qualités & ufoges de cette plante.
Erreurs de LinnæUs. Ibid. 93. a. ,
CADAVRE, procès foit au cadavre ou à la mémoire du
criminel. Comment fe foit la procédure. La loi f^que inter-
difoit le commerce des hommes à celui qui ayoit dépouille
un cadavre. Chaque famille veut qu’un mort j0“ 1*1® a-
obfeques, & fouftre rarement qu’il loit façrifié à l inltruttion
publique. II. 510. b. Ce qu’on raconte de S. François e
Sales, feandalifé de l’impiété de ceux qui déterroient les
mortspour les difféquer. Utilité des cadavres. Ce que
là-deffus M, de la Métrie. Ibid. 511. b. , itt-
Cadavre, végétation des cheveux fur ce.ja.ns; cadavres
,18. a. Effets lü froid fur les cadavres y i f j ^ i M s g «
médicales qu’on ffre des cadavres humants. VIll. î 74. f. f th ^
CAD
con,railée chez les, Juifs par, l’attouchement d’un cadavre,
Y 7i 8. Ü Pourquoi la chaleur a fubfifté pltmeurs heures
dans certains cadavres. Suppl. II. 3x0. | De l’engoreement
des vaiffeaux du cerveau dans les cadavres. Suppl. IV. 67.
b Hénvorrhagies obfervées par le nez,la bouche,les oreilles,
jes yeux de quelques-uns. Ibid. État des cadavres de ceux
qui font morts de chagrin ou dé joie.Suppl. IV. 856. b. Vrnte
des cadavres dans les cas de meurtre. Suppl. III. 882. b. &c.
Hémorrhagie prétendue.des cadavres, en nréfence de ceux
qu’on foupçonnoit coupables de meurtre. 089. a. Des con-
tufions faites fur un cadavre. Spppl.lV. 66. b. 67. a. Examen
des cadavres de ceux qui ont été noyés , pendus ou étouffés
, voyez Noyé, Suffocation èc Sufpen/ion. Examen dit cadavre
d’un enfant qu’on foupçonne avoir été tué par famere,
voyez In f a n t i c i d e . De la pHtréfoftion des cadavres, & des
émanations qui s’en exhalent dans les cimetieres ,. voye^
P u t r é f a c t i o n . .
C a d a v r e , {Hift. nat.) Exemple tiré des tranfaftions
philofophiques.de la fociété royale de Londres , qui démontre
la propriété qu’ont certaines terres de préfeiyèr les cadavres
de corruption. Suppl. II. 03. b. , . vxrrf
CADAVEREUX , vifage. Signes qu’on en tire. XVII.
337. a. XVI. 791. b. . . . - i
CADDOR, ( Gcogr. ) erreurs a corriger dans cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. IL 93. b. _
CADE, forte de vaiffeau ou les Romains tenoient leurs
Vins. XVII. 299. a.
Cade, huile de, fes carafteres & ufoges. II. 797. b. 579. b.
e8o. a. VIII. 339. b.
CADÉE, {Ligue de) ou ligue de la maifon-Dicu chez les
Grifons. Pays qu’elle renferme. Langue & religion de fes
habitans. Son alliance avec les Suiffes. IL Wk a.
Cadée ligue de, communautés de la Cadée dont il eft parlé
dans l’Encyclopédie. Munfter-Thall. X. 864. b. Prégell. XIII.
2.84. a. Quatre villages. XVII. 276. b.
CADELARI, {Botan.)'plante du Malabar. Ses difteren-
tes défignations. Suppl. II. 93. b. Defcription, culture, qualités
& ufoges de cette plante. Deuxierne efpece. Schemcadc-
lari. Ibid. 94. a. Ses différens noms. Carafteres qui duhn-
guent cette elpéce de la précédente. Liêux ou elle croit.
Ses ufoges-3, karal hcebo. Ses différentes défignations. En
quoi cette plante différé des précédentes. Ses ufoges. Lieux
où elle croît naturellement. Ses carafteres ; 4, cadelari de Sicile
,■ carafteres qui la diitinguent. Ibid. b. Lieux ou il croit.
Confofion que Linnæus a jettée dans ces différentes efpeces.
Ibid. 95. a.
CÂDENACO, ( Botan. ) nom brame d’une plante liliacée
du Malabar. Ses différentes dénominations. Sa defcription.
Suppl. II. 95. a. Culture, qualités & ufoges de cette plante.
Deuxième efpece, çevari. Auteurs qui en ont donné la figure.
lbid.b. Carafteres qui diitinguent cette efpece. Lieux où die fe
trouve. 3 ,jouoff. Contrées où cette plante fe trouve. Carafteres
qui la diitinguent. Ses qualités. Erreurs' de Linnæus.
" Claifification de ces plantes. Ibid. 96. a. - »
CADENAT, efpece ^ïe petite ferrure. Les uns font a
ferrure, les autres à reffort, les autres à fecret. Leurs figir-
res. Cadenats d’Allemagne. Defcription des cadenats en
coeur, en triangle & en boule. Autre câdenat en demi-^
coeur & à anfe quarrée. Cadenat cylindrique à- reffort à
boudin. II. 511. b. Autre cadenat à cylindre. Cadenat à ferrure.
Ibid. 512. a. Cadenat à fecret. lbid.b.
Cadenat, article de ferrurerie. XVII. 824. b. vol. IX. des
planches, article Serrurier, pl. 29 & 30.
CADENCE , ( Belles-lettr. ) définition. La profe doit être
nombreufe, & l’orateur doit prejidre foin de contenter l’o-'
reille. Avantage du ftyle périodique & foutenu. D’ou dépend
la cadence des vers dans la profe grecque & latine,
& dans les langues vivantes. II. 512. b. Paffage de M. l^ollin
fur la cadence de l’ancienne poéfie. Exemples cités de Virgile.
Ibid. 513, a. Voyc{ H a rm o n i e .
C adence, {Mufiq.) paffage d’un accord diffonant à un
autre-accord quelconque. Toute l’harmonie n’eft proprement
qu’une fuite de cadences. Afte de cadence. Comme il n’y a
point de diffonance fans cadence, il n’y a point non plus
ce cadence • fans diffonance exprimée ou fous-entendue. On
compte ordinairement quatre eipeccs de cadence.: la cadence
parfaite, là cadencé interrompue,II. 513. b. là cadence rompue,
la cadence irrégulière j celle-ci forme une oppofition
prefque entière à la cadence parfaite. Ibid. 514. a. Raifons'
que donne M. Rameau des dénominations qu’on a données
aux différentes efpeces de cadence. Autres ‘ obfervations fur
la cadence irrégulière. Ibid. b. Autre efpece de cadence dif-
tinfte des précédentes. Ibid. 5 x 5 . a.
Cadence régulière. XIV. 42. a. Gadence irrégulière. VIII.
.9P9- «• Afte-de cadence. Suppl. ¡§§ 1 1 b. Pourquoi les accords
confonnans forment des cadences. Ibid. II. 556 .a. Des caden-
.ces dans lé récitatif. Ibid. IV. 587. b. 588. a, b. Cadence autre-
Tome I,
C A D 2° 9
fois nommée trémolo. 9761 b. Cadence nommée bombo. Ibid,
II. 11. a. Voyc^ T r i l l .
Câdence, battement de voix que les Italiens appellent trillo >
& que nous appelions auffi tremblement. II. 515. a.
Cadence. Cadence pleine, brifée & doublée. Cadence qu
termine une phrafe harmonique. Suppl. II. 9G. a. Cadence
détournée, dominante, étrangère, évitée ou feinte, hors du
mode, irrégulière,médlante, régulière, fiüiple, trompeufe.
La cadence eft une qualité dé la bonne mufique, qui donne
xin fentiment v i f de la mefure. Elle eft für-tout requife dans
les airs à danfer. lbid. b.-
■ Cadence, dans nos danfeS modernes. Il fout pbferver que la
cadence'ne fe' marque pas toujours comme fe bat la mefure.
Cadence, dans là dànle fe prend dans le même fens que
mefure Qc mouvement en mufique. Sentir la cadence. Sortir de
cadence. Cadence vraie & fauffe. Deux maniérés dont elle
s’exprime en danfant. II. 515. <z.
C a d e n c e , {Manege) mefure que le cheval doit garder
dans tous fes mouvèmens. II. 515. Cheval qui manie tou*
jours de la même cadence j qui fuit fa cadencé j qui ne change
point de cadence, bc, lbid.b.
CADENCÉ , '{Mufiq. ) mufique bien cadencée. D’où dé+
pénd cette qualité. Suppl. II. 96 .b. •
CADENE. {Marine)-Cadene de hauban. On voit à chaque
porte-hauban une cadene faite d’une fe i^ barre recourbée
& qui' furmonte. Comment les cadenes font tenues. Cadenes
des hünes. Autres cadenes dans lés grands porte-haubans»
¿ADENZA, ( Mufiqè) mot italien par lequel on indique
un point d’orgue non écrit. Il fe' foit ordinairement fur la
première note d’une cadence finale. On l’appelle aufli arbitrio»
Suppl. II. 96. b.
Cadença, différence des mots cadenfa & ad libitum. Suppl,
III. 739; a.
CADÈS, ( Ge'ogr, facn ) erreur dans cet article de l’En«
cyclopédie. Suppl. IL 97. a.
CADET, (M.) phyfiolOgifte. Suppl. IV. 364. a,
C a d e t , réglés de fûccemon par rapport aux cadets, fuivant
diverfes coutumes. II. 515. b.
C a d e t s , compagnies de jeunes gentilshommes, créées par
Louis XIV, en 1682.,II. 515. ¿.Comment le roi pourvut à
leur inftruftion. Cet établiffement dûra dix ans dans fa
vigueur. Caufes qui l’altérerent & le firent enfin tomber
entièrement. Compagnies de cadets rétablies en 1726, &
réformées en 1733. Ibid. 516. a.
C a d e t s d Artillerie. Cadets, jeunes gentilshommes qui font
le fervice en attendant le grade d’officier. H. 516. a.
CÀDI , j uges civils chez les Turcs. Origine de ce mot. Ce
qu’il dénote pris dans'un fens abfolu. II. 516. a.
CADILESQUER, chéf de la juftice chez les Turcs. Etymologie
de ce mot. On -n’en compte que deux, celui de
Romanie & celui d’Anatolie, auquel on ajoute celui dit
• Caire. Les deux prenxiers font fubordonnés au reis effendi.
II.<ri6.âT.
CADIS, étoffe. Où elle fe fabrique. Il eft permis de. la
teindre avec'le brefil. II. 516. a. Cadis qui fe fabriquent en
Languedoc. Cadis ras; les religieufes en confomment beau-
• coup .Ibid. b. ‘ 'J ,
CADISADEL1TES, fefte mufulmane, efpece de ftoïciens»
Religion de ceux qui habitent près dé Hongrie & de Bofnie*
■ II.516. b.
CADIX, autrefois Gades. VII. 414. b. Defcription du port
de cette ville. XIII. 75. b. Efpece de gens dans Cadix em-
• ployés par les marchands pour certahies contrebandes. X.
4 4 3 -1
CADMÉE, reftes de la cadmée de Thebes. XVI. 180.
CADMIE ,*( Chym. & Métall.) fiibftance femi-métallique;
Pourqiloi on la nomme cadmie des fourneaux. Différence
• entre cette cadmie & la calamine. Divers noms fous lefquels
on l’a défignée. Subftances avec lefquelles on l’a confondue.
Danger qui peut réfülter de cette confixfion. II. 516. b. Différentes
fortes de cadmies provenant, de la différence des
vapeurs des minéraux qui les produifént. La meilleure eft
celle de Goflar dans le duChé de Brunfwick : comment elle
fe forme. Préparation qu’on lui donne. Opération par laquelle
on foit le laiton. Ibid. 517.*. Le cuivre par cette opération
acquiert .près d’un tiers de ion poids. Oii peut tirer du zinc
delà cadmie des fourneaux c<jnme de la folfile. Effet de la
diffolution de la cadmie dans lTefprit de vinaigre. Ibid. b. _ '
Cadmie des fourneaux: fes ràpports avec la calamine. II.
540: *. Elle eft comptée parmi les matières médicales des
anciens. XVI. 766. b.
CADMüS , roi de Thebes. XII. 499. a.
C adm u s de Milet, hiftorien. X. 502. b.
CADOU, fruit des Indes : fes propriétés & ufoges. XVIi
370. ¿.J7X. 0. ,
CADRAN folaire, furfoce fur laquelle on trace certaines
lignes qui fervent à mefurer le téms par le moyen de l’ombre
du foleil fur ces lignes. Diverfes efpeces de cadrans. Pouji-
GgS